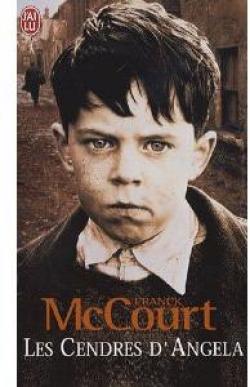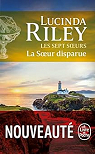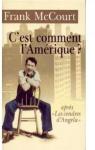Frank McCourt/5
968 notes
Résumé :
"Quand je revois mon enfance, le seul fait d'avoir survécu m'étonne. Ce fut, bien sûr, une enfance misérable: l'enfance heureuse vaut rarement qu'on s'y arrête. Pire que l'enfance misérable ordinaire est l'enfance misérable en Irlande. Et pire encore est l'enfance misérable en Irlande catholique."
C'est ce que décrit Frank McCourt dans ce récit autobiographique. Le père, Malachy, est un charmeur irresponsable. Quand, par chance, il trouve du travail,... >Voir plus
C'est ce que décrit Frank McCourt dans ce récit autobiographique. Le père, Malachy, est un charmeur irresponsable. Quand, par chance, il trouve du travail,... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Les cendres d'AngelaVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (92)
Voir plus
Ajouter une critique
« Le maître dit que c'est chose glorieuse de mourir pour la foi, Papa dit que c'est chose glorieuse de mourir pour l'Irlande, et je me demande s'il y a quelqu'un au monde qui aimerait que nous vivions ». Voilà le genre d'interrogations tragi-comiques qui passent par la tête du petit Frank McCourt dans cette autobiographie de son « enfance irlandaise ». Frank est né à Brooklyn, en 1930. En ces années de Grande Dépression, la vie est loin d'être rose, surtout avec un père qui boit son salaire ou son chômage dans les bars, et une mère qui manque devenir folle à la mort de son nourrisson. Alors Malachy et Angela, les parents de Frank, émigrés irlandais, décident de retourner vers la Mère-Patrie. Ils débarquent à Limerick, ville d'où Angela est originaire, vers 1935. Hélas, foin de lendemains qui chantent des ballades irlandaises dans cette ville humide et sinistre du sud catholique, dans laquelle le père aura bien du mal à trouver du travail en raison de ses origines nord-irlandaises, puis, quand par miracle il en trouve, à ramener sa paie à la maison plutôt qu'au pub. Une Irlande, loin d'être encore un « dragon celtique », dans laquelle la mère devra ravaler sa fierté pour faire la queue devant la Société de Saint-Vincent-de-Paul ou, pire, devant l'assistance publique, pour obtenir un coupon de nourriture ou un manteau pour ses gamins. Dans un pays où la foi catholique est si prégnante qu'elle en devient superstition, Frank McCourt nous livre une enfance de crève-la-faim et de crève-le-froid, pour lui et ses frangins, dans leur taudis insalubre au fond d'une ruelle transformée en cloaque à la moindre bruine. Et pourtant... quelle leçon de vie donnée par ce petit bonhomme, qui s'accroche tant qu'il peut à son objectif : éviter de mourir de faim, quitte à chaparder chez les autres, puis, en grandissant, travailler et rapporter son salaire à la maison, ce que son père a toujours été incapable de faire. Et c'est là le plus surprenant : Frank ne semble pas en vouloir à son père d'être ce bon à rien de patriote alcoolique. Au contraire, tout en étant lucide sur ce « soutien » de famille largement défaillant, il continue à l'aimer et à l'admirer, sans réelle rancune.
Ce qui fait tout le charme (oui vous avez bien lu : charme) de ce bouquin, malgré le contexte de misère noire et son cortège de souffrances et de malheurs, c'est qu'il est raconté à hauteur d'enfant puis d'adolescent, sur un ton tour à tour naïf, chenapan, cocasse, parfois carrément drôle, désabusé, émouvant, mais jamais larmoyant ou amer.
Volonté, énergie, résilience sont les clés que Frank s'est forgées au cours de cette enfance misérable, et qui lui permettront d'ouvrir les portes d'une vie moins rude...
Ce qui fait tout le charme (oui vous avez bien lu : charme) de ce bouquin, malgré le contexte de misère noire et son cortège de souffrances et de malheurs, c'est qu'il est raconté à hauteur d'enfant puis d'adolescent, sur un ton tour à tour naïf, chenapan, cocasse, parfois carrément drôle, désabusé, émouvant, mais jamais larmoyant ou amer.
Volonté, énergie, résilience sont les clés que Frank s'est forgées au cours de cette enfance misérable, et qui lui permettront d'ouvrir les portes d'une vie moins rude...
Souvenir de lecture
Titre : Les cendres d'Angela pulitzer de l'autobiographie
Année : 1996
Editeur : Belfond
Auteur : Franck Mc Court ( 1930/2009 )
Résumé : L'histoire de la famille Mc Court dans l'Irlande des années 30. Francky est un gamin miséreux né d'une mère courage et d'un père dispendieux et alcoolique. de Brooklyn à Limerick les Mc Court vivent dans le dénuement le plus total et Franck, l'un des enfants survivant et le narrateur de cette histoire, tente de subsister et d'échapper à son destin malgré la faim, le froid et un environnement familial des plus déplorable.
Mon humble avis : Les cendres d'Angela est, à n'en pas douter, un des bouquins qui aura le plus marqué ma vie de lecteur. Une histoire simple : un gamin catholique irlandais tente de survivre au beau milieu d'une famille pauvre, dans un pays qui connait la famine et la ruine. Un témoignage à la fois digne et terrible, empreint d'une dignité rare et d'une humanité hors du commun. Comment ne pas s'attacher à cet enfant au quotidien funeste qui malgré les difficultés de sa vie miséreuse garde une lucidité et une envie de vivre en tout point admirable ? Deux décennies après la lecture de ce petit bijou j'en garde un souvenir ému, ébloui par tant de courage et de résilience. Les cendres d'Angela ne tombe jamais dans le pathos ou le misérabilisme, Mc Court décrit son quotidien avec décence, simplicité mais aussi une bonne dose d'humour et l'on suit les pérégrinations de cet enfant avec un plaisir indicible. Mc Court n'est peut-être pas un auteur au style flamboyant ( c'est le moins que l'on puisse dire et cela sera confirmé par ses romans suivants d'une qualité moindre ) mais la force de son histoire personnelle, la description de l'intérieur d'une famille déchirée emporte tout et font de ce témoignage un objet unique et très émouvant. L'absence de rancoeur est également une des caractéristiques de ce texte, Mc Court dépeint sa famille avec bienveillance et respect malgré l'alcoolisme de son père et la violence de son frère. Un exemple vous dis-je ! Une leçon de vie qui, à mon humble avis, ne peut que marquer le lecteur d'une trace indélébile et des noms tels que Malachy, Angela ou Cuchulainn resteront gravés longtemps dans votre mémoire si vous avez la chance de ne pas avoir lu ce roman simple et bouleversant.
J'achète ? : Oui évidemment et tu m'en dis des nouvelles....
Lien : http://francksbooks.wordpres..
Titre : Les cendres d'Angela pulitzer de l'autobiographie
Année : 1996
Editeur : Belfond
Auteur : Franck Mc Court ( 1930/2009 )
Résumé : L'histoire de la famille Mc Court dans l'Irlande des années 30. Francky est un gamin miséreux né d'une mère courage et d'un père dispendieux et alcoolique. de Brooklyn à Limerick les Mc Court vivent dans le dénuement le plus total et Franck, l'un des enfants survivant et le narrateur de cette histoire, tente de subsister et d'échapper à son destin malgré la faim, le froid et un environnement familial des plus déplorable.
Mon humble avis : Les cendres d'Angela est, à n'en pas douter, un des bouquins qui aura le plus marqué ma vie de lecteur. Une histoire simple : un gamin catholique irlandais tente de survivre au beau milieu d'une famille pauvre, dans un pays qui connait la famine et la ruine. Un témoignage à la fois digne et terrible, empreint d'une dignité rare et d'une humanité hors du commun. Comment ne pas s'attacher à cet enfant au quotidien funeste qui malgré les difficultés de sa vie miséreuse garde une lucidité et une envie de vivre en tout point admirable ? Deux décennies après la lecture de ce petit bijou j'en garde un souvenir ému, ébloui par tant de courage et de résilience. Les cendres d'Angela ne tombe jamais dans le pathos ou le misérabilisme, Mc Court décrit son quotidien avec décence, simplicité mais aussi une bonne dose d'humour et l'on suit les pérégrinations de cet enfant avec un plaisir indicible. Mc Court n'est peut-être pas un auteur au style flamboyant ( c'est le moins que l'on puisse dire et cela sera confirmé par ses romans suivants d'une qualité moindre ) mais la force de son histoire personnelle, la description de l'intérieur d'une famille déchirée emporte tout et font de ce témoignage un objet unique et très émouvant. L'absence de rancoeur est également une des caractéristiques de ce texte, Mc Court dépeint sa famille avec bienveillance et respect malgré l'alcoolisme de son père et la violence de son frère. Un exemple vous dis-je ! Une leçon de vie qui, à mon humble avis, ne peut que marquer le lecteur d'une trace indélébile et des noms tels que Malachy, Angela ou Cuchulainn resteront gravés longtemps dans votre mémoire si vous avez la chance de ne pas avoir lu ce roman simple et bouleversant.
J'achète ? : Oui évidemment et tu m'en dis des nouvelles....
Lien : http://francksbooks.wordpres..
Heureusement que j'ai vu des photos de Frank McCourt installé dans un salon avec de beaux meubles et plein de livres sur une étagère autour de lui sans quoi ce livre aurait été encore plus difficile. Une enfance à Limerick dans le plus grand dénuement. Une enfance dure et pourtant racontée sans rancoeur, avec les yeux d'un gamin qui voit, vit, dit et se questionne. J'ai énormément apprécié cette lecture qui fait tout relativiser. Une plongée dans un monde où tout fait défaut, sauf l'amour qui tient chaud au coeur dans la famille malgré les coups de grisou. C'est noir et lumineux, malgré tout.
Alors que la plupart des Irlandais tentent de quitter leur patrie pour émigrer en Amérique, Malachy et Angela McCourt font l'inverse: ne se remettant pas du décès de leur petite fille, ils quittent Brooklyn et, avec les quatre enfants qui leur restent, rejoignent Limerick, la ville natale d'Angela.
Mais Malachy, le père, ne trouve pas de travail. Et de toute façon, lorsqu'il parvient à en dénicher un, il finit toujours par se faire renvoyer: Malachy de faire la tournée des pubs le vendredi, jour de paie, et n'arrive jamais à se réveiller à temps pour aller travailler le samedi matin.
Pendant que le père boit son salaire, les enfants ont faim et froid: ils vivent dans un logement insalubre et doivent aller à l'école avec des trous dans les semelles de leurs chaussures.
Frank, l'aîné des enfants, observe ses parents avec une grande lucidité malgré son jeune âge. Il se rend compte que la situation de sa famille ne s'est pas améliorée maintenant qu'ils vivent en Irlande, bien au contraire. Devenu adolescent, Frank décroche son premier emploi et décide de mettre de l'argent de côté afin de pouvoir retourner en Amérique.
Je ne sais pas pourquoi j'ai subitement eu envie de lire simultanément ma version anglaise et la traduction française, mais je l'ai fait! Je peux donc vous assurer que la traduction française est excellente, même si, au début du roman, l'adaptation est plutôt déconcertante. Il faut dire que les premières années de la vie des McCourt sont racontées par un Frank qui se met dans la peau de l'enfant qu'il était alors et que le des premières pages est donc plus proche d'un discours oral que de l'écrit. Et cela donne beaucoup mieux en anglais...
Ce qui est marquant dans l'enfance de Frank McCourt, c'est la façon dont sa famille a survécu à la misère dans laquelle elle se trouvait. Il le dit d'ailleurs lui-même : " Quand je revois mon enfance, le seul fait d'avoir survécu m'étonne. Ce fut, bien sûr, une enfance misérable : l'enfance heureuse vaut rarement qu'on s'y arrête. Pire que l'enfance misérable ordinaire est l'enfance misérable en Irlande. Et pire encore est l'enfance misérable en Irlande catholique. " . Et l'on s'étonne avec lui que les McCourt n'aient pas perdu plus d'enfants (trois sont morts en bas âge).
Malgré ce côté dramatique, l'auteur ne tombe absolument pas dans le ressentiment ou dans l'amertume lorqu'il nous parle de ses premières années. Car s'il a parfois ressenti de la colère ou de la honte, Frank Mccourt ne garde, de son enfance malheureuse, aucune séquelle. Souvent, sa plume se fait légère et pleine d'humour, et même les passages les plus dramatiques du récit semblent avoir été écrit par un auteur que ses propres souvenirs font sourire.
C'est ce que j'admire le plus chez McCourt: s'être retrouvé dans des conditions de vie déplorables, mais n'en avoir gardé que l'envie de s'en tirer, sans en vouloir à personne. Plusieurs fois, on est choqué par ce qu'on apprend et on s'attend presque à voir le jeune Frank fuguer ou se révolter contre ce père irresponsable, mais non ! Il donne en fait l'impression d'essayer de vivre le plus normalement possible malgré les difficultés quotidiennes rencontrées pour manger, s'habiller ou se chauffer.
Le récit que nous fait l'auteur de la situation des Irlandais de l'époque est également très intéressant. Sans se lancer dans des détails politiques ou historiques (qui n'auraient pas beaucoup d'intérêt dans ce genre de récit), McCourt parvient à nous faire comprendre à demi-mot que sa famille n'est pas la seule à souffrir de la pauvreté. Les petites gens qui vivent dans le même quartier que les McCourt semblent tous avoir des difficultés à joindre les deux bouts mais, heureusement, tous les hommes des environs ne sont pas des Malachy et assument au moins leurs responsabilités de pères de famille.
Angela's Ashes est donc une autobiographie assez dure, un récit qui marque. Pour l'aborder au mieux, il faut tenter d'adopter la même conduite que le jeune Frank: observer ce qu'il se passe sans juger et sans condamner. Comme lui, il faut pouvoir pardonner aux adultes et à la vie qui n'est pas toujours tendre envers les enfants.
Mais Malachy, le père, ne trouve pas de travail. Et de toute façon, lorsqu'il parvient à en dénicher un, il finit toujours par se faire renvoyer: Malachy de faire la tournée des pubs le vendredi, jour de paie, et n'arrive jamais à se réveiller à temps pour aller travailler le samedi matin.
Pendant que le père boit son salaire, les enfants ont faim et froid: ils vivent dans un logement insalubre et doivent aller à l'école avec des trous dans les semelles de leurs chaussures.
Frank, l'aîné des enfants, observe ses parents avec une grande lucidité malgré son jeune âge. Il se rend compte que la situation de sa famille ne s'est pas améliorée maintenant qu'ils vivent en Irlande, bien au contraire. Devenu adolescent, Frank décroche son premier emploi et décide de mettre de l'argent de côté afin de pouvoir retourner en Amérique.
Je ne sais pas pourquoi j'ai subitement eu envie de lire simultanément ma version anglaise et la traduction française, mais je l'ai fait! Je peux donc vous assurer que la traduction française est excellente, même si, au début du roman, l'adaptation est plutôt déconcertante. Il faut dire que les premières années de la vie des McCourt sont racontées par un Frank qui se met dans la peau de l'enfant qu'il était alors et que le des premières pages est donc plus proche d'un discours oral que de l'écrit. Et cela donne beaucoup mieux en anglais...
Ce qui est marquant dans l'enfance de Frank McCourt, c'est la façon dont sa famille a survécu à la misère dans laquelle elle se trouvait. Il le dit d'ailleurs lui-même : " Quand je revois mon enfance, le seul fait d'avoir survécu m'étonne. Ce fut, bien sûr, une enfance misérable : l'enfance heureuse vaut rarement qu'on s'y arrête. Pire que l'enfance misérable ordinaire est l'enfance misérable en Irlande. Et pire encore est l'enfance misérable en Irlande catholique. " . Et l'on s'étonne avec lui que les McCourt n'aient pas perdu plus d'enfants (trois sont morts en bas âge).
Malgré ce côté dramatique, l'auteur ne tombe absolument pas dans le ressentiment ou dans l'amertume lorqu'il nous parle de ses premières années. Car s'il a parfois ressenti de la colère ou de la honte, Frank Mccourt ne garde, de son enfance malheureuse, aucune séquelle. Souvent, sa plume se fait légère et pleine d'humour, et même les passages les plus dramatiques du récit semblent avoir été écrit par un auteur que ses propres souvenirs font sourire.
C'est ce que j'admire le plus chez McCourt: s'être retrouvé dans des conditions de vie déplorables, mais n'en avoir gardé que l'envie de s'en tirer, sans en vouloir à personne. Plusieurs fois, on est choqué par ce qu'on apprend et on s'attend presque à voir le jeune Frank fuguer ou se révolter contre ce père irresponsable, mais non ! Il donne en fait l'impression d'essayer de vivre le plus normalement possible malgré les difficultés quotidiennes rencontrées pour manger, s'habiller ou se chauffer.
Le récit que nous fait l'auteur de la situation des Irlandais de l'époque est également très intéressant. Sans se lancer dans des détails politiques ou historiques (qui n'auraient pas beaucoup d'intérêt dans ce genre de récit), McCourt parvient à nous faire comprendre à demi-mot que sa famille n'est pas la seule à souffrir de la pauvreté. Les petites gens qui vivent dans le même quartier que les McCourt semblent tous avoir des difficultés à joindre les deux bouts mais, heureusement, tous les hommes des environs ne sont pas des Malachy et assument au moins leurs responsabilités de pères de famille.
Angela's Ashes est donc une autobiographie assez dure, un récit qui marque. Pour l'aborder au mieux, il faut tenter d'adopter la même conduite que le jeune Frank: observer ce qu'il se passe sans juger et sans condamner. Comme lui, il faut pouvoir pardonner aux adultes et à la vie qui n'est pas toujours tendre envers les enfants.
Franck Mc Court nous raconte son enfance misérable à New York puis en Irlande dans les années trente.
Au menu, un peu de pain s'il y en a et un mug de thé. Enfin, s'il reste de quoi faire du feu. Toute la famille dort dans le même lit, les poux et les puces vont se régaler. Il fait froid et humide mais le père, Malachy, est parti boire dans un pub, il rentrera tard et demandera aux enfants de se lever à trois heures du matin pour leur faire jurer qu'ils sont prêts à mourir pour l'Irlande.
De toute façon il vient encore de perdre son travail et il faudra se rendre à l'école avec des chaussures trouées, sans manteau et le poids de la religion catholique à chaque instant dans la tête. Histoire de ne pas recevoir de coups en cas de mauvaises réponses ou d'être mal vu par les voisins…
C'est une époque particulièrement difficile dans cette Irlande catholique mais les parents Angela et Malachy ne s'emploient guère à améliorer la vie de leurs enfants. Pourtant, trois d'entre eux sont morts.
Ce qui rend très touchant le texte de Franck Mc Court, c'est l'absence d'amertume ou de rancoeur tout au long d'un récit d'une grande lucidité. Il a su conserver les souvenirs aimants de ses parents. Son père n'avait pas son pareil pour raconter à son fils la vie de Cuchulainn, mythe celtique irlandais et il y a beaucoup de tendresse dans le portrait de sa mère.
Le livre est un peu long mais la peinture sociale en arrière-plan est passionnante et l'on reste émerveillé par la capacité de résistance physique et psychologique des enfants à ce point rudoyés par la vie.
« Les cendres d'Angela » est un attachant livre de souvenirs d'enfance aux couleurs sombres.
Au menu, un peu de pain s'il y en a et un mug de thé. Enfin, s'il reste de quoi faire du feu. Toute la famille dort dans le même lit, les poux et les puces vont se régaler. Il fait froid et humide mais le père, Malachy, est parti boire dans un pub, il rentrera tard et demandera aux enfants de se lever à trois heures du matin pour leur faire jurer qu'ils sont prêts à mourir pour l'Irlande.
De toute façon il vient encore de perdre son travail et il faudra se rendre à l'école avec des chaussures trouées, sans manteau et le poids de la religion catholique à chaque instant dans la tête. Histoire de ne pas recevoir de coups en cas de mauvaises réponses ou d'être mal vu par les voisins…
C'est une époque particulièrement difficile dans cette Irlande catholique mais les parents Angela et Malachy ne s'emploient guère à améliorer la vie de leurs enfants. Pourtant, trois d'entre eux sont morts.
Ce qui rend très touchant le texte de Franck Mc Court, c'est l'absence d'amertume ou de rancoeur tout au long d'un récit d'une grande lucidité. Il a su conserver les souvenirs aimants de ses parents. Son père n'avait pas son pareil pour raconter à son fils la vie de Cuchulainn, mythe celtique irlandais et il y a beaucoup de tendresse dans le portrait de sa mère.
Le livre est un peu long mais la peinture sociale en arrière-plan est passionnante et l'on reste émerveillé par la capacité de résistance physique et psychologique des enfants à ce point rudoyés par la vie.
« Les cendres d'Angela » est un attachant livre de souvenirs d'enfance aux couleurs sombres.
critiques presse (1)
D’une puissance narrative poignante, l’histoire autobiographique de Frank McCourt (décédé en 2009), écrite à distance (il a alors plus de soixante-cinq ans) est à la fois incroyable et sordide. Sans complaisance.
Lire la critique sur le site : Actualitte
Citations et extraits (52)
Voir plus
Ajouter une citation
J’ai grandi en Irlande, dans une grande maison de la banlieue de Dublin, au milieu des années 1960 et au cours des suivantes. Mon père, journaliste, partait tôt le matin et, lorsqu’il rentrait en fin d’après-midi, il se servait un verre de vin et sortait voir son jardin de roses. Dans son temps de libre, ma mère servait des repas à domicile aux invalides et aux personnes âgées, qu’elle leur livrait dans une Mini Cooper jaune, décorée de deux bandes noires de compétition. Le soir, elle chantait en faisant la cuisine : « The boys are all mad about Nelly, she’s the daughter of Officer Kelly1. » C’était une maison agréable, tranquille, bourgeoise et confortable. Chaque matin, les bouteilles de lait tintaient devant la porte. Nous avions d’épais rideaux pour étouffer les courants d’air et deux cheminées que nous utilisions peu. Mais les radiateurs blancs cliquetaient tout l’hiver. J’ai fréquenté l’école des Frères chrétiens et, hormis quelques coups d’une lanière en cuir, j’ai échappé aux aspects les plus insidieux de l’église catholique.
À bien des points de vue, ce fut une enfance heureuse, sans doute pas l’idéal pour un écrivain, mais voilà : elle ne se distinguait pas spécialement, je suppose, de celles d’autres enfants du Kent ou de l’Ohio, de Sydney ou de Stockholm.
Mais j’ai toujours su qu’une histoire différente restait cachée non loin dans mon dos. Mes parents avaient grandi dans la pauvreté : ma mère dans une ferme laitière à Derry, et le père de mon père était marchand de charbon à Dublin. Leur pays n’était pas celui qu’ils m’ont ouvert. De leur passé, ils m’ont dit fort peu. Peut-être étaient-ils trop accaparés par les tâches quotidiennes, le remboursement de l’emprunt immobilier, les urgences ordinaires. Ou peut-être n’ai-je pas posé les bonnes questions. On pouvait cependant sentir une sorte de réticence tacite, pas seulement à la maison, mais partout – en classe, à l’église, dans les médias. Avec le recul, je pense que cette réticence touchait la nation entière, tel un chapelet de souvenirs à la traîne derrière nous. La génération de mes parents – ces Irlandais qui connurent le début du XXe siècle – n’avait pas envie de parler des périodes difficiles, de peur, éventuellement, de les connaître à nouveau : More Bread or I’ll Appear2.
Non qu’ils aient délibérément choisi le silence. Je crois aujourd’hui qu’ils ont préféré nous offrir un présent riche en opportunités. Portés par le courant, nous sommes allés de l’avant sans regarder en arrière. Le passé était un lointain pays.
Bien des années plus tard, je suis parti aux États-Unis et me suis installé à New York où je suis devenu écrivain. Je suis souvent rentré à Dublin – qu’à ce jour j’appelle toujours « chez moi ». Un après-midi d’hiver, j’avais dans ma valise un cadeau pour mes parents : un exemplaire dédicacé des Cendres. « Pour Sean et Sally, amitiés, Frank McCourt. » Bien sûr, ils l’avaient déjà lu (toute l’Irlande l’avait lu, décortiqué, pillé, dépouillé, chanté, canonisé). Mon père, chroniqueur littéraire à l’Evening Press, était très fier que son fils lui apporte les mémoires de Frank avec sa signature. À New York, j’avais eu la chance de le côtoyer. Nous avions partagé nos histoires, promu nos livres ensemble en Allemagne. Nous nous retrouvions en ville dans les réceptions et les galas de charité. Nous avions noué des liens d’amitié. Frank et Ellen, son épouse, avaient écrit une lettre pour nous recommander auprès du syndicat de l’immeuble où nous voulions emménager.
Les Cendres d’Angela étaient posées sur la table en acajou du salon, près d’un vase de roses fraîchement cueillies dans le jardin.
Dans la soirée, je me suis assis devant la remise où écrivait mon père, dehors, à côté de la maison, et je lui ai demandé ce qu’il pensait de la controverse soulevée par l’autobiographie. Elle avait fait grand bruit à Limerick, et des critiques narquoises avaient paru en Angleterre (pour la plupart écrites par des journalistes irlandais). Adossé à son siège, mon père a fermé les yeux un instant. « Limerick n’avait rien à envier à Foxrock », m’a-t-il répondu avec une pointe d’ironie. Foxrock était la banlieue la plus riche d’Irlande, et il avait grandi dans une bicoque délabrée. Il s’est tu un instant, puis s’est livré davantage. Il m’avait déjà parlé auparavant, mais jamais avec autant de détails. Des affaires de mon grand-père, des charbonniers, des courses de Leopardstown, des lévriers à Dalymount, des fenêtres brisées de la maison de Cornelscourt, des bagarres dans le jardin de l’église Saint Brigid, des bouteilles vides au pub de Cabinteely, des placards plus vides encore chez lui, des chaises cassées pour entretenir le feu, des nuits pluvieuses quand Big Jack Doyle débarquait pour boire, de l’argent perdu à l’hippodrome du Curragh, du jour où les Black and Tans3 sont arrivés, munis d’un mandat d’arrêt à l’encontre de mon grand-père, des cris, des chansons, des silences, et des mille tourments quotidiens.
Le plus intéressant se nichait dans les détails, disséminés entre nous et ce que nous rapportait McCourt.
Les Cendres d’Angela m’ont renvoyé dans le labyrinthe de mon passé. J’ai ramassé le livre sur la table du salon, pour une troisième lecture, pourtant le contenu me paraissait toujours nouveau et nécessaire. Je voyais mon père, encore baigné par la rosée, marchant d’un pas lourd dans les ruelles de Dublin, en short, avec ses chaussures trouées – et la pluie qui lui tombait dessus, et son désir de réussir, âpre comme une poignée de sel dans la bouche.
La littérature prolonge la mémoire. Un récit donne naissance à d’autres récits. Le monde se nourrit d’une provision de détails, créant des réactions en chaîne qui nous relient les uns aux autres. Et selon John Berger : « Plus jamais on ne pourra raconter une histoire comme si elle était unique. »
En apparence, celle de Frank était une histoire simple. Il était né à Brooklyn et on l’avait ramené en Irlande, où il avait vécu ce qu’il a appelé une « enfance misérable », aujourd’hui célèbre. Revenant à New York à l’âge de dix-neuf ans, il a enchaîné les petits boulots avant de devenir un illustre professeur. Il voulait écrire plus que tout autre chose. De trente à quarante ans, il a gagné sa vie comme enseignant, avec l’idée d’arriver un jour à produire un livre. Au terme de cette décennie, il avait le plus grand mal à préserver du temps hors de ses heures de cours, et craignait que son désir d’écrire ne soit qu’une illusion. À cinquante ans, il n’était plus sûr d’en avoir encore envie. Il retrouvait d’autres écrivains au Lions Head Pub et se reprochait amèrement de ne pas avoir franchi le pas. McCourt adorait la littérature et saisissait toute son importance. Il s’inquiétait qu’elle lui soit passée à côté.
Puis il a rencontré Ellen Frey, qui travaillait dans les relations publiques et dont il est tombé amoureux. Il l’a épousée, et ce fut son troisième et dernier mariage. Elle savait que, s’il voulait l’aimer vraiment, il devait écrire. Mais aussi que, si elle-même l’aimait vraiment, elle devait lui permettre de le faire.
Il a donc pris sa retraite de professeur et, en octobre 1994, à l’âge de soixante-trois ans, il s’est consacré à la création. Comme tout écrivain, il a rencontré des difficultés. Pourtant, quelque part dans le fouillis des mots, le dédale de la langue, les pages jetées, une voix a surgi, la voix de son enfance dans les ruelles de Limerick. Il faut l’imaginer en train d’écrire à la main, assis à sa table dans son appartement de la 18e Rue Est. Les livres éparpillés dans la pièce. Jeter un mot pour happer le suivant. La poursuite de cette voix à l’intérieur. Les heures d’évasion. Le paragraphe qui ne cesse de glisser vers le bas de la page. Les rires, la tête renversée, quand la phrase est bonne. La peur de ne jamais être lu et de fouler aux pieds le souvenir des morts. Mais cette voix était profondément sincère et la sincérité l’a poussé à continuer. C’était son histoire, il restituait le visage de l’époque avec fidélité. Jamais il n’a eu l’impression d’être une victime. Se considérer comme tel aurait été un échec de l’intelligence. Frank avait besoin de retrouver un état proche de la naissance, composé de joie, de faim et de terreur. Il s’est fait une spécialité d’étudier la poussière pour lui faire remonter le temps.
Le jour où il a atteint la dernière page, il a attendu le retour d’Ellen pour jeter les derniers mots en sa présence : « Eh, Frank, c’est quand même un sacré pays, non ? » Et ensuite : « Si. » Ils ont débouché une bouteille de champagne. Il n’était pas sûr de lui, mais au moins avait-il achevé quelque chose. Puis, stupéfait, il a reçu un coup de téléphone de Molly Friedrich, un agent littéraire, et de l’éditrice Nan Graham, et le livre a fait des étincelles. Les critiques ont suivi. Le New York Times a publié son portrait. Des millions d’exemplaires ont été vendus, et Les Cendres se sont vues couronnées de prix, dont le Pulitzer. Le plus important est que les gens se soient sentis concernés. Ils ont compris et partagé une sorte d’intimité universelle. Les Français, les Allemands, les Américains ont adoré Frank. Même les Irlandais – vaguement chagrinés de voir nos souffrances secrètes ainsi exposées – ont commencé à l’aimer.
Qui aurait cru que l’enfance d’un jeune garçon à Limerick nous ouvrirait le cœur sur son époque ? Qui aurait mesuré la valeur de ce récit ? Qui aurait dit qu’en racontant une ville pour l’ensemble ignorée, et une vie promise à l’oubli, on défendait la démocratie dans ce qu’elle offre de plus grand ? S’il est précieux en soi, le détail force le souvenir.
À sa grande surprise, Frank McCourt s’est révélé une manière d’historien. Son histoire a donné un nom aux anonymes et nous interdit d’oublier.
Toute la fraîcheur d’une œuvre réussie réside dans le talent d’utiliser ce que les autres n’ont pas encore perçu ou senti. Frank McCourt le savait instinctivement. Sans prétendre à quoi que ce so
À bien des points de vue, ce fut une enfance heureuse, sans doute pas l’idéal pour un écrivain, mais voilà : elle ne se distinguait pas spécialement, je suppose, de celles d’autres enfants du Kent ou de l’Ohio, de Sydney ou de Stockholm.
Mais j’ai toujours su qu’une histoire différente restait cachée non loin dans mon dos. Mes parents avaient grandi dans la pauvreté : ma mère dans une ferme laitière à Derry, et le père de mon père était marchand de charbon à Dublin. Leur pays n’était pas celui qu’ils m’ont ouvert. De leur passé, ils m’ont dit fort peu. Peut-être étaient-ils trop accaparés par les tâches quotidiennes, le remboursement de l’emprunt immobilier, les urgences ordinaires. Ou peut-être n’ai-je pas posé les bonnes questions. On pouvait cependant sentir une sorte de réticence tacite, pas seulement à la maison, mais partout – en classe, à l’église, dans les médias. Avec le recul, je pense que cette réticence touchait la nation entière, tel un chapelet de souvenirs à la traîne derrière nous. La génération de mes parents – ces Irlandais qui connurent le début du XXe siècle – n’avait pas envie de parler des périodes difficiles, de peur, éventuellement, de les connaître à nouveau : More Bread or I’ll Appear2.
Non qu’ils aient délibérément choisi le silence. Je crois aujourd’hui qu’ils ont préféré nous offrir un présent riche en opportunités. Portés par le courant, nous sommes allés de l’avant sans regarder en arrière. Le passé était un lointain pays.
Bien des années plus tard, je suis parti aux États-Unis et me suis installé à New York où je suis devenu écrivain. Je suis souvent rentré à Dublin – qu’à ce jour j’appelle toujours « chez moi ». Un après-midi d’hiver, j’avais dans ma valise un cadeau pour mes parents : un exemplaire dédicacé des Cendres. « Pour Sean et Sally, amitiés, Frank McCourt. » Bien sûr, ils l’avaient déjà lu (toute l’Irlande l’avait lu, décortiqué, pillé, dépouillé, chanté, canonisé). Mon père, chroniqueur littéraire à l’Evening Press, était très fier que son fils lui apporte les mémoires de Frank avec sa signature. À New York, j’avais eu la chance de le côtoyer. Nous avions partagé nos histoires, promu nos livres ensemble en Allemagne. Nous nous retrouvions en ville dans les réceptions et les galas de charité. Nous avions noué des liens d’amitié. Frank et Ellen, son épouse, avaient écrit une lettre pour nous recommander auprès du syndicat de l’immeuble où nous voulions emménager.
Les Cendres d’Angela étaient posées sur la table en acajou du salon, près d’un vase de roses fraîchement cueillies dans le jardin.
Dans la soirée, je me suis assis devant la remise où écrivait mon père, dehors, à côté de la maison, et je lui ai demandé ce qu’il pensait de la controverse soulevée par l’autobiographie. Elle avait fait grand bruit à Limerick, et des critiques narquoises avaient paru en Angleterre (pour la plupart écrites par des journalistes irlandais). Adossé à son siège, mon père a fermé les yeux un instant. « Limerick n’avait rien à envier à Foxrock », m’a-t-il répondu avec une pointe d’ironie. Foxrock était la banlieue la plus riche d’Irlande, et il avait grandi dans une bicoque délabrée. Il s’est tu un instant, puis s’est livré davantage. Il m’avait déjà parlé auparavant, mais jamais avec autant de détails. Des affaires de mon grand-père, des charbonniers, des courses de Leopardstown, des lévriers à Dalymount, des fenêtres brisées de la maison de Cornelscourt, des bagarres dans le jardin de l’église Saint Brigid, des bouteilles vides au pub de Cabinteely, des placards plus vides encore chez lui, des chaises cassées pour entretenir le feu, des nuits pluvieuses quand Big Jack Doyle débarquait pour boire, de l’argent perdu à l’hippodrome du Curragh, du jour où les Black and Tans3 sont arrivés, munis d’un mandat d’arrêt à l’encontre de mon grand-père, des cris, des chansons, des silences, et des mille tourments quotidiens.
Le plus intéressant se nichait dans les détails, disséminés entre nous et ce que nous rapportait McCourt.
Les Cendres d’Angela m’ont renvoyé dans le labyrinthe de mon passé. J’ai ramassé le livre sur la table du salon, pour une troisième lecture, pourtant le contenu me paraissait toujours nouveau et nécessaire. Je voyais mon père, encore baigné par la rosée, marchant d’un pas lourd dans les ruelles de Dublin, en short, avec ses chaussures trouées – et la pluie qui lui tombait dessus, et son désir de réussir, âpre comme une poignée de sel dans la bouche.
La littérature prolonge la mémoire. Un récit donne naissance à d’autres récits. Le monde se nourrit d’une provision de détails, créant des réactions en chaîne qui nous relient les uns aux autres. Et selon John Berger : « Plus jamais on ne pourra raconter une histoire comme si elle était unique. »
En apparence, celle de Frank était une histoire simple. Il était né à Brooklyn et on l’avait ramené en Irlande, où il avait vécu ce qu’il a appelé une « enfance misérable », aujourd’hui célèbre. Revenant à New York à l’âge de dix-neuf ans, il a enchaîné les petits boulots avant de devenir un illustre professeur. Il voulait écrire plus que tout autre chose. De trente à quarante ans, il a gagné sa vie comme enseignant, avec l’idée d’arriver un jour à produire un livre. Au terme de cette décennie, il avait le plus grand mal à préserver du temps hors de ses heures de cours, et craignait que son désir d’écrire ne soit qu’une illusion. À cinquante ans, il n’était plus sûr d’en avoir encore envie. Il retrouvait d’autres écrivains au Lions Head Pub et se reprochait amèrement de ne pas avoir franchi le pas. McCourt adorait la littérature et saisissait toute son importance. Il s’inquiétait qu’elle lui soit passée à côté.
Puis il a rencontré Ellen Frey, qui travaillait dans les relations publiques et dont il est tombé amoureux. Il l’a épousée, et ce fut son troisième et dernier mariage. Elle savait que, s’il voulait l’aimer vraiment, il devait écrire. Mais aussi que, si elle-même l’aimait vraiment, elle devait lui permettre de le faire.
Il a donc pris sa retraite de professeur et, en octobre 1994, à l’âge de soixante-trois ans, il s’est consacré à la création. Comme tout écrivain, il a rencontré des difficultés. Pourtant, quelque part dans le fouillis des mots, le dédale de la langue, les pages jetées, une voix a surgi, la voix de son enfance dans les ruelles de Limerick. Il faut l’imaginer en train d’écrire à la main, assis à sa table dans son appartement de la 18e Rue Est. Les livres éparpillés dans la pièce. Jeter un mot pour happer le suivant. La poursuite de cette voix à l’intérieur. Les heures d’évasion. Le paragraphe qui ne cesse de glisser vers le bas de la page. Les rires, la tête renversée, quand la phrase est bonne. La peur de ne jamais être lu et de fouler aux pieds le souvenir des morts. Mais cette voix était profondément sincère et la sincérité l’a poussé à continuer. C’était son histoire, il restituait le visage de l’époque avec fidélité. Jamais il n’a eu l’impression d’être une victime. Se considérer comme tel aurait été un échec de l’intelligence. Frank avait besoin de retrouver un état proche de la naissance, composé de joie, de faim et de terreur. Il s’est fait une spécialité d’étudier la poussière pour lui faire remonter le temps.
Le jour où il a atteint la dernière page, il a attendu le retour d’Ellen pour jeter les derniers mots en sa présence : « Eh, Frank, c’est quand même un sacré pays, non ? » Et ensuite : « Si. » Ils ont débouché une bouteille de champagne. Il n’était pas sûr de lui, mais au moins avait-il achevé quelque chose. Puis, stupéfait, il a reçu un coup de téléphone de Molly Friedrich, un agent littéraire, et de l’éditrice Nan Graham, et le livre a fait des étincelles. Les critiques ont suivi. Le New York Times a publié son portrait. Des millions d’exemplaires ont été vendus, et Les Cendres se sont vues couronnées de prix, dont le Pulitzer. Le plus important est que les gens se soient sentis concernés. Ils ont compris et partagé une sorte d’intimité universelle. Les Français, les Allemands, les Américains ont adoré Frank. Même les Irlandais – vaguement chagrinés de voir nos souffrances secrètes ainsi exposées – ont commencé à l’aimer.
Qui aurait cru que l’enfance d’un jeune garçon à Limerick nous ouvrirait le cœur sur son époque ? Qui aurait mesuré la valeur de ce récit ? Qui aurait dit qu’en racontant une ville pour l’ensemble ignorée, et une vie promise à l’oubli, on défendait la démocratie dans ce qu’elle offre de plus grand ? S’il est précieux en soi, le détail force le souvenir.
À sa grande surprise, Frank McCourt s’est révélé une manière d’historien. Son histoire a donné un nom aux anonymes et nous interdit d’oublier.
Toute la fraîcheur d’une œuvre réussie réside dans le talent d’utiliser ce que les autres n’ont pas encore perçu ou senti. Frank McCourt le savait instinctivement. Sans prétendre à quoi que ce so
Oh. Elle tire sur sa Woodbine. Je vais te dire ce que c'est, fait-elle. C'est de la distinction de classe. Ils ne veulent pas de garçons des ruelles sur l'autel. Ils ne veulent pas de ceux qui ont les genoux croûteuxbet les cheveux en bataille. Oh, non, ils veulent les mignons garçons, avec l'huile capillaire et les chaussures neuves, qui ont un père avec costume-cravate et place stable. Voilà ce que c'est. On dira ce qu'on voudra, c'est difficile de s'accrocher à la foi quand tant de snobisme s'y mêle.
Och, aye.
Oh, och aye mon cul! C'est tout ce que tu as à la bouche. Tu pourrais aller voir le prêtre et lui expliquer que tu te retrouves avec un fils qui a sa tête farcie de latin... Et pourquoi il ne peut pas être enfant de
chœur ? Et qu'est-ce qu'il va faire de tout ce latin ?
Och, aye.
Oh, och aye mon cul! C'est tout ce que tu as à la bouche. Tu pourrais aller voir le prêtre et lui expliquer que tu te retrouves avec un fils qui a sa tête farcie de latin... Et pourquoi il ne peut pas être enfant de
chœur ? Et qu'est-ce qu'il va faire de tout ce latin ?
Vous devez apprendre et étudier afin de vous faire vos propres idées sur l'histoire et tout le reste mais c'est impossible tant qu'on a l'esprit vide. Aussi, meublez votre esprit, meublez-le. C'est la maison qui abrite votre trésor et personne d'autre au monde ne peut s'immiscer à l'intérieur. Si vous gagnez aux courses hippiques et achetez une maison qui a besoin de mobilier, la remplirez vous de babioles et de rossignols? Votre esprit est votre maison et, si vous l'encombrez d'immondices rapportées des cinémas, il pourrira dans votre tête. Vous pouvez être pauvres, vos chaussures peuvent être en piteux état, mais votre esprit est un palais.
Quand je revois mon enfance, le seul fait d'avoir survécu m'étonne. Ce fut, bien sûr, une enfance misérable : l'enfance heureuse vaut rarement qu'on s'y arrête. Pire que l'enfance misérable ordinaire est l'enfance misérable en Irlande. Et pire encore est l'enfance misérable en Irlande catholique.
Le matin, on a le monde rien que pour nous et jamais il ne me dit que je devrais mourir pour l'Irlande.Il (** le père) me raconte l'ancien temps en Irlande, lorsque les Anglais ne laissaient pas les catholiques avoir des écoles car ils voulaient tenir le peuple dans l'ignorance, et que les enfants catholiques se retrouvaient au fin fond du pays, dans ce qu'on appelait alors les écoles buissonnières, pour apprendre l'anglais, l'irlandais, le latin et le grec. Le peuple adorait apprendre.Il adorait les histoires et la poésie même si rien de tout ça n'aidait à décrocher un boulot. Hommes, femmes et enfants se rassemblaient dans des fossés pour entendre ces grands maîtres et chacun s'émerveillait de ce qu'un homme pouvait transporter dans sa tête.
( Belfond,1997, p.244 )
( Belfond,1997, p.244 )
Videos de Frank McCourt (5)
Voir plusAjouter une vidéo
Dans la catégorie :
Histoire des familles célèbresVoir plus
>Biographie générale et généalogie>Généalogie, onomastique>Histoire des familles célèbres (13)
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus

Enfance brisée
LydiaB
59 livres

Promenade irlandaise
kathel
45 livres
Autres livres de Frank McCourt (4)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les cendres d'Angela
Quel est l'auteur ?
Stephen Frye
Conan Doyle
Franck Mc Court
John Connolly
12 questions
24 lecteurs ont répondu
Thème : Les cendres d'Angela de
Frank McCourtCréer un quiz sur ce livre24 lecteurs ont répondu