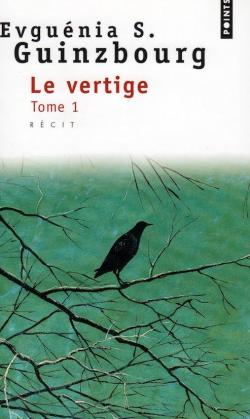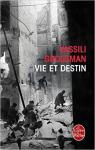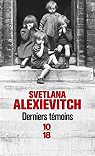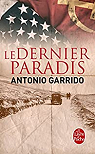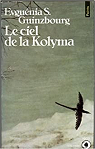Evguénia GuinzbourgEvguénia Semionovna GuinzbourgLe vertige tome 1 sur 2
Geneviève Johannet (Traducteur)/5 115 notes
Geneviève Johannet (Traducteur)/5 115 notes
Résumé :
Le premier tome de son autobiographie retrace sa vie depuis 1935 à 1940, à travers les différentes étapes de son arrestation.
Diplômée d'histoire à l'université de Kazan, elle participe à la création du journal Tatarie rouge et à l'écriture de L'Histoire de la Tatarie. En 1935, après l'arrestation d'un de ses collègues, le professeur Elvov, elle est accusée de ne pas avoir signalé une de ses erreurs dans ces textes. Cet homme étant rapidement considéré comme ... >Voir plus
Diplômée d'histoire à l'université de Kazan, elle participe à la création du journal Tatarie rouge et à l'écriture de L'Histoire de la Tatarie. En 1935, après l'arrestation d'un de ses collègues, le professeur Elvov, elle est accusée de ne pas avoir signalé une de ses erreurs dans ces textes. Cet homme étant rapidement considéré comme ... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Le vertige, tome 1Voir plus
Critiques, Analyses et Avis (15)
Voir plus
Ajouter une critique
En 1937, l'auteure et son mari militaient activement et sincèrement pour le Parti Communiste d'Union Soviétique.
Cette année-là, Staline intensifia sa politique répressive contre les prétendus ennemis de l'Etat (il s'agissait plutôt d'ennemis supposés de Staline lui-même, dont le nombre fut proportionnel à sa paranoïa).
Après s'être vue retirer sa carte de membre du Parti - pour avoir jadis fréquenté un intellectuel coupable de prises de positions contraire à la ligne du Parti - Evguenia fut poursuivie et emprisonnée pour ce même motif. Suite à une instruction à charge (assortie de pressions diverses pour l'obtention d'aveux et de témoignages contre d'autres), elle fut condamnée à dix ans d'emprisonnement. Son mari, coupable d'être l'époux d'une condamnée politique fut ensuite lui aussi arrêté. Les jeunes enfants furent confiés à la grand-mère.
D'abord recluse en isolement, Evguénia partagea ensuite sa cellule avec une autre victime de la répression soviétique. L'isolement fut particulièrement difficile, d'autant plus que des gardiens prenaient plaisir à accentuer les souffrances des détenus. Heureusement, Evguénia put communiquer avec des prisonniers voisins au moyen d'un code et de coups aux murs (comme le font des personnages du roman "le Zéro et l'Infini d'Arthur Koestler consacré aux Purges).
L'exécution de Nicolas Iéjov le 5 février 1940 (Ежов, 1895-1940, chef suprême du NKVD et principal artisan des Grandes Purges de Staline, surnommé "le nabot sanguinaire" il aimait participer aux séances de tortures), suscita un grand espoir chez de nombreux détenus. C'était ignorer que Staline tirait les ficelles du système répressif, et compter sans la nomination du zélé Lavrenti Béria (Бе́рия 1899-1953), celui que Staline avait présenté comme le chef de la 'Gestapo soviétique' auprès de Ribentrop lors de la signature du Pacte Germano-soviétique (septembre 1939). Staline mort le 5 mars 1953 (peut-être grâce à Béria ?) n'eut pas le temps de faire exécuter Béria, mais les successeurs de Staline s'en chargèrent…
En 1939, de nombreux prisonniers, dont Evguénia, furent transférés en camp de travail forcé : après l'isolement et une cellule partagée à deux, elle s'est ainsi retrouvée groupée avec de nombreuses autres victimes, toutes serrées dans le compartiment fermé d'un wagon de marchandises, puis dans un fond de cale de bateau.
Ce témoignage recoupe en de nombreux points ceux d'autres victimes de la répression soviétique, notamment celui d'Alexandre Soljénitsyne dans 'L'Archipel du Goulag' (lequel cite d'ailleurs Guinzbourg à plusieurs reprises). A la différence de ce dernier, Guinzbourg limite ici son propos à son vécu, sans efforts de théorisation ou de mise en perspective historique. Sa lecture n'en est que plus fluide et agréable, d'autant qu'elle porte un regard très fin sur le monde qui l'entoure. On comprend que Guinzburg ne fut qu'une victime parmi des milliers d'autres, et que la seule logique de ce système était le maintien au pouvoir, par la terreur et par la force, de celui qui s'en était emparé - un système tellement efficace qu'il ne s'effondra pas à la mort de Staline mais que ses successeurs continuèrent à l'utiliser, bien que dans des proportions nettement moindres.
On perçoit aussi la dureté des traitements subis par l'auteure, même si elle ne fut pas la plus mal lotie, puisqu'elle est revenue vivante de ces épreuves.
La suite de son récit (tome 2 que j'avais lu avant ce premier tome) est tout aussi réussie.
J'ai été surpris de prendre plaisir à lire ces deux ouvrages dont le thème n'a pourtant rien de réjouissant. Je les recommande vivement.
Cette année-là, Staline intensifia sa politique répressive contre les prétendus ennemis de l'Etat (il s'agissait plutôt d'ennemis supposés de Staline lui-même, dont le nombre fut proportionnel à sa paranoïa).
Après s'être vue retirer sa carte de membre du Parti - pour avoir jadis fréquenté un intellectuel coupable de prises de positions contraire à la ligne du Parti - Evguenia fut poursuivie et emprisonnée pour ce même motif. Suite à une instruction à charge (assortie de pressions diverses pour l'obtention d'aveux et de témoignages contre d'autres), elle fut condamnée à dix ans d'emprisonnement. Son mari, coupable d'être l'époux d'une condamnée politique fut ensuite lui aussi arrêté. Les jeunes enfants furent confiés à la grand-mère.
D'abord recluse en isolement, Evguénia partagea ensuite sa cellule avec une autre victime de la répression soviétique. L'isolement fut particulièrement difficile, d'autant plus que des gardiens prenaient plaisir à accentuer les souffrances des détenus. Heureusement, Evguénia put communiquer avec des prisonniers voisins au moyen d'un code et de coups aux murs (comme le font des personnages du roman "le Zéro et l'Infini d'Arthur Koestler consacré aux Purges).
L'exécution de Nicolas Iéjov le 5 février 1940 (Ежов, 1895-1940, chef suprême du NKVD et principal artisan des Grandes Purges de Staline, surnommé "le nabot sanguinaire" il aimait participer aux séances de tortures), suscita un grand espoir chez de nombreux détenus. C'était ignorer que Staline tirait les ficelles du système répressif, et compter sans la nomination du zélé Lavrenti Béria (Бе́рия 1899-1953), celui que Staline avait présenté comme le chef de la 'Gestapo soviétique' auprès de Ribentrop lors de la signature du Pacte Germano-soviétique (septembre 1939). Staline mort le 5 mars 1953 (peut-être grâce à Béria ?) n'eut pas le temps de faire exécuter Béria, mais les successeurs de Staline s'en chargèrent…
En 1939, de nombreux prisonniers, dont Evguénia, furent transférés en camp de travail forcé : après l'isolement et une cellule partagée à deux, elle s'est ainsi retrouvée groupée avec de nombreuses autres victimes, toutes serrées dans le compartiment fermé d'un wagon de marchandises, puis dans un fond de cale de bateau.
Ce témoignage recoupe en de nombreux points ceux d'autres victimes de la répression soviétique, notamment celui d'Alexandre Soljénitsyne dans 'L'Archipel du Goulag' (lequel cite d'ailleurs Guinzbourg à plusieurs reprises). A la différence de ce dernier, Guinzbourg limite ici son propos à son vécu, sans efforts de théorisation ou de mise en perspective historique. Sa lecture n'en est que plus fluide et agréable, d'autant qu'elle porte un regard très fin sur le monde qui l'entoure. On comprend que Guinzburg ne fut qu'une victime parmi des milliers d'autres, et que la seule logique de ce système était le maintien au pouvoir, par la terreur et par la force, de celui qui s'en était emparé - un système tellement efficace qu'il ne s'effondra pas à la mort de Staline mais que ses successeurs continuèrent à l'utiliser, bien que dans des proportions nettement moindres.
On perçoit aussi la dureté des traitements subis par l'auteure, même si elle ne fut pas la plus mal lotie, puisqu'elle est revenue vivante de ces épreuves.
La suite de son récit (tome 2 que j'avais lu avant ce premier tome) est tout aussi réussie.
J'ai été surpris de prendre plaisir à lire ces deux ouvrages dont le thème n'a pourtant rien de réjouissant. Je les recommande vivement.
Krutoj maršrut
Traduction : Bernard Abbots avec le concours de Jean-Jacques Marie
Le 1er décembre 1934, à l'Institut Smolny de Saint-Pétersbourg, aux environs de 16 h 30, Sergueï Mironovitch Kostrikov, mieux connu sous son nom de guerre de Kirov, est assassiné, d'une balle dans la nuque, par un jeune et obscur membre du Parti communiste soviétique, Leonid Vassilievitch Nikolaïev. Etrangement, les gardes du corps de Kirov, renforcés de quatre unités sur ordre personnel de Staline après l'étrange attentat manqué de septembre de la même année, semblaient s'être dissous dans la nature ...
Staline, prévenu dans la soirée, impute aussitôt la responsabilité du meurtre à Zinoviev et à ses partisans. C'est l'époque où l'Homme d'Acier redoute au maximum que ses opposants, mécontents de l'emprise de l'appareil policier sur le Parti et la vie politique, hostiles également à sa politique économique, ne lui confisquent le pouvoir. Il est temps pour lui d'éradiquer les vieux bolcheviks, ceux qui possèdent encore suffisamment de prestige pour lui faire de l'ombre. Il s'attèle sans états d'âme à la tâche et signe un décret d'exception qui passera à L Histoire sous le nom de "loi du 1er décembre." Ce décret va, en modifiant du tout au tout les procédures judiciaires, favoriser le déclenchement des Grandes Purges - et la terreur de masse dont l'URSS n'émergera, avec peine, qu'à la mort du dictateur, près de vingt ans plus tard.
Membre du comité régional du Parti communiste de Tatarie, épouse de Pavel Axionov, lequel appartenait au bureau politique du Parti communiste de l'URSS, tranquille professeur d'Histoire à Kazan et mère de deux enfants, Aliocha et Vassia - celui-ci deviendra par la suite l'écrivain Vassili Axionov - Evguenia Semionovna Guinzbourg, comme tant d'autres, plus puissants ou plus humbles qu'elle, sera aspirée par la monstrueuse spirale.
Inquiétée dès 1935, elle reçoit tout d'abord un blâme pour ne pas avoir signalé une "erreur" dans l'un des textes de "L'Histoire de la Tatarie Rouge" de son collègue, le professeur Elvov, bientôt arrêté pour "trotskysme". Puis c'est l'exclusion du Parti et, par voie de conséquence, la perte de son emploi à l'université. Enfin, le 15 février 1937, elle est arrêtée pour "activités contre-révolutionnaires."
Au début, évidemment, Evguenia, bonne communiste, qui croit dur comme fer à l'idéal marxiste, pense qu'il y a erreur, cherche à se justifier, à prouver sa bonne foi. Mais, peu à peu, sans qu'elle l'exprime clairement à ce moment dans son livre, elle se rend compte que ses interlocuteurs, eux, ne sont justement pas de bonne foi. Comme elle veut encore croire à ce qui fut et reste la règle de sa vie, elle se laisse glisser dans une sorte de dépression, surtout lorsqu'elle comprend qu'elle risque de ne plus voir de longtemps ni son mari, ni ses deux fils. Mais, du jour où elle pénètre dans les cachots de la sous-direction générale du NKVD, au Lac-Noir, à Moscou, elle ne cessera plus de se battre.
"Le Vertige", qui sera suivi de "Le Ciel de la Kolyma", retrace le sinistre parcours de la jeune femme depuis sa première incarcération au Lac-Noir en 1937 jusqu'à son arrivée, deux ans plus tard à la Kolyma où elle échoue tout d'abord au camp d'Elguen. Ce premier volume n'évoque donc pratiquement que des prisons : comme nous le répète l'auteur qui, grâce au ciel et à Marx, a su conserver un certain sens de l'humour, même quand tout, y compris l'humour en question, vire au noir le plus absolu, plus la prison est sale et les gardiens négligés et familiers, plus la Mort s'éloigne de vous ; plus la prison est impeccable et les gardiens polis, plus elle se rapproche ...
Du Lac-Noir, Guinzbourg est transportée à la Boutyrka, l'une des prisons les plus célèbres et les plus actives de Moscou, puis à celle de Lefortovo. Après sa condamnation à une peine de dix ans de détention en cellule d'isolement, assortie de cinq ans de retrait des droits civiques, on la transfère à Iaroslavl. D'abord strictement seule dans sa minuscule cellule, elle aura très vite une compagne qui n'est autre qu'une amie de jeunesse : les purges fonctionnent si bien que les mesures d'isolement drastique ne peuvent être respectées, faute tout simplement de place suffisante.
Finalement, en mai 1939, alors que les deux femmes pensent qu'elles mourront d'épuisement, de malnutrition et de désespoir bien avant la fin de leur peine, Guinzbourg voit la sienne commuée en dix ans de travaux forcés à accomplir dans les camps de la Kolyma. Elle part donc, avec près de quatre-vingt autres prisonnières venues d'horizons différents mais toutes des "politiques", dans un wagon à bestiaux qui les achemine, sous un soleil de plomb et avec des restrictions d'eau impensables, jusqu'au camp de transit de Souzdal, à Vladivostok. de là, nouveau départ, en bateau cette fois, vers la Kolyma et le camp d'Elguen, mot qui, en iakoute, la langue du cru, signifie "mort." Tout d'abord préposée à l'abattage des arbres en pleine taïga et par des températures sibériennes, Guinzbourg, qui n'en peut plus, a la chance d'être mutée à la "Maison d'Enfance" du camp, une crêche où l'on s'occupe des enfants nés à la Kolyma - car il y en a, oui.
L'ensemble fourmille de tant d'événements - on est presque tenté, malgré le contexte douloureux, d'écrire "de rebondissements" - et de réflexions qu'il serait malvenu de tenter de les détailler. Saluons cependant la limpidité de l'écriture, la logique de la construction et un don réel pour le récit qui font de ce livre un document qu'on n'est pas près d'oublier. D'ailleurs, comme nous vous le disions, il y a une "suite", avec laquelle on est pressé d'enchaîner. ;o)
Traduction : Bernard Abbots avec le concours de Jean-Jacques Marie
Le 1er décembre 1934, à l'Institut Smolny de Saint-Pétersbourg, aux environs de 16 h 30, Sergueï Mironovitch Kostrikov, mieux connu sous son nom de guerre de Kirov, est assassiné, d'une balle dans la nuque, par un jeune et obscur membre du Parti communiste soviétique, Leonid Vassilievitch Nikolaïev. Etrangement, les gardes du corps de Kirov, renforcés de quatre unités sur ordre personnel de Staline après l'étrange attentat manqué de septembre de la même année, semblaient s'être dissous dans la nature ...
Staline, prévenu dans la soirée, impute aussitôt la responsabilité du meurtre à Zinoviev et à ses partisans. C'est l'époque où l'Homme d'Acier redoute au maximum que ses opposants, mécontents de l'emprise de l'appareil policier sur le Parti et la vie politique, hostiles également à sa politique économique, ne lui confisquent le pouvoir. Il est temps pour lui d'éradiquer les vieux bolcheviks, ceux qui possèdent encore suffisamment de prestige pour lui faire de l'ombre. Il s'attèle sans états d'âme à la tâche et signe un décret d'exception qui passera à L Histoire sous le nom de "loi du 1er décembre." Ce décret va, en modifiant du tout au tout les procédures judiciaires, favoriser le déclenchement des Grandes Purges - et la terreur de masse dont l'URSS n'émergera, avec peine, qu'à la mort du dictateur, près de vingt ans plus tard.
Membre du comité régional du Parti communiste de Tatarie, épouse de Pavel Axionov, lequel appartenait au bureau politique du Parti communiste de l'URSS, tranquille professeur d'Histoire à Kazan et mère de deux enfants, Aliocha et Vassia - celui-ci deviendra par la suite l'écrivain Vassili Axionov - Evguenia Semionovna Guinzbourg, comme tant d'autres, plus puissants ou plus humbles qu'elle, sera aspirée par la monstrueuse spirale.
Inquiétée dès 1935, elle reçoit tout d'abord un blâme pour ne pas avoir signalé une "erreur" dans l'un des textes de "L'Histoire de la Tatarie Rouge" de son collègue, le professeur Elvov, bientôt arrêté pour "trotskysme". Puis c'est l'exclusion du Parti et, par voie de conséquence, la perte de son emploi à l'université. Enfin, le 15 février 1937, elle est arrêtée pour "activités contre-révolutionnaires."
Au début, évidemment, Evguenia, bonne communiste, qui croit dur comme fer à l'idéal marxiste, pense qu'il y a erreur, cherche à se justifier, à prouver sa bonne foi. Mais, peu à peu, sans qu'elle l'exprime clairement à ce moment dans son livre, elle se rend compte que ses interlocuteurs, eux, ne sont justement pas de bonne foi. Comme elle veut encore croire à ce qui fut et reste la règle de sa vie, elle se laisse glisser dans une sorte de dépression, surtout lorsqu'elle comprend qu'elle risque de ne plus voir de longtemps ni son mari, ni ses deux fils. Mais, du jour où elle pénètre dans les cachots de la sous-direction générale du NKVD, au Lac-Noir, à Moscou, elle ne cessera plus de se battre.
"Le Vertige", qui sera suivi de "Le Ciel de la Kolyma", retrace le sinistre parcours de la jeune femme depuis sa première incarcération au Lac-Noir en 1937 jusqu'à son arrivée, deux ans plus tard à la Kolyma où elle échoue tout d'abord au camp d'Elguen. Ce premier volume n'évoque donc pratiquement que des prisons : comme nous le répète l'auteur qui, grâce au ciel et à Marx, a su conserver un certain sens de l'humour, même quand tout, y compris l'humour en question, vire au noir le plus absolu, plus la prison est sale et les gardiens négligés et familiers, plus la Mort s'éloigne de vous ; plus la prison est impeccable et les gardiens polis, plus elle se rapproche ...
Du Lac-Noir, Guinzbourg est transportée à la Boutyrka, l'une des prisons les plus célèbres et les plus actives de Moscou, puis à celle de Lefortovo. Après sa condamnation à une peine de dix ans de détention en cellule d'isolement, assortie de cinq ans de retrait des droits civiques, on la transfère à Iaroslavl. D'abord strictement seule dans sa minuscule cellule, elle aura très vite une compagne qui n'est autre qu'une amie de jeunesse : les purges fonctionnent si bien que les mesures d'isolement drastique ne peuvent être respectées, faute tout simplement de place suffisante.
Finalement, en mai 1939, alors que les deux femmes pensent qu'elles mourront d'épuisement, de malnutrition et de désespoir bien avant la fin de leur peine, Guinzbourg voit la sienne commuée en dix ans de travaux forcés à accomplir dans les camps de la Kolyma. Elle part donc, avec près de quatre-vingt autres prisonnières venues d'horizons différents mais toutes des "politiques", dans un wagon à bestiaux qui les achemine, sous un soleil de plomb et avec des restrictions d'eau impensables, jusqu'au camp de transit de Souzdal, à Vladivostok. de là, nouveau départ, en bateau cette fois, vers la Kolyma et le camp d'Elguen, mot qui, en iakoute, la langue du cru, signifie "mort." Tout d'abord préposée à l'abattage des arbres en pleine taïga et par des températures sibériennes, Guinzbourg, qui n'en peut plus, a la chance d'être mutée à la "Maison d'Enfance" du camp, une crêche où l'on s'occupe des enfants nés à la Kolyma - car il y en a, oui.
L'ensemble fourmille de tant d'événements - on est presque tenté, malgré le contexte douloureux, d'écrire "de rebondissements" - et de réflexions qu'il serait malvenu de tenter de les détailler. Saluons cependant la limpidité de l'écriture, la logique de la construction et un don réel pour le récit qui font de ce livre un document qu'on n'est pas près d'oublier. D'ailleurs, comme nous vous le disions, il y a une "suite", avec laquelle on est pressé d'enchaîner. ;o)
Krutoï marshrut
Traduction : Geneviève Johannet
La première partie de l'oeuvre de Guinzbourg, que nous connaissons en Occident sous le titre de "Le Vertige", est sortie en Italie au milieu des années soixante. le texte avait voyagé jusqu'à Milan par l'habituelle voie clandestine de l'époque : le samizdat. le succès remporté, l'émotion soulevée par ce récit si prenant et si habilement mené, entraînèrent évidemment la parution de la seconde moitié qui reçut chez nous le titre de "Le Ciel de la Kolyma."
Guinzbourg y relate ses années de camp, sa rencontre avec celui qui deviendra son second mari, le médecin Anton Walter, un Russe originaire de Crimée mais dont les ancêtres étaient arrivés en Russie sous le règne de Catherine la Grande, les difficultés auxquelles se heurtent les condamnés ayant achevé leur peine et rejoignant la vie civile en qualité de "relégués" et, bien sûr, la fin de Staline et le changement d'atmosphère qu'elle entraîne dans toute la Kolyma.
Le titre de la première partie faisait référence au "vertige" ressenti par la narratrice se voyant sombrer dans l'infernale spirale de la violence stalinienne. Cependant, s'il y a un adjectif que l'on se sent obligé d'utiliser après la lecture du texte tout entier, c'est "vertigineux."
Depuis le début, accroché à une Evguénia Guinzbourg d'abord incrédule, puis résignée, et enfin bien décidée à lutter jusqu'au bout et, chose encore plus essentielle, à préserver son intégrité morale et intellectuelle, le lecteur se sent lui aussi aspiré, contraint de plonger au plus profond d'une dictature pour mieux en saisir le fonctionnement et la démence sous-jacente. On parle beaucoup du "devoir de mémoire" pour certains événements de notre cher XXème siècle - toujours les mêmes, d'ailleurs. Ce "devoir", il convient aussi de l'évoquer et de l'évoquer encore au sujet du totalitarisme soviétique. En effet, si celui-ci semble avoir disparu en Russie, il continue à fleurir dans de nombreux endroits de la planète, notamment en Asie. Ce qui prouve qu'il est toujours bien vivant et s'est contenté de changer de peau, tel un monstrueux serpent idéologique et politique tapi dans son coin et attendant, espérant ...
Avec une incroyable sûreté et un sens aigu du détail, Evguenia Guinzbourg nous restitue des jours qui furent, pour elle et pour tant d'autres, à la fois apocalyptiques et sinistrement réels et même, on peut l'écrire, banals. Si les récits des rescapés des camps de la Mort nazis conservent toujours - en tous cas pour nous, et tant pis si cela en choque certains - quelque chose de wagnérien, dans l'optique germanique et scandinave du "Crépuscule des Dieux", dans l'effondrement, la décomposition empoisonnée et méphitique de tout un monde, le tout éclairé par les flammes vacillantes et démoniaques des crématoires en folie, celui de Guinzbourg dépeint une apocalypse humaine, où les engelures et les doigts de pied qu'on ampute sont monnaie courante, où le scorbut règne en maître, où, surtout, une Administration implacable, un système qu'on ne voit jamais mais qu'on devine toujours, fait aujourd'hui d'un mensonge une vérité et vice versa. Cette apocalypse-là ne veut pas engloutir les dieux qui l'ont déchaînée : si l'on pense aux flammes, ce sont à celles du Moloch-Baal antique, si l'on pense à un univers, c'est à celui du "Dépeupleur" de Beckett.
L'impression qu'on en retire est difficile à définir. Mais elle tendrait en tous cas à établir une différence entre les totalitarismes. Non pas en matière de gravité ou d'importance : seulement pour leur essence et bien que, au final, le résultat recherché et obtenu, la destruction de l'esprit avant celle du corps, reste le même. ;o)
Traduction : Geneviève Johannet
La première partie de l'oeuvre de Guinzbourg, que nous connaissons en Occident sous le titre de "Le Vertige", est sortie en Italie au milieu des années soixante. le texte avait voyagé jusqu'à Milan par l'habituelle voie clandestine de l'époque : le samizdat. le succès remporté, l'émotion soulevée par ce récit si prenant et si habilement mené, entraînèrent évidemment la parution de la seconde moitié qui reçut chez nous le titre de "Le Ciel de la Kolyma."
Guinzbourg y relate ses années de camp, sa rencontre avec celui qui deviendra son second mari, le médecin Anton Walter, un Russe originaire de Crimée mais dont les ancêtres étaient arrivés en Russie sous le règne de Catherine la Grande, les difficultés auxquelles se heurtent les condamnés ayant achevé leur peine et rejoignant la vie civile en qualité de "relégués" et, bien sûr, la fin de Staline et le changement d'atmosphère qu'elle entraîne dans toute la Kolyma.
Le titre de la première partie faisait référence au "vertige" ressenti par la narratrice se voyant sombrer dans l'infernale spirale de la violence stalinienne. Cependant, s'il y a un adjectif que l'on se sent obligé d'utiliser après la lecture du texte tout entier, c'est "vertigineux."
Depuis le début, accroché à une Evguénia Guinzbourg d'abord incrédule, puis résignée, et enfin bien décidée à lutter jusqu'au bout et, chose encore plus essentielle, à préserver son intégrité morale et intellectuelle, le lecteur se sent lui aussi aspiré, contraint de plonger au plus profond d'une dictature pour mieux en saisir le fonctionnement et la démence sous-jacente. On parle beaucoup du "devoir de mémoire" pour certains événements de notre cher XXème siècle - toujours les mêmes, d'ailleurs. Ce "devoir", il convient aussi de l'évoquer et de l'évoquer encore au sujet du totalitarisme soviétique. En effet, si celui-ci semble avoir disparu en Russie, il continue à fleurir dans de nombreux endroits de la planète, notamment en Asie. Ce qui prouve qu'il est toujours bien vivant et s'est contenté de changer de peau, tel un monstrueux serpent idéologique et politique tapi dans son coin et attendant, espérant ...
Avec une incroyable sûreté et un sens aigu du détail, Evguenia Guinzbourg nous restitue des jours qui furent, pour elle et pour tant d'autres, à la fois apocalyptiques et sinistrement réels et même, on peut l'écrire, banals. Si les récits des rescapés des camps de la Mort nazis conservent toujours - en tous cas pour nous, et tant pis si cela en choque certains - quelque chose de wagnérien, dans l'optique germanique et scandinave du "Crépuscule des Dieux", dans l'effondrement, la décomposition empoisonnée et méphitique de tout un monde, le tout éclairé par les flammes vacillantes et démoniaques des crématoires en folie, celui de Guinzbourg dépeint une apocalypse humaine, où les engelures et les doigts de pied qu'on ampute sont monnaie courante, où le scorbut règne en maître, où, surtout, une Administration implacable, un système qu'on ne voit jamais mais qu'on devine toujours, fait aujourd'hui d'un mensonge une vérité et vice versa. Cette apocalypse-là ne veut pas engloutir les dieux qui l'ont déchaînée : si l'on pense aux flammes, ce sont à celles du Moloch-Baal antique, si l'on pense à un univers, c'est à celui du "Dépeupleur" de Beckett.
L'impression qu'on en retire est difficile à définir. Mais elle tendrait en tous cas à établir une différence entre les totalitarismes. Non pas en matière de gravité ou d'importance : seulement pour leur essence et bien que, au final, le résultat recherché et obtenu, la destruction de l'esprit avant celle du corps, reste le même. ;o)
Evguénia Guinzbourg est une communiste convaincue, mariée à un cacique du parti lorsque surviennent les grandes purges de la fin des années 1930. Elle va connaître les accusations sans fondement, les procès ubuesques, la prison et l'isolement, les transports en wagons à bestiaux à travers la Sibérie, et enfin les camps du goulag. Et encore, elle constate qu'elle a eu de la chance d'être jugée avant que la torture ne soit systématiquement employée pour soutirer des aveux aux accusés.
La vie dans les camps est souvent courte, car les conditions sont effroyables, comparables aux camps de concentration nazis en plus froid, car la température descend à -40 ou -50° dans la région de la Kolima. Certes il n'y a pas eu de camps d'extermination, le pouvoir se contentait de faire mourir les détenus à petit feu, et seuls ceux qui avaient un emploi privilégié avaient une chance de survivre. Une différence énorme quand même entre les camps nazis et les soviétiques : les Juifs et les résistants enfermés haïssaient le pouvoir nazi qui les avaient envoyé là. Au goulag, bien peu savent pourquoi ils ont été condamnés, l'auteure cite un dialogue de fou avec un gardien :
- Pourquoi ils m'ont condamné à 10 ans ?
- Je sais que tu n'es pas coupable. Si tu avais été coupable, ils t'auraient donné bien plus de dix ans."
Dans tout le récit, on voit la puissance de la propagande soviétique et le degré d'endoctrinement des Russes. Evguénia Guinzbourg elle-même n'a rien compris à L Histoire. On entend des condamnés qui admirent Staline et imaginent que "Staline ne sait absolument rien des illégalités commises en ce moment." C'est quand même lui qui ordonnait les purges et fixait les quotas d'accusés à envoyer au goulag. L'auteure elle, n'aime pas Staline, mais se demande "nous-mêmes, après tout ce qui nous était arrivé, aurions-nous voté pour un autre régime que le régime soviétique ?". Même en voyant l'horreur du système, elle soutient le régime, comme si les dizaines de millions de victimes n'étaient qu'une petite bavure. Et dans sa présentation, écrite dans les années 1960, l'auteure écrit :
"Dans notre parti, dans notre pays, règne de nouveau la grande vérité léniniste."
La vérité n'a jamais existé en URSS. Alexandre Soljenitsyne ou encore Andreï Sakharov ont subi la répression bien après la mort de Staline, et il faut savoir que les premiers camps de concentration soviétiques ont été créés avant 1920, sous le règne de Lénine. La propagande communiste a toujours affirmé que Lénine était un pur, et que le mal était venu de Staline, ce qui lui permet de ne pas remettre en question le système. On met tout sur le dos d'une personne, et on se dédouane de toutes les horreurs, c'est tellement facile.
La réalité c'est que lorsque le communisme se veut "la dictature du prolétariat" seule le premier mot est juste. Et comme dans toutes les dictatures, le système a besoin d'ennemis pour motiver le peuple et justifier la violence. Elle est intrinsèque au système, et tous les régimes communistes ont favorisé la répression. La Chine maoïste avec la révolution culturelle, la Corée du Nord, le Vietnam dont les habitants préféraient devenir boat-people, affronter les pirates et les tempêtes que de subir les "camps de réhabilitation par le travail", le comble de l'horreur étant atteint par les Khmers Rouges qui ont déporté la totalité de leur population.
C'est choquant de constater que Evguénia Guinzbourg et ses compagnes n'ont rien compris de tout ça et continuent de croire à un idéal communiste après en avoir subi les conséquences pendant des années.
La vie dans les camps est souvent courte, car les conditions sont effroyables, comparables aux camps de concentration nazis en plus froid, car la température descend à -40 ou -50° dans la région de la Kolima. Certes il n'y a pas eu de camps d'extermination, le pouvoir se contentait de faire mourir les détenus à petit feu, et seuls ceux qui avaient un emploi privilégié avaient une chance de survivre. Une différence énorme quand même entre les camps nazis et les soviétiques : les Juifs et les résistants enfermés haïssaient le pouvoir nazi qui les avaient envoyé là. Au goulag, bien peu savent pourquoi ils ont été condamnés, l'auteure cite un dialogue de fou avec un gardien :
- Pourquoi ils m'ont condamné à 10 ans ?
- Je sais que tu n'es pas coupable. Si tu avais été coupable, ils t'auraient donné bien plus de dix ans."
Dans tout le récit, on voit la puissance de la propagande soviétique et le degré d'endoctrinement des Russes. Evguénia Guinzbourg elle-même n'a rien compris à L Histoire. On entend des condamnés qui admirent Staline et imaginent que "Staline ne sait absolument rien des illégalités commises en ce moment." C'est quand même lui qui ordonnait les purges et fixait les quotas d'accusés à envoyer au goulag. L'auteure elle, n'aime pas Staline, mais se demande "nous-mêmes, après tout ce qui nous était arrivé, aurions-nous voté pour un autre régime que le régime soviétique ?". Même en voyant l'horreur du système, elle soutient le régime, comme si les dizaines de millions de victimes n'étaient qu'une petite bavure. Et dans sa présentation, écrite dans les années 1960, l'auteure écrit :
"Dans notre parti, dans notre pays, règne de nouveau la grande vérité léniniste."
La vérité n'a jamais existé en URSS. Alexandre Soljenitsyne ou encore Andreï Sakharov ont subi la répression bien après la mort de Staline, et il faut savoir que les premiers camps de concentration soviétiques ont été créés avant 1920, sous le règne de Lénine. La propagande communiste a toujours affirmé que Lénine était un pur, et que le mal était venu de Staline, ce qui lui permet de ne pas remettre en question le système. On met tout sur le dos d'une personne, et on se dédouane de toutes les horreurs, c'est tellement facile.
La réalité c'est que lorsque le communisme se veut "la dictature du prolétariat" seule le premier mot est juste. Et comme dans toutes les dictatures, le système a besoin d'ennemis pour motiver le peuple et justifier la violence. Elle est intrinsèque au système, et tous les régimes communistes ont favorisé la répression. La Chine maoïste avec la révolution culturelle, la Corée du Nord, le Vietnam dont les habitants préféraient devenir boat-people, affronter les pirates et les tempêtes que de subir les "camps de réhabilitation par le travail", le comble de l'horreur étant atteint par les Khmers Rouges qui ont déporté la totalité de leur population.
C'est choquant de constater que Evguénia Guinzbourg et ses compagnes n'ont rien compris de tout ça et continuent de croire à un idéal communiste après en avoir subi les conséquences pendant des années.
Il s'agit de la première partie d'un grand roman autobiographique sur la vie d''Evguénia Guinzbourg entre 1935 et 1955 (son arrestation, son séjour en prison puis dans des camps jusqu'à la mort de Staline et réhabilitation en 1955). Dans ce tome le récit s'arrête en 1940. Historienne spécialiste de l'histoire de la Tatarie (Tatarstan), ses ennuis commence en 1935 lorsqu'un de ses collègues est arrêté. On lui reproche alors de ne pas avoir précédemment dénoncé ses erreurs et elle reçoit un blâme. L'engrenage commence : elle perd son poste, est interdite d'enseignement, puis exclue du Parti Communiste. Finalement en 1937 elle est arrêtée et après 6 mois de prison est condamnée à 10 ans de cellule d'isolement. Elle en fera deux (et pas à l'isolement complet car il y a tant d'arrestation que c'est impossible), le reste de sa peine sera commué en travaux forcés à la Kolyma, au camp d'Elguen. La Kolyma, c'est le fin fond de la Sibérie, perçue par les détenus comme une île non entourée d'eau, tant elle semble loin du reste du continent de par son isolement et les difficultés d'accès. Nul besoin de barrières. Elle survit à l'hiver 39-40 extrêmement rude. Elle fait la plonge dans un réfectoire, elle fait du bûcheronnage et puis un jour a des nouvelles de son fils par un détenu qui l'a rencontré (son fils c'est le futur écrivain Vassili Axionov). En 1940 elle est employée comme infirmière dans un camp d'enfants (enfants dont les parents ont été arrêtés) et se met à pleurer et réalise que cela faisait des années qu'elle n'avait pas pleuré, et qu'en pleurant par compassion pour ces enfants elle retrouve son humanité.
C'est un témoignage poignant, la lecture est aisée, ce n'est absolument pas le même type d'ouvrage que L'Archipel du Goulag de Soljénitsyne. Les deux ouvrages se recoupent mais elle raconte exclusivement son vécu. Elle arrive à garder un certain sens de l'humour, et une sacrée force de caractère.
C'est un témoignage poignant, la lecture est aisée, ce n'est absolument pas le même type d'ouvrage que L'Archipel du Goulag de Soljénitsyne. Les deux ouvrages se recoupent mais elle raconte exclusivement son vécu. Elle arrive à garder un certain sens de l'humour, et une sacrée force de caractère.
Citations et extraits (27)
Voir plus
Ajouter une citation
[...] ... Je n'aurais jamais cru que Iaroslavski, considéré comme la conscience du parti, pût construire d'aussi faux syllogismes. C'est de sa bouche même que j'entendis pour la première fois la théorie, qui eut une si large diffusion en 1937, selon laquelle "l'objectif et le subjectif sont, en substance, la même chose." Que vous ayez commis un délit ou bien que vous ayez, par négligence ou manque de vigilance, porté de l'eau au moulin de celui qui l'a commis, vous êtes également coupable : même si vous n'étiez absolument au courant de rien. Pour ce qui me concernait, voici la suite logique de ce qui en résulta : Elvov avait fait dans son étude des erreurs théoriques, qu'il l'eût fait à dessein ou non, cela n'avait pas d'importance ; je travaillais avec Elvov, je le savais auteur de cet article et je ne l'avais pas démasqué : c'était de la complicité avec l'ennemi.
Au manque de vigilance que m'avait attribué le consciencieux et humain Sidorov, succéda la nouvelle définition de mes crimes. Elle était pire que "l'attitude conciliatrice" de Beiline : Iaroslavski m'accusait de "complicité avec les ennemis du peuple." Ainsi, on mettait les petits points sur les i : la complicité avec l'ennemi était passible de poursuites pénales.
Je perdis le contrôle de mes nerfs. Je commençai à crier contre ce vieil homme respecté de tous, je tapai du pied ; j'aurais été capable de le frapper à coups de poing si son énorme bureau ne nous avait pas séparés. Oui, j'étais arrivée à un tel point de désespoir que je commençai à lui jeter au visage des questions trop simples, que dictait le bon sens. A cette époque, ces questions-là étaient plus que jamais considérées comme de mauvais goût : tous devaient montrer qu'ils tenaient les syllogismes les plus absurdes comme la synthèse de la pensée de tous. Dès que quelqu'un posait une question susceptible de dévoiler l'insanité de certaines idées, les autres s'indignaient et se moquaient de lui comme d'un idiot.
Mais j'étais dans un état de rage tel que je me permis de crier à Iaroslavski :
- "D'accord, je ne l'ai pas critiqué ! Et vous ? Non seulement vous ne l'avez pas critiqué, mais vous avez vous-même patronné la publication de son essai dans l'"Histoire du Parti." Pourquoi est-ce à vous de me juger, plutôt que le contraire ? J'ai trente ans, vous en avez soixante. Je suis membre du parti depuis peu, vous êtes la conscience du parti. Pourquoi est-ce moi que l'on doit tourmenter alors qu'on vous laisse derrière votre table ? Vous n'avez pas honte ?" ... [...]
Au manque de vigilance que m'avait attribué le consciencieux et humain Sidorov, succéda la nouvelle définition de mes crimes. Elle était pire que "l'attitude conciliatrice" de Beiline : Iaroslavski m'accusait de "complicité avec les ennemis du peuple." Ainsi, on mettait les petits points sur les i : la complicité avec l'ennemi était passible de poursuites pénales.
Je perdis le contrôle de mes nerfs. Je commençai à crier contre ce vieil homme respecté de tous, je tapai du pied ; j'aurais été capable de le frapper à coups de poing si son énorme bureau ne nous avait pas séparés. Oui, j'étais arrivée à un tel point de désespoir que je commençai à lui jeter au visage des questions trop simples, que dictait le bon sens. A cette époque, ces questions-là étaient plus que jamais considérées comme de mauvais goût : tous devaient montrer qu'ils tenaient les syllogismes les plus absurdes comme la synthèse de la pensée de tous. Dès que quelqu'un posait une question susceptible de dévoiler l'insanité de certaines idées, les autres s'indignaient et se moquaient de lui comme d'un idiot.
Mais j'étais dans un état de rage tel que je me permis de crier à Iaroslavski :
- "D'accord, je ne l'ai pas critiqué ! Et vous ? Non seulement vous ne l'avez pas critiqué, mais vous avez vous-même patronné la publication de son essai dans l'"Histoire du Parti." Pourquoi est-ce à vous de me juger, plutôt que le contraire ? J'ai trente ans, vous en avez soixante. Je suis membre du parti depuis peu, vous êtes la conscience du parti. Pourquoi est-ce moi que l'on doit tourmenter alors qu'on vous laisse derrière votre table ? Vous n'avez pas honte ?" ... [...]
[...] ... je fréquentais avec assiduité les cours d'instruction politique d'Evdokia Ivanovna, m'y rendant même après une garde de nuit, et d'autant plus volontiers qu'elle donnait malgré tout quelques bribes d'information puisées dans les journaux récents, auxquels nous n'avions pas accès.
J'ai gardé un souvenir très net de l'un de ses cours, consacré à l'étude d'un rapport de Molotov (= membre du bureau politique du Parti et ami personnel de Staline ; il représentait celui-ci lors de la signature du fameux traité de non-agression réciproque entre l'Allemagne et l'URSS). Il y était question du rôle positif joué par le régime hitlérien dans le renforcement de l'économie allemande. Le chômage avait disparu, de nouvelles autoroutes avaient été construites. Huit ans de national-socialisme avaient transformé un pays ruiné, écrasé par le traité de Versailles, en l'un des Etats européens les plus avancés.
Là-dessus, Evdokia Ivanovna baissa un peu la voix et nous conseilla d'un ton confidentiel de ne plus employer, étant donné nos rapports actuels avec notre puissant voisin, le terme de "fascistes", et de le remplacer par l'expression "les nationaux-socialistes allemands." Tandis qu'un bon clin d'oeil rusé laissait entendre que cette petite politesse nous rapportait de gros avantages dont les hitlériens, dans leur naïveté, ne se doutaient sans doute même pas.
... Ainsi s'écoula cette année, la plus tranquille peut-être que j'ai passée au camp. Sous le harnais d'un travail usant mais malgré tout supportable. Dans la touffeur puante de notre merveilleuse baraque 7. Dans l'angoisse chaque nuit renouvelée d'un transfert possible. Sous l'égide de ces deux puissances cardinales : l'Ourtch et la Kavétché.
Cependant, le temps précipitait son cours. Le mois de juin 1941 approchait. ... [...]
J'ai gardé un souvenir très net de l'un de ses cours, consacré à l'étude d'un rapport de Molotov (= membre du bureau politique du Parti et ami personnel de Staline ; il représentait celui-ci lors de la signature du fameux traité de non-agression réciproque entre l'Allemagne et l'URSS). Il y était question du rôle positif joué par le régime hitlérien dans le renforcement de l'économie allemande. Le chômage avait disparu, de nouvelles autoroutes avaient été construites. Huit ans de national-socialisme avaient transformé un pays ruiné, écrasé par le traité de Versailles, en l'un des Etats européens les plus avancés.
Là-dessus, Evdokia Ivanovna baissa un peu la voix et nous conseilla d'un ton confidentiel de ne plus employer, étant donné nos rapports actuels avec notre puissant voisin, le terme de "fascistes", et de le remplacer par l'expression "les nationaux-socialistes allemands." Tandis qu'un bon clin d'oeil rusé laissait entendre que cette petite politesse nous rapportait de gros avantages dont les hitlériens, dans leur naïveté, ne se doutaient sans doute même pas.
... Ainsi s'écoula cette année, la plus tranquille peut-être que j'ai passée au camp. Sous le harnais d'un travail usant mais malgré tout supportable. Dans la touffeur puante de notre merveilleuse baraque 7. Dans l'angoisse chaque nuit renouvelée d'un transfert possible. Sous l'égide de ces deux puissances cardinales : l'Ourtch et la Kavétché.
Cependant, le temps précipitait son cours. Le mois de juin 1941 approchait. ... [...]
[...] ... "Carcérales" ... Les affreuses bêtes qu'on appelle "carcérales" ... Nous traînerons avec nous cette définition, comme un poids écrasant, pendant près de dix ans. Nous sommes les plus méchantes des méchantes, les plus criminelles des criminelles, les plus malheureuses des malheureuses ; le comble du mal.
Nous ne nous rendîmes pas compte immédiatement de la gravité de notre situation. Ce n'est que plus tard que nous comprîmes que, si à Iaroslavl [en prison] nous étions toutes placées sur le même plan, ici, dans un nouveau cercle de notre descente, l'égalité n'existait pas : les déportés se trouvaient répartis en différentes catégories, suivant la fantaisie des bourreaux.
Pour la première fois, nous entendîmes parler des "artistes des moeurs." C'était l'aristocratie du camp : les détenus qui avaient commis des crimes dans leur service mais non des crimes politiques. Eux n'étaient pas des "ennemis du peuple", mais de simples dilapidateurs des deniers publics, concussionnaires et prévaricateurs. (Nous ne ferions connaissance des véritables détenus "de droit commun" que plus tard. Dans le camp de transit, il n'y en avait pas.)
Les "artistes des moeurs" étaient fiers de ne pas appartenir au groupe des "ennemis du peuple." Ils expiaient leurs fautes par un travail acharné. Certains postes exécutifs, dans le camp, étaient occupés par des détenus : c'était aux "artistes des moeurs" qu'on les confiait. La plupart des starostes, des chefs d'équipe, des chefs de groupe et des plantons se recrutaient parmi eux.
Ensuite venait la hiérarchie compliquée de "l'article 58" : les politiques. Le paragraphe 10 était le moins grave ; il s'appliquait aux "conteurs de blagues", aux "bavards", à ceux que la terminologie officielle qualifiait d'"agitateurs antisoviétiques." Les condamnés pour "activités contre-révolutionnaires" occupaient plus ou moins la même position : il s'agissait, pour la plupart, de sans-parti. On leur confiait un travail moins dur et, parfois ils pouvaient même occuper certains postes administratifs réservés aux déportés. Il en était rarement de même pour les déportés "soupçonnés d'espionnage." Jusqu'à notre arrivée, les pires criminels étaient les condamnés pour "activités contre-révolutionnaires trotskystes." On leur réservait les plus pénibles travaux, en plein air ; on ne les admettait pas aux "postes administratifs" ; et parfois, les jours de fête, on les mettait au cahot.
Notre arrivée leur rendit courage. ... [...]
Nous ne nous rendîmes pas compte immédiatement de la gravité de notre situation. Ce n'est que plus tard que nous comprîmes que, si à Iaroslavl [en prison] nous étions toutes placées sur le même plan, ici, dans un nouveau cercle de notre descente, l'égalité n'existait pas : les déportés se trouvaient répartis en différentes catégories, suivant la fantaisie des bourreaux.
Pour la première fois, nous entendîmes parler des "artistes des moeurs." C'était l'aristocratie du camp : les détenus qui avaient commis des crimes dans leur service mais non des crimes politiques. Eux n'étaient pas des "ennemis du peuple", mais de simples dilapidateurs des deniers publics, concussionnaires et prévaricateurs. (Nous ne ferions connaissance des véritables détenus "de droit commun" que plus tard. Dans le camp de transit, il n'y en avait pas.)
Les "artistes des moeurs" étaient fiers de ne pas appartenir au groupe des "ennemis du peuple." Ils expiaient leurs fautes par un travail acharné. Certains postes exécutifs, dans le camp, étaient occupés par des détenus : c'était aux "artistes des moeurs" qu'on les confiait. La plupart des starostes, des chefs d'équipe, des chefs de groupe et des plantons se recrutaient parmi eux.
Ensuite venait la hiérarchie compliquée de "l'article 58" : les politiques. Le paragraphe 10 était le moins grave ; il s'appliquait aux "conteurs de blagues", aux "bavards", à ceux que la terminologie officielle qualifiait d'"agitateurs antisoviétiques." Les condamnés pour "activités contre-révolutionnaires" occupaient plus ou moins la même position : il s'agissait, pour la plupart, de sans-parti. On leur confiait un travail moins dur et, parfois ils pouvaient même occuper certains postes administratifs réservés aux déportés. Il en était rarement de même pour les déportés "soupçonnés d'espionnage." Jusqu'à notre arrivée, les pires criminels étaient les condamnés pour "activités contre-révolutionnaires trotskystes." On leur réservait les plus pénibles travaux, en plein air ; on ne les admettait pas aux "postes administratifs" ; et parfois, les jours de fête, on les mettait au cahot.
Notre arrivée leur rendit courage. ... [...]
[...] ... Les maîtres de la morgue étaient des truands. Des apaches patentés. Ils trouvaient trop fatiguant de recoudre les corps après les autopsies et de creuser des tombes assez longues pour les contenir. Alors, ils vidaient les cadavres et les coupaient en morceaux pour les entasser ensuite dans un trou rond très peu profond situé derrière l'éminence où grimpaient les mélèzes.
Je rencontrai un matin ce cortège funéraire. C'était l'aube, et j'avais dû courir à la pharmacie plus tôt que de coutume. Trois truands tiraient de longs traîneaux iakoutes remplis de viande humaine dépecée. Des jambons gelés, bleuis, pointaient sans pudeur vers le ciel. Des bras coupés traînaient dans la neige. De temps en temps, des morceaux d'entrailles tombaient à terre. Les sacs prévus par le règlement pour l'ensevelissement des détenus étaient fort raisonnablement utilisés par les truands dépeceurs comme monnaie d'échange pour différentes opérations commerciales. J'avais donc devant les yeux dans toute sa nudité le rituel des enterrement à Belitchié.
Ce fut la première et unique fois de ma vie où j'eus quelque chose comme une crise d'hystérie. Je me rappelai l'expression HACHOIR A VIANDE souvent appliquée à nos camps de redressement par le travail. La vue des traîneaux iakoutes avec leur chargement substituait tout à coup au sens figuré une réalité matérielle à trois dimensions : les voici, les morceaux de viande humaine prêts à entrer dans le hachoir géant ! Avec horreur et stupéfaction, je m'entendis suffoquer de rire et sangloter tout haut. Puis je fus prise de vomissements incoercibles. Je ne sais plus comment je me traînai jusqu'à mon pavillon. ... [...]
Je rencontrai un matin ce cortège funéraire. C'était l'aube, et j'avais dû courir à la pharmacie plus tôt que de coutume. Trois truands tiraient de longs traîneaux iakoutes remplis de viande humaine dépecée. Des jambons gelés, bleuis, pointaient sans pudeur vers le ciel. Des bras coupés traînaient dans la neige. De temps en temps, des morceaux d'entrailles tombaient à terre. Les sacs prévus par le règlement pour l'ensevelissement des détenus étaient fort raisonnablement utilisés par les truands dépeceurs comme monnaie d'échange pour différentes opérations commerciales. J'avais donc devant les yeux dans toute sa nudité le rituel des enterrement à Belitchié.
Ce fut la première et unique fois de ma vie où j'eus quelque chose comme une crise d'hystérie. Je me rappelai l'expression HACHOIR A VIANDE souvent appliquée à nos camps de redressement par le travail. La vue des traîneaux iakoutes avec leur chargement substituait tout à coup au sens figuré une réalité matérielle à trois dimensions : les voici, les morceaux de viande humaine prêts à entrer dans le hachoir géant ! Avec horreur et stupéfaction, je m'entendis suffoquer de rire et sangloter tout haut. Puis je fus prise de vomissements incoercibles. Je ne sais plus comment je me traînai jusqu'à mon pavillon. ... [...]
Aux cabinets, nous avions l’occasion d’élargir un peu nos horizons en matière de nouvelles politiques. Le morceau de journal qu’on nous donnait comme papier hygiénique pouvait se révéler extrêmement intéressant. Le seul journal permis en prison était « L’ouvrier du Nord », le quotidien de Iaroslav. Aux cabinets, il n’était pas rare de tomber sur des morceaux de la « Pravda » ou des « Izvestia ». Nous lisions attentivement ces articles, en tirant toute une série de déductions de phrases les plus souvent incomplètes. (chapitre « Jour après jour, mois après mois », page 257 dans la collection Points).
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Evguénia Guinzbourg (2)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les écrivains et le suicide
En 1941, cette immense écrivaine, pensant devenir folle, va se jeter dans une rivière les poches pleine de pierres. Avant de mourir, elle écrit à son mari une lettre où elle dit prendre la meilleure décision qui soit.
Virginia Woolf
Marguerite Duras
Sylvia Plath
Victoria Ocampo
8 questions
1726 lecteurs ont répondu
Thèmes :
suicide
, biographie
, littératureCréer un quiz sur ce livre1726 lecteurs ont répondu