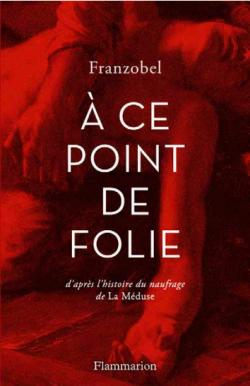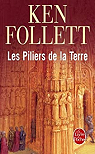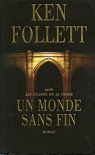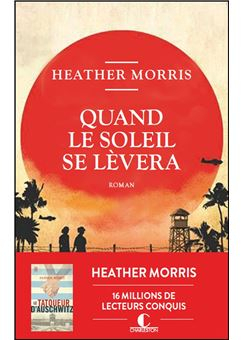Franzobel
Olivier Mannoni (Traducteur)/5 74 notes
Olivier Mannoni (Traducteur)/5 74 notes
Résumé :
Le 17 juin 1816, la frégate La Méduse quitte Rochefort à destination de Saint-Louis, au Sénégal. À son bord, quelques 400 passagers formant comme une petite France – bourgeois, militaires, négociants, un équipage nombreux. Au commandement, un capitaine dont l’incompétence avérée sera à l’origine du naufrage. Les chaloupes étant en trop petit nombre, 150 passagers sont abandonnés sur un radeau. Seuls 15 seront sauvés, après treize journées d’enfer, jalonnées de meurt... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après À ce point de folieVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (27)
Voir plus
Ajouter une critique
Le fait divers est passé à la postérité grâce à l'immense toile (sept mètres sur cinq !) de Géricault exposée en bonne place au Louvre. En juillet 1816, la frégate La Méduse en route vers Saint-Louis-du-Sénégal s'échoue sur le banc d'Arguin. Les canots de sauvetage ne sont pas assez nombreux pour embarquer tous les passagers. Cent cinquante d'entre eux s'entassent sur un radeau de fortune. Tandis que le commandant Chaumareys et le gouverneur Schmaltz parviennent sains et saufs à Saint-Louis, le radeau dérive en haute mer sous un soleil de plomb. Treize jours plus tard, lorsqu'il lui est enfin porté secours, le radeau ne compte plus que quinze survivants à son bord.
C'est bizarrement un romancier autrichien qui vient revisiter cet épisode célèbre. Il le fait avec un panache qui n'a rien à envier à celui de nos plumes les plus éloquentes, en plus de cinq-cents pages qui se dévorent avec gourmandise. Franzobel est quasiment inconnu en France où un seul de ses livres avait été traduit avant celui-ci. On le suspecterait presque d'avoir pris à l'exercice trop de plaisir, devenant expert en navigation à voile et lestant sa prose de termes techniques qui en obscurcissent parfois la lecture pour qui n'a pas passé ses vacances d'été depuis l'enfance aux Glénans.
Franzobel ne résiste pas au plaisir de nous amener à bord et de nous y faire découvrir les participants de cette funeste odyssée dont on connait par avance le dramatique dénouement. L'inexpérience du capitaine, un royaliste qui n'avait jamais commandé à la mer, l'hostilité de ses seconds, bonapartistes enragés, la fatuité du gouverneur Schmaltz et de son épouse, tout semble conspirait à l'inéluctable échouement du 2 juillet.
L'auteur nous fait toucher du doigt combien l'autorité, lorsqu'elle est mal exercée peut transformer des avanies en drames. Si La Méduse avait été mieux commandée, elle ne serait pas échouée. Quand bien même elle se serait échouée, un capitaine expérimenté aurait réussi à la dégager. Il n'aurait pas pris la décision de construire un radeau trop lourd et impossible à gouverner. Et, surtout, il n'aurait jamais pris la poudre d'escampette en abandonnant ledit radeau et ses passagers à une mort certaine.
Bien sûr, on ne s'ennuie pas en compagnie de cette troupe bigarrée. Au point d'ailleurs de passer un peu trop de temps avec elle - presque la moitié du livre - avant que les choses sérieuses commencent sur le banc d'Arguin. On aurait aimé en passer un peu plus sur le radeau proprement dit et comprendre comment des naufragés désespérés en viennent à décider de se nourrir de chair humaine. C'était là le coeur du sujet - si l'on ose dire - qui explique le retentissement et la postérité du naufrage de la Méduse.
On aurait aimé également suivre les rescapés après leur sauvetage, devant la cour martiale qui se réunit à Rochefort en janvier 1817 pour juger Chaumareys. Las ! le procès est expédié en quelques pages trop courtes. Dommage...
C'est bizarrement un romancier autrichien qui vient revisiter cet épisode célèbre. Il le fait avec un panache qui n'a rien à envier à celui de nos plumes les plus éloquentes, en plus de cinq-cents pages qui se dévorent avec gourmandise. Franzobel est quasiment inconnu en France où un seul de ses livres avait été traduit avant celui-ci. On le suspecterait presque d'avoir pris à l'exercice trop de plaisir, devenant expert en navigation à voile et lestant sa prose de termes techniques qui en obscurcissent parfois la lecture pour qui n'a pas passé ses vacances d'été depuis l'enfance aux Glénans.
Franzobel ne résiste pas au plaisir de nous amener à bord et de nous y faire découvrir les participants de cette funeste odyssée dont on connait par avance le dramatique dénouement. L'inexpérience du capitaine, un royaliste qui n'avait jamais commandé à la mer, l'hostilité de ses seconds, bonapartistes enragés, la fatuité du gouverneur Schmaltz et de son épouse, tout semble conspirait à l'inéluctable échouement du 2 juillet.
L'auteur nous fait toucher du doigt combien l'autorité, lorsqu'elle est mal exercée peut transformer des avanies en drames. Si La Méduse avait été mieux commandée, elle ne serait pas échouée. Quand bien même elle se serait échouée, un capitaine expérimenté aurait réussi à la dégager. Il n'aurait pas pris la décision de construire un radeau trop lourd et impossible à gouverner. Et, surtout, il n'aurait jamais pris la poudre d'escampette en abandonnant ledit radeau et ses passagers à une mort certaine.
Bien sûr, on ne s'ennuie pas en compagnie de cette troupe bigarrée. Au point d'ailleurs de passer un peu trop de temps avec elle - presque la moitié du livre - avant que les choses sérieuses commencent sur le banc d'Arguin. On aurait aimé en passer un peu plus sur le radeau proprement dit et comprendre comment des naufragés désespérés en viennent à décider de se nourrir de chair humaine. C'était là le coeur du sujet - si l'on ose dire - qui explique le retentissement et la postérité du naufrage de la Méduse.
On aurait aimé également suivre les rescapés après leur sauvetage, devant la cour martiale qui se réunit à Rochefort en janvier 1817 pour juger Chaumareys. Las ! le procès est expédié en quelques pages trop courtes. Dommage...
Titre original : ?
Titre français : A Ce Point de Folie - D'après l'Histoire du Naufrage de la Méduse
Traduction : Olivier Mannoni
ISBN : 9782081429406
Commencé sans grand empressement en raison de certains troubles de santé actuels, ce roman m'a littéralement aspirée par sa densité et son naturel. L'auteur précise qu'il ne s'agit pas d'une biographie mais d'une biographie romancée. Comme Géricault dans son inoubliable toile - plus même que le peintre puisque celui-ci se borne (et c'est largement suffisant) à nous dresser le portrait des malheureux qui périrent sur le radeau de la Méduse - Franzobel s'attache a brosser le portrait de chacun de ses héros (ou contre-héros ?) En cette dimension où une normalité déjà bien cruelle va se heurter de plein fouet à un instinct de conservation déchaîné, peut-on parler de héros ou de contre-héros ?
De lâches, en tout cas, on peut. A la courte paille, (dommage, ceux-là, on ne les mangera pas mais, d'un autre côté, ne risquions-nous pas l'empoisonnement ? ) nous tirons le capitaine de frégate Hugues Duroy de Chaumareys, quadragénaire qui a préféré émigrer pendant la Révolution et courir les tailleurs londoniens plutôt que de se battre jusqu'au bout, aux côtés d'un La Rochejaquelein par exemple, rentrer ensuite en France et y réintégrer l'administration des Douanes avant de se dire que, puisqu'un tel de ses aïeux avait fait une belle carrière dans la Royale, il se devait de suivre son exemple. Et son "ami d'enfance" - dont Chaumareys se demandera à un certain moment s'il l'a réellement connu durant l'enfance - Antoine Richeford.
Ce sont eux - le premier fut d'ailleurs condamné dans les formes par Louis XVIII - qui sont et resteront dans L Histoire les responsables, par leur incompétence, du naufrage de la Méduse, puissante frégate qui, entouré du brick L'Argus, de la corvette L'Echo et de la flûte La Loire, est chargé de rejoindre les comptoirs du Sénégal. Nous sommes en juillet 1816. Nous l'avons dit, La Méduse est un vaisseau puissant qui, bien que son capitaine n'ait plus navigué depuis l'Ancien Régime, distance assez vite les autres bâtiments. Chaumareys, royaliste à tout crin, de ceux qui n'ont "rien appris, ni rien oublié", est pompeux, arrogant et vous case des latinismes à chaque phrase. Il boit aussi, moins sans doute que son ami Richeford, mais surtout, au fond de lui, il doute de lui-même. Snob et plein de morgue, croyant que tout se règle par le nom et l'argent, au lieu de s'appuyer sur un solide trio de premiers officiers, lesquels ont à ses yeux le tort d'avoir servi Bonaparte, il en arrive à céder une bonne part de son autorité à ... Richeford, lequel se pare aussitôt du tricorne de capitaine et va accumuler erreur sur erreur.
A partir de là, si l'on fait abstraction de la façon très dure, voire impitoyable dont étaient traités les marins de l'époque, en France comme en Grande-Bretagne, et des hostilités qui, peu à peu, commencent à apparaître entre les membres des équipages et les passagers (La Méduse a, songez donc, l'honneur de transporter à Saint-Louis le futur Gouverneur des Colonies, accompagné de sa mégère d'épouse et d'une fille atteinte d'un angiome mais qui fera une "belle fin" en épousant l'un des premiers officiers bonapartistes), l'Absurdité, mais une absurdité meurtrière, et l'horreur s'installent à bord.
Incontestablement, Franzobel a du souffle, une bonne dose d'humour, noir ou pas, et la passion nécessaire au sujet on ne peut plus délicat qu'il traite. Ce sujet, ce n'est ni plus ni moins que l'abandon volontaire des plus misérables du lot sur un radeau, le fameux "Radeau de la Méduse", tout cela non par méchanceté d'ailleurs ou par mépris social : simplement parce que l'architecte du navire n'avait pas calculé le nombre exact de canots de sauvetage nécessaires ! Si le naufrage de la Méduse, était inévitable parce que Chaumareys a préféré se rendre aux "avis bacchiques" de Richeford, lequel ne connaissait rien à la Marine, que suivre les conseils éclairés de ses officiers, la tragédie des canots de sauvetage d'abord, puis celle du radeau en devenaient quasi obligatoires. Certes, à peu de choses près, les canots de sauvetage arriveront à St Louis avec le nombre de passagers qu'ils transportaient au départ. Mais, sur les cent quarante-sept laissés pour compte du radeau, seuls cinq survivront dont la majorité s'abîmera ensuite dans la Mort ou dans la folie. A deux exceptions près, le jeune Victor, qui avait voulu voir du pays, mais qui sera tout heureux, après l'horrible expérience de la Méduse, de rentrer dans des foyers confortables. Et le docteur Jean-Baptiste-Marie Savigny, second médecin sur La Méduse, personnage parfois très ambigu avec son obsession d'anatomiste, mais qui aura au moins le courage, revenu à terre, de rédiger une brochure sur les sinistres vérités du naufrage de la Méduse et les atrocités accomplies sur le radeau. Menacé de toutes parts, il maintiendra ses dires, brisera sa carrière dans la marine mais c'est grâce à lui qu'un certain Théodore Géricault aura vent de l'affaire et imaginera son inoubliable toile - laquelle n'eut pas l'heur de plaire à Louis XVIII. Peu importe, puisqu'elle figurera un jour en bonne place, auprès du Sacre de Napoléon Ier de David.
Signalons que, dès le début, la sinistre silhouette du maître-coq, Gaines, qui poursuit le jeune Victor de sa brutalité et de sa concupiscence, pourra apparaître comme la personnification du Mal à l'état pur, infiltré bien sûr sur le radeau où la Mort, une mort horrible, l'attend avec patience et probablement un profond dégoût. On peut y voir un "double", moins grossier et assurément méphistophélique, dans le personnage de Griffon.
Que dire de plus ? Sinon : lisez "A Ce Point de Folie" de Franzobel, auteur autrichien controversé, dit-on - on peut comprendre pourquoi - mais qui, comme Savigny, a au moins le mérite d'aller jusqu'au bout de ses convictions d'écrivain. Et aller au bout de ses convictions, ce n'est pas toujours facile, surtout avec un sujet tel que celui de la Méduse qui vous écrase brutalement la question en pleine figure :
- "Et vous, mes bons amis ? Pendant ces treize jours sur le radeau, sans aucun espoir, sans eau, sans nourriture, avec le soleil au-dessus de vous et les requins autour ... qu'eussiez-vous fait ?" ;o)
Titre français : A Ce Point de Folie - D'après l'Histoire du Naufrage de la Méduse
Traduction : Olivier Mannoni
ISBN : 9782081429406
Commencé sans grand empressement en raison de certains troubles de santé actuels, ce roman m'a littéralement aspirée par sa densité et son naturel. L'auteur précise qu'il ne s'agit pas d'une biographie mais d'une biographie romancée. Comme Géricault dans son inoubliable toile - plus même que le peintre puisque celui-ci se borne (et c'est largement suffisant) à nous dresser le portrait des malheureux qui périrent sur le radeau de la Méduse - Franzobel s'attache a brosser le portrait de chacun de ses héros (ou contre-héros ?) En cette dimension où une normalité déjà bien cruelle va se heurter de plein fouet à un instinct de conservation déchaîné, peut-on parler de héros ou de contre-héros ?
De lâches, en tout cas, on peut. A la courte paille, (dommage, ceux-là, on ne les mangera pas mais, d'un autre côté, ne risquions-nous pas l'empoisonnement ? ) nous tirons le capitaine de frégate Hugues Duroy de Chaumareys, quadragénaire qui a préféré émigrer pendant la Révolution et courir les tailleurs londoniens plutôt que de se battre jusqu'au bout, aux côtés d'un La Rochejaquelein par exemple, rentrer ensuite en France et y réintégrer l'administration des Douanes avant de se dire que, puisqu'un tel de ses aïeux avait fait une belle carrière dans la Royale, il se devait de suivre son exemple. Et son "ami d'enfance" - dont Chaumareys se demandera à un certain moment s'il l'a réellement connu durant l'enfance - Antoine Richeford.
Ce sont eux - le premier fut d'ailleurs condamné dans les formes par Louis XVIII - qui sont et resteront dans L Histoire les responsables, par leur incompétence, du naufrage de la Méduse, puissante frégate qui, entouré du brick L'Argus, de la corvette L'Echo et de la flûte La Loire, est chargé de rejoindre les comptoirs du Sénégal. Nous sommes en juillet 1816. Nous l'avons dit, La Méduse est un vaisseau puissant qui, bien que son capitaine n'ait plus navigué depuis l'Ancien Régime, distance assez vite les autres bâtiments. Chaumareys, royaliste à tout crin, de ceux qui n'ont "rien appris, ni rien oublié", est pompeux, arrogant et vous case des latinismes à chaque phrase. Il boit aussi, moins sans doute que son ami Richeford, mais surtout, au fond de lui, il doute de lui-même. Snob et plein de morgue, croyant que tout se règle par le nom et l'argent, au lieu de s'appuyer sur un solide trio de premiers officiers, lesquels ont à ses yeux le tort d'avoir servi Bonaparte, il en arrive à céder une bonne part de son autorité à ... Richeford, lequel se pare aussitôt du tricorne de capitaine et va accumuler erreur sur erreur.
A partir de là, si l'on fait abstraction de la façon très dure, voire impitoyable dont étaient traités les marins de l'époque, en France comme en Grande-Bretagne, et des hostilités qui, peu à peu, commencent à apparaître entre les membres des équipages et les passagers (La Méduse a, songez donc, l'honneur de transporter à Saint-Louis le futur Gouverneur des Colonies, accompagné de sa mégère d'épouse et d'une fille atteinte d'un angiome mais qui fera une "belle fin" en épousant l'un des premiers officiers bonapartistes), l'Absurdité, mais une absurdité meurtrière, et l'horreur s'installent à bord.
Incontestablement, Franzobel a du souffle, une bonne dose d'humour, noir ou pas, et la passion nécessaire au sujet on ne peut plus délicat qu'il traite. Ce sujet, ce n'est ni plus ni moins que l'abandon volontaire des plus misérables du lot sur un radeau, le fameux "Radeau de la Méduse", tout cela non par méchanceté d'ailleurs ou par mépris social : simplement parce que l'architecte du navire n'avait pas calculé le nombre exact de canots de sauvetage nécessaires ! Si le naufrage de la Méduse, était inévitable parce que Chaumareys a préféré se rendre aux "avis bacchiques" de Richeford, lequel ne connaissait rien à la Marine, que suivre les conseils éclairés de ses officiers, la tragédie des canots de sauvetage d'abord, puis celle du radeau en devenaient quasi obligatoires. Certes, à peu de choses près, les canots de sauvetage arriveront à St Louis avec le nombre de passagers qu'ils transportaient au départ. Mais, sur les cent quarante-sept laissés pour compte du radeau, seuls cinq survivront dont la majorité s'abîmera ensuite dans la Mort ou dans la folie. A deux exceptions près, le jeune Victor, qui avait voulu voir du pays, mais qui sera tout heureux, après l'horrible expérience de la Méduse, de rentrer dans des foyers confortables. Et le docteur Jean-Baptiste-Marie Savigny, second médecin sur La Méduse, personnage parfois très ambigu avec son obsession d'anatomiste, mais qui aura au moins le courage, revenu à terre, de rédiger une brochure sur les sinistres vérités du naufrage de la Méduse et les atrocités accomplies sur le radeau. Menacé de toutes parts, il maintiendra ses dires, brisera sa carrière dans la marine mais c'est grâce à lui qu'un certain Théodore Géricault aura vent de l'affaire et imaginera son inoubliable toile - laquelle n'eut pas l'heur de plaire à Louis XVIII. Peu importe, puisqu'elle figurera un jour en bonne place, auprès du Sacre de Napoléon Ier de David.
Signalons que, dès le début, la sinistre silhouette du maître-coq, Gaines, qui poursuit le jeune Victor de sa brutalité et de sa concupiscence, pourra apparaître comme la personnification du Mal à l'état pur, infiltré bien sûr sur le radeau où la Mort, une mort horrible, l'attend avec patience et probablement un profond dégoût. On peut y voir un "double", moins grossier et assurément méphistophélique, dans le personnage de Griffon.
Que dire de plus ? Sinon : lisez "A Ce Point de Folie" de Franzobel, auteur autrichien controversé, dit-on - on peut comprendre pourquoi - mais qui, comme Savigny, a au moins le mérite d'aller jusqu'au bout de ses convictions d'écrivain. Et aller au bout de ses convictions, ce n'est pas toujours facile, surtout avec un sujet tel que celui de la Méduse qui vous écrase brutalement la question en pleine figure :
- "Et vous, mes bons amis ? Pendant ces treize jours sur le radeau, sans aucun espoir, sans eau, sans nourriture, avec le soleil au-dessus de vous et les requins autour ... qu'eussiez-vous fait ?" ;o)
«Le Radeau de la Méduse », immense toile de Théodore Géricault inspirée par un drame de l'actualité, ne peut manquer d'influencer toute notre lecture de Franzobel. L'ancien régime a volé en éclats avec ses têtes et ses valeurs. La légende napoléonienne a disloqué l'Europe, enfiévré les esprits. La chute du dernier conquérant épique désespère les énergies, déchire les rêves de gloire, exacerbe les antagonismes. En ce début de siècle, les plus intrépides s'embarquent pour des contrées exotiques comme l'Afrique. Les artistes cherchent en eux des motifs d'exaltation ou de simples raisons de vivre. La peinture romantique de la Méduse instaure un espace romanesque où se déploie la tempête des sentiments, le tableau semble se construire sur une dynamique émotive chargée de discipliner la violence illimitée des mouvements internes. L'artiste n'a placé qu'une mince bande d'un ciel tourmenté de nuages en accord avec la sinistre mêlée des anatomies. Là des corps s'accumulent en deux pyramides humaines : renoncement, avachissement et mort au fond de l'embarcation, élancement et espoir de salut à sa tête.
Il aurait fallu sans doute de la démesure et bien d'autres moyens littéraires pour reprendre ce flambeau là et tenter de peindre, d'actualiser l'enchevêtrement des destins, des conditions, des aspirations. La bien trop prudente tentative de Franzobel n'est pas sans intérêt mais elle semble manquer irrémédiablement sa cible. Certes, on lira sans déplaisir un roman de mer de plus et on découvrira les détails sordides de l'histoire d'un vrai naufrage et d'un authentique tableau. Dans ces pages, il ne manque pas une voile, pas un cordage à la Méduse en partance pour le Sénégal ; l'accastillage est au complet et les termes de marine dépaysants ; les matelots sont dans les haubans et les officiers président à d'obscures manoeuvres. Sous le vent, les personnages historiques se mêlent aux personnages de fiction, ils se meuvent malheureusement dans un monde simpliste, un monde en bonnes et bien épaisses tranches napolitaines. le pouvoir est aux royalistes sur le pont, au très incompétent et très faible commandant Hugues Duroy de Chaumareys, à son fabulateur ami Richeford, au très suffisant gouverneur Julien-Désiré Schaltz, au commandant du contingent Paulin Etienne d'Anglas de Praviel. La compétence aux ordres est aux mains des bourgeois républicains et bonapartistes du navire, aux officiers tels que Reynaud le second, Savigny le savant médecin de bord ; aux experts tels que Corrérard l'ironique ingénieur, Griffon le froid administrateur ; aux commerçants Picard et consorts. La plèbe des matelots, des mousses et des militaires du rang enfin, semble dans la cale n'écouter que ses délétères pulsions qu'il conviendrait urgemment d'endiguer. Heureusement, il y a quelques goûteux raisins de Corinthe dans cette dernière tranche, de rares raisins sans lesquels la petite cuillère nous resterait dans la bouche et le livre nous tomberait irrémédiablement des mains. Victor, le mousse fugueur, martyrisé par le chef cuisinier Gaines et son aide Clutterbucket, protégé par le matelot Osée Thomas, particularise et humanise un peu le récit.
Franzobel introduit lourdement de nombreux anachronismes dans son roman (rayons UV, cancer de la peau, changement climatique, contrôle de sécurité, syndicats, travail d'enfant, etc.). Il semble craindre que des liens ne s'établissent pas avec l'histoire présente. L'anomie qui découle du manque de régulation de la société sur l'individu, c'est entendu, est le sujet de ce livre, la préoccupation centrale de l'auteur. le recul des valeurs sur la Méduse, puis s'accélérant sur le radeau, conduit à la diminution et à la destruction de l'ordre social : les lois et les règles ne peuvent plus garantir la régulation sociale et l'impensable implacablement surgit. Rien là, qu'après Emile Durkheim, nous ne sachions déjà. « La politique est la grande génératrice et la littérature la grande particularisatrice, et elles sont dans une relation non seulement d'inversion mais aussi d'antagonisme… Quand on généralise la souffrance, on a le communisme. Quand on particularise la souffrance, on a la littérature. » Nous attendions, comme le suggère Philip Roth, que Franzobel dise autre chose, dise d'avantage et différemment que la sociologie. Sur le navire les violences sont coutumières, omniprésentes. C'est la brutalité des supérieurs sur les subalternes d'une société de punition et la flagellation jusqu'à la mort du matelot Prust ; c'est la supériorité du fort sur le faible et le supplice de Victor dans la cambuse ; c'est l'optimisation des chances de survie et le sacrifice des malades sur le radeau ; c'est enfin la condamnation pour vol de nourriture d'une microsociété de surveillance et le meurtre perpétué sur deux jeunes ouvriers … La philosophie à la petite semaine sur la soi-disant nature humaine, la misanthropie latente et le regard surplombant du narrateur semblent dominer ce récit et servir d'explication. Cela nous parait grandement insuffisant. Nous aurions aimé pénétrer d'avantage les personnages, saisir de l'intérieur leurs revirements incessants, leurs passages de la soumission à la révolte ; comprendre leurs acceptations successives de la punition, puis de la surveillance, puis du calcul utilitaire. Nous aurions aimé sonder les coeurs, les reins, les têtes de ces anti-héros ordinaires, comprendre les failles, les déchirures et les indicibles peurs à l'oeuvre dans ce drame. Ce roman de l'anomie en pleine mer sans aucun doute reste à écrire.
Il aurait fallu sans doute de la démesure et bien d'autres moyens littéraires pour reprendre ce flambeau là et tenter de peindre, d'actualiser l'enchevêtrement des destins, des conditions, des aspirations. La bien trop prudente tentative de Franzobel n'est pas sans intérêt mais elle semble manquer irrémédiablement sa cible. Certes, on lira sans déplaisir un roman de mer de plus et on découvrira les détails sordides de l'histoire d'un vrai naufrage et d'un authentique tableau. Dans ces pages, il ne manque pas une voile, pas un cordage à la Méduse en partance pour le Sénégal ; l'accastillage est au complet et les termes de marine dépaysants ; les matelots sont dans les haubans et les officiers président à d'obscures manoeuvres. Sous le vent, les personnages historiques se mêlent aux personnages de fiction, ils se meuvent malheureusement dans un monde simpliste, un monde en bonnes et bien épaisses tranches napolitaines. le pouvoir est aux royalistes sur le pont, au très incompétent et très faible commandant Hugues Duroy de Chaumareys, à son fabulateur ami Richeford, au très suffisant gouverneur Julien-Désiré Schaltz, au commandant du contingent Paulin Etienne d'Anglas de Praviel. La compétence aux ordres est aux mains des bourgeois républicains et bonapartistes du navire, aux officiers tels que Reynaud le second, Savigny le savant médecin de bord ; aux experts tels que Corrérard l'ironique ingénieur, Griffon le froid administrateur ; aux commerçants Picard et consorts. La plèbe des matelots, des mousses et des militaires du rang enfin, semble dans la cale n'écouter que ses délétères pulsions qu'il conviendrait urgemment d'endiguer. Heureusement, il y a quelques goûteux raisins de Corinthe dans cette dernière tranche, de rares raisins sans lesquels la petite cuillère nous resterait dans la bouche et le livre nous tomberait irrémédiablement des mains. Victor, le mousse fugueur, martyrisé par le chef cuisinier Gaines et son aide Clutterbucket, protégé par le matelot Osée Thomas, particularise et humanise un peu le récit.
Franzobel introduit lourdement de nombreux anachronismes dans son roman (rayons UV, cancer de la peau, changement climatique, contrôle de sécurité, syndicats, travail d'enfant, etc.). Il semble craindre que des liens ne s'établissent pas avec l'histoire présente. L'anomie qui découle du manque de régulation de la société sur l'individu, c'est entendu, est le sujet de ce livre, la préoccupation centrale de l'auteur. le recul des valeurs sur la Méduse, puis s'accélérant sur le radeau, conduit à la diminution et à la destruction de l'ordre social : les lois et les règles ne peuvent plus garantir la régulation sociale et l'impensable implacablement surgit. Rien là, qu'après Emile Durkheim, nous ne sachions déjà. « La politique est la grande génératrice et la littérature la grande particularisatrice, et elles sont dans une relation non seulement d'inversion mais aussi d'antagonisme… Quand on généralise la souffrance, on a le communisme. Quand on particularise la souffrance, on a la littérature. » Nous attendions, comme le suggère Philip Roth, que Franzobel dise autre chose, dise d'avantage et différemment que la sociologie. Sur le navire les violences sont coutumières, omniprésentes. C'est la brutalité des supérieurs sur les subalternes d'une société de punition et la flagellation jusqu'à la mort du matelot Prust ; c'est la supériorité du fort sur le faible et le supplice de Victor dans la cambuse ; c'est l'optimisation des chances de survie et le sacrifice des malades sur le radeau ; c'est enfin la condamnation pour vol de nourriture d'une microsociété de surveillance et le meurtre perpétué sur deux jeunes ouvriers … La philosophie à la petite semaine sur la soi-disant nature humaine, la misanthropie latente et le regard surplombant du narrateur semblent dominer ce récit et servir d'explication. Cela nous parait grandement insuffisant. Nous aurions aimé pénétrer d'avantage les personnages, saisir de l'intérieur leurs revirements incessants, leurs passages de la soumission à la révolte ; comprendre leurs acceptations successives de la punition, puis de la surveillance, puis du calcul utilitaire. Nous aurions aimé sonder les coeurs, les reins, les têtes de ces anti-héros ordinaires, comprendre les failles, les déchirures et les indicibles peurs à l'oeuvre dans ce drame. Ce roman de l'anomie en pleine mer sans aucun doute reste à écrire.
Suite au partenariat avec Babelio, je les remercie ainsi que la maison d'édition Flammarion pour la lecture de ce roman.
Qui n'a jamais entendu parler du radeau de la méduse ? Un lointain souvenir ou au contraire une vérité qui fait mal d'imaginer ce qui a pu se produire. le 18 juillet 1816, l'Argus trouve une embarcation bancale avec à son bord des survivants du naufrage de ce navire : la Méduse. une quinzaine d'hommes et de femmes, enfin qui y ressemblaient bien avant d'être découvert. Les conditions ont été terribles durant les treize jours entre le naufrage et leur retour à la civilisation. Si certains ont réussi à s'en sortir, non sans avoir perdu un peu de leur esprit, d'autres n'ont pas survécu malgré les soins reçus. Nous suivons Savigny, médecin de bord et Osée, matelot durant quelques temps après leur retour en France. Puis le retour sur le navire, au moment du départ. Ce moment où tous les passagers, matelots, hommes d'armée partent pour trois semaines de voyage vers le Sénégal. Ce moment où personne ne prend conscience que ce lieu est dangereux, autant parce que les mousses risquent gros, mais surtout avec la mer qui peut se déchainer à n'importe quel moment.
Bien entendu ce livre n'est pas le récit typique de ce qui est arrivé, mais de ce qui aurait pu se produire à bord. À cette époque, au temps des rois, chacun doit rester à sa place. Pourtant, sur ce navire, les grades ne restent pas forcément en l'état. La bourgeoisie n'est pas isolée comme elle le voudrait, je pense à la famille Picard, par exemple. Victor, celui dont Osée ne cesse de dire son prénom depuis son retour sur la terre ferme, nous le suivons. Ce petit devient un souffre-douleur, pourtant il arrive à s'en sortir de situations plutôt dramatique. Tentatives de viols, tentatives de pertes de peau par la cuisinière chauffée... Et puis il y a cette vie sur ce rafiot, La Méduse continue son bonhomme de chemin, emportant avec elle les passagers qui ne voient rien. Les tracas sont les mêmes qu'à terre, mais en ayant moins de place, moins d'intimité. Les relations sont exacerbées, les besoins deviennent terre à terre. Les rancoeurs sont tenaces, la vie devient plus difficile. Et c'est là que tout prend l'eau. Les trous se forment, les seaux arrivent mais c'est trop tard.
L'histoire de ce navire qui s'est perdu en route, c'est le récit de bon nombre de passagers qui ont tenté de survivre à des éléments indépendant de leur volonté, mais pas uniquement. Les désaccords se suivent tant que les personnages sont ensemble. La rancune est tenace et les esprits vont commencer à sombrer. Essayer de ne pas s'attacher à eux est difficile, ne pas les haïr ou ne pas les adorer devient un problème. L'auteur donne assez de détails sur chacun pour imaginer sa vie avant de mettre un pied sur La Méduse, jusqu'à ce qu'il remette le pied sur terre, s'il survit. Car c'est bien le hic, sur le nombre impressionnant, on se retrouve dans la même position que le Titanic. Trop de monde, pas assez d'embarcations en cas de naufrage, un bateau qui se fracasse au pire moment. Qui doit vivre ? Qui doit mourir ? Les éléments se déchainent, les requins font leur apparition.
Les personnages sont nombreux. Nous les suivons, découvrant le pourquoi ils sont sur ce navire. Arétéé Schmaltz, fille du gouverneur qui recherche un médecin pouvant effacer la tache de vin qui lui couvre la moitié du visage. Victor qui fuit, Osée qui aime cette vie depuis ces 6 ans, la Reine qui se veut tout puissante, et tous les autres qu'on a envie soit de torturer, soit de les protéger. Rien n'est simple. Ceux qui meurent se demandent pourquoi eux non pas pu être sur un rafiot. Ceux qui y sont se demandent comment survivre sans nourriture, avec de simples tonneaux de vins. L'esprit humain est complexe. Vouloir survivre pour retrouver ses proches, ses amis, sa famille, oui, mais à quel prix ? Qui serait capable de continuer en devenant autre chose qu'un être humain ? L'animal en nous semble prendre vie et nous faire oublier qui nous sommes : des gens civilisés. La plupart du temps.
C'est un conflit permanent entre ce que l'on veut et ce que l'on doit faire. Les personnages ne cessent de retrouver un peu de lucidité, mais, car il y a un mais, initialement certains ne sont pas "corrects". Ils préfèrent s'amuser aux dépends des autres. Il est question de Bonaparte également qui pourrait peut-être aider, à moins que le fait d'écrire ce qui s'est produit ne dérange ? L'humour souvent noir de l'auteur est parfait à mes yeux. C'est ce type d'humour que je préfère, plus dans le sombre, le glauque qui fait rire, pour éviter de s'apitoyer sur le sort de ses hommes et femmes qui vont y passer, autant le dire. Un naufrage à cette époque, des personnages qui ne sont pas tous d'accord, forcément il va y avoir des moments où il faut trancher dans le vif !
En conclusion, c'est un récit qui permet de nous poser des questions. La principale étant de savoir si nous aurions agit de la même façon que certains. Survivre dans de telles conditions, aurions-nous laissé la faim nous envahir ou la folie prendre le pas sur notre corps ? Sacrifice, amitié, dénigrement, les mutineries si infimes quelles soient auraient pu être le bon déclencheur pour tous les sauver. Aller jusqu'au fond des choses comme le doc, fouiner dans les cerveaux, dans les entrailles, ça il sait le faire. Un dernier point, on sait enfin ce qui est arrivé à ce fameux Victor, c'est un soulagement de savoir s'il a survécu ou non a cette folle épopée.
http://chroniqueslivresques.eklablog.com/a-ce-point-de-folie-franzobel-a148464850
Lien : http://chroniqueslivresques...
Qui n'a jamais entendu parler du radeau de la méduse ? Un lointain souvenir ou au contraire une vérité qui fait mal d'imaginer ce qui a pu se produire. le 18 juillet 1816, l'Argus trouve une embarcation bancale avec à son bord des survivants du naufrage de ce navire : la Méduse. une quinzaine d'hommes et de femmes, enfin qui y ressemblaient bien avant d'être découvert. Les conditions ont été terribles durant les treize jours entre le naufrage et leur retour à la civilisation. Si certains ont réussi à s'en sortir, non sans avoir perdu un peu de leur esprit, d'autres n'ont pas survécu malgré les soins reçus. Nous suivons Savigny, médecin de bord et Osée, matelot durant quelques temps après leur retour en France. Puis le retour sur le navire, au moment du départ. Ce moment où tous les passagers, matelots, hommes d'armée partent pour trois semaines de voyage vers le Sénégal. Ce moment où personne ne prend conscience que ce lieu est dangereux, autant parce que les mousses risquent gros, mais surtout avec la mer qui peut se déchainer à n'importe quel moment.
Bien entendu ce livre n'est pas le récit typique de ce qui est arrivé, mais de ce qui aurait pu se produire à bord. À cette époque, au temps des rois, chacun doit rester à sa place. Pourtant, sur ce navire, les grades ne restent pas forcément en l'état. La bourgeoisie n'est pas isolée comme elle le voudrait, je pense à la famille Picard, par exemple. Victor, celui dont Osée ne cesse de dire son prénom depuis son retour sur la terre ferme, nous le suivons. Ce petit devient un souffre-douleur, pourtant il arrive à s'en sortir de situations plutôt dramatique. Tentatives de viols, tentatives de pertes de peau par la cuisinière chauffée... Et puis il y a cette vie sur ce rafiot, La Méduse continue son bonhomme de chemin, emportant avec elle les passagers qui ne voient rien. Les tracas sont les mêmes qu'à terre, mais en ayant moins de place, moins d'intimité. Les relations sont exacerbées, les besoins deviennent terre à terre. Les rancoeurs sont tenaces, la vie devient plus difficile. Et c'est là que tout prend l'eau. Les trous se forment, les seaux arrivent mais c'est trop tard.
L'histoire de ce navire qui s'est perdu en route, c'est le récit de bon nombre de passagers qui ont tenté de survivre à des éléments indépendant de leur volonté, mais pas uniquement. Les désaccords se suivent tant que les personnages sont ensemble. La rancune est tenace et les esprits vont commencer à sombrer. Essayer de ne pas s'attacher à eux est difficile, ne pas les haïr ou ne pas les adorer devient un problème. L'auteur donne assez de détails sur chacun pour imaginer sa vie avant de mettre un pied sur La Méduse, jusqu'à ce qu'il remette le pied sur terre, s'il survit. Car c'est bien le hic, sur le nombre impressionnant, on se retrouve dans la même position que le Titanic. Trop de monde, pas assez d'embarcations en cas de naufrage, un bateau qui se fracasse au pire moment. Qui doit vivre ? Qui doit mourir ? Les éléments se déchainent, les requins font leur apparition.
Les personnages sont nombreux. Nous les suivons, découvrant le pourquoi ils sont sur ce navire. Arétéé Schmaltz, fille du gouverneur qui recherche un médecin pouvant effacer la tache de vin qui lui couvre la moitié du visage. Victor qui fuit, Osée qui aime cette vie depuis ces 6 ans, la Reine qui se veut tout puissante, et tous les autres qu'on a envie soit de torturer, soit de les protéger. Rien n'est simple. Ceux qui meurent se demandent pourquoi eux non pas pu être sur un rafiot. Ceux qui y sont se demandent comment survivre sans nourriture, avec de simples tonneaux de vins. L'esprit humain est complexe. Vouloir survivre pour retrouver ses proches, ses amis, sa famille, oui, mais à quel prix ? Qui serait capable de continuer en devenant autre chose qu'un être humain ? L'animal en nous semble prendre vie et nous faire oublier qui nous sommes : des gens civilisés. La plupart du temps.
C'est un conflit permanent entre ce que l'on veut et ce que l'on doit faire. Les personnages ne cessent de retrouver un peu de lucidité, mais, car il y a un mais, initialement certains ne sont pas "corrects". Ils préfèrent s'amuser aux dépends des autres. Il est question de Bonaparte également qui pourrait peut-être aider, à moins que le fait d'écrire ce qui s'est produit ne dérange ? L'humour souvent noir de l'auteur est parfait à mes yeux. C'est ce type d'humour que je préfère, plus dans le sombre, le glauque qui fait rire, pour éviter de s'apitoyer sur le sort de ses hommes et femmes qui vont y passer, autant le dire. Un naufrage à cette époque, des personnages qui ne sont pas tous d'accord, forcément il va y avoir des moments où il faut trancher dans le vif !
En conclusion, c'est un récit qui permet de nous poser des questions. La principale étant de savoir si nous aurions agit de la même façon que certains. Survivre dans de telles conditions, aurions-nous laissé la faim nous envahir ou la folie prendre le pas sur notre corps ? Sacrifice, amitié, dénigrement, les mutineries si infimes quelles soient auraient pu être le bon déclencheur pour tous les sauver. Aller jusqu'au fond des choses comme le doc, fouiner dans les cerveaux, dans les entrailles, ça il sait le faire. Un dernier point, on sait enfin ce qui est arrivé à ce fameux Victor, c'est un soulagement de savoir s'il a survécu ou non a cette folle épopée.
http://chroniqueslivresques.eklablog.com/a-ce-point-de-folie-franzobel-a148464850
Lien : http://chroniqueslivresques...
Franzobel (pseudonyme pour Franz Stefan Griebl), né en 1967 à Vöcklabruck, est un écrivain autrichien. Après avoir fait des études d'allemand et d'histoire et travaillé au Burgtheater de Vienne, en 1989 il se lance dans l'écriture. A ce point de folie est son tout nouveau roman.
Le 17 juin 1816, La Méduse quitte Rochefort à destination de Saint-Louis au Sénégal, embarquant 400 passagers sans compter l'équipage. Au commandement, un capitaine dont l'incompétence avérée est à l'origine du naufrage de la frégate après quelques jours de mer. Comme les chaloupes sont en trop petit nombre, 147 voyageurs sont abandonnés sur un radeau. Seuls quinze d'entre eux en réchapperont au terme de treize journées d'enfer, jalonnées de meurtres, de corps dépecés et d'ultimes stratégies de survie. L'un des rescapés, le médecin de bord Jean-Baptiste Henri Savigny, fera le récit de ce périple tragique, que le monde entier voudra connaître jusque dans ses détails les plus atroces…
Comme l'indiquait le sous-titre du roman, « d'après l'histoire du naufrage de la Méduse » et ce court résumé, A ce point de folie nous entraine dans cette folle aventure dramatique. S'il s'agit bien d'un roman, tout y est vrai aussi, les noms et les faits, comme j'ai pu le vérifier par de rapides recherches.
Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur l'histoire, le résumé en dit l'essentiel et le reste vous le lirez. Sachez que c'est rondement mené d'une écriture très vivante et qu'on lit ce bouquin goulûment du début jusqu'à la fin. Les personnages sont particulièrement bien campés (en particulier les officiers bouffis de suffisance et d'incompétence), les dialogues sont fort bien troussés, c'est bien documenté sur la vie à bord en ces temps-là, le texte est imagé et l'écrivain a choisi de maintenir une certaine distance entre son texte et le lecteur soit en usant de phrases telles que « Quant à nous, qui avons pour l'instant bien assez visité les entrailles crasseuses du navire, nous devrions être impatients de savoir ce qui se passait sur le gaillard d'arrière, là où se tenait le capitaine… », à moins qu'il n'y glisse des références contemporaines comme ce, « Imaginons un genre de Lino Ventura jeune. »
L'humour est aussi du voyage, « … elles jouissaient de l'attention qu'on accordait à bord à toutes les créatures féminines (depuis la figure de proue jusqu'à la chèvre embarquée, en passant par la fille du gouverneur) » et les clins d'yeux aussi, « il levait la main en signe de refus. Je préférerais ne pas. » Tout cela pour vous dire, et je voudrais insister sur ce point : certes il s'agit d'un drame, de plus historiquement avéré, mais Franzobel a pris délibérément le parti d'en parler sans appuyer sur le côté morbide et atroce des faits, tout au contraire, le texte est léger, très souvent drôle même dans les pires situations. Que ceux qui seraient effrayés, a priori, par les cadavres et le cannibalisme qu'on sait trouver dans ce livre, n'aient peur, le ton général du récit vous fera digérer (sic !) le truc.
Voilà pour la forme. Pour le fond, la question centrale du cannibalisme est posée, « Il devait manger, mais l'effroi le paralysait. Il s'accrochait à des mots comme morale, civilisation, culture, tel un noyé s'agrippe à son tronc d'arbre. » Sauf que les mots sont bien beaux quand on disserte dans un fauteuil dans son salon… Avec de ci-de là, quelques résonnances avec l'actualité et ces migrants en Méditerranée…
Un bon roman et je le répète lourdement, beaucoup moins épouvantable que certains (comme l'éditeur ?) voudraient nous le faire croire…
Le 17 juin 1816, La Méduse quitte Rochefort à destination de Saint-Louis au Sénégal, embarquant 400 passagers sans compter l'équipage. Au commandement, un capitaine dont l'incompétence avérée est à l'origine du naufrage de la frégate après quelques jours de mer. Comme les chaloupes sont en trop petit nombre, 147 voyageurs sont abandonnés sur un radeau. Seuls quinze d'entre eux en réchapperont au terme de treize journées d'enfer, jalonnées de meurtres, de corps dépecés et d'ultimes stratégies de survie. L'un des rescapés, le médecin de bord Jean-Baptiste Henri Savigny, fera le récit de ce périple tragique, que le monde entier voudra connaître jusque dans ses détails les plus atroces…
Comme l'indiquait le sous-titre du roman, « d'après l'histoire du naufrage de la Méduse » et ce court résumé, A ce point de folie nous entraine dans cette folle aventure dramatique. S'il s'agit bien d'un roman, tout y est vrai aussi, les noms et les faits, comme j'ai pu le vérifier par de rapides recherches.
Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur l'histoire, le résumé en dit l'essentiel et le reste vous le lirez. Sachez que c'est rondement mené d'une écriture très vivante et qu'on lit ce bouquin goulûment du début jusqu'à la fin. Les personnages sont particulièrement bien campés (en particulier les officiers bouffis de suffisance et d'incompétence), les dialogues sont fort bien troussés, c'est bien documenté sur la vie à bord en ces temps-là, le texte est imagé et l'écrivain a choisi de maintenir une certaine distance entre son texte et le lecteur soit en usant de phrases telles que « Quant à nous, qui avons pour l'instant bien assez visité les entrailles crasseuses du navire, nous devrions être impatients de savoir ce qui se passait sur le gaillard d'arrière, là où se tenait le capitaine… », à moins qu'il n'y glisse des références contemporaines comme ce, « Imaginons un genre de Lino Ventura jeune. »
L'humour est aussi du voyage, « … elles jouissaient de l'attention qu'on accordait à bord à toutes les créatures féminines (depuis la figure de proue jusqu'à la chèvre embarquée, en passant par la fille du gouverneur) » et les clins d'yeux aussi, « il levait la main en signe de refus. Je préférerais ne pas. » Tout cela pour vous dire, et je voudrais insister sur ce point : certes il s'agit d'un drame, de plus historiquement avéré, mais Franzobel a pris délibérément le parti d'en parler sans appuyer sur le côté morbide et atroce des faits, tout au contraire, le texte est léger, très souvent drôle même dans les pires situations. Que ceux qui seraient effrayés, a priori, par les cadavres et le cannibalisme qu'on sait trouver dans ce livre, n'aient peur, le ton général du récit vous fera digérer (sic !) le truc.
Voilà pour la forme. Pour le fond, la question centrale du cannibalisme est posée, « Il devait manger, mais l'effroi le paralysait. Il s'accrochait à des mots comme morale, civilisation, culture, tel un noyé s'agrippe à son tronc d'arbre. » Sauf que les mots sont bien beaux quand on disserte dans un fauteuil dans son salon… Avec de ci-de là, quelques résonnances avec l'actualité et ces migrants en Méditerranée…
Un bon roman et je le répète lourdement, beaucoup moins épouvantable que certains (comme l'éditeur ?) voudraient nous le faire croire…
critiques presse (1)
Dans « A ce point de folie », l’écrivain autrichien fait du fameux drame de « La Méduse » la métaphore de celui des Européens face à la crise des migrants.
Lire la critique sur le site : LeMonde
Citations et extraits (34)
Voir plus
Ajouter une citation
Quel genre d’objet ? Le capitaine, Léon Parnajon, tira sur sa pipe, se fit passer la longue-vue et ne vit rien, ni île ni navire. Une épave ? Des minutes s’écoulèrent encore avant que n’entre quelque chose dans le champ réduit de sa lorgnette : le commandant aperçut une plate-forme flottante où se dressait une tente.
Des Maures ? Des Berbères ? D’autres sortes de chameliers ? Un À ce point de folie abri pour nomades du désert emporté par les flots ? Des esclaves évadés ? À cette époque, il n’était pas rare que des Noirs maîtrisent
leurs surveillants avec l’espoir absurde de fuir. Le capitaine cherchait toujours une explication quand il distingua une silhouette titubante, au bord de la plate-forme, la tête penchée en arrière et… oui, l’homme urinait, il urinait dans sa main, semblait-il et… Impossible ! il buvait le liquide. Dès que le pisseur leva les yeux et aperçut la voile de L’Argus, il se mit à sautiller furieusement et à mouliner des bras. Voilà même qu’il grimpait au mât, à présent, et agitait un chiffon.
Du calme, du calme, Pissetrogne. Nous t’avons repéré.
Le type ne tint pas très longtemps sur son mât, il se laissa
glisser au sol avant de disparaître sous la tente. D’autres en sortirent alors, moulinant aussi des bras. Constatant que L’Argus les avait repérés, ils se jetèrent au cou les uns des autres et s’embrassèrent.
Non, ce ne sont pas des esclaves évadés. Pas des Négros. Peut-être des naufragés ? Ceux de La Méduse ? Inconcevable ! La Méduse s’est échouée il y a deux semaines ; à l’heure qu’il est, et avec un peu de chance, s’il reste des survivants c’est sur la côte, mais, selon toute
vraisemblance, on ne trouvera que la coque.
Une demi-heure plus tard, L’Argus avait rejoint l’étrange
embarcation. Un radeau, visiblement. En tout cas, le capitaine n’avait pas eu la berlue, le rafiot possédait bien un petit mât et une bâche pour se protéger du soleil. Le mousse compta treize,
quatorze, quinze silhouettes décharnées. La plupart étaient entièrement nues, si ce n’est, au bout de leurs jambes émaciées, des bottes qui leur donnaient une drôle d’allure – celle d’enfants ayant chaussé des souliers trop grands. Des squelettes ambulants ! L’un d’eux arborait une perruque de lin, une veste d’uniforme jaune et un sabre en bandoulière. À son tricorne, c’était forcément un militaire. Des Français ? Ou des pirates ? Cinq d’entre eux tenaient encore debout, les autres étaient allongés
ou accroupis. On mit le canot à l’eau et l’on rama dans leur
direction.
— Soyez prudents ! cria Parnajon. C’est peut-être un piège.
Peut-être…
Non, ce n’était pas un piège. Quand le navire fut suffisamment
proche, les marins discernèrent des yeux creux, des barbes hirsutes comme du maquis, des lèvres plus sèches que du parchemin.
Des épaules brûlées, des lambeaux de peau qui se détachaient, des plaies et des cloques sur tous les corps. Non, ce n’étaient pas des esclaves, ni des Berbères, ni des pirates, mais des Européens. Et quels Européens ! Aux cages thoraciques saillantes, au bassin taillé en harpe, aux fesses en galettes. Leurs cheveux, figés par le sel, rappelaient le rembourrage pour fauteuil.
Et les yeux ? Masqués d’un voile sombre : des yeux de
déments. Qu’est-ce que c’étaient que ces types ? Qu’avaient-ils vécu ?
Le tableau était pitoyable. Figures décharnées, bras filiformes et sans force, habits râpés jusqu’à la corde. Des loques. Vision poignante et répugnante. En comparaison, même la canaille parisienne a encore un air de noblesse. Le capitaine, personnage marginal dans notre histoire, les fit monter à bord et ordonna qu’on leur servît du bouillon de viande et du vin. Et puis du cognac avec des œufs brouillés.
Ces spectres errants – le capitaine Parnajon et tous les autres passagers de L’Argus durent l’admettre – étaient les rescapés du radeau de La Méduse. Ceux qu’on avait crus morts, quinze survivants sur cent quarante-sept passagers, qui avaient résisté treize jours durant sur le radeau. Treize jours ! Le capitaine tira sur sa pipe et considéra l’assemblage de planches, un travail d’amateurs,
sans compter la voile qui faisait office de tente. Incroyable
que ce machin ait pu tenir aussi longtemps sur l’eau. L’image qui suivit lui glaça le sang : un pied, coupé au-dessus de la cheville et coincé entre deux lames de bois. La chair était jaunâtre, boursouflée, la forme générale s’était estompée pour prendre l’aspect d’une éponge, mais, pas de doute possible, c’était un pied. Et Parnajon avisa alors de petites bandes grises suspendues aux cordages.
Du poisson séché ? Des tranches de lard vieux ? Non, le
capitaine en était certain, c’était de la chair humaine ! Comment ces quinze-là auraient-ils pu survivre autrement ? Ces pissetrognes ne s’étaient pas contentés de boire leur urine, ils s’étaient entre-dévorés. Parnajon s’étrangla en inspirant la fumée de sa pipe, avant d’être pris d’une quinte de toux. Ignorant encore que cette journée, ce radeau, ces bandes de chair grises lui vaudraient, quoi donc ? Une mention marginale dans les livres d’histoire ? Une place dans les notes de bas de page du livre de
l’immortalité ?
Le cannibalisme n’avait rien d’une aberration entre gens de mer, pour peu qu’on s’en tînt aux règles. Même la très sainte Église catholique tolérait la consommation de chair humaine dans les situations extrêmes. Avec quinze survivants sur cent quarante-sept, les règles avaient-elles été respectées ? Ou bien n’en avait-on appliqué qu’une seule, la loi du plus fort ?
S’était-on dépecé mutuellement avant de se nourrir les uns des autres ?
À peine arrivés à bord, certains des rescapés tombèrent à
genoux en remerciant le Seigneur. L’un serra le mousse dans ses bras ; l’autre le capitaine, lequel, se remémorant la scène de l’urine, le tint à distance avec une pointe d’écœurement. Quatre d’entre eux étaient tellement faibles qu’il fallut les porter, un cinquième cria quelque chose à propos d’une bourse restée sur le radeau : Mon argent ! Mes papiers ! On eut du mal à le dissuader
de plonger dans l’eau. Un autre encore commanda du champagne, des huîtres, des langoustes, du gâteau meringué et une serviette.
— Dites à l’orchestre de ne pas se gêner pour jouer plus fort. Et aux dames de prendre patience. Je danserai bientôt avec elles.
Celui-ci avait perdu la raison. Un autre – le géologue
Alexandre Corréard, auquel nous aurons encore affaire – estima sèchement :
— Messieurs, je suis outré, vous arrivez avec dix bonnes
minutes de retard. Et la ponctualité ? Quelle désinvolture ! Si tout le monde faisait pareil…
Il tenta de sourire et, ne voyant personne réagir à la plaisanterie, il s’effondra.
C’étaient des morts vivants aux yeux éteints. Des yeux qui en avaient trop vu. Un seul sortait du lot, il avait l’air en meilleure santé : c’était l’homme à la veste d’uniforme jaune et à la perruque de lin, qui pressait à présent son tricorne sur sa poitrine.
Il avait une barbe épaisse, un visage rose et charnu, des yeux bleus et perçants. Quand on y regardait de plus près, on voyait que sa veste élimée n’avait plus de boutons et que le cuir rongé de ses bottes était veiné de croûtes de sel.
— Jean-Baptiste Henri Savigny, second médecin de bord de La Méduse.
Il exécuta une profonde révérence, adressée au capitaine Parnajon,
mais à nous aussi : le genre humain. Puis il inspira profondément
et dit, d’une voix étonnamment puissante :
— Le monde doit savoir, et il l’apprendra, par quoi nous
sommes passés… Nous sommes en vie parce que notre devoir était de survivre et de raconter notre terrible sort…
Il évoqua l’échouage de La Méduse sur le banc de sable
d’Arguin, les canots de sauvetage qui les avaient abandonnés, une mutinerie. Les mots lui coulaient de la bouche en cascade.
Cordages coupés, tempêtes, un papillon, poissons volants,
requins, une deuxième mutinerie, les fûts d’eau éclatés, les rations de vin, etc.
— Il faut que vous préveniez Joséphine, ma fiancée. Dites lui que je suis en vie et qu’elle doit préparer de la limonade.
Une grande limonade glacée. Un tonneau de limonade. Douze boisseaux ! Et un cassoulet avec une oie. Du ragoût. De la tarte Tatin – non, celle-là, on ne l’inventerait que dans quatre-vingts ans, donc de la tarte aux pommes. De la crème brûlée, des profiteroles, des glaces…
Il fallut que Parnajon lève les mains, lui signifiant qu’il devrait remettre son festin à plus tard, pour que l’homme se sente en train de dérailler à son tour. Il demanda au capitaine l’autorisation de tirer une bouffée de sa pipe – « J’attends ce plaisir depuis deux semaines » –, et quand le commandant la lui eut tendue à contrecœur, il s’affaissa et l’on dut le soutenir – mais il continuait à divaguer à propos de Joséphine :
— Elle n’est pas belle et son intelligence laisse à désirer, elle
est extraordinairement ordinaire, ça n’est pas une princesse, mais
je l’aime. Je…
— Qu’avez-vous mangé ? demanda le capitaine.
Le regard fixé sur le rescapé, il récupéra sa pipe et l’essuya.
— Mangé ?
Savigny leva les yeux au ciel et se mit à rire. Une irrésistible queue de bœuf aux petites joues de veau cuite en terrine et couverte de fromage, des genoux de porc aux lentilles, des tranches de rate, des rognons braisés, du pain à la moelle de bœuf, du foie d’oie, des carpes farcies, des tartes aux poires… Il dévisagea Parnajon, suivit son
regard, vit les bandes de chair grises accrochées au radeau et lut dans les pensées du capitaine de L’Argus. Il serait difficile d’expliquer au monde civilisé ce qui s’était déroulé sur cette embarcation.
Quelqu’un le comprendrait-il ? Ou bien s’agissait-il d’un scandale à étouffer coûte que coûte ? Une chose qu’on ne devrait jamais apprendre ?
Ces ombres faméliques n’auraient pas survécu un jour de plus en mer, et bien que Parnajon fût heureux d’avoir sauvé quinze personnes de la mort, de sombres pressentiments se mêlaient à son exaltation. Étaient-ce de pauvres créatures maltraitées par le destin ou des bêtes sauvages qu’il avait ramenées à son b
Des Maures ? Des Berbères ? D’autres sortes de chameliers ? Un À ce point de folie abri pour nomades du désert emporté par les flots ? Des esclaves évadés ? À cette époque, il n’était pas rare que des Noirs maîtrisent
leurs surveillants avec l’espoir absurde de fuir. Le capitaine cherchait toujours une explication quand il distingua une silhouette titubante, au bord de la plate-forme, la tête penchée en arrière et… oui, l’homme urinait, il urinait dans sa main, semblait-il et… Impossible ! il buvait le liquide. Dès que le pisseur leva les yeux et aperçut la voile de L’Argus, il se mit à sautiller furieusement et à mouliner des bras. Voilà même qu’il grimpait au mât, à présent, et agitait un chiffon.
Du calme, du calme, Pissetrogne. Nous t’avons repéré.
Le type ne tint pas très longtemps sur son mât, il se laissa
glisser au sol avant de disparaître sous la tente. D’autres en sortirent alors, moulinant aussi des bras. Constatant que L’Argus les avait repérés, ils se jetèrent au cou les uns des autres et s’embrassèrent.
Non, ce ne sont pas des esclaves évadés. Pas des Négros. Peut-être des naufragés ? Ceux de La Méduse ? Inconcevable ! La Méduse s’est échouée il y a deux semaines ; à l’heure qu’il est, et avec un peu de chance, s’il reste des survivants c’est sur la côte, mais, selon toute
vraisemblance, on ne trouvera que la coque.
Une demi-heure plus tard, L’Argus avait rejoint l’étrange
embarcation. Un radeau, visiblement. En tout cas, le capitaine n’avait pas eu la berlue, le rafiot possédait bien un petit mât et une bâche pour se protéger du soleil. Le mousse compta treize,
quatorze, quinze silhouettes décharnées. La plupart étaient entièrement nues, si ce n’est, au bout de leurs jambes émaciées, des bottes qui leur donnaient une drôle d’allure – celle d’enfants ayant chaussé des souliers trop grands. Des squelettes ambulants ! L’un d’eux arborait une perruque de lin, une veste d’uniforme jaune et un sabre en bandoulière. À son tricorne, c’était forcément un militaire. Des Français ? Ou des pirates ? Cinq d’entre eux tenaient encore debout, les autres étaient allongés
ou accroupis. On mit le canot à l’eau et l’on rama dans leur
direction.
— Soyez prudents ! cria Parnajon. C’est peut-être un piège.
Peut-être…
Non, ce n’était pas un piège. Quand le navire fut suffisamment
proche, les marins discernèrent des yeux creux, des barbes hirsutes comme du maquis, des lèvres plus sèches que du parchemin.
Des épaules brûlées, des lambeaux de peau qui se détachaient, des plaies et des cloques sur tous les corps. Non, ce n’étaient pas des esclaves, ni des Berbères, ni des pirates, mais des Européens. Et quels Européens ! Aux cages thoraciques saillantes, au bassin taillé en harpe, aux fesses en galettes. Leurs cheveux, figés par le sel, rappelaient le rembourrage pour fauteuil.
Et les yeux ? Masqués d’un voile sombre : des yeux de
déments. Qu’est-ce que c’étaient que ces types ? Qu’avaient-ils vécu ?
Le tableau était pitoyable. Figures décharnées, bras filiformes et sans force, habits râpés jusqu’à la corde. Des loques. Vision poignante et répugnante. En comparaison, même la canaille parisienne a encore un air de noblesse. Le capitaine, personnage marginal dans notre histoire, les fit monter à bord et ordonna qu’on leur servît du bouillon de viande et du vin. Et puis du cognac avec des œufs brouillés.
Ces spectres errants – le capitaine Parnajon et tous les autres passagers de L’Argus durent l’admettre – étaient les rescapés du radeau de La Méduse. Ceux qu’on avait crus morts, quinze survivants sur cent quarante-sept passagers, qui avaient résisté treize jours durant sur le radeau. Treize jours ! Le capitaine tira sur sa pipe et considéra l’assemblage de planches, un travail d’amateurs,
sans compter la voile qui faisait office de tente. Incroyable
que ce machin ait pu tenir aussi longtemps sur l’eau. L’image qui suivit lui glaça le sang : un pied, coupé au-dessus de la cheville et coincé entre deux lames de bois. La chair était jaunâtre, boursouflée, la forme générale s’était estompée pour prendre l’aspect d’une éponge, mais, pas de doute possible, c’était un pied. Et Parnajon avisa alors de petites bandes grises suspendues aux cordages.
Du poisson séché ? Des tranches de lard vieux ? Non, le
capitaine en était certain, c’était de la chair humaine ! Comment ces quinze-là auraient-ils pu survivre autrement ? Ces pissetrognes ne s’étaient pas contentés de boire leur urine, ils s’étaient entre-dévorés. Parnajon s’étrangla en inspirant la fumée de sa pipe, avant d’être pris d’une quinte de toux. Ignorant encore que cette journée, ce radeau, ces bandes de chair grises lui vaudraient, quoi donc ? Une mention marginale dans les livres d’histoire ? Une place dans les notes de bas de page du livre de
l’immortalité ?
Le cannibalisme n’avait rien d’une aberration entre gens de mer, pour peu qu’on s’en tînt aux règles. Même la très sainte Église catholique tolérait la consommation de chair humaine dans les situations extrêmes. Avec quinze survivants sur cent quarante-sept, les règles avaient-elles été respectées ? Ou bien n’en avait-on appliqué qu’une seule, la loi du plus fort ?
S’était-on dépecé mutuellement avant de se nourrir les uns des autres ?
À peine arrivés à bord, certains des rescapés tombèrent à
genoux en remerciant le Seigneur. L’un serra le mousse dans ses bras ; l’autre le capitaine, lequel, se remémorant la scène de l’urine, le tint à distance avec une pointe d’écœurement. Quatre d’entre eux étaient tellement faibles qu’il fallut les porter, un cinquième cria quelque chose à propos d’une bourse restée sur le radeau : Mon argent ! Mes papiers ! On eut du mal à le dissuader
de plonger dans l’eau. Un autre encore commanda du champagne, des huîtres, des langoustes, du gâteau meringué et une serviette.
— Dites à l’orchestre de ne pas se gêner pour jouer plus fort. Et aux dames de prendre patience. Je danserai bientôt avec elles.
Celui-ci avait perdu la raison. Un autre – le géologue
Alexandre Corréard, auquel nous aurons encore affaire – estima sèchement :
— Messieurs, je suis outré, vous arrivez avec dix bonnes
minutes de retard. Et la ponctualité ? Quelle désinvolture ! Si tout le monde faisait pareil…
Il tenta de sourire et, ne voyant personne réagir à la plaisanterie, il s’effondra.
C’étaient des morts vivants aux yeux éteints. Des yeux qui en avaient trop vu. Un seul sortait du lot, il avait l’air en meilleure santé : c’était l’homme à la veste d’uniforme jaune et à la perruque de lin, qui pressait à présent son tricorne sur sa poitrine.
Il avait une barbe épaisse, un visage rose et charnu, des yeux bleus et perçants. Quand on y regardait de plus près, on voyait que sa veste élimée n’avait plus de boutons et que le cuir rongé de ses bottes était veiné de croûtes de sel.
— Jean-Baptiste Henri Savigny, second médecin de bord de La Méduse.
Il exécuta une profonde révérence, adressée au capitaine Parnajon,
mais à nous aussi : le genre humain. Puis il inspira profondément
et dit, d’une voix étonnamment puissante :
— Le monde doit savoir, et il l’apprendra, par quoi nous
sommes passés… Nous sommes en vie parce que notre devoir était de survivre et de raconter notre terrible sort…
Il évoqua l’échouage de La Méduse sur le banc de sable
d’Arguin, les canots de sauvetage qui les avaient abandonnés, une mutinerie. Les mots lui coulaient de la bouche en cascade.
Cordages coupés, tempêtes, un papillon, poissons volants,
requins, une deuxième mutinerie, les fûts d’eau éclatés, les rations de vin, etc.
— Il faut que vous préveniez Joséphine, ma fiancée. Dites lui que je suis en vie et qu’elle doit préparer de la limonade.
Une grande limonade glacée. Un tonneau de limonade. Douze boisseaux ! Et un cassoulet avec une oie. Du ragoût. De la tarte Tatin – non, celle-là, on ne l’inventerait que dans quatre-vingts ans, donc de la tarte aux pommes. De la crème brûlée, des profiteroles, des glaces…
Il fallut que Parnajon lève les mains, lui signifiant qu’il devrait remettre son festin à plus tard, pour que l’homme se sente en train de dérailler à son tour. Il demanda au capitaine l’autorisation de tirer une bouffée de sa pipe – « J’attends ce plaisir depuis deux semaines » –, et quand le commandant la lui eut tendue à contrecœur, il s’affaissa et l’on dut le soutenir – mais il continuait à divaguer à propos de Joséphine :
— Elle n’est pas belle et son intelligence laisse à désirer, elle
est extraordinairement ordinaire, ça n’est pas une princesse, mais
je l’aime. Je…
— Qu’avez-vous mangé ? demanda le capitaine.
Le regard fixé sur le rescapé, il récupéra sa pipe et l’essuya.
— Mangé ?
Savigny leva les yeux au ciel et se mit à rire. Une irrésistible queue de bœuf aux petites joues de veau cuite en terrine et couverte de fromage, des genoux de porc aux lentilles, des tranches de rate, des rognons braisés, du pain à la moelle de bœuf, du foie d’oie, des carpes farcies, des tartes aux poires… Il dévisagea Parnajon, suivit son
regard, vit les bandes de chair grises accrochées au radeau et lut dans les pensées du capitaine de L’Argus. Il serait difficile d’expliquer au monde civilisé ce qui s’était déroulé sur cette embarcation.
Quelqu’un le comprendrait-il ? Ou bien s’agissait-il d’un scandale à étouffer coûte que coûte ? Une chose qu’on ne devrait jamais apprendre ?
Ces ombres faméliques n’auraient pas survécu un jour de plus en mer, et bien que Parnajon fût heureux d’avoir sauvé quinze personnes de la mort, de sombres pressentiments se mêlaient à son exaltation. Étaient-ce de pauvres créatures maltraitées par le destin ou des bêtes sauvages qu’il avait ramenées à son b
— Je ferai en sorte que vous ayez à rendre des comptes si vous perdez
encore plus de temps, lança le gouverneur. Qu'une quelconque bourrique
passe par-dessus bord et se noie ne justifie pas que nous arrivions en retard
à Saint-Louis.
— Je vous traînerai en cour martiale si vous n'ordonnez pas de mettre à
l'eau un canot de sauvetage, menaçait le deuxième officier. C'est une vie
humaine qui est en jeu.
p; que je detestait ce scelerat ce fumier de schmaltz
encore plus de temps, lança le gouverneur. Qu'une quelconque bourrique
passe par-dessus bord et se noie ne justifie pas que nous arrivions en retard
à Saint-Louis.
— Je vous traînerai en cour martiale si vous n'ordonnez pas de mettre à
l'eau un canot de sauvetage, menaçait le deuxième officier. C'est une vie
humaine qui est en jeu.
p; que je detestait ce scelerat ce fumier de schmaltz
Il but du vin, lequel était beaucoup trop chaud, puis essuya les gouttelettes restées sur sa lèvre supérieure. Terminé ! Tous ses cauchemars étaient devenus réalités. Ensablés ! Ils allaient devoir rejoindre la côte en chaloupe. Et s’ils étaient pris dans une tempête ? S’il devait aller aux toilettes ? Et qui le poudrerais ? Sur la côte, ils seraient attendus par les Berbères et les cannibales. Epouvantable. A cet instant seulement, il comprit la portée de cette catastrophe. L’angoisse l’envahissait tout entier.
On ne se battait plus ni contre un adversaire ni pour vaincre, mais contre la vie et pour la mort. Lavillette, qui faisait partie des forcenés, prit appui sur un caporal et lui coupa une main à la hache : celle-ci tomba à la mer, où elle flotta un moment comme un étrange poisson à cinq doigts. Juste un rêve. C'est forcément un rêve.
Les Picard s'étaient vu
attribuer le brick L'Argus – sous le commandement de notre capitaine
Parnajon –, mais Adélaïde, créature butée, ne voulait pas d'autre bateau
que La Méduse, le plus gros de la flotte. C'était plus sûr. Sinon, pourquoi le
futur gouverneur de Saint-Louis l'avait-il choisi ? Lui aussi voyageait avec
femme et enfant. Il devait avoir ses raisons.
ps; c'est la faute a cette tete de mule d'adelaide si la famille picard a pris le bateau maudi la meduse
attribuer le brick L'Argus – sous le commandement de notre capitaine
Parnajon –, mais Adélaïde, créature butée, ne voulait pas d'autre bateau
que La Méduse, le plus gros de la flotte. C'était plus sûr. Sinon, pourquoi le
futur gouverneur de Saint-Louis l'avait-il choisi ? Lui aussi voyageait avec
femme et enfant. Il devait avoir ses raisons.
ps; c'est la faute a cette tete de mule d'adelaide si la famille picard a pris le bateau maudi la meduse
autres livres classés : roman historiqueVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Franzobel (1)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3197 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3197 lecteurs ont répondu