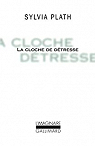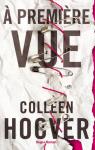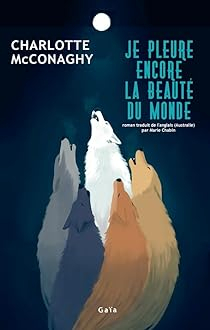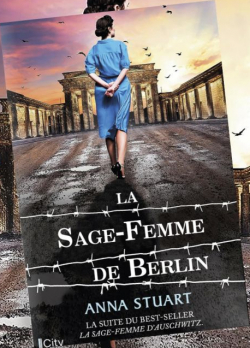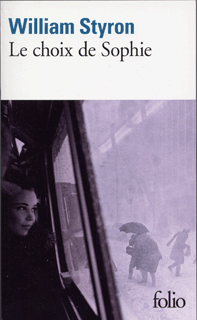William Styron
Maurice Rambaud (Traducteur)/5 291 notes
Maurice Rambaud (Traducteur)/5 291 notes
Résumé :
Nous ne croyons pas à l’Enfer, nous sommes incapables de l’imaginer, et pourtant il existe, on peut s’y retrouver brusquement au-delà de toute expression. Telle est la leçon de ce petit livre magnifique et terrible.
Récit d’une dépression grave, avec son cortège d’angoisses, d’insomnies, de « rafales dévastatrices », de tentations de suicide, il nous montre pour la première fois ce qu’est réellement cette « tempête de ténèbres » intérieure qui peut fr... >Voir plus
Récit d’une dépression grave, avec son cortège d’angoisses, d’insomnies, de « rafales dévastatrices », de tentations de suicide, il nous montre pour la première fois ce qu’est réellement cette « tempête de ténèbres » intérieure qui peut fr... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Face aux ténèbresVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (40)
Voir plus
Ajouter une critique
C'est terriblement difficile de faire une critique sur ce livre tant le sujet traité, le suicide, est encore tabou. La dépression, pour beaucoup de personnes qui ne l'ont jamais vécue, est déjà difficile à comprendre, mais quand elle va dans les abysses d'une souffrance qui n'a pas de nom, elle est incompréhensible.
Pour l'entourage d'une personne atteinte de ce mal et qui n'a comme seule solution que se donner la mort, c'est tout simplement inimaginable.
Ce que nous livre ici William Styron dans son livre Face aux ténèbres-chronique d'une folie, est une plongée dans l'univers de cette souffrance innommable, mais avec cette note d'espoir que l'on peut -parfois- s'en sortir.
Quand cela arrive, quand on s'en sort, on n'est plus jamais le(la) même.
Pour l'entourage d'une personne atteinte de ce mal et qui n'a comme seule solution que se donner la mort, c'est tout simplement inimaginable.
Ce que nous livre ici William Styron dans son livre Face aux ténèbres-chronique d'une folie, est une plongée dans l'univers de cette souffrance innommable, mais avec cette note d'espoir que l'on peut -parfois- s'en sortir.
Quand cela arrive, quand on s'en sort, on n'est plus jamais le(la) même.
Styron nous fait ici l'analyse de sa propre dépression. Pour celui qui n'en a jamais ressenti les affres, le mot « dépression » est une notion abstraite et floue. La plupart du temps, et aujourd'hui encore, elle est perçue comme une faiblesse de l'esprit qu'il suffit de combattre avec énergie et volonté. Il s'agit de « prendre sur soi », ne pas « s'écouter ». On va même jusqu'à parler de « lâcheté » en cas d'actes irréparables. Une « dépression » au sens météorologique du terme est une spirale descendante, ce qui est bien le cas ici.
Malheureusement la seule volonté n'y suffit pas puisqu'elle a déserté. le dépressif dérive sans but. Il ne perçoit rien que le néant au point d'envisager le suicide comme une solution comme une autre. Il banalise la mort lorsque la douleur morale, physiquement éprouvée devient trop insupportable, lancinante et sans fin. Cette insurmontable angoisse qui vous terrasse et entraine inexorablement vers le fond. C'est un reniement de soi, une totale dévalorisation, de l'autodestruction. C'est une punition qu'il s'inflige probablement lié à un sentiment de culpabilité.
Comment cette notion peut-elle être concevable par des individus exempts de ces troubles ? Cette notion de folie que Styron lui-même revendique est finalement plus acceptable pour eux. Aujourd'hui, la dépression est reconnue et qualifiée de « maladie » (du siècle même), tant les cas sont nombreux et en sans cesse en augmentation au fil des années (et plus encore avec la pandémie qui nous frappe depuis 2020 !). Mais à l'époque de la rédaction du livre, le phénomène était certes connu mais mal maitrisé par les médecins. La psychiatrie ne faisait pas l'unanimité. Elle prescrivait (comme c'est toujours le cas aujourd'hui) des traitements médicamenteux souvent forts avec des effets secondaires mal connus, en première intention.
La réalité des névroses est aujourd'hui clairement reconnue par la médecine et catégorisées (phobiques, compulsives, obsessionnelles, hystériques…) mais n'est toujours contrôlée que partiellement et très peu acceptée dans le quotidien d'une grande majorité de la population non atteinte de ce fléau.
Styron quant à lui, en brossant un tableau clinique sans complaisance de sa dépression tente d'expliquer aux néophytes ce qui se passe dans sa tête : le mal-être les angoisses, la perte de motivations, l'annihilation de ses envies, son sentiment de carence et d'inutilité. Il essaye de décrire ses symptômes pour faire ressentir ce qu'endurent les dépressifs. Pour leur faire toucher du doigt la profondeur des blessures qu'ils ressentent. Mais ce ne sont que des mots sans ressenti physique pour ceux qui ne sont pas touché. Sans la charge émotionnelle à laquelle ils se réfèrent. Les mots sont une information, on peut s'imaginer sur le moment ce qu'ils veulent dire, mais en aucun cas en ressentir la douleur physique, son ampleur dans la durée (on informe par exemple un tiers que nous avons mal à la tête, ou mal aux dents. Il le sait, il comprend le sens des termes utilisés, mais comment pourrait-il en ressentir la douleur et se représenter que 4h après vous en souffrez encore alors même que l'info lui est sortie de la tête?).
Styron tente de trouver des causes à son mal-être, comme par exemple son corps qui rejette l'alcool qui serait à l'origine de sa dépression alors que ce n'est probablement qu'une première manifestation. Il donne aussi ses positions vis-à-vis des psychiatres, les accusant d'être inefficaces avec un recours automatique à la prescription médicamenteuse (Ce qui n'est pas tout à fait faux). Il prône l'internement comme remède souverain qui aide à retrouver une sérénité intime et profonde en le coupant du quotidien. Ça n'est pas entièrement faux aussi à cela près qu'aujourd'hui on parle de maison de repos et non plus d'internement (réservés pour les « fous » dangereux pour eux-mêmes et pour les autres – schizos, psychopathes, maniaques, etc…) Styron, aux mains de psychologues (et non pas psychiatres) qui lui fournissent écoute et dialogue, dit avoir trouvé le déclic nécessaire pour surmonter les affres de ce marasme et remonter la pente. Là encore, c'est tout à fait vrai qu'il faut un « déclic » (on ne « décide » pas que sa dépression est terminée).
Ce drame personnel, vécu douloureusement est un roman désespéré même si l'on entrevoit un espoir ténu vers la fin. Pour avoir été touchée personnellement par ce mal insondable, cet état des lieux me parle forcément. Je comprends le cheminement qui a dû être le sien, sa descente aux enfers et toutes les étapes décrites puisque ses mots se rattachent à des sensations physiques précises pour moi. Ils font sens. Cependant, je reste sceptique sur la compréhension de l'abime par les non-dépressifs car c'est un cheminement très personnel où l'on se bat avec ses propres démons. Aucun dépressif ne ressemble à un autre puisqu'aucun n'aura la même histoire même si les symptômes peuvent être catégorisés et sont plus ou moins les mêmes.
Pour ma part, et contre toute attente, je n'ai pas perçu de réelle empathie envers l'auteur. Malgré ma compréhension de ce qui frappe l'auteur, je n'ai malheureusement pas vraiment senti de vraies émotions sur les mots de celui-ci. Je n'ai pas discerné la force du propos. Cela reste des allégations dépourvues d'impact réel. Cela reste distant, comme un spectateur parlerait de ce qu'il voit, un constat sans plus.
On passe des premières manifestations de la dépression aux profondeurs de l'angoisse sans réellement ressentir les paliers par lesquels il a dû passer. Je comprends que les descriptions auraient pu paraitre trop pesantes s'il avait tout dit en détail. Pourtant l'écriture ici est noire, sans espoir et apparemment sans issue. Les mots utilisés en attestent. Pour autant, j'ai l'impression d'avoir lu un rapport clinique écrit à froid comme l'aurait fait un médecin et non pas un vécu personnel même si telle en était l'intention. le récit méticuleux me semble en effet rester superficielle. Son histoire personnelle me parait plutôt prétexte à donner son avis sur les traitements et les prises en charge psychiatrique.
Cela ne reste que mon modeste ressenti et ça n'enlève rien aux propos de l'auteur. C'était mon premier essai avec Styron, avant de m'attaquer au pavé qu'est le « choix de Sophie » dont l'adaptation cinématographique m'avait touchée en plein coeur. A lire donc… à suivre…
Malheureusement la seule volonté n'y suffit pas puisqu'elle a déserté. le dépressif dérive sans but. Il ne perçoit rien que le néant au point d'envisager le suicide comme une solution comme une autre. Il banalise la mort lorsque la douleur morale, physiquement éprouvée devient trop insupportable, lancinante et sans fin. Cette insurmontable angoisse qui vous terrasse et entraine inexorablement vers le fond. C'est un reniement de soi, une totale dévalorisation, de l'autodestruction. C'est une punition qu'il s'inflige probablement lié à un sentiment de culpabilité.
Comment cette notion peut-elle être concevable par des individus exempts de ces troubles ? Cette notion de folie que Styron lui-même revendique est finalement plus acceptable pour eux. Aujourd'hui, la dépression est reconnue et qualifiée de « maladie » (du siècle même), tant les cas sont nombreux et en sans cesse en augmentation au fil des années (et plus encore avec la pandémie qui nous frappe depuis 2020 !). Mais à l'époque de la rédaction du livre, le phénomène était certes connu mais mal maitrisé par les médecins. La psychiatrie ne faisait pas l'unanimité. Elle prescrivait (comme c'est toujours le cas aujourd'hui) des traitements médicamenteux souvent forts avec des effets secondaires mal connus, en première intention.
La réalité des névroses est aujourd'hui clairement reconnue par la médecine et catégorisées (phobiques, compulsives, obsessionnelles, hystériques…) mais n'est toujours contrôlée que partiellement et très peu acceptée dans le quotidien d'une grande majorité de la population non atteinte de ce fléau.
Styron quant à lui, en brossant un tableau clinique sans complaisance de sa dépression tente d'expliquer aux néophytes ce qui se passe dans sa tête : le mal-être les angoisses, la perte de motivations, l'annihilation de ses envies, son sentiment de carence et d'inutilité. Il essaye de décrire ses symptômes pour faire ressentir ce qu'endurent les dépressifs. Pour leur faire toucher du doigt la profondeur des blessures qu'ils ressentent. Mais ce ne sont que des mots sans ressenti physique pour ceux qui ne sont pas touché. Sans la charge émotionnelle à laquelle ils se réfèrent. Les mots sont une information, on peut s'imaginer sur le moment ce qu'ils veulent dire, mais en aucun cas en ressentir la douleur physique, son ampleur dans la durée (on informe par exemple un tiers que nous avons mal à la tête, ou mal aux dents. Il le sait, il comprend le sens des termes utilisés, mais comment pourrait-il en ressentir la douleur et se représenter que 4h après vous en souffrez encore alors même que l'info lui est sortie de la tête?).
Styron tente de trouver des causes à son mal-être, comme par exemple son corps qui rejette l'alcool qui serait à l'origine de sa dépression alors que ce n'est probablement qu'une première manifestation. Il donne aussi ses positions vis-à-vis des psychiatres, les accusant d'être inefficaces avec un recours automatique à la prescription médicamenteuse (Ce qui n'est pas tout à fait faux). Il prône l'internement comme remède souverain qui aide à retrouver une sérénité intime et profonde en le coupant du quotidien. Ça n'est pas entièrement faux aussi à cela près qu'aujourd'hui on parle de maison de repos et non plus d'internement (réservés pour les « fous » dangereux pour eux-mêmes et pour les autres – schizos, psychopathes, maniaques, etc…) Styron, aux mains de psychologues (et non pas psychiatres) qui lui fournissent écoute et dialogue, dit avoir trouvé le déclic nécessaire pour surmonter les affres de ce marasme et remonter la pente. Là encore, c'est tout à fait vrai qu'il faut un « déclic » (on ne « décide » pas que sa dépression est terminée).
Ce drame personnel, vécu douloureusement est un roman désespéré même si l'on entrevoit un espoir ténu vers la fin. Pour avoir été touchée personnellement par ce mal insondable, cet état des lieux me parle forcément. Je comprends le cheminement qui a dû être le sien, sa descente aux enfers et toutes les étapes décrites puisque ses mots se rattachent à des sensations physiques précises pour moi. Ils font sens. Cependant, je reste sceptique sur la compréhension de l'abime par les non-dépressifs car c'est un cheminement très personnel où l'on se bat avec ses propres démons. Aucun dépressif ne ressemble à un autre puisqu'aucun n'aura la même histoire même si les symptômes peuvent être catégorisés et sont plus ou moins les mêmes.
Pour ma part, et contre toute attente, je n'ai pas perçu de réelle empathie envers l'auteur. Malgré ma compréhension de ce qui frappe l'auteur, je n'ai malheureusement pas vraiment senti de vraies émotions sur les mots de celui-ci. Je n'ai pas discerné la force du propos. Cela reste des allégations dépourvues d'impact réel. Cela reste distant, comme un spectateur parlerait de ce qu'il voit, un constat sans plus.
On passe des premières manifestations de la dépression aux profondeurs de l'angoisse sans réellement ressentir les paliers par lesquels il a dû passer. Je comprends que les descriptions auraient pu paraitre trop pesantes s'il avait tout dit en détail. Pourtant l'écriture ici est noire, sans espoir et apparemment sans issue. Les mots utilisés en attestent. Pour autant, j'ai l'impression d'avoir lu un rapport clinique écrit à froid comme l'aurait fait un médecin et non pas un vécu personnel même si telle en était l'intention. le récit méticuleux me semble en effet rester superficielle. Son histoire personnelle me parait plutôt prétexte à donner son avis sur les traitements et les prises en charge psychiatrique.
Cela ne reste que mon modeste ressenti et ça n'enlève rien aux propos de l'auteur. C'était mon premier essai avec Styron, avant de m'attaquer au pavé qu'est le « choix de Sophie » dont l'adaptation cinématographique m'avait touchée en plein coeur. A lire donc… à suivre…
Face aux ténèbres n'est pas seulement un livre fort; c'est aussi un beau livre, quoique le sujet en soit grave et perturbant. La dépression est un sujet qui continue à mettre beaucoup de monde mal à l'aise. Ça peut aller jusqu'au tabou.
William Styron rédige ici un récit autobiographique de sa propre lutte face aux ténèbres. Mais il élargit l'angle d'approche en parlant de la dépression en général et des rapports ambigus et malaisés entre la personne en souffrance et les proches. Démunis face à ce problème impalpable, il y a ceux qui le réfutent carrément avec des conseils inutiles et qui agressent un peu plus le blessé : "Bouge-toi un peu plus!", "Tu t'écoutes trop!" et autres. Quand simplement se lever du matin est déjà une bataille remportée de haute lutte contre la maladie et soi-même. Quand tenir un jour de plus est un exploit...
William Styron parle également de quelques personnalités du monde littéraire en prise avec cette maladie qui les a poussés jusqu'au suicide: Romain Gary, son ami, Sylvia Plath, etc.
Lui-même s'est retrouvé à friser le point de non-retour, cette terrifiante zone qu'il nomme "la désespérance au-delà de la désespérance".
Un témoignage âpre, sans fard mais non sans pudeur. L'auteur n'écrit pas pour faire pleurer dans les chaumières ni par ostentation. Il se veut éclairant sur la dépression et son emprise similaire à celle d'une immonde araignée sur sa proie engluée dans la toile. Son récit m'a touchée au coeur. Pour autant il n'est pas déprimant, sa lecture ne m'a pas plus plombé le moral. Juste fait ressentir une infinie compassion pour tous ces êtres en souffrance.
Je sais déjà que ce court texte, je le relirai.
William Styron rédige ici un récit autobiographique de sa propre lutte face aux ténèbres. Mais il élargit l'angle d'approche en parlant de la dépression en général et des rapports ambigus et malaisés entre la personne en souffrance et les proches. Démunis face à ce problème impalpable, il y a ceux qui le réfutent carrément avec des conseils inutiles et qui agressent un peu plus le blessé : "Bouge-toi un peu plus!", "Tu t'écoutes trop!" et autres. Quand simplement se lever du matin est déjà une bataille remportée de haute lutte contre la maladie et soi-même. Quand tenir un jour de plus est un exploit...
William Styron parle également de quelques personnalités du monde littéraire en prise avec cette maladie qui les a poussés jusqu'au suicide: Romain Gary, son ami, Sylvia Plath, etc.
Lui-même s'est retrouvé à friser le point de non-retour, cette terrifiante zone qu'il nomme "la désespérance au-delà de la désespérance".
Un témoignage âpre, sans fard mais non sans pudeur. L'auteur n'écrit pas pour faire pleurer dans les chaumières ni par ostentation. Il se veut éclairant sur la dépression et son emprise similaire à celle d'une immonde araignée sur sa proie engluée dans la toile. Son récit m'a touchée au coeur. Pour autant il n'est pas déprimant, sa lecture ne m'a pas plus plombé le moral. Juste fait ressentir une infinie compassion pour tous ces êtres en souffrance.
Je sais déjà que ce court texte, je le relirai.
Je ne connais pas grand-chose à la psychologie et à la psychiatrie mais je suis sensible à ces disciplines et j'ai trouvé ce récit de Styron très éclairant, édifiant par moments. Il raconte sa dépression, cette « tempête déchaînée dans [le] cerveau », les causes probables de son mal (il émet des hypothèses, bien sûr, car rien n'est certain), ses idées d'autodestruction et de suicide, son hospitalisation et sa guérison. Oui, car nombreux sont ceux qui l'oublient ou qui ne comprennent pas la dépression : c'est une maladie grave qui peut avoir une issue tragique. L'auteur l'illustre en racontant son expérience et en citant des écrivains et artistes qui ont vécu cette « tempête des ténèbres » intérieure comme Romain Gary, Virginia Woolf, Sylvia Plath, Ernest Hemingway ou encore Diane Arbus. Tous se sont suicidés. Styron raconte encore la douleur, l'hypocondrie, la haine de soi, le sentiment de perte ou d'inutilité qu'entraînent la dépression, qui sont autant de symptômes de la dépression. Son récit est également une mise en garde pour tous ceux qui n'ont jamais été plongés dans cet état de désespérance et qui seraient tentés de dire à un dépressif qu'il ne tient qu'à lui de s'en sortir : « Une rude tâche que de lancer : ‘‘courage !'' quand on est en sécurité sur le rivage à quelqu'un qui se noie, ce qui équivaut à une insulte […]. » Il les encourage plutôt à faire preuve d'un « soutien fervent et impliqué ».
Voilà donc un récit intéressant, qui peut éclairer ceux qui ont du mal à comprendre cette maladie et ses souffrances. Non, un dépressif ne « se pénalise » pas tout seul (une phrase que j'ai entendue un jour) ; oui, la dépression est un mal dont il est difficile de se sortir ; non, la seule volonté ne suffit pas toujours ; et oui, la présence et la patience des proches sont souvent indispensables. Enfin, et c'est le plus important, oui, on peut en guérir, William Styron en est la preuve.
Voilà donc un récit intéressant, qui peut éclairer ceux qui ont du mal à comprendre cette maladie et ses souffrances. Non, un dépressif ne « se pénalise » pas tout seul (une phrase que j'ai entendue un jour) ; oui, la dépression est un mal dont il est difficile de se sortir ; non, la seule volonté ne suffit pas toujours ; et oui, la présence et la patience des proches sont souvent indispensables. Enfin, et c'est le plus important, oui, on peut en guérir, William Styron en est la preuve.
L'auteur le dit lui-même: comment expliquer ce qu'est une dépression à ceux qui ne l'ont jamais vécu?
Il tente plusieurs analogies - la noyade, la suffocation, une tempête dans le cerveau, un sentiment d'effroi, une paralysie totale - mais rien n'est assez précis pour faire comprendre cet état qui s'empare de l'être en entier et qui ne lui laisse que très peu de répit. C'est à Paris, lors d'une remise de prix, que Styron prend conscience de l'étendue des dégâts, celle d'un état dépressif dajà profondément installé qu'il n'avait jusque là pas voulu accepter. Il retourne précipitamment aux Etats-Unis pour rencontrer un psy, s'enferme dans sa maison et sombre complètement en quelques semaines. le voilà, à son tour, en proie à des idées suicidaires, après avoir vécu celles de ses amis, Romain Gary, Jean Seberg, et d'autres écrivains.
La dépression et surtout le suicide restent des sujets difficiles à aborder pour nombre d'entre nous, et c'est pour cela que Styron insiste pour en analyser les tenants et aboutissants. Dans ce court essai, il va au plus près de cette pulsion suicidaire, des instants qui précèdent la tentative, certains effets intimes qu'on jette ou qu'on chérit au contraire comme trace de ce qui bientôt ne servira plus, la lettre d'adieu, et lors de tous ces gestes, son double l'observant froidement.
Heureusement, il en réchappe, puisqu'il est là pour essayer de nous dire et peut-être, aussi, de nous sauver. Il faut une grande part de lucidité et d'empathie pour écrire un texte comme celui-ci, revenu des ténèbres.
Il tente plusieurs analogies - la noyade, la suffocation, une tempête dans le cerveau, un sentiment d'effroi, une paralysie totale - mais rien n'est assez précis pour faire comprendre cet état qui s'empare de l'être en entier et qui ne lui laisse que très peu de répit. C'est à Paris, lors d'une remise de prix, que Styron prend conscience de l'étendue des dégâts, celle d'un état dépressif dajà profondément installé qu'il n'avait jusque là pas voulu accepter. Il retourne précipitamment aux Etats-Unis pour rencontrer un psy, s'enferme dans sa maison et sombre complètement en quelques semaines. le voilà, à son tour, en proie à des idées suicidaires, après avoir vécu celles de ses amis, Romain Gary, Jean Seberg, et d'autres écrivains.
La dépression et surtout le suicide restent des sujets difficiles à aborder pour nombre d'entre nous, et c'est pour cela que Styron insiste pour en analyser les tenants et aboutissants. Dans ce court essai, il va au plus près de cette pulsion suicidaire, des instants qui précèdent la tentative, certains effets intimes qu'on jette ou qu'on chérit au contraire comme trace de ce qui bientôt ne servira plus, la lettre d'adieu, et lors de tous ces gestes, son double l'observant froidement.
Heureusement, il en réchappe, puisqu'il est là pour essayer de nous dire et peut-être, aussi, de nous sauver. Il faut une grande part de lucidité et d'empathie pour écrire un texte comme celui-ci, revenu des ténèbres.
Citations et extraits (32)
Voir plus
Ajouter une citation
Camus, me dit Romain (Gary), faisait de temps à autre allusion au profond désespoir qui l'habitait et parlait de suicide. Il en parlait parfois en plaisantant, mais la plaisanterie avait un arrière-goût de vin aigre, qui n'allait pas sans perturber Romain. Pourtant il n'avait apparemment jamais attenté à ses jours, aussi n'est-il peut-être nullement fortuit que malgré la constance de la tonalité mélancolique, un sentiment de triomphe de la vie sur la mort soit au cœur du -Mythe de Sisyphe- et de son austère message: en l'absence de tout espoir, nous devons néanmoins continuer à lutter pour survivre, et de fait nous survivons-de justesse. (p.43)
Tout d'abord cela n'eut rien de vraiment inquiétant, dans la mesure où le changement était subtil, mais je constatais cependant que le décor qui m'entourait à certains moments se parait de tonalités différentes : les ombres du crépuscule semblaient plus sombres, mes matins étaient moins radieux, les promenades en forêt se faisaient moins toniques, et il y avait maintenant un moment en fin d'après-midi pendant mes heures de travail où une sorte de panique et d'angoisse me submergeait, le temps de quelques minutes à peine...
La souffrance occasionnée par une dépression grave est tout à fait inconcevable pour qui ne l'a jamais endurée, et si dans de nombreux cas elle tue, c'est parce que l'angoisse qui l'accompagne est devenue intolérable.
Quant à ceux qui ont séjourné dans la sombre forêt de la dépression, et connu son inexplicable torture, leur remontée de l'abîme n'est pas sans analogie avec l'ascension du poète, qui laborieusement se hisse pour échapper aux noires entrailles de l'enfer
(Le poète russe Maïakowski avait sévèrement jugé le suicide de son célèbre contemporain Essenine quelques années plus tôt, ce qui devrait constituer un avertissement pour quiconque se sent enclin à condamner l'autodestruction.)
Lorsque l'on pense à ces créateurs, ces hommes et ces femmes dotés de tant de talent, et voués à la mort, on est amené à s'interroger sur leur enfance, l'enfance où tout le monde le sait, les germes de la maladie plongent leurs racines; se peut-il que certains d'entre eux aient eu, alors, une intuition de la nature périssable de la psyché, de la subtile fragilité? Et pourquoi eu furent-ils détruits, tandis que d'autres- frappés de façon similaire - parviennent à s'en sortir?
Lorsque l'on pense à ces créateurs, ces hommes et ces femmes dotés de tant de talent, et voués à la mort, on est amené à s'interroger sur leur enfance, l'enfance où tout le monde le sait, les germes de la maladie plongent leurs racines; se peut-il que certains d'entre eux aient eu, alors, une intuition de la nature périssable de la psyché, de la subtile fragilité? Et pourquoi eu furent-ils détruits, tandis que d'autres- frappés de façon similaire - parviennent à s'en sortir?
Videos de William Styron (7)
Voir plusAjouter une vidéo
Seul le silence de RJ Ellory - Bande-annonce
Joseph a douze ans lorsquil découvre dans son village de Géorgie le corps dune fillette assassinée. Une des premières victimes dune longue série de crimes. Des années plus tard, alors que laffaire semble enfin élucidée, Joseph sinstalle à New York. Mais, de nouveau, les meurtres denfants se multiplient Pour exorciser ses démons, Joseph part à la recherche de ce tueur qui le hante. Avec ce récit crépusculaire à la noirceur absolue, RJ Ellory évoque autant William Styron que Truman Capote, par la puissance de son écriture et la complexité des émotions quil met en jeu.
+ Lire la suite
autres livres classés : dépressionVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de William Styron (18)
Voir plus
Quiz
Voir plus
le choix de sophie
Quelle actrice connue d'hollywood a reprit dans un film le rôle de sophie ?
marylin Monroe
cameron diaz
jodie Foster
meryl Streep
6 questions
115 lecteurs ont répondu
Thème : Le choix de Sophie de
William StyronCréer un quiz sur ce livre115 lecteurs ont répondu