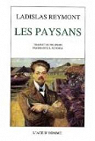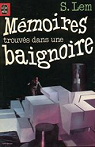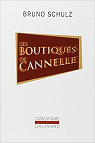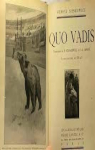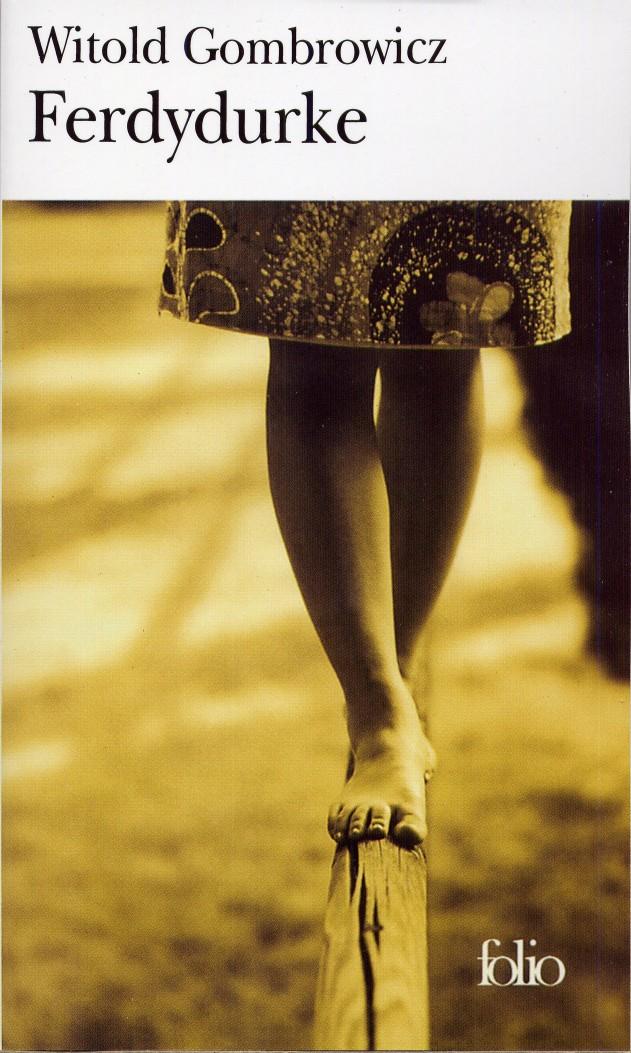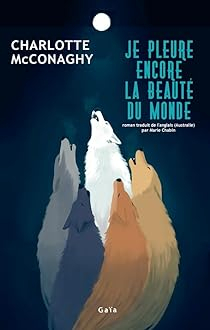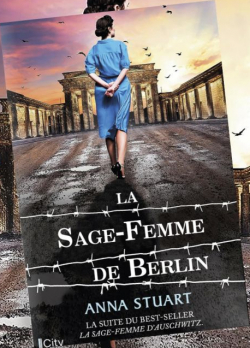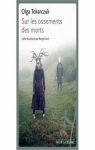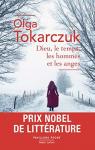Olga Tokarczuk
Maryla Laurent (Traducteur)/5 48 notes
Maryla Laurent (Traducteur)/5 48 notes
Résumé :
Nouvelle traduction - Editions Noir sur Blanc - ISBN 978-2-88250-696-2 - Parution : 02/09/2021
En Basse Silésie, aux confins de cette vieille Pologne, les paysages sont baignés dans un halo de brume grisâtre. La terre détrempée et boueuse se mêle au ciel bas et sans cesse pluvieux qui s'abat comme une chape de plomb sur des êtres sombres et presque sans vie. Tout ici semble avoir un goût âcre de terre. Dans cet univers où même les ténèbres sentent l'h... >Voir plus
En Basse Silésie, aux confins de cette vieille Pologne, les paysages sont baignés dans un halo de brume grisâtre. La terre détrempée et boueuse se mêle au ciel bas et sans cesse pluvieux qui s'abat comme une chape de plomb sur des êtres sombres et presque sans vie. Tout ici semble avoir un goût âcre de terre. Dans cet univers où même les ténèbres sentent l'h... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Maison de jour, maison de nuitVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (14)
Voir plus
Ajouter une critique
Le deuxième livre est toujours une étape importante. Pour l'auteur, qui doit confirmer les espoirs placés en lui après un premier succès ou inverser la tendance si le premier livre n'a pas trouvé son public. Mais également pour le lecteur, qui se lance dans l'aventure de relire un auteur qui soit lui a beaucoup plu (au risque de découvrir que ce n'était qu'un heureux hasard) soit lui a déplu mais à qui il souhaite donner une seconde chance (au risque de vivre une deuxième désillusion et d'enterrer ainsi définitivement l'écrivain en le sortant de toutes ses PAL).
Ce livre est le troisième roman de la prix Nobel polonaise Olga Tokarczuk... mais le deuxième traduit en français. Son premier roman n'a en effet pas eu les honneurs de la traduction... alors qu'ironiquement le lieu de l'action est la France du 17ème siècle. Avis aux éditeurs français qui pourraient avoir intérêt à commander une traduction, avec en plus le bandeau "Lauréate du Prix Nobel" toujours garantie de vente.
Ce livre est ma deuxième lecture... après celle du premier roman, je fais dans la lecture chronologique mais totalement par hasard puisque j'ai choisi ce livre uniquement parce qu'il était disponible dans ma bibliothèque. Mais tant mieux cela sera l'occasion de voir en quoi l'écriture de Tokarczuk évolue et en quoi elle se ressemble en avançant.
J'avais vraiment adoré Dieu, le temps, les hommes et les anges. Et quand on entame une deuxième lecture d'un auteur qu'on a fortement apprécié, on voit s'ouvrir plusieurs chemins: soit l'auteur restera dans la veine de ce qu'elle a écrit, soit l'auteur changera totalement de style, de genre, de narration. La première solution est à la fois rassurante et frustrante : l'auteure ne risque-t-elle pas de se répéter, de faire moins bien de la même façon et donc se révéler décevante ? La seconde solution serait inquiétante et excitante : va-t-elle déployer son talent d'écriture dans un nouveau format ou se perdre en cherchant à innover ?
Cette deuxième lecture prend le premier chemin. Tokarczuk reprend le format de son deuxième roman dans le troisième. le récit est organisé autour d'un cadre mais laisse se déployer plusieurs histoires en son sein. Là ou Dieu, le temps... se positionnait dans le village fictif d'Antan qui lui permettait ainsi d'explorer plusieurs périodes de l'histoire polonaise, elle pose son histoire dans un hameau proche de la ville de Nowa Ruda, en Silésie, à deux pas de la frontière tchèque. Dans cette région au carrefour des influences entre Allemagne, République Tchèque et Pologne en fonction des vicissitudes de l'Histoire et des déplacements de population, l'auteure peut ainsi encore nous promener dans le temps pour nous raconter un territoire, cette fois-ci réel, à travers le prisme des époques différentes.
Là où elle avait joué avec la fantasy en créant un monde à part entière dans son deuxième roman, elle prend ici comme fil rouge les rêves, ce qui lui permet aussi de garder une vraie liberté dans le récit, puisque rien n'est réellement impossible dans les rêves. L'auteur semble se sentir à l'étroit dans la réalité pure et froide et elle cherche à s'affranchir de ces limites et le biais du rêve est particulièrement bien choisi puisqu'elle l'utilise comme grille d'analyse de plusieurs phénomènes (religion, divination, et même lycanthropie cannibale à un moment).
Au delà des rêves, ces différents récits bénéficient également d'une histoire cadre avec une narratrice mystérieuse au mari seulement initialé (le taiseux R.) et ressemblant particulièrement par beaucoup d'aspects à l'auteure elle-même. En visite dans la région, acquéreurs d'une maison de vacances ô combien originale (traversée par une rivière, pas idéal pour l'humidité, mais avouez-le très poétique), ils nous permettent ainsi de rencontrer la galerie de personnages pittoresques, la voisine perruquière Marta, les bûcherons occasionnels Bidule Machin et Marek Marek. D'autres personnes ne sont que croisés mais cela ne les empêche pas de devenir les protagonistes principaux d'histoires plus développées, plus originales les unes que les autres, d'un cadavre trop proche de la frontière pour avoir une mort tranquille à un moine en questionnement sur son genre, en passant par une femme amoureuse d'un rêve.
La connaissance de la région et l'amour pour celle-ci se sentent parfaitement dans les mots de Tokarczuk. Elle s'est installée à Walbrzych, toute proche de Nowa Ruda, au début de sa carrière de psychothérapeute et a du sillonner ces chemins vallonnées, admirer ces paysages enneigés dans sa jeunesse. Son amour des champignons , déjà très présent dans le deuxième roman, s'exprime ici tout au long du récit, s'épanouissant même dans plusieurs recettes bien détaillées. Cet amour va même jusqu'à remettre en cause la classification de vénéneux, préférant tester par soi-même si le caractère comestible ne dépend pas autant de la femme qui le mange que du champignon lui-même... On ne conseille pas forcément de suivre ces conseils !
Avec tous ces ingrédients, vous devez vous dire que me voilà conquis et ravi... Et bien pas totalement ! J'ai beaucoup moins trouvé mon compte dans cette lecture que dans la première. Est-ce dû à la perte de la surprise de la découverte ou à une organisation qui m'a semblé moins ciselée ? Je me suis à certains moments perdu dans l'entremêlement d'histoires pourtant toutes très intéressantes. Peut-être que le récit cadre plus terre à terre m'a moins emporté que le village d'Antan si féérique dans sa normalité apparente.
Cela reste néanmoins une lecture très agréable, pleine de questions originales que je ne m'étais jamais posée, comme celle que j'ai relevée en citation : pourquoi ne change-t-on pas de nom lorsque la vie fait de nous des personnes parfois tellement différentes de celles que nous étions à la naissance ? Je vous laisse sur cette question, le temps de programmer pour dans quelques temps ma prochaine lecture de Tokarczuk, Les Pérégrins sans doute si je suis l'ordre chronologique que le hasard m'a créé !
Ce livre est le troisième roman de la prix Nobel polonaise Olga Tokarczuk... mais le deuxième traduit en français. Son premier roman n'a en effet pas eu les honneurs de la traduction... alors qu'ironiquement le lieu de l'action est la France du 17ème siècle. Avis aux éditeurs français qui pourraient avoir intérêt à commander une traduction, avec en plus le bandeau "Lauréate du Prix Nobel" toujours garantie de vente.
Ce livre est ma deuxième lecture... après celle du premier roman, je fais dans la lecture chronologique mais totalement par hasard puisque j'ai choisi ce livre uniquement parce qu'il était disponible dans ma bibliothèque. Mais tant mieux cela sera l'occasion de voir en quoi l'écriture de Tokarczuk évolue et en quoi elle se ressemble en avançant.
J'avais vraiment adoré Dieu, le temps, les hommes et les anges. Et quand on entame une deuxième lecture d'un auteur qu'on a fortement apprécié, on voit s'ouvrir plusieurs chemins: soit l'auteur restera dans la veine de ce qu'elle a écrit, soit l'auteur changera totalement de style, de genre, de narration. La première solution est à la fois rassurante et frustrante : l'auteure ne risque-t-elle pas de se répéter, de faire moins bien de la même façon et donc se révéler décevante ? La seconde solution serait inquiétante et excitante : va-t-elle déployer son talent d'écriture dans un nouveau format ou se perdre en cherchant à innover ?
Cette deuxième lecture prend le premier chemin. Tokarczuk reprend le format de son deuxième roman dans le troisième. le récit est organisé autour d'un cadre mais laisse se déployer plusieurs histoires en son sein. Là ou Dieu, le temps... se positionnait dans le village fictif d'Antan qui lui permettait ainsi d'explorer plusieurs périodes de l'histoire polonaise, elle pose son histoire dans un hameau proche de la ville de Nowa Ruda, en Silésie, à deux pas de la frontière tchèque. Dans cette région au carrefour des influences entre Allemagne, République Tchèque et Pologne en fonction des vicissitudes de l'Histoire et des déplacements de population, l'auteure peut ainsi encore nous promener dans le temps pour nous raconter un territoire, cette fois-ci réel, à travers le prisme des époques différentes.
Là où elle avait joué avec la fantasy en créant un monde à part entière dans son deuxième roman, elle prend ici comme fil rouge les rêves, ce qui lui permet aussi de garder une vraie liberté dans le récit, puisque rien n'est réellement impossible dans les rêves. L'auteur semble se sentir à l'étroit dans la réalité pure et froide et elle cherche à s'affranchir de ces limites et le biais du rêve est particulièrement bien choisi puisqu'elle l'utilise comme grille d'analyse de plusieurs phénomènes (religion, divination, et même lycanthropie cannibale à un moment).
Au delà des rêves, ces différents récits bénéficient également d'une histoire cadre avec une narratrice mystérieuse au mari seulement initialé (le taiseux R.) et ressemblant particulièrement par beaucoup d'aspects à l'auteure elle-même. En visite dans la région, acquéreurs d'une maison de vacances ô combien originale (traversée par une rivière, pas idéal pour l'humidité, mais avouez-le très poétique), ils nous permettent ainsi de rencontrer la galerie de personnages pittoresques, la voisine perruquière Marta, les bûcherons occasionnels Bidule Machin et Marek Marek. D'autres personnes ne sont que croisés mais cela ne les empêche pas de devenir les protagonistes principaux d'histoires plus développées, plus originales les unes que les autres, d'un cadavre trop proche de la frontière pour avoir une mort tranquille à un moine en questionnement sur son genre, en passant par une femme amoureuse d'un rêve.
La connaissance de la région et l'amour pour celle-ci se sentent parfaitement dans les mots de Tokarczuk. Elle s'est installée à Walbrzych, toute proche de Nowa Ruda, au début de sa carrière de psychothérapeute et a du sillonner ces chemins vallonnées, admirer ces paysages enneigés dans sa jeunesse. Son amour des champignons , déjà très présent dans le deuxième roman, s'exprime ici tout au long du récit, s'épanouissant même dans plusieurs recettes bien détaillées. Cet amour va même jusqu'à remettre en cause la classification de vénéneux, préférant tester par soi-même si le caractère comestible ne dépend pas autant de la femme qui le mange que du champignon lui-même... On ne conseille pas forcément de suivre ces conseils !
Avec tous ces ingrédients, vous devez vous dire que me voilà conquis et ravi... Et bien pas totalement ! J'ai beaucoup moins trouvé mon compte dans cette lecture que dans la première. Est-ce dû à la perte de la surprise de la découverte ou à une organisation qui m'a semblé moins ciselée ? Je me suis à certains moments perdu dans l'entremêlement d'histoires pourtant toutes très intéressantes. Peut-être que le récit cadre plus terre à terre m'a moins emporté que le village d'Antan si féérique dans sa normalité apparente.
Cela reste néanmoins une lecture très agréable, pleine de questions originales que je ne m'étais jamais posée, comme celle que j'ai relevée en citation : pourquoi ne change-t-on pas de nom lorsque la vie fait de nous des personnes parfois tellement différentes de celles que nous étions à la naissance ? Je vous laisse sur cette question, le temps de programmer pour dans quelques temps ma prochaine lecture de Tokarczuk, Les Pérégrins sans doute si je suis l'ordre chronologique que le hasard m'a créé !
Début de lecture assez déroutant avant de me rendre compte qu'il valait mieux prendre l'histoire, les histoires plutôt, comme elles venaient et ne pas tenter de trouver un sens global au livre ! On prend une grande respiration, on laisse aller son intellect et on profite des mots !
Le point commun à toutes histoires est le lieu où elles se situent, dans un village en Basse-Silésie aux confins de la Pologne, à la frontière de la Tchéquie, avec son cortège de personnes étranges, rêveuses, terre à terre mais surtout de toutes époques !
Nous ne saurons pas grand-chose de la narratrice, ni de qui j'imagine être son conjoint, qu'elle nomme R., si ce n'est qu'ils font un séjour annuel dans ce village, dans les années 1990 !
Des fragments de vie contemporaine, de légendes aussi, un peu de spiritualité, beaucoup de poésie dans ces textes qui mettent notre imagination en mouvement : champignons, perruques, un moine qui se voudrait femme, déplacements de population à la fin de la guerre, l'automne qui est la saison de la région, cruauté et merveilleux se nouent et tissent un roman surprenant et onirique !
A déguster !
Challenge Plumes Féminines 2022
Challenge 20ème Siècle 2022
Pioche dans ma PAL mai 2022 par CallieTourneLesPages
Le point commun à toutes histoires est le lieu où elles se situent, dans un village en Basse-Silésie aux confins de la Pologne, à la frontière de la Tchéquie, avec son cortège de personnes étranges, rêveuses, terre à terre mais surtout de toutes époques !
Nous ne saurons pas grand-chose de la narratrice, ni de qui j'imagine être son conjoint, qu'elle nomme R., si ce n'est qu'ils font un séjour annuel dans ce village, dans les années 1990 !
Des fragments de vie contemporaine, de légendes aussi, un peu de spiritualité, beaucoup de poésie dans ces textes qui mettent notre imagination en mouvement : champignons, perruques, un moine qui se voudrait femme, déplacements de population à la fin de la guerre, l'automne qui est la saison de la région, cruauté et merveilleux se nouent et tissent un roman surprenant et onirique !
A déguster !
Challenge Plumes Féminines 2022
Challenge 20ème Siècle 2022
Pioche dans ma PAL mai 2022 par CallieTourneLesPages
Un roman de Pologne rurale, près de la frontière tchèque, un texte qui va dans toutes les directions.
C'est d'abord l'histoire d'une femme qui vit dans la montagne près de sa voisine Martha. On a les arbres fruitiers, Martha élève des poulets et a fabriqué des perruques. Elle raconte aussi toutes sortes d'histoires sur la région, sur les Allemands qui y ont vécu, ou sur toutes sortes de personnages hauts en couleur.
Le propos du roman est discontinu, car entrecoupé de légendes, parfois intéressantes, parfois moins. Par exemple, la vie de sainte Kummernis, vierge et martyre, ainsi que celle de son biographe m'ont un peu lassée, j'avais hâte de finir ces histoires, et ce n'est jamais bon quand on considère ainsi une lecture. (On trouve d'ailleurs cette sainte sous le nom de Wilgeforte dans Wikipédia.)
Heureusement, il y a la qualité de l'écriture imagée, le propos tantôt incisif, tantôt loufoque, tantôt ancré dans le quotidien banal, tantôt flottant dans l'imaginaire ou le philosophique.
C'est d'abord l'histoire d'une femme qui vit dans la montagne près de sa voisine Martha. On a les arbres fruitiers, Martha élève des poulets et a fabriqué des perruques. Elle raconte aussi toutes sortes d'histoires sur la région, sur les Allemands qui y ont vécu, ou sur toutes sortes de personnages hauts en couleur.
Le propos du roman est discontinu, car entrecoupé de légendes, parfois intéressantes, parfois moins. Par exemple, la vie de sainte Kummernis, vierge et martyre, ainsi que celle de son biographe m'ont un peu lassée, j'avais hâte de finir ces histoires, et ce n'est jamais bon quand on considère ainsi une lecture. (On trouve d'ailleurs cette sainte sous le nom de Wilgeforte dans Wikipédia.)
Heureusement, il y a la qualité de l'écriture imagée, le propos tantôt incisif, tantôt loufoque, tantôt ancré dans le quotidien banal, tantôt flottant dans l'imaginaire ou le philosophique.
Quelle que soit l'oeuvre choisie, et elles sont assez diverses dans la forme, c'est toujours pour moi une expérience incroyable, ébouriffante et nourrissante de m'immerger dans l'univers d'Olga Tokarczuk et d'observer le monde à travers ses focales souvent inédites et toujours intéressantes : les réseaux micellaires, la poussée d'un cheveu ou encore les rêves des autres captés sur internet sont des prismes d'appréhension du monde que je ne trouve que chez elle, tout comme cette atmosphère suspendue entre pensée onirisée et rêverie fantastique.
Ce qui me plait particulièrement dans "Maison de jour...", son troisième roman, c'est sa fraîcheur, le naturel qui s'en dégage par rapport à son roman ultérieur "Les Pérégrins", plus mature, plus construit, plus reconnu aussi, mais qui, bien que construit sur un même modèle d'enchevêtrement d'histoires et réflexions subtilement liées les unes aux autres, dégage une énergie un peu moins spontanée.
Peu importe l'histoire, d'ailleurs irracontable, et dans laquelle j'ai à peine reconnu ce qu'en dit la quatrième de couverture: l'essentiel est dans le plaisir de lecture savouré chaque soir, tantôt auprès de la vieille et sage Martha qui tisse patiemment des perruques en été et hiberne en hiver, tantôt en immersion dans la vie d'une sainte à barbe, dans l'histoire d'un couple qui périclite, ou encore juchée comme ce cadavre sur la montagne à la frontière tchèque. Une expérience dont l'on ressort à la fois plus léger et plus riche.
Ce qui me plait particulièrement dans "Maison de jour...", son troisième roman, c'est sa fraîcheur, le naturel qui s'en dégage par rapport à son roman ultérieur "Les Pérégrins", plus mature, plus construit, plus reconnu aussi, mais qui, bien que construit sur un même modèle d'enchevêtrement d'histoires et réflexions subtilement liées les unes aux autres, dégage une énergie un peu moins spontanée.
Peu importe l'histoire, d'ailleurs irracontable, et dans laquelle j'ai à peine reconnu ce qu'en dit la quatrième de couverture: l'essentiel est dans le plaisir de lecture savouré chaque soir, tantôt auprès de la vieille et sage Martha qui tisse patiemment des perruques en été et hiberne en hiver, tantôt en immersion dans la vie d'une sainte à barbe, dans l'histoire d'un couple qui périclite, ou encore juchée comme ce cadavre sur la montagne à la frontière tchèque. Une expérience dont l'on ressort à la fois plus léger et plus riche.
Il est impossible de résumer ce livre, qui malgré son titre de roman ne contient pas de récit structuré, il s'agit de fragments, de morceaux, d'histoires de personnes ou de lieux, mélangés à une sorte de journal de la narratrice, narratrice dont ne nous savons presque rien, et qui paraît pourtant ressembler à l'auteur elle-même. Elle nous y décrit une vie très quotidienne, banale et sans éclats, de cuisine ou de visite à une voisine, et pourtant le merveilleux, le magique, et l'extraordinaire se cache dans les gestes apparemment sans importance de tous les jours. Et puis d'autres personnages, vivant ou disparus depuis longtemps surgissent au fil des pages, au grès de l'inspiration de l'auteur, ils ont des liens plus ou moins lâches avec la narratrice, comme cette femme qui entend une voix, qu'elle essaie de retrouver, et qui vit une étrange expérience, et dont la silhouette croise la narratrice. C'est donc un mélange de voix, de bouts d'histoires, de recettes de cuisine improbables et pleines de poésies, nous entrevoyons des vies, dont le point commun semble être la solitude et l'impossibilité de partager son expérience avec les autres. Une tapisserie aux couleurs un peu passées, pleine de détails qui constituent à chaque fois un monde en soi.
C'est par moments extraordinaire, certaines petites histoires sont des petits moments d'anthologie, que l'on a envie de lire et de relire pour les savourer. le style est limpide et dépouillé, tout en possédant une grand force d'évocation. Mais je trouve la construction à la longue un peu frustrante, cette narratrice dont on ne sait rien, qui ne se livre pas, devient lassante, et la juxtaposition de morceaux sans lien apparent, tout au moins pour moi, commence à moins bien fonctionner au bout d'un moment à mon sens . C'est néanmoins une lecture troublante et qui laisse des traces, et je poursuivrai l'exploration de l'auteur.
C'est par moments extraordinaire, certaines petites histoires sont des petits moments d'anthologie, que l'on a envie de lire et de relire pour les savourer. le style est limpide et dépouillé, tout en possédant une grand force d'évocation. Mais je trouve la construction à la longue un peu frustrante, cette narratrice dont on ne sait rien, qui ne se livre pas, devient lassante, et la juxtaposition de morceaux sans lien apparent, tout au moins pour moi, commence à moins bien fonctionner au bout d'un moment à mon sens . C'est néanmoins une lecture troublante et qui laisse des traces, et je poursuivrai l'exploration de l'auteur.
Citations et extraits (31)
Voir plus
Ajouter une citation
Les yeux sont ainsi faits, ils voient une portion inerte d'un tout plus grand, vivant, et ce qu'ils voient, ils l'épinglent et le tuent. C'est pourquoi, quand je regarde les choses, je suis persuadé que je vois du permanent. C'est pourtant une image fausse du monde, lequel est labile et tremblant. Il n'y a en lui aucun point zéro dont on pourrait se souvenir et que l'on pourrait comprendre. Les yeux font des photographies qui ne peuvent être qu'un inventaire, un schéma.
Le paysage relève de la plus grande des illusions, parce qu'il ne saurait avoir de permanence. On s'en souvient comme si c'était un tableau. La mémoire crée des cartes postales sans comprendre en aucune manière le monde. Voilà pourquoi le paysage s'adapte tellement aux états d'âme de ceux qui le regardent. Les gens y voient leur propre intériorité d'un instant éphémère. Partout l'on ne voit que soi. Rien de plus.
Le paysage relève de la plus grande des illusions, parce qu'il ne saurait avoir de permanence. On s'en souvient comme si c'était un tableau. La mémoire crée des cartes postales sans comprendre en aucune manière le monde. Voilà pourquoi le paysage s'adapte tellement aux états d'âme de ceux qui le regardent. Les gens y voient leur propre intériorité d'un instant éphémère. Partout l'on ne voit que soi. Rien de plus.
Désormais, ils étaient devenus des êtres tellement différents qu'ils auraient pu changer de prénom et de nom ; aller déposer une demande à la mairie : "Nous ne sommes plus ceux que nous étions. Nous souhaitons un changement d'identité", ou quelque chose de ce genre. Qu'en-est il des registres d'actes civils quand les gens se transforment et deviennent différents ? Pourquoi un enfant porte-t-il le même prénom quand il est devenu adulte ? Pourquoi une femme aimée s'appelle-t-elle de la même manière lorsqu'elle a été trompée et abandonnée ? Pourquoi les hommes gardent-ils leur nom quand ils rentrent de la guerre, ou encore pourquoi un garçon battu par son père conserve-t-il le même prénom idiot quand il se met à battre ses enfants ?
Cosmogonies
Mon philosophe favori est Arkhémanês, l'un des maîtres de Pythagore. Selon Arkhémanês, le monde est créé par l'action conguguée de deux principes. Arkhémanês les considère comme de puissants êtres originels, omniprésents et éternels. Le terme le plus approprié pour qualifier cette action conjuguée, pourrait être "éternel engloutissement". L'un mange l'autre, sans fin. En cela consiste l'existence du monde. Le premier de ces êtres, c'est Chtonos. Quelque chose qui en permanence croît, bourgeonne, enfante. Le but et le moyen de son existence, c'est de créer à partir de soi-même. Cette création ne consiste pas seulement à se reproduire, mais aussi à faire émaner de soi des êtres qui ne lui ressemblent pas - ou même qui lui sont opposés. C'est pourquoi, à l'intérieur de Chtonos, se poursuit sans cesse une croissance aveugle et irréfléchie - la chair à canon de l'existence. L'autre être, Chaos, engloutit Chtonos, le consomme, en quelque sorte. Sans cesse et de manière infaillible. Chaos est immatériel, il dissout les espaces de Chtonos comme s'il les digérait. Sans Chtonos, il ne pourrait pas exister, et vice versa. Il transforme Chtonos en néant - aujourd'hui, nous dirions qu'il l'annihile.
L'union de ces deux êtres est extraordinairement intense, et elle donne naissance à Chronos - un principe qu'on pourrait valablement comparer à l'oeil d'un cyclone. En plein centre de l'engloutissement, de la destruction, de l'annihilation se crée un être qui a l'apparence de la paix, un être-oasis, presque un mirage, caractérisé par la stabilité, la régularité, l'ordre et même une certaine harmonie d'où l'existence du monde tire son origine. Chronos freine l'engloutissement, lui donne une certaine forme. D'un côté, il tamise l'oeuvre de création, en rassemble les résultats en petits îlots ordonnés par le temps - lequel constitue l'essence même de Chronos, son principe de base ; d'un autre côté, il atténue l'impact de la destruction. À cet endroit se crée le monde et ses énergies fondamentales.
Mon philosophe favori est Arkhémanês, l'un des maîtres de Pythagore. Selon Arkhémanês, le monde est créé par l'action conguguée de deux principes. Arkhémanês les considère comme de puissants êtres originels, omniprésents et éternels. Le terme le plus approprié pour qualifier cette action conjuguée, pourrait être "éternel engloutissement". L'un mange l'autre, sans fin. En cela consiste l'existence du monde. Le premier de ces êtres, c'est Chtonos. Quelque chose qui en permanence croît, bourgeonne, enfante. Le but et le moyen de son existence, c'est de créer à partir de soi-même. Cette création ne consiste pas seulement à se reproduire, mais aussi à faire émaner de soi des êtres qui ne lui ressemblent pas - ou même qui lui sont opposés. C'est pourquoi, à l'intérieur de Chtonos, se poursuit sans cesse une croissance aveugle et irréfléchie - la chair à canon de l'existence. L'autre être, Chaos, engloutit Chtonos, le consomme, en quelque sorte. Sans cesse et de manière infaillible. Chaos est immatériel, il dissout les espaces de Chtonos comme s'il les digérait. Sans Chtonos, il ne pourrait pas exister, et vice versa. Il transforme Chtonos en néant - aujourd'hui, nous dirions qu'il l'annihile.
L'union de ces deux êtres est extraordinairement intense, et elle donne naissance à Chronos - un principe qu'on pourrait valablement comparer à l'oeil d'un cyclone. En plein centre de l'engloutissement, de la destruction, de l'annihilation se crée un être qui a l'apparence de la paix, un être-oasis, presque un mirage, caractérisé par la stabilité, la régularité, l'ordre et même une certaine harmonie d'où l'existence du monde tire son origine. Chronos freine l'engloutissement, lui donne une certaine forme. D'un côté, il tamise l'oeuvre de création, en rassemble les résultats en petits îlots ordonnés par le temps - lequel constitue l'essence même de Chronos, son principe de base ; d'un autre côté, il atténue l'impact de la destruction. À cet endroit se crée le monde et ses énergies fondamentales.
Je suis allée chez Marta pour lui rendre service en fauchant les orties du sentier qui conduit au ruisseau. Elle piétinait derrière moi, les bras croisés, et elle prétendait que Dieu avait oublié de créer un tas d'animaux.
"Le pataugeur, dis-je. Il serait dur comme une tortue, mais muni de longues jambes et de dents broyeuses. Il se baladerait dans le ruisseau, boufferait toutes les saletés, la vase, les branches mortes, même les ordures que l'eau apporte du village."
C'est ainsi que nous commençâmes à évoquer tous les animaux que Dieu avait omis de créer pour des raisons connues de lui seul. Il a oublié tant d'oiseaux, tant d'animaux qui vivent sous terre. A la fin, Marta déclara que l'animal qui lui manquait le plus, c'était ce grand lourdaud qui vient s'assoir, la nuit, à la croisée des chemins. Elle ne mentionna pas son nom.
"Le pataugeur, dis-je. Il serait dur comme une tortue, mais muni de longues jambes et de dents broyeuses. Il se baladerait dans le ruisseau, boufferait toutes les saletés, la vase, les branches mortes, même les ordures que l'eau apporte du village."
C'est ainsi que nous commençâmes à évoquer tous les animaux que Dieu avait omis de créer pour des raisons connues de lui seul. Il a oublié tant d'oiseaux, tant d'animaux qui vivent sous terre. A la fin, Marta déclara que l'animal qui lui manquait le plus, c'était ce grand lourdaud qui vient s'assoir, la nuit, à la croisée des chemins. Elle ne mentionna pas son nom.
Ce n'est pas une raison pour ne pas croire aux rêves, finit-elle par se dire. Ils ont toujours un sens, c'est le monde réel qui n'arrive pas à la cheville des rêves. Les bottins mentent, les trains prennent des directions erronées. Les rues se ressemblent trop, les lettres s'emmêlent dans les noms des villes, les gens oublient leur propre prénom. Seul le rêve est vrai.
Videos de Olga Tokarczuk (9)
Voir plusAjouter une vidéo
Avec Catherine Cusset, Lydie Salvayre, Grégory le Floch & Jakuta Alikavazovic
Animé par Olivia Gesbert, rédactrice en chef de la NRF
Quatre critiques de la Nouvelle Revue Française, la prestigieuse revue littéraire de Gallimard, discutent ensemble de livres récemment parus. Libres de les avoir aimés ou pas aimés, ces écrivains, que vous connaissez à travers leurs livres, se retrouvent sur la scène de la Maison de la Poésie pour partager avec vous une expérience de lecteurs, leurs enthousiasmes ou leurs réserves, mais aussi un point de vue sur la littérature d'aujourd'hui. Comment un livre rencontre-t-il son époque ? Dans quelle histoire littéraire s'inscrit-il ? Cette lecture les a-t-elle transformés ? Ont-ils été touchés, convaincus par le style et les partis pris esthétiques de l'auteur ? Et vous ?
Au cours de cette soirée il devrait être question de Triste tigre de Neige Sinno (P.O.L.) ; American Mother de Colum McCann (Belfond), le murmure de Christian Bobin (Gallimard) ; le banquet des Empouses de Olga Tokarczuk (Noir sur Blanc).
À lire – Catherine Cusset, La définition du bonheur, Gallimard, 2021. Lydie Salvayre, Depuis toujours nous aimons les dimanches, le Seuil, 2024. Grégory le Floch, Éloge de la plage, Payot et Rivages, 2023. Jakuta Alikavazovic, Comme un ciel en nous, Coll. « Ma nuit au musée », Stock 2021.
Lumière par Valérie Allouche Son par Adrien Vicherat Direction technique par Guillaume Parra Captation par Claire Jarlan
Quatre critiques de la Nouvelle Revue Française, la prestigieuse revue littéraire de Gallimard, discutent ensemble de livres récemment parus. Libres de les avoir aimés ou pas aimés, ces écrivains, que vous connaissez à travers leurs livres, se retrouvent sur la scène de la Maison de la Poésie pour partager avec vous une expérience de lecteurs, leurs enthousiasmes ou leurs réserves, mais aussi un point de vue sur la littérature d'aujourd'hui. Comment un livre rencontre-t-il son époque ? Dans quelle histoire littéraire s'inscrit-il ? Cette lecture les a-t-elle transformés ? Ont-ils été touchés, convaincus par le style et les partis pris esthétiques de l'auteur ? Et vous ?
Au cours de cette soirée il devrait être question de Triste tigre de Neige Sinno (P.O.L.) ; American Mother de Colum McCann (Belfond), le murmure de Christian Bobin (Gallimard) ; le banquet des Empouses de Olga Tokarczuk (Noir sur Blanc).
À lire – Catherine Cusset, La définition du bonheur, Gallimard, 2021. Lydie Salvayre, Depuis toujours nous aimons les dimanches, le Seuil, 2024. Grégory le Floch, Éloge de la plage, Payot et Rivages, 2023. Jakuta Alikavazovic, Comme un ciel en nous, Coll. « Ma nuit au musée », Stock 2021.
Lumière par Valérie Allouche Son par Adrien Vicherat Direction technique par Guillaume Parra Captation par Claire Jarlan
+ Lire la suite
Dans la catégorie :
Littérature polonaiseVoir plus
>Littératures indo-européennes>Balto-slaves : Bulgare, macédonienne, serbo-croate>Littérature polonaise (69)
autres livres classés : littérature polonaiseVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Olga Tokarczuk (15)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Auteur Mystère cher à mon Petit Coeur
Une pincée d'anticipation sociale:
Outrage et rébellion
Copyright
8 questions
8 lecteurs ont répondu
Thèmes :
polar noir
, romans policiers et polars
, noir
, littératureCréer un quiz sur ce livre8 lecteurs ont répondu