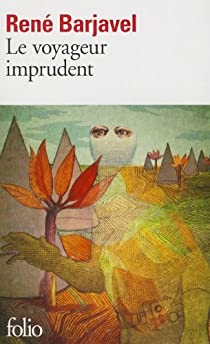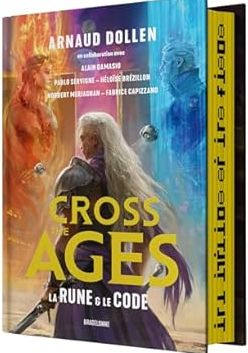René Barjavel/5
1592 notes
Résumé :
" Le lendemain, il avança d'un siècle de plus. Puis de deux, de trois, de cinq. Ce qu'il vit et rapporta à l'infirme leur parut tellement effrayant qu'ils décidèrent, d'un commun accord, de faire en avant un bond gigantesque pour être immédiatement fixés sur le sort de leurs lointains petits-enfants.
En effet, si l'électricité avait disparu, et la civilisation de la machine trouvé son terme, une force nouvelle était née ; l'humanité, qui avait appris à l'util... >Voir plus
En effet, si l'électricité avait disparu, et la civilisation de la machine trouvé son terme, une force nouvelle était née ; l'humanité, qui avait appris à l'util... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Le Voyageur imprudentVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (129)
Voir plus
Ajouter une critique
On ne joue pas avec le temps sans s'en attirer les foudres !
C'est ce que vont découvrir le physicien Noël Essaillon, sa charmante fille Annette (eh, eh!...) et le mathématicien Pierre Saint-Menoux (eh,eh,he!). Grâce aux articles de Saint-Menoux, Noël a mis au point une substance, la noëlite, qui permet de voyager dans le temps. Il pense disposer du temps à sa guise ... et pouvoir agir sur le bonheur de l'humanité. Pauvre homme! Pauvres hommes!
Publié en 1944, ce livre a sacrément bien vieilli pour un roman d'anticipation! Malgré quelques incohérences (selon moi, mais je ne donnerai pas plus de détails pour ne pas spoiler), malgré une conception de la femme et de l'amour assez rétrograde - bah oui, désolée mesdames! ...et (mal)heureux messieurs! -, il n'en demeure pas moins captivant. Il est comme ce bout sparadrap dont on essaierait en vain de se débarrasser ! J'ai en tête l'image du capitaine haddock dans une des BD de Tintin (je ne souviens plus de laquelle) qui lutte pour se débarrasser sans grand succès d'un bout de sparadrap ! Ce livre est pareil. Quelque soit les reproches qu'on pourrait lui faire, il est drôlement accrocheur!!
Il serait difficile de ne pas faire le rapprochement avec la machine à explorer le temps de H.G.Wells. Pourtant, ce livre-ci va plus bien loin, ne serait ce que parce qu'il introduit le paradoxe temporel. Personnellement, j'ai préféré celui-ci. Mais j'admets aussi avoir beaucoup de mal avec le style de HG Wells. Je ne sais donc pas si cette remarque est très pertinente. Cependant, j'ai bien aimé la construction, sous forme de strates. 3 chapitres, 3 strates, évolutives, qui paraissent de prime abord indépendantes, un peu comme une culture en terrasse, une culture des rizières du temps :) La vision du futur que Barjavel propose est glaçante. Elle n'en est pourtant pas moins ni plus barbare que celle d'aujourd'hui, juste différente. Elle donne une vision de l'évolution de l'humanité que je préférerai ne pas voir. Ooooh... comme elles sont belles mes oeillères! La dernière partie (la troisième strate) est de loin la plus intéressante et la plus surprenante. Elle fait voler en éclats ce qu'on pouvait penser des protagonistes initialement... elle fait tout voler en éclat en fait! Génial!
Un très grand merci à Nadou38 d'avoir fait ce voyage avec moi ! ...un monde parallèle enrichissant!
C'est ce que vont découvrir le physicien Noël Essaillon, sa charmante fille Annette (eh, eh!...) et le mathématicien Pierre Saint-Menoux (eh,eh,he!). Grâce aux articles de Saint-Menoux, Noël a mis au point une substance, la noëlite, qui permet de voyager dans le temps. Il pense disposer du temps à sa guise ... et pouvoir agir sur le bonheur de l'humanité. Pauvre homme! Pauvres hommes!
Publié en 1944, ce livre a sacrément bien vieilli pour un roman d'anticipation! Malgré quelques incohérences (selon moi, mais je ne donnerai pas plus de détails pour ne pas spoiler), malgré une conception de la femme et de l'amour assez rétrograde - bah oui, désolée mesdames! ...et (mal)heureux messieurs! -, il n'en demeure pas moins captivant. Il est comme ce bout sparadrap dont on essaierait en vain de se débarrasser ! J'ai en tête l'image du capitaine haddock dans une des BD de Tintin (je ne souviens plus de laquelle) qui lutte pour se débarrasser sans grand succès d'un bout de sparadrap ! Ce livre est pareil. Quelque soit les reproches qu'on pourrait lui faire, il est drôlement accrocheur!!
Il serait difficile de ne pas faire le rapprochement avec la machine à explorer le temps de H.G.Wells. Pourtant, ce livre-ci va plus bien loin, ne serait ce que parce qu'il introduit le paradoxe temporel. Personnellement, j'ai préféré celui-ci. Mais j'admets aussi avoir beaucoup de mal avec le style de HG Wells. Je ne sais donc pas si cette remarque est très pertinente. Cependant, j'ai bien aimé la construction, sous forme de strates. 3 chapitres, 3 strates, évolutives, qui paraissent de prime abord indépendantes, un peu comme une culture en terrasse, une culture des rizières du temps :) La vision du futur que Barjavel propose est glaçante. Elle n'en est pourtant pas moins ni plus barbare que celle d'aujourd'hui, juste différente. Elle donne une vision de l'évolution de l'humanité que je préférerai ne pas voir. Ooooh... comme elles sont belles mes oeillères! La dernière partie (la troisième strate) est de loin la plus intéressante et la plus surprenante. Elle fait voler en éclats ce qu'on pouvait penser des protagonistes initialement... elle fait tout voler en éclat en fait! Génial!
Un très grand merci à Nadou38 d'avoir fait ce voyage avec moi ! ...un monde parallèle enrichissant!
Par des temps où l'on en vient à vous seriner que tout voyage est imprudent autant l'effectuer dans le temps. Paru en 1944, toujours actuel ! le présent n'est-il pas le résultat déjà dépassé des passés ? Pour s'évader de la médiatisation outrancière d'un épiphénomène avant tout lié à la surpopulation de l'espèce invasive dont les carnages sont passés sous silence, quoi de mieux que ce voyage dans le temps avec René Barjavel ?
Autant j'avais émis des réticences pour Ravage, autant je suis fan inconditionnel de celui-ci. Vraiment il y a tout, jusqu'à toucher le néant et le paradoxe du temps. Oserai-je en une ellipse : Jules Verne sans les longueurs ? Alors même si vous n'avez pas le temps : prenez-le ! C'est la tournée à René ! "Le présent, est-ce le moment où je déguste cette merveilleuse liqueur ? Non ! Tant qu'elle n'a pas atteint mes lèvres c'est l'avenir. Quand la sensation de son goût, de sa chaleur, qui m'emplit la bouche, quand ce plaisir atteint mon cerveau, il a déjà quitté mon palais. C'est le passé. L'avenir sombre dans le passé dès qu'il a cessé d'être le futur. le présent n'existe pas." p.45
P.S. Oui, oui : en Mars 1958 Barjavel complète par un magistral post-scriptum : "Etre ET ne pas être, voilà la question. A moins que ce ne soit une réponse..." p.245
Elémentaires particules qui donnent toute sa noblesse à cet incontournable !
Autant j'avais émis des réticences pour Ravage, autant je suis fan inconditionnel de celui-ci. Vraiment il y a tout, jusqu'à toucher le néant et le paradoxe du temps. Oserai-je en une ellipse : Jules Verne sans les longueurs ? Alors même si vous n'avez pas le temps : prenez-le ! C'est la tournée à René ! "Le présent, est-ce le moment où je déguste cette merveilleuse liqueur ? Non ! Tant qu'elle n'a pas atteint mes lèvres c'est l'avenir. Quand la sensation de son goût, de sa chaleur, qui m'emplit la bouche, quand ce plaisir atteint mon cerveau, il a déjà quitté mon palais. C'est le passé. L'avenir sombre dans le passé dès qu'il a cessé d'être le futur. le présent n'existe pas." p.45
P.S. Oui, oui : en Mars 1958 Barjavel complète par un magistral post-scriptum : "Etre ET ne pas être, voilà la question. A moins que ce ne soit une réponse..." p.245
Elémentaires particules qui donnent toute sa noblesse à cet incontournable !
J'ai lu le Voyageur Imprudent tardivement. En fait, j'ai appris son existence étonnamment tard. Soit par lacune personnelle, soit à cause de la distance géographique et culturelle entre la France et le Québec. Mais bon, quand j'ai su qu'il existait un roman de science-fiction français, de voyage dans le temps, écrit pendant la Deuxième Guerre mondiale, il fallait que je le lise.
Et cela a été toute une surprise, ce livre est une mine d'étrangeté!
Dès le départ, le contexte de la guerre est évacué. le protagoniste voyage dans un futur proche, après la guerre. Sans dire combien de temps plus tard exactement, ni qui l'a gagnée.
J'ai souvent vu le livre cité comme l'inventeur du Paradoxe du Grand-père. C'est faux, de nombreux auteurs de pulps américains avaient exploré le concept avant (même si Barjavel n'avait aucune façon de le savoir).
L'originalité est dans le ton, à des lieues de ce qui se faisait à l'époque. le premier réflexe du protagoniste quand il se rencontre lui-même? Il s'enlace et se tripote.
Puis on part dans un futur lointain où l'on voit où l'évolution a poussé l'humanité. Ce futur lointain que Barjavel nous construit est... complètement disjoncté! On sent bien l'influence de Wells, mais aussi le désir d'aller beaucoup plus loin.
Et puis, il y a aussi une histoire d'amour. Dont la principale caractéristique est, disons, d'exister.
Et cela a été toute une surprise, ce livre est une mine d'étrangeté!
Dès le départ, le contexte de la guerre est évacué. le protagoniste voyage dans un futur proche, après la guerre. Sans dire combien de temps plus tard exactement, ni qui l'a gagnée.
J'ai souvent vu le livre cité comme l'inventeur du Paradoxe du Grand-père. C'est faux, de nombreux auteurs de pulps américains avaient exploré le concept avant (même si Barjavel n'avait aucune façon de le savoir).
L'originalité est dans le ton, à des lieues de ce qui se faisait à l'époque. le premier réflexe du protagoniste quand il se rencontre lui-même? Il s'enlace et se tripote.
Puis on part dans un futur lointain où l'on voit où l'évolution a poussé l'humanité. Ce futur lointain que Barjavel nous construit est... complètement disjoncté! On sent bien l'influence de Wells, mais aussi le désir d'aller beaucoup plus loin.
Et puis, il y a aussi une histoire d'amour. Dont la principale caractéristique est, disons, d'exister.
« Un voyageur imprudent » de Barjavel publié un peu après le célèbre « Ravage » en est une suite… ou un prequel ! Oui comment le placer dans le temps ? Futur, passé, présent… Dur à définir à la sortie de ce livre ! Un roman qui se veut rempli de pensées philosophiques sur le temps, l'évolution de l'humanité, l'amour, la science… Un roman qui surpasse de très loin le plus connu « Ravage » même si on retrouve la misogynie dérangeante de l'auteur !
Nous nous situons donc dans les années 40, temps de guerre, Vichy et compagnie. Temps sombres où un professeur de mathématique rencontre un autre savant qui a découvert une matière qui permet de figer le présent. Avec cette matière, il devient possible de voyager dans le temps !
Les voyages dans le temps m'ont toujours passionné… A commencer par « Retour vers le futur » qui a bercé mon enfance ! Il y a eu aussi les écrits de Wells (que je n'ai pas lu) et puis donc ce Barjavel que j'étais impatient de commencer ! Des voyages en 2052 (quel hasard !), à la fin du XIXe et du XVIIIe mais aussi au Me.
Et c'est en 100 000 après JC que la fantaisie de Barjavel nous frappe. On avait bien vu qu'il était visionnaire pour 2052 alors on ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour notre avenir évolutif… L'humanité devient C'est tout simplement fascinant et flippant à la fois surtout que Enfin, je ne dévoilerai rien du dénouement de l'histoire mais je pense qu'on ne pouvait trouver plus belle fin ! Une des meilleures que j'ai lue certainement…
A côté de cela, il y a aussi l'histoire d'amour entre le héros et la fille du scientifique fou… Une histoire pas si simple au milieu de tout ce monde de sciences. Barjavel arrive également à glisser de sacré rebondissement qui nous fait accélérer le rythme cardiaque
Ainsi pouvons-nous changer le passé ? Qu'arrive-t-il quand nous le changeons ? L'évolution, la cruauté, l'histoire de l'Humanité s'inscrit elle dans un dessein qui ne saurait être modifié ? C'est toutes ces questions qui sont explorées dans cet excellent bouquin que je recommande ! Et pas besoin d'avoir lu Ravage même si la fin de ce dernier et dévoilée !
Nous nous situons donc dans les années 40, temps de guerre, Vichy et compagnie. Temps sombres où un professeur de mathématique rencontre un autre savant qui a découvert une matière qui permet de figer le présent. Avec cette matière, il devient possible de voyager dans le temps !
Les voyages dans le temps m'ont toujours passionné… A commencer par « Retour vers le futur » qui a bercé mon enfance ! Il y a eu aussi les écrits de Wells (que je n'ai pas lu) et puis donc ce Barjavel que j'étais impatient de commencer ! Des voyages en 2052 (quel hasard !), à la fin du XIXe et du XVIIIe mais aussi au Me.
Et c'est en 100 000 après JC que la fantaisie de Barjavel nous frappe. On avait bien vu qu'il était visionnaire pour 2052 alors on ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour notre avenir évolutif… L'humanité devient C'est tout simplement fascinant et flippant à la fois surtout que Enfin, je ne dévoilerai rien du dénouement de l'histoire mais je pense qu'on ne pouvait trouver plus belle fin ! Une des meilleures que j'ai lue certainement…
A côté de cela, il y a aussi l'histoire d'amour entre le héros et la fille du scientifique fou… Une histoire pas si simple au milieu de tout ce monde de sciences. Barjavel arrive également à glisser de sacré rebondissement qui nous fait accélérer le rythme cardiaque
Ainsi pouvons-nous changer le passé ? Qu'arrive-t-il quand nous le changeons ? L'évolution, la cruauté, l'histoire de l'Humanité s'inscrit elle dans un dessein qui ne saurait être modifié ? C'est toutes ces questions qui sont explorées dans cet excellent bouquin que je recommande ! Et pas besoin d'avoir lu Ravage même si la fin de ce dernier et dévoilée !
Mon premier Barjavel ! J’étais un peu prudente parce que ce roman date de 1944 et j’avais peur qu’il ait mal vieilli. Mais comme La guerre éternelle de Joe Halderman (dans un tout autre genre), il s’est bien conservé. Je n’avais pas lu la quatrième de couverture, je savais seulement qu’il était question de voyage dans le temps. La première partie est un peu longue, Barjavel pose les bases de son histoire, comment on voyage, les différentes options qui s’offre à Pierre Saint-Menoux, quelques essais de rodage… on trépigne d’impatience !
Le style de Barjavel est surprenant, on alterne entre les frissons et les sourires, l’horreur et les gloussements. Au final, j’ai beaucoup aimé ce livre : Barjavel aborde beaucoup de thèmes ici : questionnement sur la société, l’homme, l’amour par le biais des voyages temporels. Les voyages dans le futur m’ont un peu dégoûtée par les descriptions détaillées et glauques. Le personnage de Noël Essaillon donne une petite allure de fable à cette histoire avec son sourire permanent et son ventre débordant. J’ai préféré les expéditions dans le passé qui donnent tout son sens au titre… Petite remarque : Barjavel était-il misogyne ou un homme de son époque ? J’ai cillé à certains passages relevés sur le rôle de la femme… sans réellement m’en offusquer. Je relirai cet auteur, au moins Ravage pour saisir les allusions glissées subtilement dans les pages.
A noter : il a été adapté en téléfilm en 1981 avec Thierry Lhermitte. A voir ce que ça peut donner !
Le style de Barjavel est surprenant, on alterne entre les frissons et les sourires, l’horreur et les gloussements. Au final, j’ai beaucoup aimé ce livre : Barjavel aborde beaucoup de thèmes ici : questionnement sur la société, l’homme, l’amour par le biais des voyages temporels. Les voyages dans le futur m’ont un peu dégoûtée par les descriptions détaillées et glauques. Le personnage de Noël Essaillon donne une petite allure de fable à cette histoire avec son sourire permanent et son ventre débordant. J’ai préféré les expéditions dans le passé qui donnent tout son sens au titre… Petite remarque : Barjavel était-il misogyne ou un homme de son époque ? J’ai cillé à certains passages relevés sur le rôle de la femme… sans réellement m’en offusquer. Je relirai cet auteur, au moins Ravage pour saisir les allusions glissées subtilement dans les pages.
A noter : il a été adapté en téléfilm en 1981 avec Thierry Lhermitte. A voir ce que ça peut donner !
critiques presse (1)
C’est pour le Voyageur imprudent qu’il mérite d’être dans nos mémoires.
Lire la critique sur le site : Actualitte
Citations et extraits (104)
Voir plus
Ajouter une citation
Les chasseurs pyrénéens du 27ème bataillon occupaient depuis deux mois le village de Vanesse, au bord de la plaine de betteraves. Ils devaient le quitter ce jour là, pour une destination inconnue. Le caporal d’échelon, Pierre Saint-Menoux, enfoui dans la paille de l’écurie, dormit peu, tourmenté par le souci de son septième déménagement. Il était responsable des dix-sept conducteurs de la compagnie de mitrailleuses, de leurs chevaux et de leurs voitures. Dans le civil, il enseignait les mathématiques au lycée Philippe-Auguste.
……………….
Pilastre arrivait avec ses deux chevaux. Il les tenait à bout de longe. Il se méfiait d’eux. Il était tourneur sur métaux. Son patron lui avait promis de le faire revenir à l’usine. Il ne connaissait rien aux bêtes. Il ne les aimait pas. Il n’aurait pas du être là. Il enrageait. Ses bêtes ne voulaient pas le connaître. L’une feu, l’autre noire, elles se détestaient autant qu’elles le craignaient. Les atteler n’était pas une mince affaire. Pilastre les frappait du poing dans les naseaux. Les chevaux reculaient, se cabraient, cherchaient à se mordre.
La roulante était une sorte de cuirassé, un monument de fer et d’acier, hérissé de trois mille têtes de rivets, porté par quatre roues ferrées, aux rayons gros comme des cuisses. Au milieu de la cour, Pilastre et ses deux chevaux dansèrent leur ballet de colère. Derrière eux, les quatre cuisiniers, casque en tête, et le mousqueton en bandoulière sur leur capote de graisse, activaient le feu , jetaient bûche après bûche dans le foyer grondant, sous les deux marmites énormes où cuisait la soupe et chauffait le café d’embarquement.
Pilastre se hissa sur le siège, s’empaqueta dans trois couvertures, saisit une trique et se mit à frapper. Les croupes bondirent, la neige vola, les chaînes cliquetèrent, le timon gémit. La roulante ne bougea pas. Chaque bête tirait de son côté, annulait l’effort de l’autre par son propre effort.
Crédent ôta sa pipe de sa bouche, cracha.
- Quel sauvage ! dit-il. Des bêtes pareilles…
Le conducteur se dressa et redoubla les coups. La haine lui creusait les joues et les yeux. Par hasard, les huit sabots se plantèrent ensemble dans la neige. La roulante partit brusquement. Pilastre tomba sur son siège. Les deux chevaux puissants traversèrent la cour au galop. Dans un bruit de train express, la roulante sauta par-dessus le tas de fumier gelé, arracha la grille d’entrée, vira au ras du fossé, pulvérisa la borne zéro kilomètre.
……………….
Pilastre arrivait avec ses deux chevaux. Il les tenait à bout de longe. Il se méfiait d’eux. Il était tourneur sur métaux. Son patron lui avait promis de le faire revenir à l’usine. Il ne connaissait rien aux bêtes. Il ne les aimait pas. Il n’aurait pas du être là. Il enrageait. Ses bêtes ne voulaient pas le connaître. L’une feu, l’autre noire, elles se détestaient autant qu’elles le craignaient. Les atteler n’était pas une mince affaire. Pilastre les frappait du poing dans les naseaux. Les chevaux reculaient, se cabraient, cherchaient à se mordre.
La roulante était une sorte de cuirassé, un monument de fer et d’acier, hérissé de trois mille têtes de rivets, porté par quatre roues ferrées, aux rayons gros comme des cuisses. Au milieu de la cour, Pilastre et ses deux chevaux dansèrent leur ballet de colère. Derrière eux, les quatre cuisiniers, casque en tête, et le mousqueton en bandoulière sur leur capote de graisse, activaient le feu , jetaient bûche après bûche dans le foyer grondant, sous les deux marmites énormes où cuisait la soupe et chauffait le café d’embarquement.
Pilastre se hissa sur le siège, s’empaqueta dans trois couvertures, saisit une trique et se mit à frapper. Les croupes bondirent, la neige vola, les chaînes cliquetèrent, le timon gémit. La roulante ne bougea pas. Chaque bête tirait de son côté, annulait l’effort de l’autre par son propre effort.
Crédent ôta sa pipe de sa bouche, cracha.
- Quel sauvage ! dit-il. Des bêtes pareilles…
Le conducteur se dressa et redoubla les coups. La haine lui creusait les joues et les yeux. Par hasard, les huit sabots se plantèrent ensemble dans la neige. La roulante partit brusquement. Pilastre tomba sur son siège. Les deux chevaux puissants traversèrent la cour au galop. Dans un bruit de train express, la roulante sauta par-dessus le tas de fumier gelé, arracha la grille d’entrée, vira au ras du fossé, pulvérisa la borne zéro kilomètre.
- Je vous attendais, monsieur Saint-Menoux, dit-il.
Je savais depuis trois mois que vous alliez venir, cette nuit, vous asseoir sur le seuil de ma maison. Et je m'en suis fort réjoui. Je sais encore d'autres choses. Par exemple que votre convoi ne commencera d'embarquer qu'à cinq heures trente-huit. Vous avez le temps de vous déshabiller, de vous restaurer, et de m'écouter. Quand vous m'aurez entendu, il ne vous manquera jamais plus de temps pour rien...
Le caporal d'échelon, agrégé de mathématiques, retint seulement de ces paroles étonnantes l'affirmation qu'il avait le temps de se déshabiller et de s'asseoir. Il n'en demanda pas plus. Il se déharnacha, défit boucles, bretelles, boutons, mousquetons, quitta fusil, bidon, musette, masque, pelle, baïonnette, ceinturon, capote, gants, casque passe-montagne, béret. Il perdit les deux tiers de son volume. Il apparut si mince que sa haute taille s'en trouvait encore étirée. Sa vareuse eût enveloppé quatre torses comme le sien, mais les manches ne parvenaient pas à ses poignets. Il se tenait un peu voûté, peut-être par la crainte habituelle de heurter le cadre d'une porte, ou un plafond. Ses yeux bleus étaient très pâles, son visage blanc, son nez et ses lèvres minces. Il passa dans ses cheveux, d'un blond très clair, que le béret avait plaqués par mèches, une main longue aux doigts maigres. La jeune fille installa les pièces de son équipement sur le dos d'un fauteuil, près du poêle. Chaussée de mules de satin rose, elle se déplaçait sans bruit. Elle prenait les objets avec des gestes efficaces, sans lenteur ni hâte nerveuse. Saint-Menoux, privé depuis son enfance des soins d'une femme, la suivait des yeux, admirait sa grâce silencieuse, et sentait fondre son embarras. Elle lui présenta une chaise, posa devant lui un bol de café. Il s'assit et but. Elle s'assit à son tour, juste assez loin de lui pour pouvoir le regarder sans le gêner. Elle était vêtue d'une robe blanche. Elle devait avoir quinze ans. " Sans doute n'a-t-elle pas fini de grandir ", se disait Saint-Menoux. Elle le regardait dans les yeux avec tranquillité. C'était une enfant qui n'avait pas appris à avoir honte.
L'infirme prit sur la table une brosse de soies blanches à manche d'écaille et, d'un geste habituel, brossa sa barbe d'or.
- Hum ! fit-il, peut-être nous sommes-nous assez regardés! Maintenant que vous nous avez vus, permettez-moi de nous présenter. Annette est ma fille. Je me nomme Noël Essaillon...
- Noël Essaillon ! s'exclama Saint-Menoux, stupéfait. Mais voyons..., c'est bien vous..., c'est vous qui m'avez répondu en février 1939 dans la Revue des Mathématiques ?
L'homme faisait "oui ! oui !" de la tète et souriait, visiblement heureux de la surprise du caporal.
- Quelle passionnante réponse, reprit celui-ci, chez qui l'étonnement cédait la place à la joie. Ah ! vous êtes l'homme que je désirais le plus rencontrer ! Il se leva. Il avait oublié ses souffrances, sa timidité, la guerre et l'étrangeté de sa présence en ce lieu. Il n'était plus que l'homme abstrait, le mathématicien passionné dont les théories, un an plus tôt, scandalisaient le monde savant. Nul ne l'avait compris, sauf ce Noël Essaillon dont les remarques avaient ouvert de nouvelles voies aux spéculations de son esprit. Il lui serra les mains avec émotion. L'infirme semblait aussi heureux que lui.
- La guerre a interrompu vos travaux, reprit le gros homme. J'ai pu continuer les miens, et suis parvenu à des résultats sensationnels. Mais vous devez avoir faim, mon pauvre ami, depuis le temps que vous traînez sur la route ! Annette, à quoi penses-tu ? La jeune fille s'absenta quelques minutes, revint avec une omelette fumante, apporta un demi-poulet froid, des fromages, une tarte et une bouteille de vin d'Alsace. - Mangez ! mangez ! dit Essaillon, cordial, et écoutez-moi. Ce que j'ai à vous dire est si peu ordinaire. Saint-Menoux ne se fit pas prier.
- Vous êtes mathématicien. Je suis physicien et chimiste. Je poursuivais de mon côté des recherches qui n'eussent abouti à rien, si vos articles de la Revue des Mathématiques n'étaient venus m'éclairer. Grâce à vous, j'ai pu vaincre certains obstacles qui me paraissaient infranchissables. Et je suis arrivé à ceci : j'ai fabriqué une substance qui me permet de disposer du temps à ma guise ! Saint-Menoux posa sa fourchette, mais l'obèse ne lui laissa pas le loisir de l'interrompre. Très animé, il poursuivait son discours. Il empoignait parfois sa barbe comme une gerbe, la séparait en deux, et la froissait entre ses doigts. Ou bien il s'arrêtait pour reprendre souffle, et sa respiration courte composait alors avec celle du feu, lente et douce, les seuls bruits de la pièce. Sa fille s'était assise un peu en arrière de lui dans la pénombre. Elle se tenait droite sur sa chaise, ses deux mains posées à plat sur ses genoux, grave comme une enfant qui écoute une histoire. Elle regardait les deux hommes tour à tour, mais surtout le nouveau personnage qui venait de s'introduire dans le conte, le grand soldat maigre aux cheveux de chanvre. Elle se levait de temps en temps sans bruit, pour essuyer le front de son père, ou changer l'assiette du visiteur. Et rien de cela n'était pour elle corvée ou habitude. S'éveiller à un jour nouveau, aller à la ville, revenir chargée de pain blond et de légumes, manger, marcher, voir passer la voisine, écouter le cri du marchand de fagots, travailler au laboratoire, c'était sa vie, l'histoire que la vie construisait pour elle, jamais grise ni banale, dans ce décor de lumière chaude, ou dans le soleil ou la neige, avec des toits pointus, avec des arbres nus ou des bouquets de verdure bruyants d'oiseaux. Saint-Menoux, pris tout entier par l'exposé de son hôte, ne prêtait pas attention au regard posé sur lui, mais il sentait la présence de la jeune fille dans la pièce, comme celle d'un objet précieux, d'une statue rehaussée de vieil or qui luit doucement dans une niche d'ombre, ou d'une tapisserie dont les personnages plats dansent sur le mur une farandole de laine.
- D'où venons-nous ? poursuivait l'infirme, où étions-nous avant de naître à la conscience de ce monde ? Les religions parlent d'un paradis perdu. Son regret hante les hommes de toute race. Ce paradis perdu, je le nomme l'univers total. C'est l'Univers que ne limitent ni le Temps ni l'Espace. Il ne dispose pas de trois ou quatre dimensions, mais de toutes les dimensions. La lumière qui l'éclaire est composée, non de sept ou vingt, ou cent, mais de toutes les couleurs. Tout ce qui est, a été, ou sera, l'habite et aussi ce qui ne sera jamais. Rien ne s'y trouve formé, parce que toutes les formes y sont possibles. Il tient dans l'atome, et notre infini ne parvient pas à l'emplir. Pour l'âme qui participe à cet univers, l'avenir ni le passé n'existent, ni le près ni le loin. Tout lui est présence... Saint-Menoux oubliait de manger. Il vit comme dans un rêve les mains blanches d'Annette lui verser à boire, poser dans son assiette la cuisse du poulet.
-Imaginez maintenant, continuait l'infirme (pour quel péché contre la perfection ?), cette âme condamnée à la chute. Elle s'engage dans ce que nous appelons la vie, pour elle une sorte de couloir, de tunnel vertical, dont les murs matériels lui cachent jusqu'au souvenir du merveilleux séjour. Elle ne peut ni remonter ni se déplacer à droite ou à gauche. Elle est inexorablement attirée vers la mort, vers le bas, vers l'autre extrémité du tunnel, qui débouche Dieu sait où, dans quelque effroyable enfer, ou dans le paradis retrouvé. Cette âme c'est vous, c'est moi, pendant notre vie terrestre, nous qui tombons en chute libre dans le temps, comme cailloux échappés à la main de Dieu. Il avait soulevé sa barbe et la lâcha pour concrétiser l'image. Elle reprit doucement son apparence de moisson. Saint-Menoux but les dernières gouttes du vin clair.
- Si je parviens, reprit Essaillon, à changer la densité de cette âme, de ce caillou, il me sera possible, soit d'accélérer sa chute, soit de l'arrêter. Je pourrai même le soustraire à la pesanteur qui l'attire vers l'avenir, et le faire remonter vers le passé ! C'est au moyen de réussir cette intervention que je travaille depuis vingt ans ! et j'ai réussi ! Il prit le mouchoir des mains de sa fille, s'épongea la tète et le cou, et ajouta d'une voix plus calme :
- Je conçois que cela vous apparaisse impossible. Aussi, avant de vous en dire davantage, je veux vous faire une démonstration. Il écarta le rideau d'or qui masquait sa poitrine, découvrit un gilet de laine aux poches gonflées comme des mamelles. Ses doigts fouillèrent parmi les objets qui les garnissaient, reparurent serrés sur une boîte plate qu'il tendit à Saint-Menoux. Celui-ci souleva le couvercle et vit un assortiment de petites sphères de couleurs variées, couchées sur un lit de coton.
- Si vous absorbez une de ces pilules, dit Essaillon, vous êtes aussitôt rajeuni, selon sa couleur, d'une heure, d'un jour, d'une semaine, d'une lune, d'un an. Il tira une seconde boîte de sa poche. Elle contenait d'autres pilules, de forme oblongue.
- Ces ovules produisent l'effet contraire. Ils accélèrent l'avance vers l'avenir. Il choisit dans les boîtes deux pilules violettes et deux ovules de même couleur, les posa devant Saint-Menoux :
- Tentez l'expérience, dit-il.
- Moi ? fit le caporal stupéfait.
Je savais depuis trois mois que vous alliez venir, cette nuit, vous asseoir sur le seuil de ma maison. Et je m'en suis fort réjoui. Je sais encore d'autres choses. Par exemple que votre convoi ne commencera d'embarquer qu'à cinq heures trente-huit. Vous avez le temps de vous déshabiller, de vous restaurer, et de m'écouter. Quand vous m'aurez entendu, il ne vous manquera jamais plus de temps pour rien...
Le caporal d'échelon, agrégé de mathématiques, retint seulement de ces paroles étonnantes l'affirmation qu'il avait le temps de se déshabiller et de s'asseoir. Il n'en demanda pas plus. Il se déharnacha, défit boucles, bretelles, boutons, mousquetons, quitta fusil, bidon, musette, masque, pelle, baïonnette, ceinturon, capote, gants, casque passe-montagne, béret. Il perdit les deux tiers de son volume. Il apparut si mince que sa haute taille s'en trouvait encore étirée. Sa vareuse eût enveloppé quatre torses comme le sien, mais les manches ne parvenaient pas à ses poignets. Il se tenait un peu voûté, peut-être par la crainte habituelle de heurter le cadre d'une porte, ou un plafond. Ses yeux bleus étaient très pâles, son visage blanc, son nez et ses lèvres minces. Il passa dans ses cheveux, d'un blond très clair, que le béret avait plaqués par mèches, une main longue aux doigts maigres. La jeune fille installa les pièces de son équipement sur le dos d'un fauteuil, près du poêle. Chaussée de mules de satin rose, elle se déplaçait sans bruit. Elle prenait les objets avec des gestes efficaces, sans lenteur ni hâte nerveuse. Saint-Menoux, privé depuis son enfance des soins d'une femme, la suivait des yeux, admirait sa grâce silencieuse, et sentait fondre son embarras. Elle lui présenta une chaise, posa devant lui un bol de café. Il s'assit et but. Elle s'assit à son tour, juste assez loin de lui pour pouvoir le regarder sans le gêner. Elle était vêtue d'une robe blanche. Elle devait avoir quinze ans. " Sans doute n'a-t-elle pas fini de grandir ", se disait Saint-Menoux. Elle le regardait dans les yeux avec tranquillité. C'était une enfant qui n'avait pas appris à avoir honte.
L'infirme prit sur la table une brosse de soies blanches à manche d'écaille et, d'un geste habituel, brossa sa barbe d'or.
- Hum ! fit-il, peut-être nous sommes-nous assez regardés! Maintenant que vous nous avez vus, permettez-moi de nous présenter. Annette est ma fille. Je me nomme Noël Essaillon...
- Noël Essaillon ! s'exclama Saint-Menoux, stupéfait. Mais voyons..., c'est bien vous..., c'est vous qui m'avez répondu en février 1939 dans la Revue des Mathématiques ?
L'homme faisait "oui ! oui !" de la tète et souriait, visiblement heureux de la surprise du caporal.
- Quelle passionnante réponse, reprit celui-ci, chez qui l'étonnement cédait la place à la joie. Ah ! vous êtes l'homme que je désirais le plus rencontrer ! Il se leva. Il avait oublié ses souffrances, sa timidité, la guerre et l'étrangeté de sa présence en ce lieu. Il n'était plus que l'homme abstrait, le mathématicien passionné dont les théories, un an plus tôt, scandalisaient le monde savant. Nul ne l'avait compris, sauf ce Noël Essaillon dont les remarques avaient ouvert de nouvelles voies aux spéculations de son esprit. Il lui serra les mains avec émotion. L'infirme semblait aussi heureux que lui.
- La guerre a interrompu vos travaux, reprit le gros homme. J'ai pu continuer les miens, et suis parvenu à des résultats sensationnels. Mais vous devez avoir faim, mon pauvre ami, depuis le temps que vous traînez sur la route ! Annette, à quoi penses-tu ? La jeune fille s'absenta quelques minutes, revint avec une omelette fumante, apporta un demi-poulet froid, des fromages, une tarte et une bouteille de vin d'Alsace. - Mangez ! mangez ! dit Essaillon, cordial, et écoutez-moi. Ce que j'ai à vous dire est si peu ordinaire. Saint-Menoux ne se fit pas prier.
- Vous êtes mathématicien. Je suis physicien et chimiste. Je poursuivais de mon côté des recherches qui n'eussent abouti à rien, si vos articles de la Revue des Mathématiques n'étaient venus m'éclairer. Grâce à vous, j'ai pu vaincre certains obstacles qui me paraissaient infranchissables. Et je suis arrivé à ceci : j'ai fabriqué une substance qui me permet de disposer du temps à ma guise ! Saint-Menoux posa sa fourchette, mais l'obèse ne lui laissa pas le loisir de l'interrompre. Très animé, il poursuivait son discours. Il empoignait parfois sa barbe comme une gerbe, la séparait en deux, et la froissait entre ses doigts. Ou bien il s'arrêtait pour reprendre souffle, et sa respiration courte composait alors avec celle du feu, lente et douce, les seuls bruits de la pièce. Sa fille s'était assise un peu en arrière de lui dans la pénombre. Elle se tenait droite sur sa chaise, ses deux mains posées à plat sur ses genoux, grave comme une enfant qui écoute une histoire. Elle regardait les deux hommes tour à tour, mais surtout le nouveau personnage qui venait de s'introduire dans le conte, le grand soldat maigre aux cheveux de chanvre. Elle se levait de temps en temps sans bruit, pour essuyer le front de son père, ou changer l'assiette du visiteur. Et rien de cela n'était pour elle corvée ou habitude. S'éveiller à un jour nouveau, aller à la ville, revenir chargée de pain blond et de légumes, manger, marcher, voir passer la voisine, écouter le cri du marchand de fagots, travailler au laboratoire, c'était sa vie, l'histoire que la vie construisait pour elle, jamais grise ni banale, dans ce décor de lumière chaude, ou dans le soleil ou la neige, avec des toits pointus, avec des arbres nus ou des bouquets de verdure bruyants d'oiseaux. Saint-Menoux, pris tout entier par l'exposé de son hôte, ne prêtait pas attention au regard posé sur lui, mais il sentait la présence de la jeune fille dans la pièce, comme celle d'un objet précieux, d'une statue rehaussée de vieil or qui luit doucement dans une niche d'ombre, ou d'une tapisserie dont les personnages plats dansent sur le mur une farandole de laine.
- D'où venons-nous ? poursuivait l'infirme, où étions-nous avant de naître à la conscience de ce monde ? Les religions parlent d'un paradis perdu. Son regret hante les hommes de toute race. Ce paradis perdu, je le nomme l'univers total. C'est l'Univers que ne limitent ni le Temps ni l'Espace. Il ne dispose pas de trois ou quatre dimensions, mais de toutes les dimensions. La lumière qui l'éclaire est composée, non de sept ou vingt, ou cent, mais de toutes les couleurs. Tout ce qui est, a été, ou sera, l'habite et aussi ce qui ne sera jamais. Rien ne s'y trouve formé, parce que toutes les formes y sont possibles. Il tient dans l'atome, et notre infini ne parvient pas à l'emplir. Pour l'âme qui participe à cet univers, l'avenir ni le passé n'existent, ni le près ni le loin. Tout lui est présence... Saint-Menoux oubliait de manger. Il vit comme dans un rêve les mains blanches d'Annette lui verser à boire, poser dans son assiette la cuisse du poulet.
-Imaginez maintenant, continuait l'infirme (pour quel péché contre la perfection ?), cette âme condamnée à la chute. Elle s'engage dans ce que nous appelons la vie, pour elle une sorte de couloir, de tunnel vertical, dont les murs matériels lui cachent jusqu'au souvenir du merveilleux séjour. Elle ne peut ni remonter ni se déplacer à droite ou à gauche. Elle est inexorablement attirée vers la mort, vers le bas, vers l'autre extrémité du tunnel, qui débouche Dieu sait où, dans quelque effroyable enfer, ou dans le paradis retrouvé. Cette âme c'est vous, c'est moi, pendant notre vie terrestre, nous qui tombons en chute libre dans le temps, comme cailloux échappés à la main de Dieu. Il avait soulevé sa barbe et la lâcha pour concrétiser l'image. Elle reprit doucement son apparence de moisson. Saint-Menoux but les dernières gouttes du vin clair.
- Si je parviens, reprit Essaillon, à changer la densité de cette âme, de ce caillou, il me sera possible, soit d'accélérer sa chute, soit de l'arrêter. Je pourrai même le soustraire à la pesanteur qui l'attire vers l'avenir, et le faire remonter vers le passé ! C'est au moyen de réussir cette intervention que je travaille depuis vingt ans ! et j'ai réussi ! Il prit le mouchoir des mains de sa fille, s'épongea la tète et le cou, et ajouta d'une voix plus calme :
- Je conçois que cela vous apparaisse impossible. Aussi, avant de vous en dire davantage, je veux vous faire une démonstration. Il écarta le rideau d'or qui masquait sa poitrine, découvrit un gilet de laine aux poches gonflées comme des mamelles. Ses doigts fouillèrent parmi les objets qui les garnissaient, reparurent serrés sur une boîte plate qu'il tendit à Saint-Menoux. Celui-ci souleva le couvercle et vit un assortiment de petites sphères de couleurs variées, couchées sur un lit de coton.
- Si vous absorbez une de ces pilules, dit Essaillon, vous êtes aussitôt rajeuni, selon sa couleur, d'une heure, d'un jour, d'une semaine, d'une lune, d'un an. Il tira une seconde boîte de sa poche. Elle contenait d'autres pilules, de forme oblongue.
- Ces ovules produisent l'effet contraire. Ils accélèrent l'avance vers l'avenir. Il choisit dans les boîtes deux pilules violettes et deux ovules de même couleur, les posa devant Saint-Menoux :
- Tentez l'expérience, dit-il.
- Moi ? fit le caporal stupéfait.
Pourtant pour Pierre Saint-Menoux il ne saurait y avoir de fin.
Réfléchissez : il a tué son ancêtre avant que celui-ci ait eu le temps de prendre femme et d'avoir des enfants. Donc, il disparaît, c'est entendu, il n'existe pas, il n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de Pierre Saint-Menoux.
Bon...
Mais si Pierre de Saint-Menoux n'existe pas, s'il n'a jamais existé, il n'a pas pu tuer son ancêtre!...
Donc, son ancêtre a poursuivi normalement son destin, s'est marié, a eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants...
Et un jour Pierre Saint-Menoux est né, a vécu, a grandi... a voulu tuer Bonaparte... et a tué son ancêtre.
Bon...
Il a tué son ancêtre?
Donc il n'existe pas.
Donc il n'a pas tué son ancêtre.
Donc il existe (...)
A partir de l'instant où son ancêtre frappé par lui est mort, Saint-Menoux n'existe pas et existe à la fois, car n'existant pas il n'a pas pu tuer, et, de ce fait, il existe et tue.
Etre ou ne pas être ? se demandait Hamlet. Etre et ne pas être, réplique Saint-Menoux.
Le nouveau souverain était un bon vivant. Il voulut faire le bonheur de ses sujets. De tous ses sujets, sans injustice. Il commença par rechercher quelques cerveaux puissants, constitua par leur réunion une sorte d’accumulateur d’énergie mentale. Cet organisme portait dans la langue de l’époque le nom de bren-treuste. Les hommes au cerveau faible, c’est-à-dire la multitude, subirent sa volonté. Il commanda au roi lui-même et l’absorba. Il devint le maître de l’humanité.
Dès cet instant, les hommes qui le composaient perdirent leur individualité. Ils ne purent profiter de leur toute-puissance. Leur volonté commune, tendue vers le bonheur de leurs semblables et qui dirigeait inexorablement ceux-ci vers une étrange félicité obligatoire, les ployait eux-mêmes sous sa loi. Ils devinrent malgré eux les serviteurs de la cité qu’ils commandaient. Leur nombre augmenta, leur puissance collective s’accrut prodigieusement. Leur pouvoir personnel était nul. La force qui émanait d’eux semblait vivre une vie propre. Les principes de justice et de bonheur social, pensés de façon exacte par les cerveaux des hommes se libéraient de l’autorité humaine qui n’avait jamais su les appliquer. Ils se constituaient en énergie indépendante. Ils allaient désormais régner avec une parfaite rigueur.
Pour le bien de tous, la force nouvelle a fixé à chaque homme une tâche précise, a modifié son corps afin de lui rendre son travail plus facile, a diminué la puissance de ses sens dans le but de lui éviter non seulement toute douleur, mais toute sensation inutile au fonctionnement de la cité.
Dès cet instant, les hommes qui le composaient perdirent leur individualité. Ils ne purent profiter de leur toute-puissance. Leur volonté commune, tendue vers le bonheur de leurs semblables et qui dirigeait inexorablement ceux-ci vers une étrange félicité obligatoire, les ployait eux-mêmes sous sa loi. Ils devinrent malgré eux les serviteurs de la cité qu’ils commandaient. Leur nombre augmenta, leur puissance collective s’accrut prodigieusement. Leur pouvoir personnel était nul. La force qui émanait d’eux semblait vivre une vie propre. Les principes de justice et de bonheur social, pensés de façon exacte par les cerveaux des hommes se libéraient de l’autorité humaine qui n’avait jamais su les appliquer. Ils se constituaient en énergie indépendante. Ils allaient désormais régner avec une parfaite rigueur.
Pour le bien de tous, la force nouvelle a fixé à chaque homme une tâche précise, a modifié son corps afin de lui rendre son travail plus facile, a diminué la puissance de ses sens dans le but de lui éviter non seulement toute douleur, mais toute sensation inutile au fonctionnement de la cité.
Qu'est ce que le présent dans notre petit univers? Pendant que je pense la phrase que je vais vous dire, elle fait partie de l'avenir. A mesure que je la prononce, elle tombe dans le passé. Le présent, est-ce le moment où je déguste cette merveilleuse liqueur? Non! Tant qu'elle n'a pas atteint mes lèvres, c'est l'avenir. Quand la sensation de son goût, de sa chaleur, qui m'emplit la bouche, quand ce plaisir atteint mon cerveau, il a déjà quitté mon palais. C'est le passé. L'avenir sombre dans le passé dès qu'il a cessé d'être futur. Le présent n'existe pas. Vouloir l'éterniser, c'était éterniser le néant.
Videos de René Barjavel (50)
Voir plusAjouter une vidéo
Découvrez le nouveau roman de Maxime Chattam. Un roman au suspense saisissant, hommage lumineux à Barjavel et à la littérature qui divertit et qui interroge. Maxime Chattam comme vous ne l'avez jamais lu.
Pour en savoir plus: https://www.albin-michel.fr/lux-9782226470072
Nous suivre sur les réseaux sociaux : Instagram : https://www.instagram.com/editionsalbinmichel Facebook : https://www.facebook.com/editionsAlbinMichel Twitter : https://twitter.com/AlbinMichel Linkedin : https://www.linkedin.com/company/albin-michel
Pour en savoir plus: https://www.albin-michel.fr/lux-9782226470072
Nous suivre sur les réseaux sociaux : Instagram : https://www.instagram.com/editionsalbinmichel Facebook : https://www.facebook.com/editionsAlbinMichel Twitter : https://twitter.com/AlbinMichel Linkedin : https://www.linkedin.com/company/albin-michel
autres livres classés : science-fictionVoir plus
Les plus populaires : Imaginaire
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de René Barjavel (43)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Le voyageur imprudent
Ce livre a pour thème...
Les voyages dans l'espace
Les voyages dans le temps
Les voyages en train
La traversée de l'Atlantique
15 questions
69 lecteurs ont répondu
Thème : Le Voyageur imprudent de
René BarjavelCréer un quiz sur ce livre69 lecteurs ont répondu