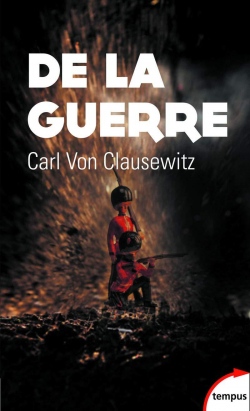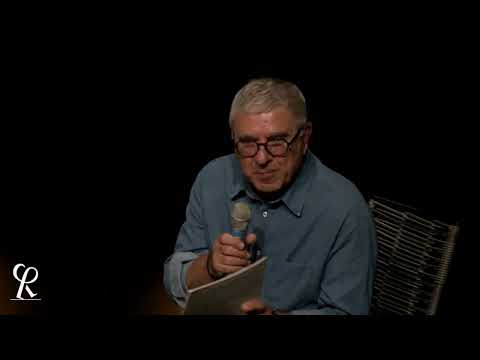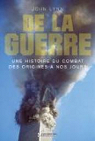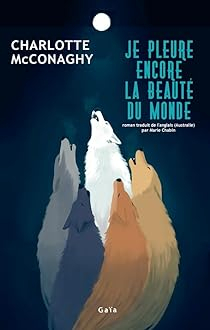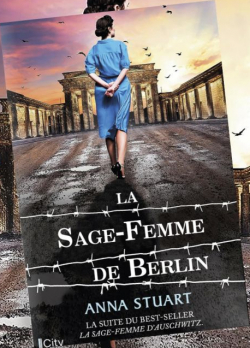Carl von Clausewitz
Denise Naville (Traducteur)Camille Rougeron (Préfacier, etc.)Pierre Naville (Préfacier, etc.)/5 105 notes
Denise Naville (Traducteur)Camille Rougeron (Préfacier, etc.)Pierre Naville (Préfacier, etc.)/5 105 notes
Résumé :
De la guerre, ouvrage inachevé publié en 1832, un an après la mort de son auteur, marque une, rupture radicale dans la façon de concevoir le phénomène de la guerre. Avant Carl von Clausewitz, la littérature militaire était essentiellement descriptive et utilitaire. S'appuyant à la fois sur sa réflexion théorique et sur son expérience de terrain - en particulier sa participation à la bataille d'Iéna en 1806 -, Clausewitz, le premier, pense la guerre dans toutes ses d... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après De la guerreVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (14)
Voir plus
Ajouter une critique
Also sprach Karl von Clausewitz
Malheureusement, beaucoup ressentent de fortes réticences à l'idée d'aborder un tel ouvrage. Bien sûr le sujet est âpre et semble ne pouvoir laisser que peu de place aux plaisirs de la lecture et de l'imaginaire.
Pour ce qui concerne la sphère de la pensée et de la réflexion, il sera également souvent écarté comme trop restrictif par son domaine d'application.
Voilà donc Clausewitz, ce si subtile analyste du champ pratique, enfermé conjointement derrière le masque de la brute militaire et du froid théoricien.
Pourtant, j'affirme ici que la plupart auront beaucoup à gagner à se risquer aux écrits de notre général prussien ; car rarement pensée et pratique, théorie et matérialité, n'auront chevauchés en une telle proximité et avec une telle pertinence du jugement.
Faites donc fi de ce titre effrayant et venez y chercher des armes pour cette forme de guerre à laquelle aucun d'entre-nous n'échappe : la confrontation aux réalités pratiques du temps présent. Si en effet certains experts en stratégie militaire contemporains pourront trouver Clausewitz « démodé » sur le terrain qui était censé être spécifiquement le sien, il en est, à mon avis, tout autrement sur celui ou il brilla véritablement et qui, s'attachant aux caractéristiques de la nature humaine, se maintient dans sa pérennité.
Ce que Clausewitz lui-même pouvait ainsi formuler : « Ne nous y trompons pas, il n'est pas question ici de formules et de problèmes scientifiques. En fait les rapports matériels sont très simples. Ce qui est plus difficile, c'est de comprendre les forces morales qui entrent en jeu. »
Car de quoi parle-t-il donc quand il affirme, « La volonté de l'homme ne puise jamais ses forces dans des subtilités logiques. »
Ou encore, « La guerre est le domaine de l'incertitude ; les trois quarts des éléments sur lesquels se fonde l'action restent dans les brumes d'une incertitude plus ou moins grande. Plus qu'en n'importe quel domaine, il faut qu'une intelligence subtile et pénétrante sache y discerner et apprécier d'instinct la vérité. En raison de cette incertitude de toutes les informations, de toute base solide, et de ces interventions constantes du hasard, la personne agissante se trouve sans cesse placée devant des réalités différentes de celles auxquelles elle s'attendait. » N'y voyez-vous pas l'expression de quelque chose qui vous concerne fort directement dès que vous êtes confrontés à la nécessité d'agir …
On trouvera aussi souvent en Clausewitz un fin psychologue, comme ici :
« La force de caractère nous amène à parler d'une variété de celle-ci, l'obstination.
Il est souvent très difficile de dire dans les cas concrets où commence l'une et où finit l'autre ; par contre, la différence abstraite entre les deux ne paraît pas difficile à établir, (…)
L'obstination est un défaut du tempérament. Cette inflexibilité de la volonté, cette intolérance envers toute contradiction, ne relèvent que d'un égoïsme particulier qui tient avant tout à obéir et à faire obéir les autres aux seules injonctions de sa propre activité spirituelle.
L'obstination s'oppose donc à l'intelligence qui est bien plutôt la capacité d'entendement. »
Enfin, dans ce qui me semble être l'une des plus remarquables définitions du cheminement dialectique entre théorie et pratique :
« La théorie doit être une observation, non une doctrine.
C'est une investigation analytique de l'objet qui aboutit à sa connaissance. Plus elle atteint ce but, plus elle passe de la forme objective d'un savoir à la forme subjective d'un pouvoir.et, appliquée à l'expérience, en l'occurrence l'histoire, entraîne la familiarité avec cet objet. »
Pour ce qui concerne les traductions disponibles, celle révisée des Editions Gérard Lebovici en 1989, par de Vatry semble la plus cohérente ; toutefois, il pourra parfois être utile de consulter la version de Denise Naville aux Editions de Minuit (1955) dont la forme plus littéraire bien que moins précise (on y trouve quelques fâcheux contresens), peut aider parfois à éclaircir quelques points obscurs. Mais quelque soit la version, il serait fort étonnant que vous ne puissiez en tirer quelque profit.
Malheureusement, beaucoup ressentent de fortes réticences à l'idée d'aborder un tel ouvrage. Bien sûr le sujet est âpre et semble ne pouvoir laisser que peu de place aux plaisirs de la lecture et de l'imaginaire.
Pour ce qui concerne la sphère de la pensée et de la réflexion, il sera également souvent écarté comme trop restrictif par son domaine d'application.
Voilà donc Clausewitz, ce si subtile analyste du champ pratique, enfermé conjointement derrière le masque de la brute militaire et du froid théoricien.
Pourtant, j'affirme ici que la plupart auront beaucoup à gagner à se risquer aux écrits de notre général prussien ; car rarement pensée et pratique, théorie et matérialité, n'auront chevauchés en une telle proximité et avec une telle pertinence du jugement.
Faites donc fi de ce titre effrayant et venez y chercher des armes pour cette forme de guerre à laquelle aucun d'entre-nous n'échappe : la confrontation aux réalités pratiques du temps présent. Si en effet certains experts en stratégie militaire contemporains pourront trouver Clausewitz « démodé » sur le terrain qui était censé être spécifiquement le sien, il en est, à mon avis, tout autrement sur celui ou il brilla véritablement et qui, s'attachant aux caractéristiques de la nature humaine, se maintient dans sa pérennité.
Ce que Clausewitz lui-même pouvait ainsi formuler : « Ne nous y trompons pas, il n'est pas question ici de formules et de problèmes scientifiques. En fait les rapports matériels sont très simples. Ce qui est plus difficile, c'est de comprendre les forces morales qui entrent en jeu. »
Car de quoi parle-t-il donc quand il affirme, « La volonté de l'homme ne puise jamais ses forces dans des subtilités logiques. »
Ou encore, « La guerre est le domaine de l'incertitude ; les trois quarts des éléments sur lesquels se fonde l'action restent dans les brumes d'une incertitude plus ou moins grande. Plus qu'en n'importe quel domaine, il faut qu'une intelligence subtile et pénétrante sache y discerner et apprécier d'instinct la vérité. En raison de cette incertitude de toutes les informations, de toute base solide, et de ces interventions constantes du hasard, la personne agissante se trouve sans cesse placée devant des réalités différentes de celles auxquelles elle s'attendait. » N'y voyez-vous pas l'expression de quelque chose qui vous concerne fort directement dès que vous êtes confrontés à la nécessité d'agir …
On trouvera aussi souvent en Clausewitz un fin psychologue, comme ici :
« La force de caractère nous amène à parler d'une variété de celle-ci, l'obstination.
Il est souvent très difficile de dire dans les cas concrets où commence l'une et où finit l'autre ; par contre, la différence abstraite entre les deux ne paraît pas difficile à établir, (…)
L'obstination est un défaut du tempérament. Cette inflexibilité de la volonté, cette intolérance envers toute contradiction, ne relèvent que d'un égoïsme particulier qui tient avant tout à obéir et à faire obéir les autres aux seules injonctions de sa propre activité spirituelle.
L'obstination s'oppose donc à l'intelligence qui est bien plutôt la capacité d'entendement. »
Enfin, dans ce qui me semble être l'une des plus remarquables définitions du cheminement dialectique entre théorie et pratique :
« La théorie doit être une observation, non une doctrine.
C'est une investigation analytique de l'objet qui aboutit à sa connaissance. Plus elle atteint ce but, plus elle passe de la forme objective d'un savoir à la forme subjective d'un pouvoir.et, appliquée à l'expérience, en l'occurrence l'histoire, entraîne la familiarité avec cet objet. »
Pour ce qui concerne les traductions disponibles, celle révisée des Editions Gérard Lebovici en 1989, par de Vatry semble la plus cohérente ; toutefois, il pourra parfois être utile de consulter la version de Denise Naville aux Editions de Minuit (1955) dont la forme plus littéraire bien que moins précise (on y trouve quelques fâcheux contresens), peut aider parfois à éclaircir quelques points obscurs. Mais quelque soit la version, il serait fort étonnant que vous ne puissiez en tirer quelque profit.
Lorsque l'on n'est pas de tempérament belliqueux, et ni militaire de carrière ou en retraite, il est parfois compliqué d'expliquer l'intérêt que l'on a à lire ce type d'ouvrage.
Il faut juste admettre que c'est dans la guerre que l'homme atteint le sommet de ses "arts", le meilleur et le pire.
Quand je dis cela, ce n'est ni un cri de joie, ni de l'admiration béate. Juste un constat, éprouvé sur plusieurs millénaires (cf l'art de la guerre de Sun Tzu).
Il s'agit alors de lire ce type de traité avec une certaine distance et d'y puiser quelques ressorts, techniques, savoir-faire, tactiques d'utilité quotidienne (et pacifique).
Ainsi, après la lecture de ce livre, il ne me paraît pas indispensable de rechercher un livre de management qui alignera les dernières platitudes et les slogans à la mode en la matière.
L'analyse qui y est faite des qualités des généraux, des officiers, des soldats, de l'art de les combiner de la façon la plus efficace, les ressorts de motivation qui amèneront ces hommes à un engagement maximum (à la mort en l'occurence ...) est très facilement (et utilement) transposable dans le quotidien d'un manager ou d'un chef d'entreprise (le sacrifice ultime n'étant pas requis dans ce contexte).
Pour la boutade, j'ai enfin compris pourquoi lors de mon service militaire, certains s'évertuaient à me faire marcher au pas et à tourner sur place dans la direction indiquée.
On retrouve très directement ces théories dans l'entraînement sportif (le tennisman et son "mur"), dans la pratique de la musique. La répétition inlassable de gestes de bases qui deviendrons des pratiques réflexes, maîtrisées en compétition (dans des situations critiques).
Quelques unes de ses phrases ont fait flore : "la guerre est la poursuite de la politique par d'autres moyens".
On laissera de côté les considérations relevant de tactiques purement militaires (l'utilisation de l'artillerie, de la cavalerie, ...), et on se tournera plutôt vers Sun Tzu (deux critiques pour le prix d'une) et "L'Art de la guerre", pour une approche plus généraliste des stratégies de confrontations, ouvrage dans lequel les ressorts psychologiques, les manoeuvres préparatoires, les stratégies de communication (intox), le rôle de la société "civile", la gouvernance de la guerre sont plus finement analysés.
Même si la compréhension du texte est un peu plus rude (éviter les phases de lecture prolongées ...)
En synthèse, on trouve dans ces ouvrages bien autre chose que l'art de tuer son prochain, et souvent du simple bon sens.
Il faut juste admettre que c'est dans la guerre que l'homme atteint le sommet de ses "arts", le meilleur et le pire.
Quand je dis cela, ce n'est ni un cri de joie, ni de l'admiration béate. Juste un constat, éprouvé sur plusieurs millénaires (cf l'art de la guerre de Sun Tzu).
Il s'agit alors de lire ce type de traité avec une certaine distance et d'y puiser quelques ressorts, techniques, savoir-faire, tactiques d'utilité quotidienne (et pacifique).
Ainsi, après la lecture de ce livre, il ne me paraît pas indispensable de rechercher un livre de management qui alignera les dernières platitudes et les slogans à la mode en la matière.
L'analyse qui y est faite des qualités des généraux, des officiers, des soldats, de l'art de les combiner de la façon la plus efficace, les ressorts de motivation qui amèneront ces hommes à un engagement maximum (à la mort en l'occurence ...) est très facilement (et utilement) transposable dans le quotidien d'un manager ou d'un chef d'entreprise (le sacrifice ultime n'étant pas requis dans ce contexte).
Pour la boutade, j'ai enfin compris pourquoi lors de mon service militaire, certains s'évertuaient à me faire marcher au pas et à tourner sur place dans la direction indiquée.
On retrouve très directement ces théories dans l'entraînement sportif (le tennisman et son "mur"), dans la pratique de la musique. La répétition inlassable de gestes de bases qui deviendrons des pratiques réflexes, maîtrisées en compétition (dans des situations critiques).
Quelques unes de ses phrases ont fait flore : "la guerre est la poursuite de la politique par d'autres moyens".
On laissera de côté les considérations relevant de tactiques purement militaires (l'utilisation de l'artillerie, de la cavalerie, ...), et on se tournera plutôt vers Sun Tzu (deux critiques pour le prix d'une) et "L'Art de la guerre", pour une approche plus généraliste des stratégies de confrontations, ouvrage dans lequel les ressorts psychologiques, les manoeuvres préparatoires, les stratégies de communication (intox), le rôle de la société "civile", la gouvernance de la guerre sont plus finement analysés.
Même si la compréhension du texte est un peu plus rude (éviter les phases de lecture prolongées ...)
En synthèse, on trouve dans ces ouvrages bien autre chose que l'art de tuer son prochain, et souvent du simple bon sens.
Cet essai est une référence mondiale pour "l'art" de la guerre. Certes, sa lecture est un peu aride, certaines tournures de phrase (ou la traduction un peu datée) peuvent interpeler.
Dans le fond, tous les aspects de la guerre terrestre sont pris en compte. Aujourd'hui, les conflits englobent davantage de facteurs (aérien, chimique, renseignement,...) et jouent sur le plan stratégique. Si l'auteur n'a pas tout anticiper, nombre de ses préceptes sont encore de vigueur.
Du point de vue politique on ne pourrait que regretter son actualité.
Dans le fond, tous les aspects de la guerre terrestre sont pris en compte. Aujourd'hui, les conflits englobent davantage de facteurs (aérien, chimique, renseignement,...) et jouent sur le plan stratégique. Si l'auteur n'a pas tout anticiper, nombre de ses préceptes sont encore de vigueur.
Du point de vue politique on ne pourrait que regretter son actualité.
La pensée de Clausewitz est claire. La guerre est un « caméléon » qui change de formes à l'infini, mais n'a qu'une seule nature: « anéantir l'ennemi ». Aussi, si elle est contrôlée par les Etats, la guerre est « la continuation de la politique par d'autres moyens ». Son point culminant/ idéal type serait la guerre absolue par la « montée aux extrêmes des belligérants ».
Ainsi l'auteur pose les piliers de ce que sera cette oeuvre magistrale.
De la Guerre est un essai théorique visant à faire comprendre la nature, les formes et les raisons de la guerre par une fine analyse autant théorique, que pratique, que psychologique(bien évidemment, au XIXe siècle Clausewitz s'arrête aux guerres Révolutionnaires et Napoléoniennes…).
C'est l'essence même de la compréhension des combats des Temps Modernes. Il est ,je trouve, indispensable de lire ce traité pour comprends entant soit peu les conflits de l'histoire occidentale, mais aussi les conflits contemporains qui se déroulent en ce moment même sur le sol européen!
Si la visualisation de la guerre clausewitzienne est contestable, elle reste largement abordable et compréhensible, que vous soyez savant ou profane :)
Un classique à lire et surtout à relire (chapitres par chapitres, livres par livres , de temps en temps, car l'overdose n'est pas loin).
Ainsi l'auteur pose les piliers de ce que sera cette oeuvre magistrale.
De la Guerre est un essai théorique visant à faire comprendre la nature, les formes et les raisons de la guerre par une fine analyse autant théorique, que pratique, que psychologique(bien évidemment, au XIXe siècle Clausewitz s'arrête aux guerres Révolutionnaires et Napoléoniennes…).
C'est l'essence même de la compréhension des combats des Temps Modernes. Il est ,je trouve, indispensable de lire ce traité pour comprends entant soit peu les conflits de l'histoire occidentale, mais aussi les conflits contemporains qui se déroulent en ce moment même sur le sol européen!
Si la visualisation de la guerre clausewitzienne est contestable, elle reste largement abordable et compréhensible, que vous soyez savant ou profane :)
Un classique à lire et surtout à relire (chapitres par chapitres, livres par livres , de temps en temps, car l'overdose n'est pas loin).
Du lourd... par la qualité de l'ouvrage et la difficulté à le digérer.
Cette pierre angulaire de la théorie militaire est une analyse théorique et philosophique de l'objet 'Guerre' tel qu'il existait au XIXème siècle.
Cet essai, bien qu'ancien, est d'une incroyable densité et mérite certainement plusieurs lectures pour être compris pleinement. le niveau d'abstraction et de réflexion fait parfois penser à du pseudo Kant. Ça doit le style allemand qui veut ça =)
Je me contenterai d'énoncer les concepts et idées que j'ai trouvé les marquants:
- La guerre n'est qu'un moyen d'atteindre un objectif et non une fin en soi
- La guerre n'est donc que le prolongement de la Politique.
- En tant qu'objet isolé et réduit à sa quintessence, la guerre est conflit entre deux partis ayant chacun pour but d'anéantir l'autre. Cela ne l'est jamais en pratique.
- Vision rationnelle et scientifique de la guerre comme une équation d'une extrême complexité variant avec le temps et contenant d'innombrables inconnues
- La somme des incertitudes n'est jamais réductibles à zéro et est nommée “brouillard de guerre”
- Il n'existe pas de dogmes ni méthodes préétablies et tenter d'en suivre est source d'échec
- Chaque guerre est unique et possède ses propres spécificités
L'auteur descend également du niveau théorique au niveau pratique.
Les principaux points de ce type que j'ai noté sont:
- Perdre une bataille ou un engagement n'est pas perdre la guerre.
- Description des facteurs permettant d'avoir l'ascendant
- Réflexions à la fois séparées et croisées aux niveaux stratégique et tactique
- Nombreux exemples historiques, principalement en rapport avec Napoléon et Frédéric le grand.
Bien que datant d'un monde dont le paradigme de la guerre est très différent du notre, cet essai est trop qualitatif et trop majeur pour ne pas être lu.
Son seul défaut est son niveau d'abstraction et de langage qui rendent la lecture parfois ardue, mais c'est un effort qui est amplement récompensé.
Cette pierre angulaire de la théorie militaire est une analyse théorique et philosophique de l'objet 'Guerre' tel qu'il existait au XIXème siècle.
Cet essai, bien qu'ancien, est d'une incroyable densité et mérite certainement plusieurs lectures pour être compris pleinement. le niveau d'abstraction et de réflexion fait parfois penser à du pseudo Kant. Ça doit le style allemand qui veut ça =)
Je me contenterai d'énoncer les concepts et idées que j'ai trouvé les marquants:
- La guerre n'est qu'un moyen d'atteindre un objectif et non une fin en soi
- La guerre n'est donc que le prolongement de la Politique.
- En tant qu'objet isolé et réduit à sa quintessence, la guerre est conflit entre deux partis ayant chacun pour but d'anéantir l'autre. Cela ne l'est jamais en pratique.
- Vision rationnelle et scientifique de la guerre comme une équation d'une extrême complexité variant avec le temps et contenant d'innombrables inconnues
- La somme des incertitudes n'est jamais réductibles à zéro et est nommée “brouillard de guerre”
- Il n'existe pas de dogmes ni méthodes préétablies et tenter d'en suivre est source d'échec
- Chaque guerre est unique et possède ses propres spécificités
L'auteur descend également du niveau théorique au niveau pratique.
Les principaux points de ce type que j'ai noté sont:
- Perdre une bataille ou un engagement n'est pas perdre la guerre.
- Description des facteurs permettant d'avoir l'ascendant
- Réflexions à la fois séparées et croisées aux niveaux stratégique et tactique
- Nombreux exemples historiques, principalement en rapport avec Napoléon et Frédéric le grand.
Bien que datant d'un monde dont le paradigme de la guerre est très différent du notre, cet essai est trop qualitatif et trop majeur pour ne pas être lu.
Son seul défaut est son niveau d'abstraction et de langage qui rendent la lecture parfois ardue, mais c'est un effort qui est amplement récompensé.
Citations et extraits (25)
Voir plus
Ajouter une citation
La guerre est le domaine de l’incertitude ; les trois quarts des éléments sur lesquels se fonde l’action restent dans les brumes d’une incertitude plus ou moins grande. Plus qu’en n’importe quel domaine, il faut qu’une intelligence subtile et pénétrante sache y discerner et apprécier d’instinct la vérité. En raison de cette incertitude de toutes les informations, de toute base solide, et de ces interventions constantes du hasard, la personne agissante se trouve sans cesse placée devant des réalités différentes de celles auxquelles elle s’attendait. (…) Notre connaissance des réalités s’est accrue, mais notre incertitude, au lieu de diminuer, a au contraire augmenté. Cela vient de ce que toutes ces expériences ne s’acquièrent pas d’un coup, mais graduellement, car nos décisions se trouvent sans cesse aux prises avec elles et notre esprit doit toujours rester sous les armes, si l’on ose ainsi s’exprimer. Or, pour traverser sans dommage ces conflits incessants avec l’imprévu, deux qualités sont indispensables : d’abord, un esprit qui même au sein de cette obscurité accrue ne perd pas toute trace de la clarté interne nécessaire pour le conduire vers la vérité ; ensuite le courage de suivre cette faible lueur.
La théorie doit être une observation, non une doctrine.
C’est une investigation analytique de l’objet qui aboutit à sa connaissance et, appliquée à l’expérience, en l’occurrence l’histoire, entraîne la familiarité avec cet objet. Plus elle atteint ce but, plus elle passe de la forme objective d’un savoir à la forme subjective d’un pouvoir.
C’est une investigation analytique de l’objet qui aboutit à sa connaissance et, appliquée à l’expérience, en l’occurrence l’histoire, entraîne la familiarité avec cet objet. Plus elle atteint ce but, plus elle passe de la forme objective d’un savoir à la forme subjective d’un pouvoir.
La force de caractère nous amène à parler d’une variété de celle-ci, l’obstination.
Il est souvent très difficile de dire dans les cas concrets où commence l’une et où finit l’autre ; par contre, la différence abstraite entre les deux ne paraît pas difficile à établir, (…)
L’obstination est un défaut du tempérament. Cette inflexibilité de la volonté, cette intolérance envers toute contradiction, ne relèvent que d’un égoïsme particulier qui tient avant tout à obéir et à faire obéir les autres aux seules injonctions de sa propre activité spirituelle.
Il est souvent très difficile de dire dans les cas concrets où commence l’une et où finit l’autre ; par contre, la différence abstraite entre les deux ne paraît pas difficile à établir, (…)
L’obstination est un défaut du tempérament. Cette inflexibilité de la volonté, cette intolérance envers toute contradiction, ne relèvent que d’un égoïsme particulier qui tient avant tout à obéir et à faire obéir les autres aux seules injonctions de sa propre activité spirituelle.
La guerre n'est rien d'autre que la continuation de la politique par d'autres moyens.
En aucun cas, la guerre n'est un but par elle-même. On ne se bat jamais, paradoxalement, que pour engendrer la paix, une certaine forme de paix.
Videos de Carl von Clausewitz (4)
Voir plusAjouter une vidéo
Confrontée à la guerre, la philosophie semble intempestive, à contre temps. Elle se déploie quand la guerre n'est pas encore là, tentant de retenir tout ce qui pourrait prolonger la paix, ou quand la guerre n'est plus là, s'escrimant alors à penser la «réparation», panser les blessures, accompagner les deuils, réanimer la morale, rétablir la justice. Lorsque «la guerre est là», lorsque fusils d'assaut, bombes et missiles éventrent les immeubles, incendient fermes, écoles, hôpitaux et usines, rasent des quartiers entiers, laissant sur le sol carbonisé enfants, hommes et femmes, chiens et chevaux, lorsqu'on est contraint de vivre tremblant dans des caves, lorsqu'il n'y a plus d'eau potable, lorsqu'on meurt de faim et de douleur – eh bien la philosophie ne trouve guère de place dans les esprits. Peut-être est-ce là la raison pour laquelle il n'y a pas une «philosophie de la guerre» comme il y a une «philosophie du langage» ou une «philosophie de l'art», et que le discours de la guerre renvoie plus aisément à la littérature ou au cinéma, aux discours de stratégie et d'art militaire, d'Intelligence, d'histoire, d'économie, de politique. Pourtant – de Héraclite à Hegel, de Platon à Machiavel, d'Augustin à Hobbes, de Montesquieu à Carl von Clausewitz, Sebald Rudolf Steinmetz, Bertrand Russell, Jan Patoka ou Michael Walzer – les philosophes ont toujours «parlé» de la guerre, pour la dénoncer ou la justifier, analyser ses fondements, ses causes, ses effets. La guerre serait-elle le «point aveugle» de la philosophie, la condamnant à ne parler que de ce qui la précède ou la suit, ou au contraire le «foyer» brûlant où se concentrent tous ses problèmes, de morale, d'immoralité, de paix sociale, d'Etat, de violence, de mort, de responsabilité, de prix d'une vie?
«Polemos (guerre, conflit) est le père de toutes choses, le roi de toutes choses. Des uns il a fait des dieux, des autres il a fait des hommes. Il a rendu les uns libres, les autres esclaves», Héraclite, Frag. 56) #philomonaco
«Polemos (guerre, conflit) est le père de toutes choses, le roi de toutes choses. Des uns il a fait des dieux, des autres il a fait des hommes. Il a rendu les uns libres, les autres esclaves», Héraclite, Frag. 56) #philomonaco
+ Lire la suite
Dans la catégorie :
Guerre et activités militairesVoir plus
>Administration publique>Art et science militaires>Guerre et activités militaires (30)
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus

Oeuvres inachevées
Alzie
61 livres

Guerre & Stratégie
GabySensei
25 livres
Autres livres de Carl von Clausewitz (10)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Philo pour tous
Jostein Gaarder fut au hit-parade des écrits philosophiques rendus accessibles au plus grand nombre avec un livre paru en 1995. Lequel?
Les Mystères de la patience
Le Monde de Sophie
Maya
Vita brevis
10 questions
438 lecteurs ont répondu
Thèmes :
spiritualité
, philosophieCréer un quiz sur ce livre438 lecteurs ont répondu