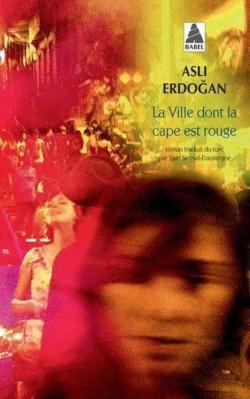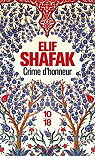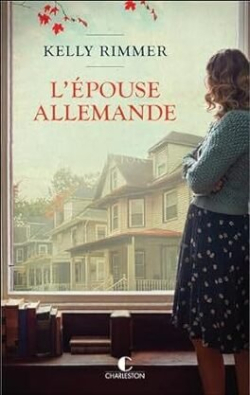Asli Erdogan
Esin Soysal Dauvergne (Traducteur)/5 51 notes
Esin Soysal Dauvergne (Traducteur)/5 51 notes
Résumé :
Ozgür, une étudiante istanbuliote, arrive un jour à Rio en pensant loger chez un universitaire. Un taxi la conduit à l'adresse indiquée, où, malheureusement, on ne l'attend pas. Seule dans cette ville débordante de sensualité mais aussi de terreurs, elle décide de rester. Chaque jour, la violence se rapproche un peu plus, mais Ozgür repousse la peur, contourne la mort puis l'apprivoise. Chaque jour, la pauvreté l'étouffe davantage et le vertige l'attire, vers le fon... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après La ville dont la cape est rougeVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (11)
Voir plus
Ajouter une critique
Des fois ici il m'est déjà arrivé de lire : "C'est compliqué, je ne sais pas par où commencer ma critique..." Hum, hum. Etrange alors que la question, la seule à se poser, est bien entendu et toujours : "Comment finir ?" Voilà celle qui hante ce bouquin. Et ... je ne peux pas spoiler.^^
Mais aussi ce défi : "Comment raconter la faim à un bourgeois bien éduqué blotti dans son fauteuil, qui exerce l'activité la plus sûre : celle de lire, et qui n'a jamais ressenti la crispation de la faim ?" p.36 Il ne suffit pas d'être grand écrivain et assurément Asli Erdogan l'est, il faut l'avoir vécue dans sa chair, avoir été du côté de la misère, avoir passé la rivière, misé son tapis ! A Rio de Janeiro sur les collines où poussent les favelas, en mordant sur la jungle, il y a naturellement des serpents. Rio impudique par trop de chaleur et de pauvreté.
Or moi, comme serpents ceux que j'ai surtout vus sont les Monty Python et comme dans "the meaning of life" si je suis déprimé, je reprends un petit chocolat. J'ai le droit d'apprécier le goût de la langue mais aussi et surtout d'admirer ce choix de tout oser, d'aller au fond de soi à la rencontre de soi. Alors moi, vous raconter ? Je dirai être parti à la rencontre d'Asli Erdogan suite à la lettre si humainement poignante d'Elif Shafak, fidèle en amitié. Je le suis, moi aussi. "La ville s'endormait et j'en oublie le nom" * Je veux dire en cela que Rio si bien décrite a au fond peu d'importance, ce qui se joue est bien au-delà, simplement la vie d'un être exceptionnel qui passera en "jugement" ce 14 mars.
L'ordre récent de mes critiques devrait vous faire comprendre toute l'importance que j'attache à vous convaincre, au risque de lasser. J'aimerais tant vous lancer à la rencontre d'Asli Erdogan et que notre communauté fasse vibrer la toile de belle énergie rendant hommage à sa grande âme, sa profonde humanité, son amour de la vie et son immense poésie. Faites-le avant son procès, il reste peu de temps. Si j'ai préféré mettre en priorité ma critique sur Cinq Méditations sur la mort donc sur la vie, c'est aussi pour vous faire ressentir l'importance de l'enjeu. Car ce livre-ci aussi parle de la Vie et nous entraîne à méditer sur la nécessité de nous engager à y jouer. Et remonte à ma mémoire cette très vieille phrase : "Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra !" dont je commence à saisir tout le sens.
De la vie j'aime tout, à ma manière, et notamment la beauté des rencontres, dont celle-ci très lumineuse, même si j'en fais bien d'autres très belles et récemment de tout à fait inattendues. La vie est pleine de surprises ! Il en faut peu pour être heureux et il faut peu pour donner un cours favorable au destin. C'est pourquoi en tout impudeur j'ai sollicité vos belles pensées d'amitié pour ce 28 février, jour de mardi gras. Car si la vie est pleine de surprises, elle ne manque pas non plus d'ironie. Rio, bien connue pour son carnaval, tout se connecte, voyez-vous.
Aussi je ne peux pas manquer de trouver très ironique ce petit passage : "J'écris pour paraître plus grande que je ne suis, parce que ... je suis très, très petite." p.141 sous la plume d'une si grande dame. Moi qui ai beau de multiplier les billets pour qu'enfin Babelio se réveille et massivement, vous lise tant cela me semble critique. Je vois bien que cela n'est pas suffisant.
Alors je tente ceci sur base d'un autre de vos beaux passages p.170 : "Elle se trouvait sur la vaste place située entre les ruelles aboutissant à l'ancien palais présidentiel et à la favela de la Colline Bleue" comment ne pas faire le lien avec une des premières, confidentielle mais peut-être ma préférée, chansons de Jacques Brel dont je possède l'intégral vinyle : Sur la place ? https://www.youtube.com/watch?v=KrsuatOl__0
"Ainsi certains jours paraît une flamme en nos coeurs mais nous ne voulons jamais laisser luire sa lueur ..."*
Non ! Ne fermez pas vos carreaux !
Ne vous voilez pas les yeux !
Lisez ce qui est beau !
* Jacques Brel
Mais aussi ce défi : "Comment raconter la faim à un bourgeois bien éduqué blotti dans son fauteuil, qui exerce l'activité la plus sûre : celle de lire, et qui n'a jamais ressenti la crispation de la faim ?" p.36 Il ne suffit pas d'être grand écrivain et assurément Asli Erdogan l'est, il faut l'avoir vécue dans sa chair, avoir été du côté de la misère, avoir passé la rivière, misé son tapis ! A Rio de Janeiro sur les collines où poussent les favelas, en mordant sur la jungle, il y a naturellement des serpents. Rio impudique par trop de chaleur et de pauvreté.
Or moi, comme serpents ceux que j'ai surtout vus sont les Monty Python et comme dans "the meaning of life" si je suis déprimé, je reprends un petit chocolat. J'ai le droit d'apprécier le goût de la langue mais aussi et surtout d'admirer ce choix de tout oser, d'aller au fond de soi à la rencontre de soi. Alors moi, vous raconter ? Je dirai être parti à la rencontre d'Asli Erdogan suite à la lettre si humainement poignante d'Elif Shafak, fidèle en amitié. Je le suis, moi aussi. "La ville s'endormait et j'en oublie le nom" * Je veux dire en cela que Rio si bien décrite a au fond peu d'importance, ce qui se joue est bien au-delà, simplement la vie d'un être exceptionnel qui passera en "jugement" ce 14 mars.
L'ordre récent de mes critiques devrait vous faire comprendre toute l'importance que j'attache à vous convaincre, au risque de lasser. J'aimerais tant vous lancer à la rencontre d'Asli Erdogan et que notre communauté fasse vibrer la toile de belle énergie rendant hommage à sa grande âme, sa profonde humanité, son amour de la vie et son immense poésie. Faites-le avant son procès, il reste peu de temps. Si j'ai préféré mettre en priorité ma critique sur Cinq Méditations sur la mort donc sur la vie, c'est aussi pour vous faire ressentir l'importance de l'enjeu. Car ce livre-ci aussi parle de la Vie et nous entraîne à méditer sur la nécessité de nous engager à y jouer. Et remonte à ma mémoire cette très vieille phrase : "Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra !" dont je commence à saisir tout le sens.
De la vie j'aime tout, à ma manière, et notamment la beauté des rencontres, dont celle-ci très lumineuse, même si j'en fais bien d'autres très belles et récemment de tout à fait inattendues. La vie est pleine de surprises ! Il en faut peu pour être heureux et il faut peu pour donner un cours favorable au destin. C'est pourquoi en tout impudeur j'ai sollicité vos belles pensées d'amitié pour ce 28 février, jour de mardi gras. Car si la vie est pleine de surprises, elle ne manque pas non plus d'ironie. Rio, bien connue pour son carnaval, tout se connecte, voyez-vous.
Aussi je ne peux pas manquer de trouver très ironique ce petit passage : "J'écris pour paraître plus grande que je ne suis, parce que ... je suis très, très petite." p.141 sous la plume d'une si grande dame. Moi qui ai beau de multiplier les billets pour qu'enfin Babelio se réveille et massivement, vous lise tant cela me semble critique. Je vois bien que cela n'est pas suffisant.
Alors je tente ceci sur base d'un autre de vos beaux passages p.170 : "Elle se trouvait sur la vaste place située entre les ruelles aboutissant à l'ancien palais présidentiel et à la favela de la Colline Bleue" comment ne pas faire le lien avec une des premières, confidentielle mais peut-être ma préférée, chansons de Jacques Brel dont je possède l'intégral vinyle : Sur la place ? https://www.youtube.com/watch?v=KrsuatOl__0
"Ainsi certains jours paraît une flamme en nos coeurs mais nous ne voulons jamais laisser luire sa lueur ..."*
Non ! Ne fermez pas vos carreaux !
Ne vous voilez pas les yeux !
Lisez ce qui est beau !
* Jacques Brel
Asli Erdogan est une écrivaine turque, particulièrement engagée dans le respect des droits de l'homme . Le droit des femmes, la cause kurde ou arménienne font partis de ses combats au quotidien. Ce qui lui valu cinq mois en prison à Istanbul. Elle décida de s'exiler plutôt que d'assister à son procès en 2017, risquant la perpétuité. Voilà, le contexte est posé.
La prose de Asli Erdogan transpire elle aussi le combat.
Ozgür est une turque trentenaire, partie à Rio pour enseigner l'Anglais. Ce livre narre sa descente aux enfers, dans une ville aux deux facettes, où l'enfer écrase littéralement les clichés touristiques. Elle se réfugie dans l'écriture en écrivant "la ville dont la cape est rouge".
L'écriture est d'une force absolue. Métaphorique, précise, crue, le style de l'auteur contribue grandement à installer ce climat de fin du monde qui accompagne le lecteur de la première à la dernière page de ce roman.
Ici tout est ligué pour anéantir Ozgür : La météo , étouffante, poisseuse, la végétation qui agresse dès qu'on s'y frotte, les hommes qui ne sont que des jouisseurs sans passion, la drogue qui coule à flot, l'argent qui se raréfie et la faim qui taraude de plus en plus. La mort aussi, avec ses rafales incessantes et ses balles perdues qui tuent femmes , enfants et innocents sans discernement. Rio n'a rien à voir avec les dépliants, c'est l'enfer sur terre.
Ici , les culs bronzés mis en valeur par des tangas fluo et qui font fantasmer l'occidental de base ne sont que des vecteurs de sida .
Ce livre , bouleversant et si bien écrit, donne une vision apocalyptique de la vie, dont il stigmatise la fragilité , renvoie les clichés (foot, plage, carnaval ) à leur triste réalité, voir à leur futilité. La force qu'il en émane est incroyable et rend nos soucis occidentaux si futiles face à la survie quotidienne de Rio.
La prose de Asli Erdogan transpire elle aussi le combat.
Ozgür est une turque trentenaire, partie à Rio pour enseigner l'Anglais. Ce livre narre sa descente aux enfers, dans une ville aux deux facettes, où l'enfer écrase littéralement les clichés touristiques. Elle se réfugie dans l'écriture en écrivant "la ville dont la cape est rouge".
L'écriture est d'une force absolue. Métaphorique, précise, crue, le style de l'auteur contribue grandement à installer ce climat de fin du monde qui accompagne le lecteur de la première à la dernière page de ce roman.
Ici tout est ligué pour anéantir Ozgür : La météo , étouffante, poisseuse, la végétation qui agresse dès qu'on s'y frotte, les hommes qui ne sont que des jouisseurs sans passion, la drogue qui coule à flot, l'argent qui se raréfie et la faim qui taraude de plus en plus. La mort aussi, avec ses rafales incessantes et ses balles perdues qui tuent femmes , enfants et innocents sans discernement. Rio n'a rien à voir avec les dépliants, c'est l'enfer sur terre.
Ici , les culs bronzés mis en valeur par des tangas fluo et qui font fantasmer l'occidental de base ne sont que des vecteurs de sida .
Ce livre , bouleversant et si bien écrit, donne une vision apocalyptique de la vie, dont il stigmatise la fragilité , renvoie les clichés (foot, plage, carnaval ) à leur triste réalité, voir à leur futilité. La force qu'il en émane est incroyable et rend nos soucis occidentaux si futiles face à la survie quotidienne de Rio.
Rio de Janeiro. le Brésil. Pays continent. La nuit venue , sa démesure est à la taille de sa fièvre. Beauté, crudité, nuit et jour, brûlure, nectar et vomissures, meurtre et paradis, aux feus artificiels montent des vapeurs charnelles. La peur, la violence, la solitude ; la nuit, l'errance l'abandon.
Contre quel miroir la jeune turque vient t elle de ses ailes inscrire sa douleur ? Ecrire, ce roman est une histoire d'écriture. Écrire pour ne pas mourir, écrire à s'en faire mourir. Une ville, un cahier, une femme, de l'humain. Voilà la pierre de l'encre : l'humain.
Survivre , Je en mots, aucun jeu, écrivain écrivant, un cri écrivant, l'écrit qui arrache chaque silence du ventre la vie. Taille d'écume, taille sur pointe de charbon de soi.
L'écriture d Asli Erdogan est sublime. Il faut souligner la qualité de la traduction d'Esin- Soysal-Dauvergne. Poésie, rythme, relief, profondeur du chant, tout est là, admirablement retranscrit. Les images sont foudroyantes, le regard de l'auteur est d'une humanité suppliciante. J'ai relevé énormément de passages. Je les ai retranscrit pour les partager avec vous. Il y a une jeunesse, une vie incandescente dans ce roman. Je rapproche son écriture à celle de Que viva la musica du fulgrant Andres Caicedo. Des mots comme des comètes, des étoiles filantes, des pépites, des trésors, qui vous font vivre des instants de lecture intense, inoubliable. Un éclat qui oeuvre , un ouvrage dans le sens le plus noble du terme.
Asli Erdogan nous parle de la vie, de l' intérieure de la vie, sur une ligne posée sur le vide, entre absolu défini et vérité infinie , des mots beaux, sensuels, qui font naître sur une colline une fresque aux couleurs, aux parfums, au rythme âcres, purs, violents, acides, flamboyants.
Il y a ce pays, cette cité, il y a le corps et l'esprit. La peau, le coeur, les lèvres, et de sa main... le geste suit. le monde danse à s'échapper.
Se donner à Ecrire comme cela, en littérature est un événement rare et c'est ce qui rend la plume d'Asli Erdogan extrêmement précieuse.
Astrid Shriqui Garain
Contre quel miroir la jeune turque vient t elle de ses ailes inscrire sa douleur ? Ecrire, ce roman est une histoire d'écriture. Écrire pour ne pas mourir, écrire à s'en faire mourir. Une ville, un cahier, une femme, de l'humain. Voilà la pierre de l'encre : l'humain.
Survivre , Je en mots, aucun jeu, écrivain écrivant, un cri écrivant, l'écrit qui arrache chaque silence du ventre la vie. Taille d'écume, taille sur pointe de charbon de soi.
L'écriture d Asli Erdogan est sublime. Il faut souligner la qualité de la traduction d'Esin- Soysal-Dauvergne. Poésie, rythme, relief, profondeur du chant, tout est là, admirablement retranscrit. Les images sont foudroyantes, le regard de l'auteur est d'une humanité suppliciante. J'ai relevé énormément de passages. Je les ai retranscrit pour les partager avec vous. Il y a une jeunesse, une vie incandescente dans ce roman. Je rapproche son écriture à celle de Que viva la musica du fulgrant Andres Caicedo. Des mots comme des comètes, des étoiles filantes, des pépites, des trésors, qui vous font vivre des instants de lecture intense, inoubliable. Un éclat qui oeuvre , un ouvrage dans le sens le plus noble du terme.
Asli Erdogan nous parle de la vie, de l' intérieure de la vie, sur une ligne posée sur le vide, entre absolu défini et vérité infinie , des mots beaux, sensuels, qui font naître sur une colline une fresque aux couleurs, aux parfums, au rythme âcres, purs, violents, acides, flamboyants.
Il y a ce pays, cette cité, il y a le corps et l'esprit. La peau, le coeur, les lèvres, et de sa main... le geste suit. le monde danse à s'échapper.
Se donner à Ecrire comme cela, en littérature est un événement rare et c'est ce qui rend la plume d'Asli Erdogan extrêmement précieuse.
Astrid Shriqui Garain
Lu d'une traite, ce roman d'Asli Erdogan est profondément marquant.
Pendant ma lecture, j'étais envoûtée par le sujet et par la très belle écriture. La présence de cette jeune femme turque à Rio est un mystère, sa survie est faite de solitude, de la folie et de la violence autour d'elle. Une fois le livre refermé, une impression plus dérangeante s'ajoute, car il n'y a aucune complaisance, aucun refuge à trouver.
On ne sait pas pourquoi le personnage de cette "gringa" est venue à Rio. Pour l'inconnu, écrit-elle dans son cahier vert, mais cela semble une explication destinée à masquer un autre motif, plus ancien. Cet inconnu ne recèle aucun bonheur, aucune joie, beaucoup de déceptions, un climat éprouvant, sécheresse ou pluie diluvienne, de la solitude, des déconvenues, des agressions, une tension permanente pour survivre à la violence et la folie d'une ville exubérante, superficielle, et sans pitié.
Beaucoup de questions se posent à la lecture, par exemple pourquoi s'infliger de telles conditions de vie ? Dans quel but ? Pourquoi vouloir dépasser ce point de non-retour, et quel est ce point ? Changer de peau, de personnalité, de vie, aller au bout de soi-même, chercher ce qu'est la vie dans son essence la plus brute ? Il n'y a pas de réponse, le personnage central se dépouille de ce qui pourrait donner du sens à cette vie d'étrangeté , comme l'amour, les croyances ou la religion, et c'est ce qui crée un certain malaise, parce qu'il n'y a pas la distance qui permet de filtrer ou supporter la crudité et la cruauté de la vie à l'état brut. Il Les réponses ne sont pas données, elles sont tout au plus esquissées, ou déguisées.
Un roman à la fois beau et difficile, tendu comme une corde près de rompre.
Pendant ma lecture, j'étais envoûtée par le sujet et par la très belle écriture. La présence de cette jeune femme turque à Rio est un mystère, sa survie est faite de solitude, de la folie et de la violence autour d'elle. Une fois le livre refermé, une impression plus dérangeante s'ajoute, car il n'y a aucune complaisance, aucun refuge à trouver.
On ne sait pas pourquoi le personnage de cette "gringa" est venue à Rio. Pour l'inconnu, écrit-elle dans son cahier vert, mais cela semble une explication destinée à masquer un autre motif, plus ancien. Cet inconnu ne recèle aucun bonheur, aucune joie, beaucoup de déceptions, un climat éprouvant, sécheresse ou pluie diluvienne, de la solitude, des déconvenues, des agressions, une tension permanente pour survivre à la violence et la folie d'une ville exubérante, superficielle, et sans pitié.
Beaucoup de questions se posent à la lecture, par exemple pourquoi s'infliger de telles conditions de vie ? Dans quel but ? Pourquoi vouloir dépasser ce point de non-retour, et quel est ce point ? Changer de peau, de personnalité, de vie, aller au bout de soi-même, chercher ce qu'est la vie dans son essence la plus brute ? Il n'y a pas de réponse, le personnage central se dépouille de ce qui pourrait donner du sens à cette vie d'étrangeté , comme l'amour, les croyances ou la religion, et c'est ce qui crée un certain malaise, parce qu'il n'y a pas la distance qui permet de filtrer ou supporter la crudité et la cruauté de la vie à l'état brut. Il Les réponses ne sont pas données, elles sont tout au plus esquissées, ou déguisées.
Un roman à la fois beau et difficile, tendu comme une corde près de rompre.
Vivre /écrire le chaos.
« Écrire, [C'est] avant tout mettre en ordre ; et si l'on pouvait qualifier Rio d'un seul mot, on dirait CHAOS. »
Vivre à Rio de Janeiro, en tant que femme, blanche, et « gringa », mais aussi refuser ces étiquettes, faire front pour tout connaître, s'exposer au danger, connaître la peur, la faim, le dégoût, comme la fascination morbide, voire mortifère, pour cette ville imprévisible… c'est la gageure d'Asli Erdogan dans ce récit autobiographique et fantasmé. Elle y rencontre les fleurs du mal, une fête païenne entièrement vécue au présent, immense scène où chacun tient son rôle de bandit sublime ou de fou misérable…
Elle mène de front la relation fragmentée de sa vie à Rio, et l'écriture syncopée de son livre « la ville dont la cape est rouge », si bien que le modèle et la copie s'interpénètrent en un étonnant amalgame. Avec deux effets : sa personnalité s'y accomplit, et son livre prend forme.
« Son but était de vernir d'une couche poétique les souvenirs congelés dans le placenta de son imagination. Mais une autre histoire avait vu le jour ; une histoire qui appartenait à une autre femme, Ö. C'était une histoire qu' Özgür n'avait pas vraiment vécue. »
Ce « roman » transmet au lecteur/voyageur une vision éclatée entre plusieurs récits : tantôt une relation immédiate (je) sur le champ, tantôt un récit distancié sous le nom d'Özgür
« le personnage principal du roman nommé Ö pour le moment un personnage à moitié fictif… »
et l'insertion régulière de fragments d'un curieux manuel de tourisme, telle cette évocation inspirée des jeunes Brésiliennes.
« Elles marchent toujours à pas cadencés, souples, comme si elles portaient sur leurs têtes des bananes, comme si elles dansaient la samba au ralenti… insoucieuses, nonchalantes, indolentes… Vers un amant invisible, aux bras grands ouverts qui les attend… Elles sourient au miroir passionné, accroché dans le vide, en écoutant les chuchotements enchantés d'une poésie ; conscientes jusqu'au bout de leurs féminités, maîtrisant entièrement un corps qui ne leur a jamais appartenu… Elles promettent des fruits interdits, plus précieux encore que ceux du paradis, avec l'ivresse du pouvoir sublime, aussi éphémère qu'une fleur sauvage ».
Il en résulte des miroirs brisés, aux éclats coupants, qui donnent une vision totale, à la fois vécue et fantasmée : vie et mort s'y côtoient, beauté et horreur se heurtent en soeurs jumelles dans une prose poétique brutale, scandée comme samba de carnaval, ou rafales de tirs meurtriers sur fond de feux d'artifices.
Le lecteur vit cette expérience, séduit par les images luxuriantes et les scènes intenses où Özgür se met en péril, de vie comme d‘écriture. Sa vision du Brésil rappelle souvent des accents de Malcolm Lowry sur le Mexique dans « Au-dessous du volcan ».
Dans ce livre publié en Turquie (1998) puis chez Actes sud (2003) Özgür devient un nom-destin :
« Elle écrivit au milieu d'une page vide, en grandes lettres : Özgür. Elle détestait les symboles. Il n'existait pas de nom aussi absurde, aussi ironique ; il ridiculisait la personne à ses propres yeux [..] elle remplit de dessins l'intérieur de la lettre Ö. Des trèfles à quatre feuilles, des têtes de squelettes, des clés de sol, des symboles à l'infini… ».
C'est pour ses articles pro-kurdes dans le journal Özgür Gündem que l'auteur est actuellement (janvier 2017) une cible politique dans son pays.
« Écrire, [C'est] avant tout mettre en ordre ; et si l'on pouvait qualifier Rio d'un seul mot, on dirait CHAOS. »
Vivre à Rio de Janeiro, en tant que femme, blanche, et « gringa », mais aussi refuser ces étiquettes, faire front pour tout connaître, s'exposer au danger, connaître la peur, la faim, le dégoût, comme la fascination morbide, voire mortifère, pour cette ville imprévisible… c'est la gageure d'Asli Erdogan dans ce récit autobiographique et fantasmé. Elle y rencontre les fleurs du mal, une fête païenne entièrement vécue au présent, immense scène où chacun tient son rôle de bandit sublime ou de fou misérable…
Elle mène de front la relation fragmentée de sa vie à Rio, et l'écriture syncopée de son livre « la ville dont la cape est rouge », si bien que le modèle et la copie s'interpénètrent en un étonnant amalgame. Avec deux effets : sa personnalité s'y accomplit, et son livre prend forme.
« Son but était de vernir d'une couche poétique les souvenirs congelés dans le placenta de son imagination. Mais une autre histoire avait vu le jour ; une histoire qui appartenait à une autre femme, Ö. C'était une histoire qu' Özgür n'avait pas vraiment vécue. »
Ce « roman » transmet au lecteur/voyageur une vision éclatée entre plusieurs récits : tantôt une relation immédiate (je) sur le champ, tantôt un récit distancié sous le nom d'Özgür
« le personnage principal du roman nommé Ö pour le moment un personnage à moitié fictif… »
et l'insertion régulière de fragments d'un curieux manuel de tourisme, telle cette évocation inspirée des jeunes Brésiliennes.
« Elles marchent toujours à pas cadencés, souples, comme si elles portaient sur leurs têtes des bananes, comme si elles dansaient la samba au ralenti… insoucieuses, nonchalantes, indolentes… Vers un amant invisible, aux bras grands ouverts qui les attend… Elles sourient au miroir passionné, accroché dans le vide, en écoutant les chuchotements enchantés d'une poésie ; conscientes jusqu'au bout de leurs féminités, maîtrisant entièrement un corps qui ne leur a jamais appartenu… Elles promettent des fruits interdits, plus précieux encore que ceux du paradis, avec l'ivresse du pouvoir sublime, aussi éphémère qu'une fleur sauvage ».
Il en résulte des miroirs brisés, aux éclats coupants, qui donnent une vision totale, à la fois vécue et fantasmée : vie et mort s'y côtoient, beauté et horreur se heurtent en soeurs jumelles dans une prose poétique brutale, scandée comme samba de carnaval, ou rafales de tirs meurtriers sur fond de feux d'artifices.
Le lecteur vit cette expérience, séduit par les images luxuriantes et les scènes intenses où Özgür se met en péril, de vie comme d‘écriture. Sa vision du Brésil rappelle souvent des accents de Malcolm Lowry sur le Mexique dans « Au-dessous du volcan ».
Dans ce livre publié en Turquie (1998) puis chez Actes sud (2003) Özgür devient un nom-destin :
« Elle écrivit au milieu d'une page vide, en grandes lettres : Özgür. Elle détestait les symboles. Il n'existait pas de nom aussi absurde, aussi ironique ; il ridiculisait la personne à ses propres yeux [..] elle remplit de dessins l'intérieur de la lettre Ö. Des trèfles à quatre feuilles, des têtes de squelettes, des clés de sol, des symboles à l'infini… ».
C'est pour ses articles pro-kurdes dans le journal Özgür Gündem que l'auteur est actuellement (janvier 2017) une cible politique dans son pays.
Citations et extraits (78)
Voir plus
Ajouter une citation
C'était un après-midi de juillet. La pluie tombait comme si elle voulait nettoyer la ville de toutes ses impuretés et les dissoudre. La rue était déserte. Il n'y avait plus de circulation, les magasins avaient baissé leurs stores, même les sans-abri s'étaient trouvé un refuge. Le match avec la Russie allait commencer dans une demi-heure. Tandis que, moi, j'essayais de rentrer chez moi, seul endroit où je pouvais échapper à cette agitation.
Je l'ai rencontré à Cinelândia, à l'entrée d'un cinéma... (je le nommerai quand je l'aurai décrit.) Il était allongé sur une couche de boue. Des gouttes piquantes comme des aiguilles lui frappaient le visage. Il n'agonisait peut-être pas encore, mais il avait gagné le large par rapport aux rives de la vie, et son retour n'était plus possible. Il était sur le point de mourir de faim. Son corps avait trahi son âme, lui avait renvoyé sa dernière nourriture. Il essayait en vain, avec le peu de forces qui lui restait, de se hisser vers sa vomissure. pour pouvoir manger, une fois de plus.
Personne ne se retournait pour s'occuper de lui. Les trois ou quatre personnes qui étaient sur la place s'empressaient d'aller regarder le match, d'ailleurs ils avaient l'habitude des différentes mises en scène de la mort. J'étais la seule, avec ma figure pâle, à rester immobile sous les torrents d'eau. J'étais comme pétrifiée, je ne pouvais ni pleurer ni crier; un cri silencieux me bloquait la gorge comme un coup de poing. Je me souvenais d'un film que j'avais vu des années auparavant. (La fiction face à la réalité! Dans quelle mesure cela pouvait-il épargner un face-à-face avec soi-même?) Dans un hôtel isolé en plein milieu des tropiques, le héros américain du film racontait l'image la plus atroce de la faim qu'il ait vue dans sa vie : un indigène cherchant parmi les excréments humains des morceaux qui n'avaient pas été digérés... J'avais eu la nausée pendant plusieurs jours, je ne croyais pas qu'une description si précise, si poignante de la faim puisse se faire. Pourtant la terrible réalité des rues de Rio était encore plus cruelle que n'importe quelle description, elle avait gravé dans mon cerveau l'image de la faim à coup de marteau.
Je suis obligée de raconter cet homme à tout le monde, celui qui croisa mon chemin à Cinelândia, une demi-heure avant le match entre le Brésil et la Russie, c'est-à-dire, à un point déterminé du temps et de l'espace. (Qu'ils veulent l'entendre ou pas.) Le prix de ce cri qui m'étouffait doit être payé. J'ai été maudite de l'avoir contemplé, durant de longues minutes, sans rien faire, et de poursuivre mon chemin. Parce qu'il n'y avait rien à faire, parce que je n'avais pas pu trouver une cuiller pour lui faire avaler sa vomissure, parce que tous les buffets étaient fermés, parce que je ne l'avais pas achevé avec un revolver pour mettre immédiatement fin à sa douleur... Qu'est-ce que j'avais à lui donner? A lui épargner? J'ai continué mon chemin, car je m'étais fixé une mission. Un argument pour retarder ma propre mort...
Pourtant, maintenant, en regardant les lettres que j'aligne sur le vide blanc qui se trouve devant moi, je ne vois plus cet homme. Je suis démunie d'un langage pouvant le raconter. Je ne suis pas assez forte, pas assez cruelle, pas assez charitable. Je ne suis jamais restée affamée assez longtemps. Les mots ne lui redonneront pas la vie, mais il peuvent au moins lui redonner son nom : Il était un Être humain.
p.139-140
Je l'ai rencontré à Cinelândia, à l'entrée d'un cinéma... (je le nommerai quand je l'aurai décrit.) Il était allongé sur une couche de boue. Des gouttes piquantes comme des aiguilles lui frappaient le visage. Il n'agonisait peut-être pas encore, mais il avait gagné le large par rapport aux rives de la vie, et son retour n'était plus possible. Il était sur le point de mourir de faim. Son corps avait trahi son âme, lui avait renvoyé sa dernière nourriture. Il essayait en vain, avec le peu de forces qui lui restait, de se hisser vers sa vomissure. pour pouvoir manger, une fois de plus.
Personne ne se retournait pour s'occuper de lui. Les trois ou quatre personnes qui étaient sur la place s'empressaient d'aller regarder le match, d'ailleurs ils avaient l'habitude des différentes mises en scène de la mort. J'étais la seule, avec ma figure pâle, à rester immobile sous les torrents d'eau. J'étais comme pétrifiée, je ne pouvais ni pleurer ni crier; un cri silencieux me bloquait la gorge comme un coup de poing. Je me souvenais d'un film que j'avais vu des années auparavant. (La fiction face à la réalité! Dans quelle mesure cela pouvait-il épargner un face-à-face avec soi-même?) Dans un hôtel isolé en plein milieu des tropiques, le héros américain du film racontait l'image la plus atroce de la faim qu'il ait vue dans sa vie : un indigène cherchant parmi les excréments humains des morceaux qui n'avaient pas été digérés... J'avais eu la nausée pendant plusieurs jours, je ne croyais pas qu'une description si précise, si poignante de la faim puisse se faire. Pourtant la terrible réalité des rues de Rio était encore plus cruelle que n'importe quelle description, elle avait gravé dans mon cerveau l'image de la faim à coup de marteau.
Je suis obligée de raconter cet homme à tout le monde, celui qui croisa mon chemin à Cinelândia, une demi-heure avant le match entre le Brésil et la Russie, c'est-à-dire, à un point déterminé du temps et de l'espace. (Qu'ils veulent l'entendre ou pas.) Le prix de ce cri qui m'étouffait doit être payé. J'ai été maudite de l'avoir contemplé, durant de longues minutes, sans rien faire, et de poursuivre mon chemin. Parce qu'il n'y avait rien à faire, parce que je n'avais pas pu trouver une cuiller pour lui faire avaler sa vomissure, parce que tous les buffets étaient fermés, parce que je ne l'avais pas achevé avec un revolver pour mettre immédiatement fin à sa douleur... Qu'est-ce que j'avais à lui donner? A lui épargner? J'ai continué mon chemin, car je m'étais fixé une mission. Un argument pour retarder ma propre mort...
Pourtant, maintenant, en regardant les lettres que j'aligne sur le vide blanc qui se trouve devant moi, je ne vois plus cet homme. Je suis démunie d'un langage pouvant le raconter. Je ne suis pas assez forte, pas assez cruelle, pas assez charitable. Je ne suis jamais restée affamée assez longtemps. Les mots ne lui redonneront pas la vie, mais il peuvent au moins lui redonner son nom : Il était un Être humain.
p.139-140
LE FOU DE SANTA TERESA Après un certain point, on ne peut plus revenir en arrière. C'est ce point qu'il faut atteindre. KAFKA Au début, la pauvreté, qui était la condition majeure du vagabondage, était entrée petit à petit dans sa vie ; pareille à une tumeur métastasique envahissant sournoisement tout le corps, elle l'avait surprise soudainement. Lorsqu'elle avait été renvoyée de l'université, elle espérait enseigner l'anglais dans l'une de ces centaines d'institutions répandues aux quatre coins de la ville. Mais ses calculs étaient faux. Tous les postes étaient occupés soit par des Américains vacanciers ou aventuriers, soit par des professionnels ayant passé leur vie à l'enseignement de l'anglais. Personne n'avait confiance en cette femme qui venait d'un pays inconnu. Pendant tout le mois de janvier où la température atteignait quarante degrés à l'ombre, elle prenait les bus bondés, où régnait une mauvaise odeur : elle parcourait toute la ville, en écrivant différents CV, du matin jusqu'au soir parmi des gens exténués de fatigue. Elle avait eu des entretiens sans résultat avec des responsables chics et arrogants. C'étaient de jeunes professionnels pour qui le fait d'être professeur d'anglais était la tâche la plus importante du monde – il en était de même pour tout ce qu'ils faisaient -, ils étaient amoureux de leur carrière et, comme s'ils voulaient montrer leurs pommes d'Adam, ils redressaient leurs mentons vers le haut. Ils analysaient d'un seul regard la femme au teint blafard qui se tenait en face d'eux, la situaient en voyant son sac déformé, ses talons usés, ses cheveux décoiffés. Après de longues démarches, elle parvint à trouver un poste, mais fut aussitôt renvoyée pour n'avoir pas coopéré avec les élèves et avoir gardé ses manières de professeur d'université. Finalement, avec beaucoup de difficultés, elle trouva quelques élèves ; la plupart étaient des ingénieurs fatigués d'être seuls, qui avaient des rapports incestueux avec leurs ordinateurs, et leur désir d'apprendre l'anglais disparaissait aussitôt la première invitation à dîner refusée. Au fur et à mesure, Özgür avait été contrainte à prendre des mesures, à augmenter ses privations. Il n'était plus question qu'elle s'achète des vêtements, qu'elle aille chez le coiffeur, chez le dentiste, ni au restaurant. Elle allait au marché du quartier et négociait les prix, un peu gênée, elle lisait le journal une fois par semaine et assistait uniquement à des concerts ou spectacles gratuits. Contrairement aux histoires d'immigrés du Nouveau Monde, son parcours avait commencé dans un quartier chic, à Copacabana; puis à Botafago, quartier modeste peuplé par la classe moyenne, où il y avait de nombreuses églises, hôpitaux et supermarchés ; elle s'était peu à peu éloignée des plages en se dirigeant le long des baies de Flamengo vers l'intérieur de la ville. De la Rio à la peau blanche, touristique, climatisée et toujours en tête d'affiche, elle avait rejoint la vraie Rio, celle qui était métisse, inconnue, infernale... De la Rio qui accumulait ses richesses avec un appétit insatiable, à l'autre qui ne se rendait même pas compte qu'elle perdait toujours...
Finalement, elle comprit que la seule personne capable de donner un sens au vide qui l'entourait, c'était elle. Personne d'autre ne pouvait à sa place déchiffrer les énigmes de la vie, ouvrir les cadenas. Elle avait commencé à écrire le jour où elle avait déterminé sa position de défense contre la violence aveugle de la ville.
Des créatures cauchemardesques, ressemblant aux rescapés d’Auschwitz, la tête couverte de bandages, mutilées, avec des pattes d’éléphant, des jambes de bois ; des adolescentes impitoyables, rabougris, se promenant en bandes ; des fillettes violées chaque jour ; des femmes qui luttent contre une faim redoublée ; d’autres, à moitié détraqués, enveloppés de haillons, qui marquent leur territoire grâce à leur puenteur, se répandent à des mètres de distance, comme celle des putois ; des enfants mendiants, recouverts de marques de coups, de brûlures, de torture ; des enfants tuberculeux, atteints de trachome, de sida… Des fous à lier, qui parlent tout seuls, qui poussent des ricanements, qui se masturbent, qui lancent des injures – totalement justifiées – aux passants représentant l’humanité… Des vieux, dont on souhaite qu’ils quittent ce monde le plus vite possible, qui s’accrochent à la vie avec leurs dents cariées… Les seigneurs des sans-abris, divisés en castes : les cambrioleurs, les imposteurs, les voleurs à la tire, les dealers de drogue, les espions… La classe moyenne, travaillant avec honnêteté : ceux qui vendent, sur leurs étagères de seconde main, des billets, des jetons, des confiserie à la noix de coco, des guaranas, des batidas… Des tribus, se rassemblant autour du feu gigantesque, sous le pont… Des familles enchevêtrées par des liens incestueux, où on ne connaît ni le nombre, ni l’âge des enfants, ni l’identité des parents… Les mendiants, qui essaient d’arracher le maximum de jours, d’heures, de minutes de tolérance presque zéro de Rio…
Il y a aussi ceux qui ne sont même plus en état de mendier. La faim les a conduits à la limite de la mort, ils ont atteint le niveau le plus pur, le plus simple de l’existence : la substance vivante… Ils dorment sans cesse, nuit et jour, allongés sur l’asphalte brûlant ou le béton humide, en plein milieu des flaques de boue, des trottoirs. Ils dorment, indifférents à tout ce qui se passe autour d’eux, aux pluies tropicales qui durent parfois des semaines, au soleil mortel, aux bus, aux policiers à ceux qui les enjambent, qui les heurtent, qui les insultent ou qui leur laissent un morceau de pain moisi. C’est un sommeil qui s’approfondit, s’alourdit, se coagule progressivement ; un voyage nonchalant vers les frontières du pays des Morts… Leur mort est toujours silencieuse, comme une bougie qui s’éteint dans le vent. Une mort à laquelle ne se mêlent ni prières, ni cantiques, ni trompettes. Ils ne gémissent pas, ne hurlent pas, ne se révoltent pas. Parce qu’il n’y a personne pour les entendre. Ils résistent à la moindre particule de vie qui leur reste, avec la passion la plus vieille, la plus désespérée, la plus irrésistible du corps, avec une volonté de fer, ils résistent, résistent, résistent… (pp. 118-119)
Il y a aussi ceux qui ne sont même plus en état de mendier. La faim les a conduits à la limite de la mort, ils ont atteint le niveau le plus pur, le plus simple de l’existence : la substance vivante… Ils dorment sans cesse, nuit et jour, allongés sur l’asphalte brûlant ou le béton humide, en plein milieu des flaques de boue, des trottoirs. Ils dorment, indifférents à tout ce qui se passe autour d’eux, aux pluies tropicales qui durent parfois des semaines, au soleil mortel, aux bus, aux policiers à ceux qui les enjambent, qui les heurtent, qui les insultent ou qui leur laissent un morceau de pain moisi. C’est un sommeil qui s’approfondit, s’alourdit, se coagule progressivement ; un voyage nonchalant vers les frontières du pays des Morts… Leur mort est toujours silencieuse, comme une bougie qui s’éteint dans le vent. Une mort à laquelle ne se mêlent ni prières, ni cantiques, ni trompettes. Ils ne gémissent pas, ne hurlent pas, ne se révoltent pas. Parce qu’il n’y a personne pour les entendre. Ils résistent à la moindre particule de vie qui leur reste, avec la passion la plus vieille, la plus désespérée, la plus irrésistible du corps, avec une volonté de fer, ils résistent, résistent, résistent… (pp. 118-119)
Un écrivain avait dit : « Pour connaître l'homme, il faut aller loin. » Ce n'est qu'après être allée si loin qu'elle en savait plus sur les Latinos : « No ire foras... » (Ne va pas dans le lointain, la réalité est au fond de toi.) Il fallait peut-être franchir l'enfer pour pouvoir renaître, traverser les tropiques dangereux, infernaux, tristes... Elle avait rejeté « le monde » qu'on lui avait offert : elle avait rassemblé toutes ses forces dans un seul but. Attraper Rio de ses mains, comme un papillon, et l'enfermer dans ses propres mots sans la tuer. La Ville dont la cape est rouge était née.
Videos de Asli Erdogan (19)
Voir plusAjouter une vidéo
Retrouvez les derniers épisodes de la cinquième saison de la P'tite Librairie sur la plateforme france.tv :
https://www.france.tv/france-5/la-p-tite-librairie/
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos de la P'tite Librairie.
Quelle romancière turque, dont les livres parlent surtout d'amour, vit aujourd'hui en exil en Allemagne après avoir purgé une peine de prison en Turquie ?
« L'Homme Coquillage », d'Asli Erdogan, c'est à lire en poche chez Babel
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos de la P'tite Librairie.
Quelle romancière turque, dont les livres parlent surtout d'amour, vit aujourd'hui en exil en Allemagne après avoir purgé une peine de prison en Turquie ?
« L'Homme Coquillage », d'Asli Erdogan, c'est à lire en poche chez Babel
autres livres classés : littérature turqueVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Asli Erdogan (7)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Tête de Turc !
De quelle pièce de Molière cette réplique est-elle extraite ? Que diable allait-il faire dans cette galère ? Ah maudite galère ! Traître de Turc à tous les diables !
Le bourgeois gentilhomme
Monsieur de Pourceaugnac
Les Fourberies de Scapin
La jalousie du barbouillé
10 questions
62 lecteurs ont répondu
Thèmes :
turquie
, turc
, littérature
, cinema
, humour
, Appréciation
, évocationCréer un quiz sur ce livre62 lecteurs ont répondu