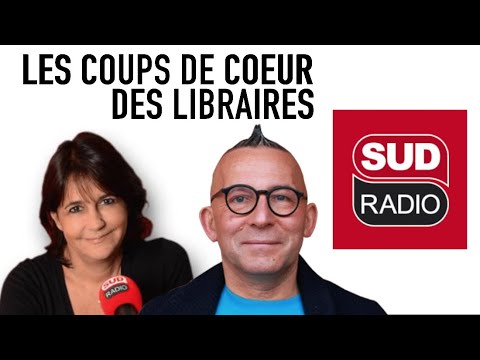Patrice Jean/5
40 notes
Résumé :
Antoine Jourdan et Thomas Dabrowski se connaissent depuis de nombreuses années. Ils ont fondé ensemble Tour d’ivoire, une revue littéraire confidentielle qu’ils animent avec ferveur.
Peu à peu, leur amitié se dérègle. Perdre un complice de jeunesse est souvent de mauvais
augure. Antoine, pris dans des tourmentes familiales et amoureuses, devra faire face à des
choix décisifs.
Mesure-t-on jamais la véritable portée de nos trahisons ? Ne pa... >Voir plus
Peu à peu, leur amitié se dérègle. Perdre un complice de jeunesse est souvent de mauvais
augure. Antoine, pris dans des tourmentes familiales et amoureuses, devra faire face à des
choix décisifs.
Mesure-t-on jamais la véritable portée de nos trahisons ? Ne pa... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Tour d'ivoireVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (11)
Voir plus
Ajouter une critique
Antoine Jourdan végète dans un emploi subalterne à la médiathèque de Rouen. Parallèlement, il codirige une revue élitiste de littérature avec son ami Thomas Dabrowski. Un jour, il découvre que dans l'héritage de ses parents figure le tableau d'un petit maître du XVIIe siècle, qui peut valoir un peu d'argent. Une dispute va éclater avec son frère et sa soeur pour savoir qu'en faire. ● Il ne se passe pas grand-chose dans ce roman qui semble surtout écrit pour diffuser les idées de l'auteur. Celles-ci, du propre aveu du narrateur, peuvent être qualifiées de « réactionnaires ». En tout cas, il est certain qu'elles vont à contre-courant des idées « mainstream ». Cela ne me dérangerait pas, mais je trouve ce livre lourdingue et caricatural. L'élitisme exige plus de finesse ! Ici le style flirte avec le kitsch et l'intrigue, réduite à la portion congrue, est loin d'être palpitante. ● On ne retrouve pas vraiment non plus l'humour qu'il y a dans L'homme surnuméraire, La Poursuite de l'idéal, ou même La France de Bernard, le premier roman de Patrice Jean, trois romans que j'ai nettement préférés à celui-ci.
Le narrateur de ce roman reproche à internet de donner la parole à des gens qui devraient se taire, et qui s'improvisent critiques littéraires. Je suis bien d'accord avec lui, mais je mettrai mon grain de sel quand même.
"Tour d'ivoire" pourrait être un roman anti-moderne de plus, après Houellebecq, Bruno Lafourcade, Patrice Jean lui-même et d'autres auteurs sous le boisseau. Il n'a plus, cependant, le mordant, la "vis comica" de ces derniers, qui ridiculisaient les Edwy Plenel, les sociologues, les bourgeois-e-s de gauche et les intermittent-e-s de la vertu. Il fait moins rire de ces masques et semble mettre la satire et l'outrage au second plan : on ne le lira pas pour se venger, pour aimer ses préjugés, ou pour le délicieux frisson transgressif du lecteur catéchisé à perpétuité par la littérature qui se vend.
Tirant vers l'essai, le récit à la première personne d'un héros velléitaire pourrait donner lieu à des réflexions sérieuses sur la Tour d'Ivoire. Comment survivre dans un monde barbare ? Peut-on se replier sur un nombre d'amis et de livres choisis, et ignorer le reste ? Mais même cette question, qui aurait pu faire du livre un manuel de survie, est tenue à distance, évoquée comme par citation, comme si elle ne concernait plus directement le récit. D'ailleurs, les personnages font le contraire de ce qu'ils disent et leur vie ne s'harmonise qu'un temps avec leur doctrine.
C'est là, je crois, la qualité principale de l'ouvrage : il ne racole pas, il ne prêche pas, il n'enseigne pas, mais raconte une histoire comme doit le faire un bon et honnête roman. Flaubert est partout dans "Tour d'ivoire", pour nous rappeler que les idéaux, les doctrines, les politiques, ne sont pas des objets romanesques, mais seulement des paysages sur lesquels se détachent les destins individuels des personnages.
Pour faire la nique à la bêtise collective, il ne faut pas créer (en littérature) une bêtise opposée. La littérature ne change rien aux choses. Elle se renie quand elle tombe dans le sermon.
"Tour d'ivoire" pourrait être un roman anti-moderne de plus, après Houellebecq, Bruno Lafourcade, Patrice Jean lui-même et d'autres auteurs sous le boisseau. Il n'a plus, cependant, le mordant, la "vis comica" de ces derniers, qui ridiculisaient les Edwy Plenel, les sociologues, les bourgeois-e-s de gauche et les intermittent-e-s de la vertu. Il fait moins rire de ces masques et semble mettre la satire et l'outrage au second plan : on ne le lira pas pour se venger, pour aimer ses préjugés, ou pour le délicieux frisson transgressif du lecteur catéchisé à perpétuité par la littérature qui se vend.
Tirant vers l'essai, le récit à la première personne d'un héros velléitaire pourrait donner lieu à des réflexions sérieuses sur la Tour d'Ivoire. Comment survivre dans un monde barbare ? Peut-on se replier sur un nombre d'amis et de livres choisis, et ignorer le reste ? Mais même cette question, qui aurait pu faire du livre un manuel de survie, est tenue à distance, évoquée comme par citation, comme si elle ne concernait plus directement le récit. D'ailleurs, les personnages font le contraire de ce qu'ils disent et leur vie ne s'harmonise qu'un temps avec leur doctrine.
C'est là, je crois, la qualité principale de l'ouvrage : il ne racole pas, il ne prêche pas, il n'enseigne pas, mais raconte une histoire comme doit le faire un bon et honnête roman. Flaubert est partout dans "Tour d'ivoire", pour nous rappeler que les idéaux, les doctrines, les politiques, ne sont pas des objets romanesques, mais seulement des paysages sur lesquels se détachent les destins individuels des personnages.
Pour faire la nique à la bêtise collective, il ne faut pas créer (en littérature) une bêtise opposée. La littérature ne change rien aux choses. Elle se renie quand elle tombe dans le sermon.
Sur le fond, les passions humaines ont toujours été les mêmes. Sur leurs formes, Patrice Jean nous en fournit une illustration contemporaine édifiante dans Tour d'ivoire. Dans la France du XXIème siècle, les grenouilles de bénitier ont cédé la place aux pimprenelles ânonnant leurs slogans progressistes. Les notables, jadis aux premiers rangs dans les églises pour écouter la parabole des premiers qui seront derniers, ont cédé la place aux bobos promoteurs du vivre-ensemble qui se maintiennent à bonne distance de la France des relégués. Dans le domaine du divertissement auquel la littérature est assignée, celle-ci ne fait pas le poids face au reste de l'offre. Sa promotion passe désormais par sa disneylandisation puisque l'époque en a décidé ainsi.
Antoine Jourdan paie le prix fort pour son refus d'entrer dans le grand bal des nouveaux dégueulasses. Relégation sociale, misère relationnelle, sentimentale… et sexuelle, bien sûr. Lorsqu'il se lance enfin dans la danse, il se trouve vite nu. C'est que l'encanaillement ne s'improvise pas, Monsieur Jourdan. L'encanaillement est une profession de foi, un plan au long cours où chacun est récompensé à hauteur de son aptitude à la compromission et à la combinaison. Vous avez perdu, Monsieur Jourdan. Vous boirez la coupe jusqu'à la lie pour vous être détourné de la comédie humaine, quand bien même vous l'auriez jugée grotesque. Quant à vos livres et vos arts réputés beaux, vos amitiés rares, ayez l'amabilité d'emporter tout ce fatras avec vous !
Patrice Jean ne devrait pas avoir besoin de grande promotion pour figurer parmi les meilleurs auteurs de cette décennie. On le comparerait volontiers à d'autres, mais j'ai vu dans l'une de ses interviews qu'il rechigne à l'exercice. Alors je me contenterai de dire que nous avons affaire ici à un grand roman.
Antoine Jourdan paie le prix fort pour son refus d'entrer dans le grand bal des nouveaux dégueulasses. Relégation sociale, misère relationnelle, sentimentale… et sexuelle, bien sûr. Lorsqu'il se lance enfin dans la danse, il se trouve vite nu. C'est que l'encanaillement ne s'improvise pas, Monsieur Jourdan. L'encanaillement est une profession de foi, un plan au long cours où chacun est récompensé à hauteur de son aptitude à la compromission et à la combinaison. Vous avez perdu, Monsieur Jourdan. Vous boirez la coupe jusqu'à la lie pour vous être détourné de la comédie humaine, quand bien même vous l'auriez jugée grotesque. Quant à vos livres et vos arts réputés beaux, vos amitiés rares, ayez l'amabilité d'emporter tout ce fatras avec vous !
Patrice Jean ne devrait pas avoir besoin de grande promotion pour figurer parmi les meilleurs auteurs de cette décennie. On le comparerait volontiers à d'autres, mais j'ai vu dans l'une de ses interviews qu'il rechigne à l'exercice. Alors je me contenterai de dire que nous avons affaire ici à un grand roman.
De prime abord, on pourrait croire qu'il s'agit d'un simple récit d'un homme qui navigue dans le monde de l'élitisme littéraire et du monde édifiant des beaux-arts. Mais sous cette surface tranquille se cache une éruption de vérités inconfortables et d'idées réactionnaires qui ébranlent nos convictions.
Ici, Patrice Jean nous sert un personnage, Antoine Jourdan, un homme qui semble avoir été jeté dans une fosse aux lions, sans armes ni armure. Il y a quelque chose de profondément ironique à voir un homme qui porte si haut l'étendard de l'élitisme se retrouver écrasé par le poids de son propre isolement et de ses frustrations. C'est le tarif à payer quand on se tient debout face à l'époque qui danse sauvagement autour de soi, en ignorant délibérément la chorégraphie collective.
Et pourtant, malgré toutes ses défaillances, "La Tour d'Ivoire" reste un récit saisissant. Pas parce qu'il est particulièrement novateur ou même agréable, mais parce qu'il n'a pas peur de se démarquer. Il y a quelque chose de presque admirable dans la façon dont Patrice Jean s'efforce de creuser sous la peau de la société contemporaine, d'exposer ses nerfs à vif et de les disséquer sans ménagement. Il est rare de trouver un auteur capable de s'éloigner autant des sentiers battus sans tomber dans la facilité.
Mais on ne peut ignorer que le style de Jean, qui flirte parfois avec le kitsch, nuit parfois à l'impact du récit. Les idées réactionnaires du personnage principal sont, à mon sens, bien trop lourdes pour être véritablement subversives, et l'intrigue du roman semble être réduite à un simple prétexte pour faire avancer le discours de l'auteur. Voici ici une oeuvre qui, bien que parfois maladroite, dépeint une image sincère et désabusée de notre époque.
Ici, Patrice Jean nous sert un personnage, Antoine Jourdan, un homme qui semble avoir été jeté dans une fosse aux lions, sans armes ni armure. Il y a quelque chose de profondément ironique à voir un homme qui porte si haut l'étendard de l'élitisme se retrouver écrasé par le poids de son propre isolement et de ses frustrations. C'est le tarif à payer quand on se tient debout face à l'époque qui danse sauvagement autour de soi, en ignorant délibérément la chorégraphie collective.
Et pourtant, malgré toutes ses défaillances, "La Tour d'Ivoire" reste un récit saisissant. Pas parce qu'il est particulièrement novateur ou même agréable, mais parce qu'il n'a pas peur de se démarquer. Il y a quelque chose de presque admirable dans la façon dont Patrice Jean s'efforce de creuser sous la peau de la société contemporaine, d'exposer ses nerfs à vif et de les disséquer sans ménagement. Il est rare de trouver un auteur capable de s'éloigner autant des sentiers battus sans tomber dans la facilité.
Mais on ne peut ignorer que le style de Jean, qui flirte parfois avec le kitsch, nuit parfois à l'impact du récit. Les idées réactionnaires du personnage principal sont, à mon sens, bien trop lourdes pour être véritablement subversives, et l'intrigue du roman semble être réduite à un simple prétexte pour faire avancer le discours de l'auteur. Voici ici une oeuvre qui, bien que parfois maladroite, dépeint une image sincère et désabusée de notre époque.
Le roman est bien ancré dans la réalité et nous emmène sur les pas d'Antoine. Antoine aime la littérature et les livres jusqu'à l'obsession, mais pas n'importe quelle littérature, celle qui est rare et pointue, celle qui n'est pas forcément appréciée de tous. Avec son meilleur ami, ils ont fondé "Tour d'Ivoire", une revue littéraire exigeante, voire intransigeante, qui, bien sûr, ne fonctionne pas du tout. Antoine vit avec sa fille dans un HLM d'une banlieue délabrée. Son ex-femme l'a quitté et le déteste. Il n'a pas d'argent, mais cela n'a pas d'importance pour Antoine ! Il a deux amis, sa fille et les livres. Cependant, tout va bientôt s'arrêter...
Ce roman social et misanthrope nous entraîne dans plusieurs univers, de la banlieue aux soirées chic de la capitale. À l'image d'un Houellebecq, Patrice Jean nous emmène totalement avec son héros. On tourne les pages avec plaisir pour découvrir la suite des aventures presque philosophiques d'Antoine.
Dommage que Patrice Jean ait choisi de rendre ses personnages si antipathiques. Ils n'aiment personne, ce qui rend parfois difficile pour les lecteurs de les apprécier et de ressentir de la sympathie pour eux et leurs histoires. C'est d'autant plus dommage que le livre est parfois très drôle ! A lire pour découvrir ce personnage de pied nickelé et son environnement un peu dingue.
Cette première rencontre avec les livres de Patrice Jean m'a définitivement donné envie d'aller découvrir ses autres oeuvres.
Ce roman social et misanthrope nous entraîne dans plusieurs univers, de la banlieue aux soirées chic de la capitale. À l'image d'un Houellebecq, Patrice Jean nous emmène totalement avec son héros. On tourne les pages avec plaisir pour découvrir la suite des aventures presque philosophiques d'Antoine.
Dommage que Patrice Jean ait choisi de rendre ses personnages si antipathiques. Ils n'aiment personne, ce qui rend parfois difficile pour les lecteurs de les apprécier et de ressentir de la sympathie pour eux et leurs histoires. C'est d'autant plus dommage que le livre est parfois très drôle ! A lire pour découvrir ce personnage de pied nickelé et son environnement un peu dingue.
Cette première rencontre avec les livres de Patrice Jean m'a définitivement donné envie d'aller découvrir ses autres oeuvres.
Citations et extraits (8)
Voir plus
Ajouter une citation
Il suffisait d'ôter à chaque idée son fard pour découvrir sous l'abstraction la sauvagerie des pulsions.
L'Incorrect, avril 2019, entretien avec l'auteur.
... Je me demande si on peut écrire des romans aujourd'hui sans parler de la littérature, parce que la littérature ne va plus de soi.
(Olivier Maulin) Vous croyez vraiment qu'il y a aujourd'hui une rupture particulière ?
(Patrice Jean). Il y a des auteurs qui vendent 500000 exemplaires, mais la littérature un peu plus exigeante, qui essaie de réfléchir et ne donne pas dans le cliché systématique, elle ne vend pas énormément. Je suis tout de même un peu inquiet. Vous ne l'êtes pas, vous ?
(Olivier Maulin et Romaric Sangars). Si.
(R. Sangars). Richard Millet parle du "culturel" comme du lieu de la déréliction du littéraire. C'est un peu ce que vous mettez en scène dans la médiathèque où travaille votre médiateur, non ?
(P. Jean). Oui, bien sûr. Hier, j'étais dans une librairie à Guérande, il y avait un grand présentoir avec les livres d'Aurélie Valognes. J''arrive à Paris et, dans le métro, je vois de grandes affiches d'Aurélie Valognes : ça prend toute la place ...
(O. Maulin) Enfin, il y a aussi le problème qu'en règle générale, les libraires sont des cons.
(P. Jean). Il ne faut pas trop le dire ... Et puis, dans mon livre, il y a un libraire héroïque.
(Maulin). Oui, qui ferme.
... Je me demande si on peut écrire des romans aujourd'hui sans parler de la littérature, parce que la littérature ne va plus de soi.
(Olivier Maulin) Vous croyez vraiment qu'il y a aujourd'hui une rupture particulière ?
(Patrice Jean). Il y a des auteurs qui vendent 500000 exemplaires, mais la littérature un peu plus exigeante, qui essaie de réfléchir et ne donne pas dans le cliché systématique, elle ne vend pas énormément. Je suis tout de même un peu inquiet. Vous ne l'êtes pas, vous ?
(Olivier Maulin et Romaric Sangars). Si.
(R. Sangars). Richard Millet parle du "culturel" comme du lieu de la déréliction du littéraire. C'est un peu ce que vous mettez en scène dans la médiathèque où travaille votre médiateur, non ?
(P. Jean). Oui, bien sûr. Hier, j'étais dans une librairie à Guérande, il y avait un grand présentoir avec les livres d'Aurélie Valognes. J''arrive à Paris et, dans le métro, je vois de grandes affiches d'Aurélie Valognes : ça prend toute la place ...
(O. Maulin) Enfin, il y a aussi le problème qu'en règle générale, les libraires sont des cons.
(P. Jean). Il ne faut pas trop le dire ... Et puis, dans mon livre, il y a un libraire héroïque.
(Maulin). Oui, qui ferme.
... tout individu passionné par l'organisation de la cité plus que par la poésie, la beauté et la vanité des choses, s'apparentait, à ses yeux, à un demeuré. Je n'en étais pas encore à ce stade (de demeuré), cependant, les leveurs de papattes [note : les militants engagés politiquement corrects] ne me laissant pas en paix, je prenais un malin plaisir à défendre toutes les idées qu'ils haïssaient, par un réflexe qu'on aurait pu qualifier de "moral". A prendre une posture je risquais de me figer en elle, oubliant qu'elle n'était, au commencement, qu'une stratégie pour faire la nique au confort intellectuel dans lequel se vautraient mes amis progressistes. Thomas, lui, ne cherchait même pas, même plus, à jouer les épouvantails à moineaux, les fascistes à sermonneurs.
p. 81
p. 81
Je finis par ouvrir l’enveloppe, mal disposé à l’endroit de l’épistolier. Quand j’en eus achevé la lecture, j’étais défait. Eidée qu’il eût choisi la méthode épistolaire ne comptait plus, ne comptait que l’objet de la lettre, sa terrible révélation. Dès les premiers mots, Thomas revenait sur la dispute de l’avant-veille : « Tu me reproches de faire grand cas de notre petite revue, de trahir, de ce fait, mon j’m-en-foutisme, mon indifférence. Mais, mon cher Antoine, je peux, à mon tour, et avec plus de raison, te renvoyer les mêmes compliments : par quelle folie, après plus de vingt ans d’insuccès heureux, crois-tu soudainement à une future prospérité de Tour d’ivoire ? Si elle reste fidèle à elle-même, notre revue n’a aucune chance de succès ; seule une dénaturation complète de ses ambitions la mènera à remporter quelques suffrages, maigres suffrages de toute façon. C’est toi qui perds la tête et, avec elle, l’indifférence philosophique qui, jusqu’à aujourd’hui, ne t’avait jamais quitté. Comment peux-tu m’imputer un changement d’état d’esprit quand je ne déplace pas d’un pouce ma ligne de conduite : l’échec, l’échec, l’échec, dans la bonne humeur et l’insouciance ! Toi, en revanche, tu me parles de quitter Rouen, de gagner de l’argent, et, pire que tout, d’accepter de partager, avec d’autres, la direction de notre revue ? Et c’est moi qui serais un père la morale, un vertueux, une fripouille ? Je conçois que tu veuilles connaître d’autres gens, d’autres rues, d’autres passions ; je le conçois, mais accepte que je veuille, moi, persévérer dans ma nonchalance. Et plus grave : ton projet, à mon sens, corrompt l’idée même de la littérature. Je ne vais pas te faire une leçon, til le sais aussi bien que moi : la littérature, c’est l’étude passionnée de la vie invisible, de la vie intérieure, de sorte que tout espoir de succès déprave cette ambition initiale. La pierre de touche de l’authenticité littéraire, ne l’oublie pas, c’est le choix qu’un écrié vain ferait, si un malin génie le lui proposait, entre la qualité de son œuvre et le succès de celle-ci. S’il opte pour le second chois
Cet écrivain hypothétique, prouve, ce faisant, qu’il ne croit pas vraiment à l’importance de la littérature ; en revanche, s’il choisit la grandeur de l’œuvre malgré son échec public, notre écrivain démontre qu’il place plus haut que tout la création, l’art, l’imaginaire ; que la vie invisible vaut plus que la vie visible. À ce petit jeu, beaucoup, crois-moi, laisseraient tomber la proie du chef-d’œuvre inconnu pour l’ombre de la gloire ! Tu me diras, tout le monde dira, « mais on peut avoir le succès et la qualité, l’invisible et le visible, le beurre et l’argent du beurre ». Certes, mais c’est déplacer la question et refuser de répondre, par voie de conséquence c’est répondre et c’est répondre par la deuxième solution. » La lettre déclinait sur plusieurs pages une théorie de la littérature que je connaissais par cœur pour la raison que je la professais moi aussi, ce que Thomas n’ignorait pas. En réalité, notre différend portait sur un point que ni l’un ni l’autre ne pouVions connaître avec certitude, ce qui nous autorisait, l’un comme l’autre, à tordre cette incertitude en notre faveur : Thomas pensait que l’éditrice nous imposerait ses choix ; j’imaginais, moi, que je garderais la main. Thomas m’accusait d’infidélité ; je l’accusais d’immobilisme, de bête vertu. À mesure de ma lecture, j’entrevoyais ce point d’incertitude comme le motif, par nature irréconciliable, de notre dispute. On ne peut tomber d’accord sur ce qui n’existe pas encore.
Thomas, plus loin, me comparait à mon beau-frère : « T’es-tu assez moqué de ce pauvre Pierre, incapable d’apprécier le tableau d’Eustache Le Sueur et qui n’avait de cesse de le transformer
En monnaie sonnante et trébuchante ; et toi, que fais-tu ? Tu te détournes de ce qui seul importe — nos choix éditoriaux — pour béer vers un avenir plus confortable, quelles qu’en soient les comPromissions. » Il y avait d’autres piques, moins blessantes, mais leur accumulation me déprimait. Le coup de grâce, néanmoins, intervenait à la fin de la lettre : « Puisque nous en sommes à l’heure de la franchise (comme si, pensais-je, d’autres heures, entre nous, avaient un jour sonné !), je vais te révéler une chose qui ne te fera sans doute pas plaisir ; je ne l’ai pas encore dit Parce que je ne savais comment l’avouer, ce n’était jamais le bon moment, jamais l’heure de l’aveu, jamais. Cette fois, le fumet des carottes que l’on cuit me pousse à ne plus garder le silence . Blandine et moi sommes amants depuis bientôt un an, ElIe n’a jamais osé t’en parler, de peur que nous ne nous fâchions, toi et moi. Elle ignore que j’ai pris la décision, aujourd’hui, de révéler cette histoire. Tu as le choix de le lui dire ou de faire comme si de rien n’était. Je ne suis pas fier de moi, ni honteux. « Ce n’est pas ma faute », comme dirait Valmont. »
La lettre se terminait par cette citation. Je connaissais assez Thomas pour deviner l’ironie derrière le refus de la culpabilité. Une lettre de cinq pages — et cette conclusion laconique, étourdissante. Je me croyais revenu de tout, mais il me restait encore des réserves de naïveté. Si le lien amoureux entre Thomas et Blandine me surprenait et, je dois l’avouer, me consternait, le plus inconcevable, à mes yeux, fut que tous deux aient cru préférable de me le cacher : il ne s’agissait pas d’adultère, ni de tromperie amoureuse ! Qu’était ma relation avec Thomas pour qu’il redoute de me dire, un jour, entre deux verres, « tu vas être surpris, ne le prends pas mal, mais j’aime ta fille et ta fille m’aime aussi », me prenait-il pour ces pères d’un siècle reculé, irascibles et violents ? Ne lisionsnous pas, d’un même élan, d'une même foi, Nietzsche et Voltaire Stendhal et Flaubert, Proust et Larbaud ? Ne soutenions-n0US pas, depuis vingt ans, les poètes, les romanciers, les philosophes quelle que soit leur notoriété, pour l’unique gloire de la littérature, bien loin des modes, au-delà des velléités de succès silence m’assommait. Ses pointes ironiques me stupéfiaient’difleçon (Thomas, donner une leçon !) me confondait. Et son in
Férence à tout ce qui embarrassait ma vie me révoltait. Enfin, cette lettre, oui, cette lettre pompeuse, hiératique, solennelle et grave Je n’avais jamais cru à l’amitié translucide, sans recoins sans dissimulations, pour la raison qu’aucun vivant ne
Nécessaires que la lumière, peut-être plus. Je n’aurais pas tout connaître de Elliomas, cette connaissance aurait de 11101. Notre amitié ; et je n’aurais pas voulu qu’on sût toutl’étais figure Cependant nous étions plus distants que je ne me
À force de fréquenter un ami, les années passant, on intègre les écarts et les incartades à l'image arrêtée qu'on s'est un jour faite de lui, de même qu'on ne le voit vieillir que si l'on tombe, par hasard, sur une vieille photographie attestant, par contrecoup, le flétrissement de l'âge.
Plus tard dans la soirée me revinrent à la mémoire le séjour en Vendée et la surprise d'y être rejoint par Thomas, accompagné de Blandine et Chloé. Alors le long voyage à la recherche des indices amoureux qui, par aveuglement, m'avaient échappé commença : un regard échangé, un retard mal excusé, une gêne, une timidité inexpliquée, une rougeur étonnante, une parole échappée, un geste retenu, tout s assemblait en une fresque sentimentale admirablement composée. À l'époque, tiraillé entre Caroline et Chloé, je n'avais rien vu, rien compris. Je ne leur en voulais pas de s'aimer ; mais je souffrais qu'ils aient pu me prendre sinon pour un ennemi, du moins pour un qu'il fallait ménager et exclure de la confidence.
Cette fois, j'étais seul. Emporté par ma défiance, j'imaginai
qu'Eugène était complice de l'intrigue : pareil aux cocus dont on dit qu'ils sont les derniers à ignorer leur infortune, je ne doutais pas qu'Eugène -- et d'autres — partageait avec les intrigants ce pauvre secret. Mon ex-épouse, si elle apprenait que Thomas convolait avec notre fille, triompherait et m'accablerait dans une même envolée.
J'étais seul. On oublie, abusé par la sympathie ou l'amour, qu'on est ontologiquement seul, on incorpore les êtres aimés à nos ambitions, nos intérêts, nos inclinations, mais que ces êtres empruntent d'autres chemins, contraires aux nôtres, ou plus simplement une direction sans rapport à celle que nous chérissons, alors surgit, nue et sans fard, notre solitude originelle. Il en va de même avec les parties de notre corps que nous oublions dans la pleine santé, et qui se rappellent à nous dans la maladie, à l'occasion d'une entaille, d'une foulure ou de toute autre souffrance : la solitude refait alors surface, entêtante, indivise ; personne ne pourra prendre le fardeau de la douleur à notre place.
Cet écrivain hypothétique, prouve, ce faisant, qu’il ne croit pas vraiment à l’importance de la littérature ; en revanche, s’il choisit la grandeur de l’œuvre malgré son échec public, notre écrivain démontre qu’il place plus haut que tout la création, l’art, l’imaginaire ; que la vie invisible vaut plus que la vie visible. À ce petit jeu, beaucoup, crois-moi, laisseraient tomber la proie du chef-d’œuvre inconnu pour l’ombre de la gloire ! Tu me diras, tout le monde dira, « mais on peut avoir le succès et la qualité, l’invisible et le visible, le beurre et l’argent du beurre ». Certes, mais c’est déplacer la question et refuser de répondre, par voie de conséquence c’est répondre et c’est répondre par la deuxième solution. » La lettre déclinait sur plusieurs pages une théorie de la littérature que je connaissais par cœur pour la raison que je la professais moi aussi, ce que Thomas n’ignorait pas. En réalité, notre différend portait sur un point que ni l’un ni l’autre ne pouVions connaître avec certitude, ce qui nous autorisait, l’un comme l’autre, à tordre cette incertitude en notre faveur : Thomas pensait que l’éditrice nous imposerait ses choix ; j’imaginais, moi, que je garderais la main. Thomas m’accusait d’infidélité ; je l’accusais d’immobilisme, de bête vertu. À mesure de ma lecture, j’entrevoyais ce point d’incertitude comme le motif, par nature irréconciliable, de notre dispute. On ne peut tomber d’accord sur ce qui n’existe pas encore.
Thomas, plus loin, me comparait à mon beau-frère : « T’es-tu assez moqué de ce pauvre Pierre, incapable d’apprécier le tableau d’Eustache Le Sueur et qui n’avait de cesse de le transformer
En monnaie sonnante et trébuchante ; et toi, que fais-tu ? Tu te détournes de ce qui seul importe — nos choix éditoriaux — pour béer vers un avenir plus confortable, quelles qu’en soient les comPromissions. » Il y avait d’autres piques, moins blessantes, mais leur accumulation me déprimait. Le coup de grâce, néanmoins, intervenait à la fin de la lettre : « Puisque nous en sommes à l’heure de la franchise (comme si, pensais-je, d’autres heures, entre nous, avaient un jour sonné !), je vais te révéler une chose qui ne te fera sans doute pas plaisir ; je ne l’ai pas encore dit Parce que je ne savais comment l’avouer, ce n’était jamais le bon moment, jamais l’heure de l’aveu, jamais. Cette fois, le fumet des carottes que l’on cuit me pousse à ne plus garder le silence . Blandine et moi sommes amants depuis bientôt un an, ElIe n’a jamais osé t’en parler, de peur que nous ne nous fâchions, toi et moi. Elle ignore que j’ai pris la décision, aujourd’hui, de révéler cette histoire. Tu as le choix de le lui dire ou de faire comme si de rien n’était. Je ne suis pas fier de moi, ni honteux. « Ce n’est pas ma faute », comme dirait Valmont. »
La lettre se terminait par cette citation. Je connaissais assez Thomas pour deviner l’ironie derrière le refus de la culpabilité. Une lettre de cinq pages — et cette conclusion laconique, étourdissante. Je me croyais revenu de tout, mais il me restait encore des réserves de naïveté. Si le lien amoureux entre Thomas et Blandine me surprenait et, je dois l’avouer, me consternait, le plus inconcevable, à mes yeux, fut que tous deux aient cru préférable de me le cacher : il ne s’agissait pas d’adultère, ni de tromperie amoureuse ! Qu’était ma relation avec Thomas pour qu’il redoute de me dire, un jour, entre deux verres, « tu vas être surpris, ne le prends pas mal, mais j’aime ta fille et ta fille m’aime aussi », me prenait-il pour ces pères d’un siècle reculé, irascibles et violents ? Ne lisionsnous pas, d’un même élan, d'une même foi, Nietzsche et Voltaire Stendhal et Flaubert, Proust et Larbaud ? Ne soutenions-n0US pas, depuis vingt ans, les poètes, les romanciers, les philosophes quelle que soit leur notoriété, pour l’unique gloire de la littérature, bien loin des modes, au-delà des velléités de succès silence m’assommait. Ses pointes ironiques me stupéfiaient’difleçon (Thomas, donner une leçon !) me confondait. Et son in
Férence à tout ce qui embarrassait ma vie me révoltait. Enfin, cette lettre, oui, cette lettre pompeuse, hiératique, solennelle et grave Je n’avais jamais cru à l’amitié translucide, sans recoins sans dissimulations, pour la raison qu’aucun vivant ne
Nécessaires que la lumière, peut-être plus. Je n’aurais pas tout connaître de Elliomas, cette connaissance aurait de 11101. Notre amitié ; et je n’aurais pas voulu qu’on sût toutl’étais figure Cependant nous étions plus distants que je ne me
À force de fréquenter un ami, les années passant, on intègre les écarts et les incartades à l'image arrêtée qu'on s'est un jour faite de lui, de même qu'on ne le voit vieillir que si l'on tombe, par hasard, sur une vieille photographie attestant, par contrecoup, le flétrissement de l'âge.
Plus tard dans la soirée me revinrent à la mémoire le séjour en Vendée et la surprise d'y être rejoint par Thomas, accompagné de Blandine et Chloé. Alors le long voyage à la recherche des indices amoureux qui, par aveuglement, m'avaient échappé commença : un regard échangé, un retard mal excusé, une gêne, une timidité inexpliquée, une rougeur étonnante, une parole échappée, un geste retenu, tout s assemblait en une fresque sentimentale admirablement composée. À l'époque, tiraillé entre Caroline et Chloé, je n'avais rien vu, rien compris. Je ne leur en voulais pas de s'aimer ; mais je souffrais qu'ils aient pu me prendre sinon pour un ennemi, du moins pour un qu'il fallait ménager et exclure de la confidence.
Cette fois, j'étais seul. Emporté par ma défiance, j'imaginai
qu'Eugène était complice de l'intrigue : pareil aux cocus dont on dit qu'ils sont les derniers à ignorer leur infortune, je ne doutais pas qu'Eugène -- et d'autres — partageait avec les intrigants ce pauvre secret. Mon ex-épouse, si elle apprenait que Thomas convolait avec notre fille, triompherait et m'accablerait dans une même envolée.
J'étais seul. On oublie, abusé par la sympathie ou l'amour, qu'on est ontologiquement seul, on incorpore les êtres aimés à nos ambitions, nos intérêts, nos inclinations, mais que ces êtres empruntent d'autres chemins, contraires aux nôtres, ou plus simplement une direction sans rapport à celle que nous chérissons, alors surgit, nue et sans fard, notre solitude originelle. Il en va de même avec les parties de notre corps que nous oublions dans la pleine santé, et qui se rappellent à nous dans la maladie, à l'occasion d'une entaille, d'une foulure ou de toute autre souffrance : la solitude refait alors surface, entêtante, indivise ; personne ne pourra prendre le fardeau de la douleur à notre place.
Lire, écrire, ne plus être au monde, réduire à pas grand-chose mes points de contact avec la vie ; la regarder de loin, à travers les lentilles du souvenir et de la fiction, cela me suffisait. Au fond, j'en avais un peu marre de vivre ; en soi, exister eût été passionnant si la plupart de mes frères humains n'avaient pas mis en berne le drapeau de la littérature et de l'art. Ne restait que cette tour d'ivoire portative en quoi consistent les grands livres.
p. 143
p. 143
Videos de Patrice Jean (5)
Voir plusAjouter une vidéo
Nouvel horaire pour l'émission "Le coup de coeur des libraires" sur les Ondes de Sud Radio. Valérie Expert et Gérard Collard vous donne rendez-vous chaque dimanche à 13h30 pour vous faire découvrir leurs passions du moment !
•
Retrouvez leurs dernières sélections de livres ici !
•
•
le Stradivarius de Goebbels de Yoann Iacono aux éditions J'ai Lu
https://www.lagriffenoire.com/le-stradivarius-de-goebbels-1.html
•
le Roman de Vienne de Jean des Cars aux éditions Litos
9782268056197
•
le diable parle toutes les langues de Jennifer Richard aux éditions Pocket
https://www.lagriffenoire.com/le-diable-parle-toutes-les-langues-1.html
•
L'Homme qui peignait les âmes de Metin Arditi aux éditions Points
https://www.lagriffenoire.com/l-homme-qui-peignait-les-ames-1.html
•
le Turquetto de Metin Arditi aux éditions Babel
https://www.lagriffenoire.com/le-turquetto.html
•
Moi et François Mitterrand de Hervé le Tellier aux éditions Folio
https://www.lagriffenoire.com/moi-et-francois-mitterrand-moi-et-jacques-chirac-moi-et-sarkosy-moi-et-francois-hollande.html
•
Il était une fois Lamartine de Sylvie Yvert aux éditions Pocket
https://www.lagriffenoire.com/il-etait-une-fois-lamartine.html
•
Maigrir pourquoi je n'y arrive pas ? de Jean-Michel Cohen aux éditions First
https://www.lagriffenoire.com/maigrir-pourquoi-je-n-y-arrive-pas.html
•
Les aveux de John Wainwright et Laurence Romance aux éditions 10-18
https://www.lagriffenoire.com/les-aveux.html
•
Les Trois Meurtres de William Drever de John Wainwright et Clément Baude aux éditions Sonatine
https://www.lagriffenoire.com/les-trois-meurtres-de-william-drever.html
•
Rééducation Nationale de Patrice Jean aux éditions Rue Fromentin
https://www.lagriffenoire.com/reeducation-nationale.html
•
Souvenirs souvenirs... (T01) de Catherine Nay aux éditions Pocket
https://www.lagriffenoire.com/souvenirs-souvenirs...-vol01.html
•
Tu le sais bien, le temps passe de Catherine Nay aux éditions Pocket
https://www.lagriffenoire.com/tu-le-sais-bien-le-temps-passe-souvenirs-souvenirs-2.html
•
Histoire intime de la V République: le sursaut (T1) : Histoire intime de la Ve République de Franz-Olivier Giesbert aux éditions Gallimard
https://www.lagriffenoire.com/histoire-intime-de-la-v-republique-vol01-le-sursaut.html
•
Histoire intime de la V République: La belle époque (T2) de Franz-Olivier Giesbert aux éditions Gallimard
https://www.lagriffenoire.com/histoire-intime-de-la-v-republique-vol02-la-belle-epoque.html
•
Sambre: Radioscopie d'un fait divers de Alice Géraud aux éditions JC Lattès
https://www.lagriffenoire.com/sambre-radioscopie-d-un-fait-divers.html
•
Gazoline de Emmanuel Flesch
+ Lire la suite

Nous n'avons jamais été modernes : Essai d'anthropologie symétrique
Bruno Latour
3
critiques
12
citations
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Patrice Jean (10)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (2 - littérature francophone )
Françoise Sagan : "Le miroir ***"
brisé
fendu
égaré
perdu
20 questions
3680 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature
, littérature française
, littérature francophoneCréer un quiz sur ce livre3680 lecteurs ont répondu