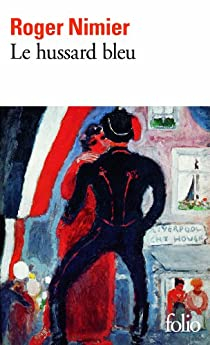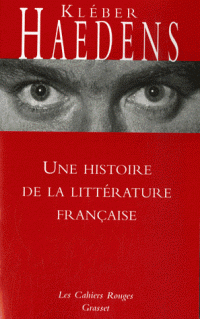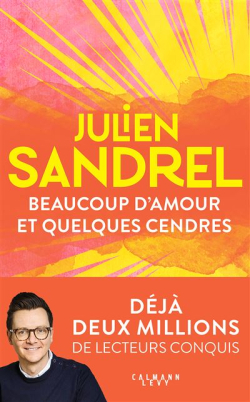Roger Nimier/5
143 notes
Résumé :
Le livre insolent, romantique et tendre qui rendit Nimier célèbre à vingt-cinq ans. Le roman qui fit école et donna naissance à la génération littéraire des « hussards ». La chronique intime, à la fois cynique et sentimentale, d'un peloton de hussards qui pénètre en Allemagne, en 1945.
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Le hussard bleuVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (13)
Voir plus
Ajouter une critique
Roman très riche et intense. En 1945, des hussards français, l'esprit revanchard, stationnent en Allemagne en attendant d'en découdre avec ce qui reste des divisions de l'ennemi.
C'est un roman choral où l'on apprend beaucoup grâce au monologue intérieur de dix personnages perdus dans cette fin de guerre:
Sanders est le soldat viril, odieux et séducteur.
Saint-Anne, c'est lui Le hussard bleu il symbolise la beauté, la jeunesse et ses grandes idées.
Forjac est le gradé cynique qui aime les hommes.
Los Anderos est le soldat communiste colérique.
Et une jeune et belle Allemande...
Les scènes d'héroïsme et celles de désoeuvrement où se commettent bien des turpitudes sont la toile de fond mais ce n'est pas qu'une chronique de guerre. D'ailleurs, on sait que beaucoup vont mourir dans les dernières embuscades de la guerre. Donc, pas trop d'intrigue de ce côté-là. Non, ce qui tient le lecteur en haleine, c'est cette belle Allemande "sauvée" par le goujat Sanders, son importance grandit peu à peu jusqu'à la surprise finale.
Du suspense auquel s'ajoute un style enlevé et une construction façon puzzle qui ne laissent pas de repos au lecteur.
Ce roman choral est un prétexte pour employer toutes les subtilités et les grossièretés de la langue selon le protagoniste. de l'argot au français littéraire, très proustien, le contraste est vraiment riche et croustillant.
De plus, la construction en chapitres "monologues" , qui ne suit pas toujours la chronologie, permet de confronter les opinions et surtout d'imaginer un récit possible et de bien cerner les personnages. Quelle réjouissance de combler les blancs et de construire sa propre histoire. Avis aux imaginatifs!
Ce roman est sous cette forme une réussite. L'usage du "je" emmène le lecteur au plus près de l'action et des états d'âme de chacun. Et certains ont des côtés obscurs qui ne nous sont pas dissimulés et détonent dans le cheminement vers la victoire: le racisme, Pétain et la Milice, les viols en pays conquis. C'est donc un livre qui dérange par ces aspects mais c'est une photographie de la fin de la guerre vraiment saisissante.
Cet effroyable second plan contraste avec de biens purs sentiments que le lecteur pourra découvrir grâce au hussard bleu Saint Anne.
Si bien que la fin m'a englouti dans un tourbillon dont je ne suis pas sorti indemne.
Lu trois fois, et ce n'est pas fini. Pour moi un chef d'oeuvre qui dérange.
C'est un roman choral où l'on apprend beaucoup grâce au monologue intérieur de dix personnages perdus dans cette fin de guerre:
Sanders est le soldat viril, odieux et séducteur.
Saint-Anne, c'est lui Le hussard bleu il symbolise la beauté, la jeunesse et ses grandes idées.
Forjac est le gradé cynique qui aime les hommes.
Los Anderos est le soldat communiste colérique.
Et une jeune et belle Allemande...
Les scènes d'héroïsme et celles de désoeuvrement où se commettent bien des turpitudes sont la toile de fond mais ce n'est pas qu'une chronique de guerre. D'ailleurs, on sait que beaucoup vont mourir dans les dernières embuscades de la guerre. Donc, pas trop d'intrigue de ce côté-là. Non, ce qui tient le lecteur en haleine, c'est cette belle Allemande "sauvée" par le goujat Sanders, son importance grandit peu à peu jusqu'à la surprise finale.
Du suspense auquel s'ajoute un style enlevé et une construction façon puzzle qui ne laissent pas de repos au lecteur.
Ce roman choral est un prétexte pour employer toutes les subtilités et les grossièretés de la langue selon le protagoniste. de l'argot au français littéraire, très proustien, le contraste est vraiment riche et croustillant.
De plus, la construction en chapitres "monologues" , qui ne suit pas toujours la chronologie, permet de confronter les opinions et surtout d'imaginer un récit possible et de bien cerner les personnages. Quelle réjouissance de combler les blancs et de construire sa propre histoire. Avis aux imaginatifs!
Ce roman est sous cette forme une réussite. L'usage du "je" emmène le lecteur au plus près de l'action et des états d'âme de chacun. Et certains ont des côtés obscurs qui ne nous sont pas dissimulés et détonent dans le cheminement vers la victoire: le racisme, Pétain et la Milice, les viols en pays conquis. C'est donc un livre qui dérange par ces aspects mais c'est une photographie de la fin de la guerre vraiment saisissante.
Cet effroyable second plan contraste avec de biens purs sentiments que le lecteur pourra découvrir grâce au hussard bleu Saint Anne.
Si bien que la fin m'a englouti dans un tourbillon dont je ne suis pas sorti indemne.
Lu trois fois, et ce n'est pas fini. Pour moi un chef d'oeuvre qui dérange.
Avec « le Hussard Bleu » j'ai fait connaissance avec cet écrivain qui m'était, jusqu'ici, inconnu !
Avant de me lancer dans la lecture de ce roman, j'ai cherché à en savoir un peu plus sur ce jeune écrivain Roger Nimier (1925/1962), chef de file des Hussards ( "l'amour du style bref, cinglant, ductile, incisif anticonformiste , le refus des modes, le goût des causes perdues") , qui marqua profondément sa génération disparu à l'âge de 37 ans, parce qu'il idolâtrait un peu trop la vitesse. (Un décès tragique et prématuré qui fait penser à d'autres fous de bolides de la m^me époque: James Dean, Jean-René Huguenin, Françoise Sagan, elle aussi, à bord d'une Aston Martin, mais qui en réchappa avec de lourdes conséquences … )
J'ai ainsi appris qu'il a eu, au lycée Pasteur, où il est un brillant élève turbulant ,Michel Tournier comme condisciple en terminale, qu'il obtient un deuxième prix de philosophie au Concours général, ensuite une licence dans cette même matière, qu'il s'engage au 2e Régiment de hussards, blessé à Royan, démobilisé au printemps 1945 , il écrit depuis cette date : romancier, rédacteur en chef (Opera), journaliste, scénariste pour le cinéma « Nouvelle vague » (Ascenseur pour l'échafaud, Les Grandes personnes), dialoguiste (L'Education sentimentale) conseiller littéraire chez Gallimard…
La lecture de la 4e de couverture me laisse un peu sceptique : « une succession de monologues intérieures … ils permettent au lecteur de visiter en détail le cervelet d'un colonel, le coeur d'un cavalier, le foie ou encore la rate d'autres soldats » et là je me mets à chantonner les paroles d'Ouvrard pour me donner du coeur à l'ouvrage… Mais on n'est pas du tout dans le registre de ce comique troupier, plus dans celui des quatre-vingt-chasseurs ! (j'en connais juste le premier couplet, entendu maintes fois chanté par mon père qui n'allait pas plus loin, parce que ma mère veillait au grain !)
Soliloques successifs de soldats, issus de milieux sociaux différents appartenant au XVI e Hussards (cavalerie blindée ) à sa tête le lieutenant commandant de Fermendidier : Casse-Pompons, Los Anderos, le capitaine de Forjac, Tisseau, il y a aussi Florence, Lili l'Allemande, et Saint- Anne, c'est lui le héros, le Hussard bleu et son ami Sanders.
Réflexions dans un langage très coloré celui de chambrée, ordurier, violent, insolent, cynique, argotique, pour évoquer la défaite, l'Occupation , la Résistance , la reprise des combats, la prise de villes, les exactions, l'occupation en sens inverse, la violence , la vengeance, la trahison, la mort .
Le Hussard bleu est un roman de l'absurde, incongruité de la guerre, indécence de la vie, absurdité de la mort … Une mise en scène déconcertante mais toute en vérité.
La phrase épilogue du roman fait éminemment penser à l'Etranger.
« Désormais, je connais mon rôle sur la terre, mais je ne sais qui je suis. Voyageur, pose des yeux tristes sur les choses, elles te le rendront au centuple. le visage barré du ciel te menace et te guide à la fois. Vivre, il me faudra vivre encore, quelques temps parmi ceux-là. Tout ce qui est humain m'est étranger.
Je peine de plus en plus à trouver intérêt au roman. Et je me demande à quoi servent ces histoires imaginaires, à l'éloquence fictive, aux applications rares, aux leçons douteuses, dont l'avantage exclusif se situe au divertissement et à l'évasion, voire au prétexte de culture, et à passer ainsi plusieurs heures de « plaisir » sans penser par soi-même, sans produire en réflexion plus que la vague anticipation d'intrigue bientôt effacée par l'appel des prochaines phrases : le roman est essentiellement une délégation d'esprit ou un imaginaire par procuration, c'est-à-dire un abandon improductif (ça repose moins qu'une sieste). C'est même un genre beaucoup plus codifié qu'on ne pense parce qu'on y est habitué et qu'on le préjuge « naturel », mais tous ceux qui daigneront y réfléchir avec dégagement à sa nécessité le trouveront arbitraire, bizarre, indirect, répondant surtout au désir d'annihilation du lecteur : peu nieront, je pense, qu'il s'agit, quand on en lit, de se fondre aussi entièrement que possible en une couleur, de s'oublier, de s'humilier, de s'éteindre en un contexte qui dépasse et impressionne, et la façon majoritaire d'infirmer mes critiques défavorables contre des romans consiste à arguer que je n'ai pas assez effacé mon individu en les lisant, que j'ai manqué à me retirer de jugement, qu'il est dommage que je sois resté si peu concerné, même comme si j'étais incapable plutôt de lire un roman que ce roman précis (et c'est injuste, il m'est arrivé d'apprécier un roman, même plusieurs !). C'est au point qu'il semble que pour « bien lire » un roman selon l'avis moderne, il faille s'y enfoncer jusqu'à perdre son sens critique, le sentiment d'identité, la conscience de mesurer une oeuvre, ce qui alors est en effet commode aux mauvais écrivains qui ne sont dénigrés qu'au détriment de la sensibilité de ceux qui les blâment, et fort avantageux aux mauvais lecteurs enthousiastes qui, au prétexte de leur bonne empathie, sentent toujours que leurs « bontés » confirment leurs « facultés humaines ». En somme, la vision actuelle d'un lecteur de roman se résume en celui qui, parce que magnifiquement apte à partager une représentation, est toujours plus ou moins satisfait : le critique négatif, quant à lui, est forcément un grincheux et un handicapé, manquant à être assez humble ou généreux, rétif à l'abandon et au sentiment, insoucieux de s'enfoncer suffisamment dans l'offre aimable du mensonge qu'on lui propose. Ainsi, contemporainement, il n'existe pas de lecteur de roman vraiment déçu, tout au plus son plaisir n'est-il pas très élevé, à moins que ce roman s'oppose à l'impression d'un « don » et qu'il s'y trouve quelque chose d'immoral, une saveur aigre, une sorte de rancune, induisant un écrivain négatif et permettant de l'éreinter sans scrupule. Or, moi, je ne présume pas, c'est bien ce qu'on constate sur un site de « critiques » comme Babelio : les moyennes des notations sont toujours de 4/5, hormis pour les écrivains estimés élitistes, distants ou cruels, réputés infréquentables, les « misanthropes ». Autrement dit, si vous écrivez un roman comme on « écrit un roman » c'est-à-dire comme vous êtes censé faire, vous avez toutes les chances d'emporter les meilleures notes et, sinon de plaire, du moins de ne pas déplaire. le lecteur de roman est l'opposé d'un critique rationnel : il aime ou n'aime pas, ou plutôt il aime avec passion ou bien… il aime seulement (un peu moins fort).
L'appréhension d'un roman est un phénomène curieux : il ne vient jamais à la pensée du lecteur qu'une intrigue constitue un détour surprenant pour n'importe quel message, que le fait de raconter une histoire s'adapte mal, ou du moins singulièrement, à une fonction pratique, pour peu qu'un esprit souhaite exposer une idée : s'il s'agit de transmettre une image, jamais il ne vient spontanément à l'esprit la résolution d'un récit de tant de pages, et il faut foncièrement « surcomposer » pour y allonger, forcément avec artifice, une parabole qu'aucune imagination ne conçoit d'emblée ou même après réflexion en cette forme – autrement dit, concevons bien le problème suivant : pourquoi se servir d'une histoire quand on a une idée à communiquer ? Mais au préalable, il faut cesser de prétendre que la généalogie du roman parle pour lui et que, comme tradition, il dispose de raisons fondamentales qu'il est inutile d'explorer pour ce que maints romanciers, qu'on estime intelligents puisqu'ils ont eu du succès, les ont intériorisées sans bien les exposer : on part toujours trop du principe que des gens supérieurs ont résolu les questions qu'on ne veut pas poser. Or, il faut être honnête, commencer par restituer quelque raisonnement et se transposer un instant à la place d'un homme qui se sent une histoire nouvelle à narrer : admettons qu'il a trouvé de quoi produire une émotion étonnante, ou qu'il a reçu une sorte de vision de rêve qu'il souhaite valoriser avec pittoresque, ou qu'il sente une réflexion édifiante dont il croit que la traduction en récit servira une illustration éloquente, eh bien ! dans toutes ces circonstances il n'a vraiment besoin, en termes d'efficacité et d'adéquation à son but, de développer un personnage selon la forme longue du roman – narration, description, dialogue et focalisation interne ! le roman est toujours la somme de peu d'idées pertinentes et initiales entre lesquelles l'écrivain comble par quantité de passages inutiles jusqu'à ce que le remplissage compte pour la majorité de l'oeuvre (sait-on qu'une tâche importante en toute planification de roman consiste à trouver de quoi « lier » les parties indispensables et premièrement désirées, de sorte que c'est une peine assez superflue, pour l'auteur, de tisser une histoire ainsi, pour la seule fierté d'en faire ce qu'on appelle avec vanité un « roman » ?)
Et pour le lecteur, c'est toujours, si pauvrement : « J'ai lu tel roman. — Alors ? — Cela m'a plu. — Mais en quoi cela t'a-t-il complété ? — J'ai vu des images, j'ai imaginé, j'ai passé longtemps en rêve. — Pas besoin d'un roman pour ça, paresseux ! Et pour quel profit ? — Cela m'a occupé. » On ne prouverait pas facilement que cette espèce d'entraînement conduit à un avantage intellectuel ou sentimental par rapport à autant d'heures passées à suivre une à une les vidéos suggérées sur Facebook ou TikTok : je parierais sur une hébétude ou un abrutissement global et similaire, parce qu'on ne voit presque jamais un lecteur, particulièrement de roman, se munir d'un papier pour retenir certaines informations ou pour faire le bilan progressif des éloquences qui l'ont intéressé (il n'y a que l'Agrégatif qui prend des notes, encore le fait-il sous le régime non de ce qu'il a personnellement tiré du livre mais de ce qu'il soupçonne qu'un jury lui demandera, ce qui réalise, comme je l'ai écrit ailleurs, une déformation de sa faculté de lire). le lecteur contemporain de roman est un « avaleur », aussi vrai que le romancier contemporain se targue d'être un « page turner » : le marché réclame que le roman soit comestible et digeste, et nul ne regarde à l'inutilité flagrante – je parle en termes de profit pour l'esprit et non pour le divertissement – d'une dépense de papier qui donne des histoires à la chaîne sans valeur ajoutée et en suivant des normes sans relation avec une intention déliée du genre. En cela, il n'existe aucune raison de supposer qu'une machine n'est pas déjà capable de rédiger un roman : c'est qu'il n'est dans l'immense majorité des cas que le résultat d'une mécanique méthode sans qu'il soit nécessaire pour l'écrivain, ni opportun s'il veut travailler sans complication, de s'interroger sur le besoin d'un pareil édifice. Parmi les seules circonstances où la forme du roman aurait une justification, c'est ou s'il servait d'occasion pour une pure démonstration de style, c'est-à-dire s'il se proposait de renfermer une quintessence d'oeuvre d'art, une virtuosité écrite, un summum de ciselure verbale, environ au même titre que Flaubert admettait le sujet d'un roman superflu, ou s'il consistait en manière détournée d'édifier en actes, même en actes théoriques, en actes de naturalistes c'est-à-dire de vraisemblance scientifique pour exécuter en l'espace imaginaire une hypothèse intelligente, ou encore si son intrigue comportait une façon de service qui ne pût se dessiner autrement, ou disons pas plus efficacement, qu'en représentant une histoire. Quand cela arrive-t-il ? où lit-on un roman qui ne se limite à représenter une action peu vraisemblable, en une langue largement dénuée d'art et d'effort, sans philosophie nette, et inapte à induire la moindre influence sur la réalité du lecteur ? Quatre cents pages de récit laissent au mieux le lecteur imprégné de visions s'évanouissant sitôt le livre fermé et dont l'inconscient est supposé conserver une mémoire comme une trace, mais ce sont des souvenirs imprécis et non fiables, dont l'extraction risque fort de produire une accumulation d'erreurs ou la poursuite de préjugés pour ce que la vision qu'un roman « passe » facilement est très probablement une représentation qui figurait déjà en l'esprit du lecteur et qu'il ne fait que prolonger sans correction, car si elle lui avait été difficile à acquérir, il ne l'aurait pas acceptée si aisément, en sorte qu'un roman « agréable », qu'on admet tel avec plaisir, est nécessairement empli de clichés complaisants – c'est d'ailleurs en cela que le Contemporain admet la fluidité du roman une vertu, du moins un critère de qualité : cette fluidité ne peut émaner que du fait qu'aucune représentation du récit n'échappe à sa pensée-faite, ainsi exprime-t-il, certes indirectement mais non sans une certaine sincérité, que ce qu'il recherche en un roman est surtout la continuation de ses modes de pensée personnels, ce pourquoi il veut lire vite, et non le bouleversement de ses savoirs et acquis, qui impliquerait des pauses et des retours sur soi contraires au principe de la fluidité.
J'ignore, à cause de ces réflexions enfin approfondies et résolument départies des usages qui font lire, si je lirais encore longtemps des romans : ce me paraît à présent une perte de temps relativement à la durée qu'il faut y consacrer, ce manque évident de rendement intellectuel est presque toujours une frustration pour l'esprit conséquent accoutumé à fuir le ravage ordinaire du divertissement, et je ne parviens décidément pas à dénicher des conseillers fiables – c'est comme si une maladie de l'indulgence touchait périodiquement même de bons lecteurs : faute de critères, ils se trompent souvent dans l'appréciation d'un roman utile, et leur erreur provient probablement de ce que, au bout d'un énième roman médiocre, on veut à tout prix que le suivant soit bon, alors on le « fabrique » tel par seul contraste, même léger, ou pour ne pas se savoir un être « négatif », pareil à celui qui, consultant incessamment des feuilles grises qu'il préfèrerait colorées, se croit légitime à s'extasier aux moindres traces de gris-cassé ou de gris-ocre : c'est un homme qui a perdu le sens chromatique, du moins le recul de ce sens initial, et dont le regard viendrait à brûler peut-être s'il rencontrait un rouge-sang ou un bleu-nuit. Et je m'aperçois que mon dégoût de ce genre me rend intempestif non plus seulement pour un Contemporain, mais même pour un homme du XIXe siècle, en ce que j'approche du mépris des sociétés savantes contre le roman d'avant le XVIIIe. Certes, je ne m'empêcherai plus de considérer que si l'auteur voulait exprimer une pensée intelligente, il composerait mieux un essai (même plutôt un recueil de pensées : j'ai déjà expliqué combien la plupart des essais sont inutilement diserts par volonté d'épate et feinte de construction) ; si c'est une émotion qu'il ambitionne, la toile de fond d'une longue intrigue est superflue, et une nouvelle suffirait, ou bien un poème : le roman est rarement la forme appropriée d'une représentation humaine. de façon générale, j'en viens à me demander si la raison d'être du roman n'est pas toujours à chercher du côté du divertissement, c'est-à-dire pour susciter quelque évanescence d'esprit dont l'explicitation, fatalement, nous fait coupable comme ici : on en écrit pour se prouver qu'on sait fasciner et séduire, on le lit pour disparaître en la situation imaginaire qu'on propose d'investir. J'admets par exemple avoir écrit La Fortune des Norsmith par défi parce qu'alors le roman me paraissait automatiquement la forme la plus « fameuse », et ArkOne après sollicitation comme un éditeur me donnait des gages de le prendre – ce dernier livre étant d'ailleurs écrit en un style un peu plus simple et accessible que ma pensée d'artiste. Ce ne signifie point que ces romans furent des complaisances – ils sont excellents et d'ailleurs exigeants, bien meilleurs qu'au moins les neuf-dixièmes de la production romanesque actuelle –, mais je dois reconnaître que j'en tirai la motivation des préjugés issus de la société même : ou le roman-comme-genre-littéraire-par-excellence, ou le roman-pour-moyen-d'accès-à-un-lectorat-vaste. Je n'aurais pas trouvé intérêt à y recourir sans cela : car l'espèce d'amoralité superbe que je désirais atteindre au premier pouvait se densifier en l'espèce d'un récit plus court et dénué de transitions servant surtout à former un tableau sérieux et cohérent, et la progression intellectuelle et émotionnelle que j'aspirais à traduire au second, avec la chute désespérée, aurait peut-être aussi bien servi en une nouvelle, ou, disons, en une nouvelle un peu longue, à la façon par exemple de « L'homme bicentenaire » d'Asimov. Mais je ne me sentais pas d'alternative, acculé en l'image même du roman « nécessaire », et je pourrais formuler approximativement la teneur et l'ordre de mon travail en stipulant que ma pensée était au service du roman plutôt que l'inverse. Et je crois que c'est de cette façon obtuse que pensent avec dommages la plupart des romanciers : ils ne réfléchissent pas si leur message a besoin du roman ou s'il ne trouverait pas, à y réfléchir, un genre plus adapté pour rendre leur propos plus efficace, mais ils se demandent : « Quel roman vais-je écrire à présent ? ». le roman leur est présupposé de l'écrit, ils ne songent pas si ce moyen correspond à un but, ce moyen est l'objectif même et tend à devenir la condition de leur pensée ; ils ne se disent pas, en somme : « Quelle idée je vais transmettre » mais « quelle idée de roman », ce qui ne revient pas du tout à avoir une idée départie d'une certaine forme contraignante et qui serait authentique justement en raison de sa spontanéité et de son but (en tout art, il est logique que la technique se plie au dessein de l'artiste) ; ils n'ont pas d'abord une « bonne idée » qu'ils tiennent à transmettre avant d'élire réflexivement ce « média adapté » par comparaison à d'autres, ils ne se sentent pas libres de sélectionner un moyen différent, mais, à cause de la réputation du roman et de son marché, ils restent prisonniers de l'a-priori du roman comme forme imposée, et condamnés à conformer leurs idées pour qu'elles puissent s'inscrire dans le roman, et, sans doute souvent, se résolvent au roman sans penser qu'ils pourraient faire autre chose, sans même se dire que ce genre est une forme parmi d'autres qui doit être au service d'une idée immatérielle et non à laquelle cette idée doit se mouler, et qui n'est pas forcément le moyen le plus propice pour matérialiser la leur ; autrement dit, avant même de savoir ce qu'ils ont envie de transmettre, ils ne songent qu'à : « Il faut que ce soit une pensée romançable », et éliminent d'emblée toute idée même supérieure dont ils ne pourraient pas faire, pour le dire en gros, quelque histoire de quatre cents pages avec progression chronologique et affective.
Et c'est exactement pourquoi – je suis enfin parvenu à le comprendre – tant de romans, leur grande majorité même, ne contiennent que peu d'idées qui, parfois dignes d'intérêt et d'art, pour être mises en valeur méritaient surtout un développement non romanesque, une forme bien différente du roman pour les soutenir. C'est ce qui donne à la plupart une impression d'inutilité, une saveur de vacuité, une sensation de torpeur, un air de délitescence : une telle histoire, ainsi composée, n'a servi à rien, elle a atténué l'idée au lieu de la porter et de la souligner, elle n'était manifestement pas la forme congruente pour dire ceci, c'est toujours long pour ce que l'auteur a voulu transmettre, épars, diffus, inconsistant, au point que la norme du roman, il faudrait en convenir, est à ce sentiment d'attente perpétuelle entre des actions ou des réflexions qui, elles, semblent bien l'essentiel auquel l'écrivain avait initialement destiné son travail, ou, pour le dire autrement, au point que le lecteur de romans se prépare toujours à patienter en faible densité de style et de faits, le roman se définissant, chez le lecteur conscient, comme la posture anticipée d'un certain ennui habitué. Si au surplus on comprend tout ce qui n'est pas artiste dans le roman, c'est-à-dire si l'on en exclut à la fois la pauvreté des intermèdes et la médiocrité des efforts sur le langage, il ne reste plus que de l'eau plus ou moins délavée, digeste et hypnotique, servant à maintenir le lecteur en la sensation d'une fluidité et d'une homogénéité, mais qui ne consiste, à l'examiner en critique, qu'en liant captieux chargé d'étourdir par plaisir de se croire « suivre » – c'est ainsi qu'on peut « lire vite » des récits qui ne nécessitent de concentration ni pour leurs péripéties ni pour leur expression. Un tel roman se dévore sans mal justement parce qu'il n'est que vide et ne réclame ni subtilité ni mémoire : c'est le propre de toute oeuvre qu'on lit d'une traite en tournant rapidement les pages parce qu'on n'a jamais à relire une phrase ; on ne s'arrête pas pour déguster une eau presque insipide, mais on la fait rentrer directement dans son gosier par pleines gorgées parce qu'on n'a pas une minute à perdre pour se désaltérer (c'est une juste métaphore : après tout, c'est bien, dans les deux cas, le temps des vacances où il fait chaud !).
Même un roman pas trop accessible comme celui de Nimier, écrit en un style de patente recherche, me sidère un peu, si j'y songe bien : après l'avoir lu, il ne m'en reste à peu près rien, j'y reconnais beaucoup de remplissage dont on a trop pris l'habitude et qu'on finit par admettre consubstantiel au roman, tant de chapitres entiers qu'on peut supprimer sans manque, et peu de situations ou d'idées m'en font l'impression d'un choc ou d'un bouleversement. À être attentif à son profit spirituel, on ignore pourquoi on lit encore, on a l'air d'espérer sempiternellement un événement qui n'a presque aucune chance d'arriver, et à la moindre distance on trouve que ce romanesque a décidément le caractère d'une lâche anecdote. Enfin au bout, on regarde en arrière les centaines de pages et les heures passées à lire, et l'on peine à formuler un avantage personnel qu'on essaie d'extraire tout de même ou auquel on tâche à ne pas penser : toujours, certes, ce n'est pas mal pour un roman, c'était un roman pas inintéressant, on a suivi les faits et opinions romanesques de personnages de roman plus ou moins vraisemblables, et si l'on se sonde, on conçoit d'emblée le roman comme gaspillage, c'est bien toujours de cette convention qu'on part pour le juger, il faut se faire, de ce loisir en quoi consiste un roman, la considération par défaut d'un objet de faible profit, de maigre permanence, auquel on se consacre en pleine conscience de la vanité d'une activité qui n'en est pas une – on se justifie après coup par l'espèce de fuite improductive que le roman a permis, on y suppose une détente que rien ne permet de distinguer de l'évanescence mentale, ou pire, on y veut croire une portée symbolique, la Culture ou les
Lien : http://henrywar.canalblog.com
L'appréhension d'un roman est un phénomène curieux : il ne vient jamais à la pensée du lecteur qu'une intrigue constitue un détour surprenant pour n'importe quel message, que le fait de raconter une histoire s'adapte mal, ou du moins singulièrement, à une fonction pratique, pour peu qu'un esprit souhaite exposer une idée : s'il s'agit de transmettre une image, jamais il ne vient spontanément à l'esprit la résolution d'un récit de tant de pages, et il faut foncièrement « surcomposer » pour y allonger, forcément avec artifice, une parabole qu'aucune imagination ne conçoit d'emblée ou même après réflexion en cette forme – autrement dit, concevons bien le problème suivant : pourquoi se servir d'une histoire quand on a une idée à communiquer ? Mais au préalable, il faut cesser de prétendre que la généalogie du roman parle pour lui et que, comme tradition, il dispose de raisons fondamentales qu'il est inutile d'explorer pour ce que maints romanciers, qu'on estime intelligents puisqu'ils ont eu du succès, les ont intériorisées sans bien les exposer : on part toujours trop du principe que des gens supérieurs ont résolu les questions qu'on ne veut pas poser. Or, il faut être honnête, commencer par restituer quelque raisonnement et se transposer un instant à la place d'un homme qui se sent une histoire nouvelle à narrer : admettons qu'il a trouvé de quoi produire une émotion étonnante, ou qu'il a reçu une sorte de vision de rêve qu'il souhaite valoriser avec pittoresque, ou qu'il sente une réflexion édifiante dont il croit que la traduction en récit servira une illustration éloquente, eh bien ! dans toutes ces circonstances il n'a vraiment besoin, en termes d'efficacité et d'adéquation à son but, de développer un personnage selon la forme longue du roman – narration, description, dialogue et focalisation interne ! le roman est toujours la somme de peu d'idées pertinentes et initiales entre lesquelles l'écrivain comble par quantité de passages inutiles jusqu'à ce que le remplissage compte pour la majorité de l'oeuvre (sait-on qu'une tâche importante en toute planification de roman consiste à trouver de quoi « lier » les parties indispensables et premièrement désirées, de sorte que c'est une peine assez superflue, pour l'auteur, de tisser une histoire ainsi, pour la seule fierté d'en faire ce qu'on appelle avec vanité un « roman » ?)
Et pour le lecteur, c'est toujours, si pauvrement : « J'ai lu tel roman. — Alors ? — Cela m'a plu. — Mais en quoi cela t'a-t-il complété ? — J'ai vu des images, j'ai imaginé, j'ai passé longtemps en rêve. — Pas besoin d'un roman pour ça, paresseux ! Et pour quel profit ? — Cela m'a occupé. » On ne prouverait pas facilement que cette espèce d'entraînement conduit à un avantage intellectuel ou sentimental par rapport à autant d'heures passées à suivre une à une les vidéos suggérées sur Facebook ou TikTok : je parierais sur une hébétude ou un abrutissement global et similaire, parce qu'on ne voit presque jamais un lecteur, particulièrement de roman, se munir d'un papier pour retenir certaines informations ou pour faire le bilan progressif des éloquences qui l'ont intéressé (il n'y a que l'Agrégatif qui prend des notes, encore le fait-il sous le régime non de ce qu'il a personnellement tiré du livre mais de ce qu'il soupçonne qu'un jury lui demandera, ce qui réalise, comme je l'ai écrit ailleurs, une déformation de sa faculté de lire). le lecteur contemporain de roman est un « avaleur », aussi vrai que le romancier contemporain se targue d'être un « page turner » : le marché réclame que le roman soit comestible et digeste, et nul ne regarde à l'inutilité flagrante – je parle en termes de profit pour l'esprit et non pour le divertissement – d'une dépense de papier qui donne des histoires à la chaîne sans valeur ajoutée et en suivant des normes sans relation avec une intention déliée du genre. En cela, il n'existe aucune raison de supposer qu'une machine n'est pas déjà capable de rédiger un roman : c'est qu'il n'est dans l'immense majorité des cas que le résultat d'une mécanique méthode sans qu'il soit nécessaire pour l'écrivain, ni opportun s'il veut travailler sans complication, de s'interroger sur le besoin d'un pareil édifice. Parmi les seules circonstances où la forme du roman aurait une justification, c'est ou s'il servait d'occasion pour une pure démonstration de style, c'est-à-dire s'il se proposait de renfermer une quintessence d'oeuvre d'art, une virtuosité écrite, un summum de ciselure verbale, environ au même titre que Flaubert admettait le sujet d'un roman superflu, ou s'il consistait en manière détournée d'édifier en actes, même en actes théoriques, en actes de naturalistes c'est-à-dire de vraisemblance scientifique pour exécuter en l'espace imaginaire une hypothèse intelligente, ou encore si son intrigue comportait une façon de service qui ne pût se dessiner autrement, ou disons pas plus efficacement, qu'en représentant une histoire. Quand cela arrive-t-il ? où lit-on un roman qui ne se limite à représenter une action peu vraisemblable, en une langue largement dénuée d'art et d'effort, sans philosophie nette, et inapte à induire la moindre influence sur la réalité du lecteur ? Quatre cents pages de récit laissent au mieux le lecteur imprégné de visions s'évanouissant sitôt le livre fermé et dont l'inconscient est supposé conserver une mémoire comme une trace, mais ce sont des souvenirs imprécis et non fiables, dont l'extraction risque fort de produire une accumulation d'erreurs ou la poursuite de préjugés pour ce que la vision qu'un roman « passe » facilement est très probablement une représentation qui figurait déjà en l'esprit du lecteur et qu'il ne fait que prolonger sans correction, car si elle lui avait été difficile à acquérir, il ne l'aurait pas acceptée si aisément, en sorte qu'un roman « agréable », qu'on admet tel avec plaisir, est nécessairement empli de clichés complaisants – c'est d'ailleurs en cela que le Contemporain admet la fluidité du roman une vertu, du moins un critère de qualité : cette fluidité ne peut émaner que du fait qu'aucune représentation du récit n'échappe à sa pensée-faite, ainsi exprime-t-il, certes indirectement mais non sans une certaine sincérité, que ce qu'il recherche en un roman est surtout la continuation de ses modes de pensée personnels, ce pourquoi il veut lire vite, et non le bouleversement de ses savoirs et acquis, qui impliquerait des pauses et des retours sur soi contraires au principe de la fluidité.
J'ignore, à cause de ces réflexions enfin approfondies et résolument départies des usages qui font lire, si je lirais encore longtemps des romans : ce me paraît à présent une perte de temps relativement à la durée qu'il faut y consacrer, ce manque évident de rendement intellectuel est presque toujours une frustration pour l'esprit conséquent accoutumé à fuir le ravage ordinaire du divertissement, et je ne parviens décidément pas à dénicher des conseillers fiables – c'est comme si une maladie de l'indulgence touchait périodiquement même de bons lecteurs : faute de critères, ils se trompent souvent dans l'appréciation d'un roman utile, et leur erreur provient probablement de ce que, au bout d'un énième roman médiocre, on veut à tout prix que le suivant soit bon, alors on le « fabrique » tel par seul contraste, même léger, ou pour ne pas se savoir un être « négatif », pareil à celui qui, consultant incessamment des feuilles grises qu'il préfèrerait colorées, se croit légitime à s'extasier aux moindres traces de gris-cassé ou de gris-ocre : c'est un homme qui a perdu le sens chromatique, du moins le recul de ce sens initial, et dont le regard viendrait à brûler peut-être s'il rencontrait un rouge-sang ou un bleu-nuit. Et je m'aperçois que mon dégoût de ce genre me rend intempestif non plus seulement pour un Contemporain, mais même pour un homme du XIXe siècle, en ce que j'approche du mépris des sociétés savantes contre le roman d'avant le XVIIIe. Certes, je ne m'empêcherai plus de considérer que si l'auteur voulait exprimer une pensée intelligente, il composerait mieux un essai (même plutôt un recueil de pensées : j'ai déjà expliqué combien la plupart des essais sont inutilement diserts par volonté d'épate et feinte de construction) ; si c'est une émotion qu'il ambitionne, la toile de fond d'une longue intrigue est superflue, et une nouvelle suffirait, ou bien un poème : le roman est rarement la forme appropriée d'une représentation humaine. de façon générale, j'en viens à me demander si la raison d'être du roman n'est pas toujours à chercher du côté du divertissement, c'est-à-dire pour susciter quelque évanescence d'esprit dont l'explicitation, fatalement, nous fait coupable comme ici : on en écrit pour se prouver qu'on sait fasciner et séduire, on le lit pour disparaître en la situation imaginaire qu'on propose d'investir. J'admets par exemple avoir écrit La Fortune des Norsmith par défi parce qu'alors le roman me paraissait automatiquement la forme la plus « fameuse », et ArkOne après sollicitation comme un éditeur me donnait des gages de le prendre – ce dernier livre étant d'ailleurs écrit en un style un peu plus simple et accessible que ma pensée d'artiste. Ce ne signifie point que ces romans furent des complaisances – ils sont excellents et d'ailleurs exigeants, bien meilleurs qu'au moins les neuf-dixièmes de la production romanesque actuelle –, mais je dois reconnaître que j'en tirai la motivation des préjugés issus de la société même : ou le roman-comme-genre-littéraire-par-excellence, ou le roman-pour-moyen-d'accès-à-un-lectorat-vaste. Je n'aurais pas trouvé intérêt à y recourir sans cela : car l'espèce d'amoralité superbe que je désirais atteindre au premier pouvait se densifier en l'espèce d'un récit plus court et dénué de transitions servant surtout à former un tableau sérieux et cohérent, et la progression intellectuelle et émotionnelle que j'aspirais à traduire au second, avec la chute désespérée, aurait peut-être aussi bien servi en une nouvelle, ou, disons, en une nouvelle un peu longue, à la façon par exemple de « L'homme bicentenaire » d'Asimov. Mais je ne me sentais pas d'alternative, acculé en l'image même du roman « nécessaire », et je pourrais formuler approximativement la teneur et l'ordre de mon travail en stipulant que ma pensée était au service du roman plutôt que l'inverse. Et je crois que c'est de cette façon obtuse que pensent avec dommages la plupart des romanciers : ils ne réfléchissent pas si leur message a besoin du roman ou s'il ne trouverait pas, à y réfléchir, un genre plus adapté pour rendre leur propos plus efficace, mais ils se demandent : « Quel roman vais-je écrire à présent ? ». le roman leur est présupposé de l'écrit, ils ne songent pas si ce moyen correspond à un but, ce moyen est l'objectif même et tend à devenir la condition de leur pensée ; ils ne se disent pas, en somme : « Quelle idée je vais transmettre » mais « quelle idée de roman », ce qui ne revient pas du tout à avoir une idée départie d'une certaine forme contraignante et qui serait authentique justement en raison de sa spontanéité et de son but (en tout art, il est logique que la technique se plie au dessein de l'artiste) ; ils n'ont pas d'abord une « bonne idée » qu'ils tiennent à transmettre avant d'élire réflexivement ce « média adapté » par comparaison à d'autres, ils ne se sentent pas libres de sélectionner un moyen différent, mais, à cause de la réputation du roman et de son marché, ils restent prisonniers de l'a-priori du roman comme forme imposée, et condamnés à conformer leurs idées pour qu'elles puissent s'inscrire dans le roman, et, sans doute souvent, se résolvent au roman sans penser qu'ils pourraient faire autre chose, sans même se dire que ce genre est une forme parmi d'autres qui doit être au service d'une idée immatérielle et non à laquelle cette idée doit se mouler, et qui n'est pas forcément le moyen le plus propice pour matérialiser la leur ; autrement dit, avant même de savoir ce qu'ils ont envie de transmettre, ils ne songent qu'à : « Il faut que ce soit une pensée romançable », et éliminent d'emblée toute idée même supérieure dont ils ne pourraient pas faire, pour le dire en gros, quelque histoire de quatre cents pages avec progression chronologique et affective.
Et c'est exactement pourquoi – je suis enfin parvenu à le comprendre – tant de romans, leur grande majorité même, ne contiennent que peu d'idées qui, parfois dignes d'intérêt et d'art, pour être mises en valeur méritaient surtout un développement non romanesque, une forme bien différente du roman pour les soutenir. C'est ce qui donne à la plupart une impression d'inutilité, une saveur de vacuité, une sensation de torpeur, un air de délitescence : une telle histoire, ainsi composée, n'a servi à rien, elle a atténué l'idée au lieu de la porter et de la souligner, elle n'était manifestement pas la forme congruente pour dire ceci, c'est toujours long pour ce que l'auteur a voulu transmettre, épars, diffus, inconsistant, au point que la norme du roman, il faudrait en convenir, est à ce sentiment d'attente perpétuelle entre des actions ou des réflexions qui, elles, semblent bien l'essentiel auquel l'écrivain avait initialement destiné son travail, ou, pour le dire autrement, au point que le lecteur de romans se prépare toujours à patienter en faible densité de style et de faits, le roman se définissant, chez le lecteur conscient, comme la posture anticipée d'un certain ennui habitué. Si au surplus on comprend tout ce qui n'est pas artiste dans le roman, c'est-à-dire si l'on en exclut à la fois la pauvreté des intermèdes et la médiocrité des efforts sur le langage, il ne reste plus que de l'eau plus ou moins délavée, digeste et hypnotique, servant à maintenir le lecteur en la sensation d'une fluidité et d'une homogénéité, mais qui ne consiste, à l'examiner en critique, qu'en liant captieux chargé d'étourdir par plaisir de se croire « suivre » – c'est ainsi qu'on peut « lire vite » des récits qui ne nécessitent de concentration ni pour leurs péripéties ni pour leur expression. Un tel roman se dévore sans mal justement parce qu'il n'est que vide et ne réclame ni subtilité ni mémoire : c'est le propre de toute oeuvre qu'on lit d'une traite en tournant rapidement les pages parce qu'on n'a jamais à relire une phrase ; on ne s'arrête pas pour déguster une eau presque insipide, mais on la fait rentrer directement dans son gosier par pleines gorgées parce qu'on n'a pas une minute à perdre pour se désaltérer (c'est une juste métaphore : après tout, c'est bien, dans les deux cas, le temps des vacances où il fait chaud !).
Même un roman pas trop accessible comme celui de Nimier, écrit en un style de patente recherche, me sidère un peu, si j'y songe bien : après l'avoir lu, il ne m'en reste à peu près rien, j'y reconnais beaucoup de remplissage dont on a trop pris l'habitude et qu'on finit par admettre consubstantiel au roman, tant de chapitres entiers qu'on peut supprimer sans manque, et peu de situations ou d'idées m'en font l'impression d'un choc ou d'un bouleversement. À être attentif à son profit spirituel, on ignore pourquoi on lit encore, on a l'air d'espérer sempiternellement un événement qui n'a presque aucune chance d'arriver, et à la moindre distance on trouve que ce romanesque a décidément le caractère d'une lâche anecdote. Enfin au bout, on regarde en arrière les centaines de pages et les heures passées à lire, et l'on peine à formuler un avantage personnel qu'on essaie d'extraire tout de même ou auquel on tâche à ne pas penser : toujours, certes, ce n'est pas mal pour un roman, c'était un roman pas inintéressant, on a suivi les faits et opinions romanesques de personnages de roman plus ou moins vraisemblables, et si l'on se sonde, on conçoit d'emblée le roman comme gaspillage, c'est bien toujours de cette convention qu'on part pour le juger, il faut se faire, de ce loisir en quoi consiste un roman, la considération par défaut d'un objet de faible profit, de maigre permanence, auquel on se consacre en pleine conscience de la vanité d'une activité qui n'en est pas une – on se justifie après coup par l'espèce de fuite improductive que le roman a permis, on y suppose une détente que rien ne permet de distinguer de l'évanescence mentale, ou pire, on y veut croire une portée symbolique, la Culture ou les
Lien : http://henrywar.canalblog.com
Le bleu va merveilleusement à François Sainte-Anne. La veste qu'il porte a cette couleur, et elle met tant en valeur la beauté de ce jeune homme de dix-huit ans que sa jeunesse, au sens militaire du mot : Sainte-Anne est un bleu que la vie va se charger de déniaiser. Avec le XVIe régiment de hussards, Sainte-Anne entre en Allemagne au printemps 1945. L'époque de la défaite française, en juin 1940, est lointaine ; voilà les Français vainqueurs, puis occupants. Les Allemands qui, jadis, paradaient dans Paris, ne sont plus que des vaincus à mépriser. le hussard bleu est une comédie humaine, une farce militaire dont toutes les pages démontrent l'absurdité générale des événements. de la mort des idéologies à celle des sentiments, Roger Nimier ne s'offusque ni ne se lamente : plutôt, il en rit, tel un insolent jeune homme capable de commettre, à 25 ans, pareil roman.
N'allons pas jusqu'à écrire que Nimier eut de la chance, mais connaître la guerre comme il la connut, fut sans doute un avantage pour son métier d'écrivain. Comme ses protagonistes, Nimier s'est engagé en 1945 dans les hussards et dut participer, de près ou de loin, aux événements qu'il décrit. À travers les monologues qui se succèdent se dessine le visage pluriel d'une armée française mortifiée par la défaite de 1940 et tiraillée, par le passé de ses soldats, entre l'idéal de la Résistance et celui de la Milice, entre De Gaulle et Pétain. Que ce soit le précieux capitaine de Forjac, la brute de colonel Fermendidier, l'imbécile Casse-Pompons ou encore le carriériste général O'Reish, la caste des officiers semble encore très vieille France, partagée entre un esthétisme érotique suranné (De Forjac) et un goût dépassé pour la chose militaire. Mais c'est à travers les figures des cavaliers, de Los Anderos au surnommé Karl Marx en passant par Maximian et, bien-sûr, par Sanders, que la farce militaire apparaît dans toute son absurdité. Car, en matière de guerre, les affrontements armés sont plutôt rares. Tout juste trouve-t-on un sévère accrochage dans les environs du lac de Constance, affrontement que les Français trouvent remarquables de perdre. Quant aux autres pages, elles se passent en stationnements paisibles, progressions tranquilles dans le pays bientôt vaincu, occupation sereine d'une Allemagne ravagée. La guerre est absurde dans son absence : les combats sont rares. La guerre est absurde dans ses formes : on se bat sans rien y voir, on soigne des moribonds toute la nuit, on meurt, réduits à l'impuissance et brûlé par des Allemands pourtant presque vaincus.
La farce de la guerre, c'est aussi celle de l'Histoire qui, plus que jamais, use des hommes comme on le fait des pions sur un échiquier sur lequel on relance toujours la même partie. Résistants et miliciens ont intégré l'armée française, mais leurs idéaux sont désormais lointains. le communisme ou le nationalisme ne sont pas des idées mortes, loin de là, mais elles s'effacent devant la fraternité des armes ou devant la haine normale de l'ennemi. Il n'y a guère que Besse, un ancien milicien et camarade de Sanders, qui, par respect pour ses engagements passés, veut encore oeuvrer pour son idéologie ; ce sera un échec qu'il paiera de sa vie. L'Histoire, en tout cas, ne s'embarrasse pas des sentiments des uns et des autres. Une autre guerre arrive, en Indochine, pour avaler les vies rescapées.
Si l'on ne fait pas la guerre dans le hussard bleu, on s'aime au moins. Les amours au temps de la guerre sont multiples. Au milieu des attentions se trouve bien souvent Sainte-Anne, dont l'arrivée au régiment lors d'un stationnement en Lorraine correspond d'ailleurs au début du roman. C'est sous le signe d'un amour - contrarié - que naît l'amitié entre Sainte-Anne et Sanders. Amitié virile entre les deux hommes, fraternelle même, qui sera à l'origine d'un triangle amoureux particulier à l'issue tragique. D'autres que Sanders aiment Sainte-Anne : de Forjac en fait son aide pour mieux idéaliser son corps, de sa chevelure jusqu'à son sexe ; Florence, l'amie d'O'Reish, le méprise autant qu'elle le veut ; Fermendidider aime son audace et son côté bonhomme. Il y a encore Rita, une jeune Allemande de vingt-cinq ans dont le mari est prisonnier en Russie. Dans sa villa, Rita est d'abord violée par Sanders, avant de le retrouver quelques mois plus tard. Objet de fantasmes de Sainte-Anne, Rita joue ainsi dans le coeur des deux hommes - Sanders et Sainte-Anne -, autant par désoeuvrement que par vengeance. La guerre a cela de moche qu'elle dénature même l'amour. Rita attire et répugne : elle attire par sa légèreté, sa lubricité, son accessibilité ; elle répugne par sa froideur, son machiavélisme, sa frivolité. Elle aime Sanders parce qu'il est l'image du guerrier ; elle hait Sanders pour son indifférence. Quant à Sainte-Anne, elle le hait pour sa fragilité. Elle l'aime, pour la même raison qui pousse tout le monde à aimer Sainte-Anne. Sainte-Anne est aimé car c'est un enfant. Sa fraîche innocence ravit tout le monde, comme son côté bravache. Comme tout enfant, Sainte-Anne a besoin de modèles : la droiture de Maximian, le désenchantement de Sanders : ainsi Sainte-Anne paraît être la personnification du monde tancé entre un idéal - perdu - et une prise de conscience de l'ignominie de l'humanité.
Point d'héroïsme dans ces pages, point de pureté, hormis chez Sainte-Anne. La guerre salit d'abord, puis elle ennuie. Cela se voit chez les personnages de Nimier. Sanders, par exemple, la joue bravache, mais la guerre l'a enlaidi, physiquement d'abord, psychologiquement ensuite. Rita, aussi, malgré toute sa morgue, ne parvient pas à cacher son ennui et sa vacuité. Dans ce roman, le courage finit par être une posture, une sorte de tradition virile qu'on se transmet pour donner du sens à l'action. On ridiculise les corps d'armées rivaux, on viole les femmes car c'est ce qui se fait en guerre, on boit, on s'enivre, on fréquente les bordels. de toute cela, Roger Nimier parle avec une audace et une profondeur étonnantes. Sa langue écrite, très orale, puise dans l'argot (les Fridolins, les suçards, le margis) et dans la phonétique (les eftépés, les bohiscoutes ...) pour donner à son roman l'aspect de la vie de ces hommes vaincus un jour, vainqueurs un autre, mais en réalité définitivement vaincus. En suivant, avec sa franchise et son humour, un régiment de hussards pénétrant en Allemagne, Roger Nimier signe, avec son Hussard bleu, un roman insolent - on pourrait dire : romantique - sur la perte de l'innocence.
N'allons pas jusqu'à écrire que Nimier eut de la chance, mais connaître la guerre comme il la connut, fut sans doute un avantage pour son métier d'écrivain. Comme ses protagonistes, Nimier s'est engagé en 1945 dans les hussards et dut participer, de près ou de loin, aux événements qu'il décrit. À travers les monologues qui se succèdent se dessine le visage pluriel d'une armée française mortifiée par la défaite de 1940 et tiraillée, par le passé de ses soldats, entre l'idéal de la Résistance et celui de la Milice, entre De Gaulle et Pétain. Que ce soit le précieux capitaine de Forjac, la brute de colonel Fermendidier, l'imbécile Casse-Pompons ou encore le carriériste général O'Reish, la caste des officiers semble encore très vieille France, partagée entre un esthétisme érotique suranné (De Forjac) et un goût dépassé pour la chose militaire. Mais c'est à travers les figures des cavaliers, de Los Anderos au surnommé Karl Marx en passant par Maximian et, bien-sûr, par Sanders, que la farce militaire apparaît dans toute son absurdité. Car, en matière de guerre, les affrontements armés sont plutôt rares. Tout juste trouve-t-on un sévère accrochage dans les environs du lac de Constance, affrontement que les Français trouvent remarquables de perdre. Quant aux autres pages, elles se passent en stationnements paisibles, progressions tranquilles dans le pays bientôt vaincu, occupation sereine d'une Allemagne ravagée. La guerre est absurde dans son absence : les combats sont rares. La guerre est absurde dans ses formes : on se bat sans rien y voir, on soigne des moribonds toute la nuit, on meurt, réduits à l'impuissance et brûlé par des Allemands pourtant presque vaincus.
La farce de la guerre, c'est aussi celle de l'Histoire qui, plus que jamais, use des hommes comme on le fait des pions sur un échiquier sur lequel on relance toujours la même partie. Résistants et miliciens ont intégré l'armée française, mais leurs idéaux sont désormais lointains. le communisme ou le nationalisme ne sont pas des idées mortes, loin de là, mais elles s'effacent devant la fraternité des armes ou devant la haine normale de l'ennemi. Il n'y a guère que Besse, un ancien milicien et camarade de Sanders, qui, par respect pour ses engagements passés, veut encore oeuvrer pour son idéologie ; ce sera un échec qu'il paiera de sa vie. L'Histoire, en tout cas, ne s'embarrasse pas des sentiments des uns et des autres. Une autre guerre arrive, en Indochine, pour avaler les vies rescapées.
Si l'on ne fait pas la guerre dans le hussard bleu, on s'aime au moins. Les amours au temps de la guerre sont multiples. Au milieu des attentions se trouve bien souvent Sainte-Anne, dont l'arrivée au régiment lors d'un stationnement en Lorraine correspond d'ailleurs au début du roman. C'est sous le signe d'un amour - contrarié - que naît l'amitié entre Sainte-Anne et Sanders. Amitié virile entre les deux hommes, fraternelle même, qui sera à l'origine d'un triangle amoureux particulier à l'issue tragique. D'autres que Sanders aiment Sainte-Anne : de Forjac en fait son aide pour mieux idéaliser son corps, de sa chevelure jusqu'à son sexe ; Florence, l'amie d'O'Reish, le méprise autant qu'elle le veut ; Fermendidider aime son audace et son côté bonhomme. Il y a encore Rita, une jeune Allemande de vingt-cinq ans dont le mari est prisonnier en Russie. Dans sa villa, Rita est d'abord violée par Sanders, avant de le retrouver quelques mois plus tard. Objet de fantasmes de Sainte-Anne, Rita joue ainsi dans le coeur des deux hommes - Sanders et Sainte-Anne -, autant par désoeuvrement que par vengeance. La guerre a cela de moche qu'elle dénature même l'amour. Rita attire et répugne : elle attire par sa légèreté, sa lubricité, son accessibilité ; elle répugne par sa froideur, son machiavélisme, sa frivolité. Elle aime Sanders parce qu'il est l'image du guerrier ; elle hait Sanders pour son indifférence. Quant à Sainte-Anne, elle le hait pour sa fragilité. Elle l'aime, pour la même raison qui pousse tout le monde à aimer Sainte-Anne. Sainte-Anne est aimé car c'est un enfant. Sa fraîche innocence ravit tout le monde, comme son côté bravache. Comme tout enfant, Sainte-Anne a besoin de modèles : la droiture de Maximian, le désenchantement de Sanders : ainsi Sainte-Anne paraît être la personnification du monde tancé entre un idéal - perdu - et une prise de conscience de l'ignominie de l'humanité.
Point d'héroïsme dans ces pages, point de pureté, hormis chez Sainte-Anne. La guerre salit d'abord, puis elle ennuie. Cela se voit chez les personnages de Nimier. Sanders, par exemple, la joue bravache, mais la guerre l'a enlaidi, physiquement d'abord, psychologiquement ensuite. Rita, aussi, malgré toute sa morgue, ne parvient pas à cacher son ennui et sa vacuité. Dans ce roman, le courage finit par être une posture, une sorte de tradition virile qu'on se transmet pour donner du sens à l'action. On ridiculise les corps d'armées rivaux, on viole les femmes car c'est ce qui se fait en guerre, on boit, on s'enivre, on fréquente les bordels. de toute cela, Roger Nimier parle avec une audace et une profondeur étonnantes. Sa langue écrite, très orale, puise dans l'argot (les Fridolins, les suçards, le margis) et dans la phonétique (les eftépés, les bohiscoutes ...) pour donner à son roman l'aspect de la vie de ces hommes vaincus un jour, vainqueurs un autre, mais en réalité définitivement vaincus. En suivant, avec sa franchise et son humour, un régiment de hussards pénétrant en Allemagne, Roger Nimier signe, avec son Hussard bleu, un roman insolent - on pourrait dire : romantique - sur la perte de l'innocence.
Désenchantement cynique, dandysme désabusé, pour un feu d'artifice jubilatoire...
Publié en 1950 par un auteur de vingt-cinq ans, ce court roman désenchanté fit l'effet d'une bombe à l'époque, et donna le coup d'envoi à la constitution du groupe littéraire informel des « Hussards ».
La quatrième de couverture parle de « livre insolent, romantique et tendre », pour cette « chronique intime, à la fois cynique et sentimentale, d'un peloton de hussards qui pénètre en Allemagne en 1945 ».
La langue de Nimier est en effet magnifique, et nous emmène avec bonheur et parfois jubilation dans les méandres des monologues intérieurs des principaux personnages : vieux colonels de carrière vichystes pesamment ralliés à la Libération, commandants déchirés plus ou moins suavement par leur homosexualité non assumée, fausses brutes au coeur tendre issues des FFI, des FTP, voire secrètement de la Milice, naïfs engagés volontaires romantiques, femmes allemandes plus ou moins accueillantes à l'envahisseur,... le rire et l'émotion sont brillamment servis par le style acéré et l'alternance remarquable des tons et des points de vue. Entre dureté profonde et insolence jaillissante, la lecture est captivante jusqu'au bout.
Il n'en reste pas moins que le désenchantement cynique est omniprésent, et que le dandysme désabusé qui tient lieu le plus souvent de réflexion, nu derrière le charme des formules assassines, laisse rapidement un certain sentiment de malaise, correspondant vraisemblablement aux objectifs de l'auteur, figure de proue de cette « nouvelle droite littéraire » qui tentait alors de renaître après les heurts de l'épuration de 1944-1947.
Publié en 1950 par un auteur de vingt-cinq ans, ce court roman désenchanté fit l'effet d'une bombe à l'époque, et donna le coup d'envoi à la constitution du groupe littéraire informel des « Hussards ».
La quatrième de couverture parle de « livre insolent, romantique et tendre », pour cette « chronique intime, à la fois cynique et sentimentale, d'un peloton de hussards qui pénètre en Allemagne en 1945 ».
La langue de Nimier est en effet magnifique, et nous emmène avec bonheur et parfois jubilation dans les méandres des monologues intérieurs des principaux personnages : vieux colonels de carrière vichystes pesamment ralliés à la Libération, commandants déchirés plus ou moins suavement par leur homosexualité non assumée, fausses brutes au coeur tendre issues des FFI, des FTP, voire secrètement de la Milice, naïfs engagés volontaires romantiques, femmes allemandes plus ou moins accueillantes à l'envahisseur,... le rire et l'émotion sont brillamment servis par le style acéré et l'alternance remarquable des tons et des points de vue. Entre dureté profonde et insolence jaillissante, la lecture est captivante jusqu'au bout.
Il n'en reste pas moins que le désenchantement cynique est omniprésent, et que le dandysme désabusé qui tient lieu le plus souvent de réflexion, nu derrière le charme des formules assassines, laisse rapidement un certain sentiment de malaise, correspondant vraisemblablement aux objectifs de l'auteur, figure de proue de cette « nouvelle droite littéraire » qui tentait alors de renaître après les heurts de l'épuration de 1944-1947.
Citations et extraits (43)
Voir plus
Ajouter une citation
Je ne suis pas idiot. Moi aussi, je trouve qu'il ne faut pas aimer les personnes qu'on ne connaît pas. C'est impoli, c'est défendu pour mille raisons et c'est ennuyeux. Je ne suis pas timide. Si j'étais devant elle, dans un salon, je saurais lui parler. Je l'obligerai à me répondre en amie. Elle serait mon amie, je n'en demande pas plus. Je me moque du reste. L'amour devient empoisonnant dès qu'il faut se déshabiller, s'embrasser, c'est trop de sueur et de salive à la fois. […] Je ne la vois que du ciel, noire au milieu de la neige. A côté d'elle, mes yeux sont énormes ; avec deux doigts, je la cache entièrement : elle tiendrait dans la paume de ma main. Elle tient dans le creux de mon cerveau. Il est vrai qu'il est assez creux.
[…] Car l'espoir, comme un animal imbécile, vient chercher sa nourriture tous les soirs. JE fais des projets. Je veux parler à Isabelle. Je veux qu'elle m'aime à son tour. Voilà qui est franchement criminel.
Naturellement, mes projets n'ont pas de sens. Ils sont fabriqués pièce par pièce. C'est un beau jeu de constructions, qui permet de rêver tranquillement. La catastrophe n'est jamais à craindre. Dans cette liberté réside le charme.
Une heure par semaine, je suis franc et j'avoue que cet amour imaginaire est le seul qui me convienne. […] Je comprenais que le métier d'amant n'est pas facile. C'est une chose comme la guerre, la banque, l'industrie. On peut y entrer sans étude, mais il faut travailler dur et, surtout, ne jamais abandonner.
Cependant, l'amour a quelque chose pour lui. Il résume le monde en un visage. A dix-huit ans, quand on a pas beaucoup de mémoire, il est tentant de prendre ce visage entre les mains et de l'embrasser. Mais c'est très fragile. On risque à tout instant de passer de l'autre côté. Alors on possède une maîtresse, une liaison ; de nouveaux devoirs s'imposent à vous ; on se trouve aussi faible et démuni qu'auparavant.
Dans la situation où je l'avais placée, Isabelle me fascinait sûrement. Ses yeux grands, clairs, lourds peut-être, hantaient mes confessions. Les pêchés imaginaires que j'avais commis avec elle donnaient du mouvement à son regard. (p. 253)
[…] Car l'espoir, comme un animal imbécile, vient chercher sa nourriture tous les soirs. JE fais des projets. Je veux parler à Isabelle. Je veux qu'elle m'aime à son tour. Voilà qui est franchement criminel.
Naturellement, mes projets n'ont pas de sens. Ils sont fabriqués pièce par pièce. C'est un beau jeu de constructions, qui permet de rêver tranquillement. La catastrophe n'est jamais à craindre. Dans cette liberté réside le charme.
Une heure par semaine, je suis franc et j'avoue que cet amour imaginaire est le seul qui me convienne. […] Je comprenais que le métier d'amant n'est pas facile. C'est une chose comme la guerre, la banque, l'industrie. On peut y entrer sans étude, mais il faut travailler dur et, surtout, ne jamais abandonner.
Cependant, l'amour a quelque chose pour lui. Il résume le monde en un visage. A dix-huit ans, quand on a pas beaucoup de mémoire, il est tentant de prendre ce visage entre les mains et de l'embrasser. Mais c'est très fragile. On risque à tout instant de passer de l'autre côté. Alors on possède une maîtresse, une liaison ; de nouveaux devoirs s'imposent à vous ; on se trouve aussi faible et démuni qu'auparavant.
Dans la situation où je l'avais placée, Isabelle me fascinait sûrement. Ses yeux grands, clairs, lourds peut-être, hantaient mes confessions. Les pêchés imaginaires que j'avais commis avec elle donnaient du mouvement à son regard. (p. 253)
Paris, voici ton fleuve et les larmes que tu versas, voilà ton visage au front penché. Paris, voici tes rues et la plaque d'identité au bras de chacune. Les hautes maisons subissent l'amertume du soir. Mes pas sonnent sur le boulevard. Désormais, je connais mon rôle sur la terre, mais je ne sais qui je suis. Voyageur, pose des yeux tristes sur les choses, elles te le rendront au centuple. Le visage barré du ciel te menace et te guide à la fois. Vivre, il me faudra vivre encore, quelque temps parmi ceux-là. Tout ce qui est humain m'est étranger.
Miracle invraisemblable (...) et dont certains êtres seulement sont pleinement capables, mais qui fleurit parfois (...) dans une attitude, dans un sourire, dans une boucle de cheveux, alors le monde s'éclaire et retrouve son unité perdue (...) et ce n'est pas sans doute une des moindres propriétés de l'amour que de nous rendre semblables aux océans, nous diluant dans l'infini de chaque heure, nous étalant à la surface des choses (...) nous laissant face à face avec notre unique pensée qui donne à tous nos gestes l'allure des grands fonds.
Au théâtre, quand j'étais enfant, n’espérais-je pas toujours que l'acteur tragique allait soudain quitter la scène pour se mêler aux spectateurs ? Comme ce serait facile, pensais-je avec la logique de mon âge. Trois mètres de chemin et Hamlet abandonnera ses scrupules. Hélas, il lui manquait une dimension qui n'était peut-être que la dimension de l'indifférence. La volonté acharnée des imbéciles de ressembler à Dieu ou à l'acteur tragique, en accumulant les incestes, les meurtres, ne prouvait qu'une chose : leur incompréhension de Dieu. Car Dieu est notre spectateur et retirer son épingle du jeu, c'est le rejoindre. Alors plus d'actions, on ne fait que des miracles...
Ces pensées n'étaient plus les miennes pour mille raisons. Mais des pensées qu'on a courtisées, qui ont répondu à votre amour, qui vous ont illuminé, puis qu'on a quittées, sont un peu comme ces anciennes maîtresses que nous rencontrons dans une soirée et chez qui nous distinguons toujours les petits cris de plaisir qu'elles avaient dans nos bras, sous les paroles les plus anodines, à condition d'aimer les femmes, bien entendu. Ainsi de l'indifférence : je la goûtais chez les autres, car je savais que son visage nocturne est de feu (éd. Gallimard, 1978, pp. 113-114).
Ces pensées n'étaient plus les miennes pour mille raisons. Mais des pensées qu'on a courtisées, qui ont répondu à votre amour, qui vous ont illuminé, puis qu'on a quittées, sont un peu comme ces anciennes maîtresses que nous rencontrons dans une soirée et chez qui nous distinguons toujours les petits cris de plaisir qu'elles avaient dans nos bras, sous les paroles les plus anodines, à condition d'aimer les femmes, bien entendu. Ainsi de l'indifférence : je la goûtais chez les autres, car je savais que son visage nocturne est de feu (éd. Gallimard, 1978, pp. 113-114).
Avec l'amour, peu à peu, l'univers tombe en lambeaux comme un malade que la gangrène a travaillé, puis une vie neuve, un jour se révèle. Mais cette vie qui tend les bras recule devant vous, et plus, vous avancez, plus elle s'écarte, brillant toujours d'un feu parfait. La poursuite vous exalte, le rouge vous monte au visage, et ce bonheur incomparable, cet absolu royal, vous le suivez à la trace, fidèlement, heureusement, jusqu'au jour où vous sentez enfin que la solitude est la plus forte. Car le vieux monde, ses habitudes, ses lois, ses plaisirs, dorment sous la poussière mais encore rien ne les remplace et l'on est comme ce voyageur écœuré des siens qui a vécu longtemps du départ : il s'embarque, il aborde l'ile dans la nuit, il ne peut trouver le soleil car demain ses yeux verront, mais un mal inconnu l'a frappé, jamais il connaitra le jour, dans l'ombre il souffle et désespère.
Videos de Roger Nimier (8)
Voir plusAjouter une vidéo
Yannick Haenel et son invitée, Linda Tuloup, lecture par Emmanuel Noblet.
Depuis plus de deux décennies, Yannick Haenel éclaire le paysage littéraire français de ses romans singuliers, où se concentrent les désirs multiples et où nous côtoyons, souvent avec jubilation, l'univers de personnages en quête d'absolu. Au cours de ce grand entretien, un format qui lui sied particulièrement, l'écrivain reviendra sur ses passions. La peinture d'abord (il a écrit sur le Caravage un essai inoubliable), mais aussi le théâtre (son Jan Karski a été adapté sur scène par Arthur Nauzyciel), la photographie (Linda Tuloup sera à ses côtés), l'histoire… On parlera aussi de littérature, de celle qui l'aide à vivre depuis toujours, d'écriture et de ce qu'en disait Marguerite Duras dont l'oeuvre l'intéresse de plus en plus, et de cinéma, vaste territoire fictionnel dont il s'est emparé dans Tiens ferme ta couronne, où son narrateur se met en tête d'adapter pour l'écran la vie de Hermann Melville, croisant tout à la fois Isabelle Huppert et Michaël Cimino…
Écrivain engagé, il a couvert pour Charlie Hebdo le procès des attentats de janvier 2015, en a fait un album avec les dessins de François Boucq, et continue de tenir des chroniques dans l'hebdomadaire. Son dernier roman, le Trésorier-payeur, nous entraîne à Béthune dans une succursale de la Banque de France, sur les traces d'un certain Georges Bataille, philosophe de formation et désormais banquier de son état, à la fois sage et complètement fou, qui revisite la notion de dépense et veut effacer la dette des plus démunis. Mais comment être anarchiste et travailler dans une banque ? Seuls l'amour et ses pulsions, le débordement et le transport des sens peuvent encore échapper à l'économie capitaliste et productiviste…
Une heure et demie en compagnie d'un écrivain passionnant, érudit et curieux de tout, pour voyager dans son oeuvre et découvrir les mondes invisibles qui la façonnent.
À lire (bibliographie sélective) — « le Trésorier-payeur », Gallimard, 2022. — Yannick Haenel, avec des illustrations de François Boucq, « Janvier 2015. le Procès », Les Échappés, 2021. — « Tiens ferme ta couronne, Gallimard, 2017 (prix Médicis 2017). — « Les Renards pâles, Gallimard, 2013. — « Jan Karski, Gallimard, 2009 (prix du roman Fnac 2009 et prix Interallié 2009) — « Cercle, Gallimard, 2007 (prix Décembre 2007 et prix Roger-Nimier 2008). — Linda Tuloup, avec un texte de Yannick Haenel, « Vénus. Où nous mènent les étreintes », Bergger, 2019.
Un grand entretien animé par Olivia Gesbert, avec des lectures par Emmanuel Noblet, et enregistré en public le 28 mai 2023 au conservatoire Pierre Barbizet, à Marseille, lors de la 7e édition du festival Oh les beaux jours !
Podcasts & replay sur http://ohlesbeauxjours.fr #OhLesBeauxJours #OLBJ2023
Depuis plus de deux décennies, Yannick Haenel éclaire le paysage littéraire français de ses romans singuliers, où se concentrent les désirs multiples et où nous côtoyons, souvent avec jubilation, l'univers de personnages en quête d'absolu. Au cours de ce grand entretien, un format qui lui sied particulièrement, l'écrivain reviendra sur ses passions. La peinture d'abord (il a écrit sur le Caravage un essai inoubliable), mais aussi le théâtre (son Jan Karski a été adapté sur scène par Arthur Nauzyciel), la photographie (Linda Tuloup sera à ses côtés), l'histoire… On parlera aussi de littérature, de celle qui l'aide à vivre depuis toujours, d'écriture et de ce qu'en disait Marguerite Duras dont l'oeuvre l'intéresse de plus en plus, et de cinéma, vaste territoire fictionnel dont il s'est emparé dans Tiens ferme ta couronne, où son narrateur se met en tête d'adapter pour l'écran la vie de Hermann Melville, croisant tout à la fois Isabelle Huppert et Michaël Cimino…
Écrivain engagé, il a couvert pour Charlie Hebdo le procès des attentats de janvier 2015, en a fait un album avec les dessins de François Boucq, et continue de tenir des chroniques dans l'hebdomadaire. Son dernier roman, le Trésorier-payeur, nous entraîne à Béthune dans une succursale de la Banque de France, sur les traces d'un certain Georges Bataille, philosophe de formation et désormais banquier de son état, à la fois sage et complètement fou, qui revisite la notion de dépense et veut effacer la dette des plus démunis. Mais comment être anarchiste et travailler dans une banque ? Seuls l'amour et ses pulsions, le débordement et le transport des sens peuvent encore échapper à l'économie capitaliste et productiviste…
Une heure et demie en compagnie d'un écrivain passionnant, érudit et curieux de tout, pour voyager dans son oeuvre et découvrir les mondes invisibles qui la façonnent.
À lire (bibliographie sélective) — « le Trésorier-payeur », Gallimard, 2022. — Yannick Haenel, avec des illustrations de François Boucq, « Janvier 2015. le Procès », Les Échappés, 2021. — « Tiens ferme ta couronne, Gallimard, 2017 (prix Médicis 2017). — « Les Renards pâles, Gallimard, 2013. — « Jan Karski, Gallimard, 2009 (prix du roman Fnac 2009 et prix Interallié 2009) — « Cercle, Gallimard, 2007 (prix Décembre 2007 et prix Roger-Nimier 2008). — Linda Tuloup, avec un texte de Yannick Haenel, « Vénus. Où nous mènent les étreintes », Bergger, 2019.
Un grand entretien animé par Olivia Gesbert, avec des lectures par Emmanuel Noblet, et enregistré en public le 28 mai 2023 au conservatoire Pierre Barbizet, à Marseille, lors de la 7e édition du festival Oh les beaux jours !
Podcasts & replay sur http://ohlesbeauxjours.fr #OhLesBeauxJours #OLBJ2023
+ Lire la suite
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus

Ecrivains de pères en fils
palamede
44 livres
Autres livres de Roger Nimier (20)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les Amants de la Littérature
Grâce à Shakespeare, ils sont certainement les plus célèbres, les plus appréciés et les plus ancrés dans les mémoires depuis des siècles...
Hercule Poirot & Miss Marple
Pyrame & Thisbé
Roméo & Juliette
Sherlock Holmes & John Watson
10 questions
5332 lecteurs ont répondu
Thèmes :
amants
, amour
, littératureCréer un quiz sur ce livre5332 lecteurs ont répondu