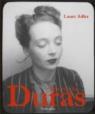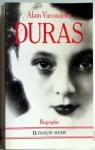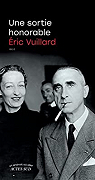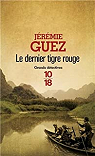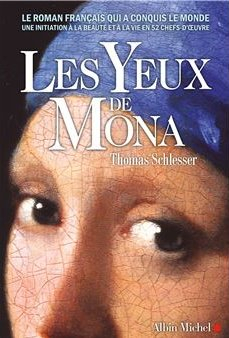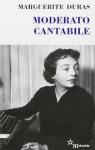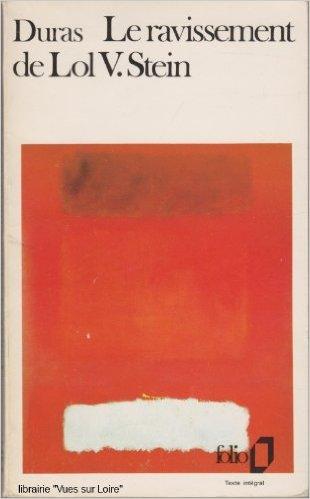Marguerite Duras/5
2303 notes
Résumé :
"Les barrages de la mère dans la plaine, c'était le grand malheur et la grande rigolade à la fois, ça dépendait des jours. C'était la grande rigolade du grand malheur. C'était terrible et c'était marrant. Ça dépendait de quel côté on se plaçait, du côté de la mer qui les avait fichus en l'air, ces barrages, d'un seul coup d'un seul, du côté des crabes qui en avaient fait des passoires, ou au contraire, du côté de ceux qui avaient mis six mois à les construire dans l... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Un barrage contre le PacifiqueVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (169)
Voir plus
Ajouter une critique
Marguerite Duras nous livre ici ses souvenirs d'adolescence indochinoise d'avant guerre (période 1920-1930) au moment même où la France est engagée dans la guerre d'Indochine. C'est donc probablement avec une certaine douleur que ces lignes furent écrites, d'autant plus que son histoire personnelle n'est pas elle-même, dénuée de douleur.
Elle nous conte, de façon un peu romancée, le calvaire de sa mère, institutrice pauvre ayant perdu son mari et s'étant fait berner par l'administration coloniale dans l'achat d'un terrain complètement inexploitable car inondé par les eaux salées de la mer de Chine en période de mousson. Laquelle mer de Chine est dénommée Pacifique par la mère, comme si seul un ennemi de cette taille avait le droit de lui causer des misères, et contre les furies duquel elle va s'échiner à tenter de construire une digue pour protéger les terres du sel dévastateur et ainsi les rendre exploitables.
L'aventure tournera au fiasco et la mère y laissera jusqu'à son dernier sou, plongeant la famille dans une misère noire. Joseph, le frère aîné de la narratrice, garde rancune de ce mauvais coup du sort et cultive une sorte de misanthropie bourrue d'homme des bois qui a quelque chose de touchant.
Aussi, la jeune Marguerite va-t-elle être convoitée par un fils de famille richissime, un chinois, inversant ainsi le rapport ordinaire entre blancs et asiatiques. Une relation très ambiguë va naître, soutenue par l'argent, où la jeune héroïne sera tiraillée entre les désirs avides de sa famille néanmoins pondérés par leurs accusations de prostitution. Un amour impossible d'un côté comme de l'autre (le père fortuné menace de déshériter son fils s'il se compromet avec la française), et plus largement une vie impossible, sans espoir autre que l'exil, à savoir le retour en France.
Un très bon livre, peut-être pas le plus grand chef-d'oeuvre de tous les temps, mais une vision poignante à 99% autobiographique. J'en retiendrais surtout les personnages ambigus qu'on ne sait trop si l'on doit aimer ou détester, à savoir le frère et la mère. L'histoire de l'héroïne m'a moins transporté. Marguerite Duras est revenue trente-cinq ans après la publication de ce roman sur cette période et y a apporté des précisions et des modifications dans L'amant.
D'une façon générale ce livre vaut surtout, à mon sens, pour ses personnages et sujets secondaires, comme par exemple la critique de l'administration coloniale, mais comme toujours, ce n'est là que mon avis, c'est-à-dire, une goutte d'eau dans le Pacifique.
Elle nous conte, de façon un peu romancée, le calvaire de sa mère, institutrice pauvre ayant perdu son mari et s'étant fait berner par l'administration coloniale dans l'achat d'un terrain complètement inexploitable car inondé par les eaux salées de la mer de Chine en période de mousson. Laquelle mer de Chine est dénommée Pacifique par la mère, comme si seul un ennemi de cette taille avait le droit de lui causer des misères, et contre les furies duquel elle va s'échiner à tenter de construire une digue pour protéger les terres du sel dévastateur et ainsi les rendre exploitables.
L'aventure tournera au fiasco et la mère y laissera jusqu'à son dernier sou, plongeant la famille dans une misère noire. Joseph, le frère aîné de la narratrice, garde rancune de ce mauvais coup du sort et cultive une sorte de misanthropie bourrue d'homme des bois qui a quelque chose de touchant.
Aussi, la jeune Marguerite va-t-elle être convoitée par un fils de famille richissime, un chinois, inversant ainsi le rapport ordinaire entre blancs et asiatiques. Une relation très ambiguë va naître, soutenue par l'argent, où la jeune héroïne sera tiraillée entre les désirs avides de sa famille néanmoins pondérés par leurs accusations de prostitution. Un amour impossible d'un côté comme de l'autre (le père fortuné menace de déshériter son fils s'il se compromet avec la française), et plus largement une vie impossible, sans espoir autre que l'exil, à savoir le retour en France.
Un très bon livre, peut-être pas le plus grand chef-d'oeuvre de tous les temps, mais une vision poignante à 99% autobiographique. J'en retiendrais surtout les personnages ambigus qu'on ne sait trop si l'on doit aimer ou détester, à savoir le frère et la mère. L'histoire de l'héroïne m'a moins transporté. Marguerite Duras est revenue trente-cinq ans après la publication de ce roman sur cette période et y a apporté des précisions et des modifications dans L'amant.
D'une façon générale ce livre vaut surtout, à mon sens, pour ses personnages et sujets secondaires, comme par exemple la critique de l'administration coloniale, mais comme toujours, ce n'est là que mon avis, c'est-à-dire, une goutte d'eau dans le Pacifique.
Un barrage contre le Pacifique, sans être une autobiographie, a été inspiré à Marguerite Duras par son adolescence en Indochine.
Après avoir économisé pendant de longues années, une veuve achète une concession dans le sud de l'Indochine. Mais les terres se révèlent incultivables car inondées régulièrement par le Pacifique. La seule solution est de construire des barrages. Malheureusement, comme ils s'avèrent insuffisants face aux assauts de l'océan, la vie de la femme, avec deux adolescents à sa charge et la pression d'une administration corrompue, devient une survie. Pour s'en sortir, il y a bien ce jeune chinois qui tourne autour de sa fille, mais quand le riche père de celui-ci refuse l'idée d'un mariage, devant tant d'infortune, la folie n'est plus loin.
Marguerite Duras dépeint une vie dans les colonies qui va à l'encontre de l'idée que l'on s'en fait habituellement. En Indochine, les maîtres sont les locaux fortunés et non les colons grugés, harcelés et ruinés par l'administration coloniale, qui ne leur laisse d'autre choix qu'un retour en France. Bien que décrit avec beaucoup de froideur, on ne peut qu'être touché par le sort de ces gens qui ont tout perdu, alors qu'ils espéraient dans un exil salutaire. Mais ce pays et cette adversité ont forgé des personnalités fortes. Il suffit pour s'en convaincre de voir le parcours exceptionnel et le talent de celle qui nous raconte son histoire dans Un barrage contre le Pacifique.
Après avoir économisé pendant de longues années, une veuve achète une concession dans le sud de l'Indochine. Mais les terres se révèlent incultivables car inondées régulièrement par le Pacifique. La seule solution est de construire des barrages. Malheureusement, comme ils s'avèrent insuffisants face aux assauts de l'océan, la vie de la femme, avec deux adolescents à sa charge et la pression d'une administration corrompue, devient une survie. Pour s'en sortir, il y a bien ce jeune chinois qui tourne autour de sa fille, mais quand le riche père de celui-ci refuse l'idée d'un mariage, devant tant d'infortune, la folie n'est plus loin.
Marguerite Duras dépeint une vie dans les colonies qui va à l'encontre de l'idée que l'on s'en fait habituellement. En Indochine, les maîtres sont les locaux fortunés et non les colons grugés, harcelés et ruinés par l'administration coloniale, qui ne leur laisse d'autre choix qu'un retour en France. Bien que décrit avec beaucoup de froideur, on ne peut qu'être touché par le sort de ces gens qui ont tout perdu, alors qu'ils espéraient dans un exil salutaire. Mais ce pays et cette adversité ont forgé des personnalités fortes. Il suffit pour s'en convaincre de voir le parcours exceptionnel et le talent de celle qui nous raconte son histoire dans Un barrage contre le Pacifique.
Vivre sa vie en aventurière,
n'avoir pas froid aux yeux !
C'est ainsi que je vois Marguerite Duras. Partager sa vie entre l'Indochine coloniale et la métropole. Avoir mené de front des études de droit et de mathématiques. A une époque prude, avoir une vie sentimentale turbulente, et ce dès le plus jeune âge. Être résistante tout en travaillant pour les allemands. Rejoindre le PCF et s'en faire éjecter pour fréquentation de boîtes de nuit et moeurs dites bourgeoises. Passer les dernières décennies de sa vie sous l'emprise de l'alcool et continuer à écrire malgré les problèmes de santé. Marguerite Duras se foutait des frontières comme des limites.
Le Barrage contre le Pacifique est un récit qui contient des éléments autobiographiques, oui, mais c'est une oeuvre de fiction, non une biographie.
S'il aborde des thèmes tels que le colonialisme, le racisme,les inégalités, l'érotisme ou le sort de la femme, ce n'est pas non plus un roman à thèses.
C'est un livre ou la romancière mêle des éléments de son passé à bien
d'autres sources d'inspiration pour en faire une oeuvre de fiction. C'est peut-être aussi sa façon de traiter le problème de ces limites qu'elle a si joyeusement enjambées.
Car des limites, il en est question. Il y a d'abord ce barrage, que la mère a essayé de construire pour sauver les terres arables d'une vallée d'inondations d'eau salée. Femme de peu d'imagination, impulsive, ne prenant pas la peine de se documenter sérieusement sur ce qu'elle entreprend, elle y laisse ses économies, sa santé et son courage. Sa vie se casse sur un projet impossible. L'obstacle était frontière, une frontière infranchissable. Envers ses enfants, cette même mère était dominante, exigeante voir tyrannique. Elle leur faisait obstacle, était cette frontière qu'ils apprendront à franchir au fur et à mesure de son déclin. Pour franchir des obstacles, pour dépasser les limites, Il faut avoir du courage, oser, mais aussi avoir de l'imagination et de la chance. Marguerite, cette acrobate de la vie, avait tout cela en abondance. A-t-elle trouvé ce qu'elle cherchait ? Si oui, cela l'a-t-il comblée ? Comment savoir… ?
n'avoir pas froid aux yeux !
C'est ainsi que je vois Marguerite Duras. Partager sa vie entre l'Indochine coloniale et la métropole. Avoir mené de front des études de droit et de mathématiques. A une époque prude, avoir une vie sentimentale turbulente, et ce dès le plus jeune âge. Être résistante tout en travaillant pour les allemands. Rejoindre le PCF et s'en faire éjecter pour fréquentation de boîtes de nuit et moeurs dites bourgeoises. Passer les dernières décennies de sa vie sous l'emprise de l'alcool et continuer à écrire malgré les problèmes de santé. Marguerite Duras se foutait des frontières comme des limites.
Le Barrage contre le Pacifique est un récit qui contient des éléments autobiographiques, oui, mais c'est une oeuvre de fiction, non une biographie.
S'il aborde des thèmes tels que le colonialisme, le racisme,les inégalités, l'érotisme ou le sort de la femme, ce n'est pas non plus un roman à thèses.
C'est un livre ou la romancière mêle des éléments de son passé à bien
d'autres sources d'inspiration pour en faire une oeuvre de fiction. C'est peut-être aussi sa façon de traiter le problème de ces limites qu'elle a si joyeusement enjambées.
Car des limites, il en est question. Il y a d'abord ce barrage, que la mère a essayé de construire pour sauver les terres arables d'une vallée d'inondations d'eau salée. Femme de peu d'imagination, impulsive, ne prenant pas la peine de se documenter sérieusement sur ce qu'elle entreprend, elle y laisse ses économies, sa santé et son courage. Sa vie se casse sur un projet impossible. L'obstacle était frontière, une frontière infranchissable. Envers ses enfants, cette même mère était dominante, exigeante voir tyrannique. Elle leur faisait obstacle, était cette frontière qu'ils apprendront à franchir au fur et à mesure de son déclin. Pour franchir des obstacles, pour dépasser les limites, Il faut avoir du courage, oser, mais aussi avoir de l'imagination et de la chance. Marguerite, cette acrobate de la vie, avait tout cela en abondance. A-t-elle trouvé ce qu'elle cherchait ? Si oui, cela l'a-t-il comblée ? Comment savoir… ?
Ma première lecture de Marguerite Duras remonte à presque vingt ans. J'avais lu L'Amant suite à l'étude d'un extrait pour le bac ( j'étais même tombée dessus à l'oral). le souvenir que j'en garde se limite à des impressions dues au cadre de l'intrigue, l'Asie coloniale, la chaleur, l'atmosphère lourde, quelques visions de persiennes laissant filtrer les rayons du soleil et les clameurs de la rue mais aussi et surtout un profond ennui.
A l'occasion du centenaire Marguerite Duras, j'ai lu Un barrage contre le Pacifique et j'ai bien cru que j'en retirerai la même chose. D'une manière générale, j'ai trouvé ma lecture assez difficile, surtout au tout début. Il m'a fallu près de la moitié du roman pour me plonger dedans et m'adapter au style. J'étais assez perplexe, j'avais l'impression de lire un livre écrit à deux mains. Des passages au style pauvre et maladroit alternant avec des envolées de toute beauté. Les personnages sont au premier abord assez antipathiques et pas du tout attachants. Leur vulgarité et leur vénalité m'ont choquée presque plus que leur misérable condition et leur malchance.
La première moitié du roman se consacre principalement à mettre en place les personnages et leur situation : une femme ayant perdu très tôt son mari doit se débrouiller pour pourvoir à ses besoins et ceux de ses enfants. D'abord institutrice à sa venue en Indochine, elle a du trouver d'autres postes pour nourrir les siens et se constituer un petit capital. Ce capital, représentant une bonne dizaine d'années d'économies, elle décide de l'investir dans une concession qu'elle s'engage à mettre en valeur et à cultiver. Malheureusement, son terrain est régulièrement recouvert par de hautes marées rendant toute culture impossible. Sa mésaventure ne semble pas être un cas isolé mais plutôt une arnaque bien rôdée profitant aux agents du cadastre et à l'administration coloniale. La mère et ses enfants tentent de survivre comme ils peuvent et attendent.
Ce roman est celui de l'espoir et de l'attente, l'attente de l'événement qui viendra changer leur condition, le miracle qui leur permettra de partir et de vivre enfin. La mère se démène et s'entête : la construction des barrages, ses entreprises pour caser sa fille, toutes ses tentatives se soldent par des échecs. Mais elle persiste jusqu'à s'en rendre malade et son impuissance la mène jusqu'aux portes de la folie.
L'ennui que l'on peut ressentir à la lecture de cette première partie reflète celui de cette famille qui voit les jours passer dans cette même et pénible attente, dans la lenteur du temps qui s'écoule quotidiennement tantôt à l'ombre du bungalow, tantôt sous la chaleur écrasante du bord de piste.
Tous les détails relatifs à la vie dans la colonie sont passionnants. Marguerite Duras brosse un portrait de l'Indochine coloniale bien loin de toute vision idyllique : la corruption des fonctionnaires coloniaux, la misère des petits colons, celle des indigènes, la ségrégation géographique des villes coloniales. Elle se livre à une véritable étude sociologique de la population coloniale, des habitants permanents, des agents de passages, les colons qui ont su profiter de la manne coloniale : plantations de latex, de riz, marchands de textiles, diamantaires, ceux qui sont contraints au trafic pour survivre : contrebande d'alcool, trafic de l'opium … A travers le personnage du caporal, les indigènes ne sont pas oubliés : la faim, la prostitution, la forte mortalité des enfants, les maladies sont autant de calamités que les colons ne cherchent même pas à enrayer.
Je disais donc que j'avais eu des difficultés à prendre les personnages en sympathie. Hormis la mère, qui ne peut que susciter la compassion par sa force, son courage et son espoir obstiné, j'ai trouvé Suzanne, sa fille, et Joseph, son fils, effroyablement égoïstes, vulgaires et comme le dit également M.Jo : immoraux. Ils semblent se moquer des efforts de leur mère et ne cherchent leur salut que par la fuite. Joseph attend qu'une femme et l'amour l'emmènent loin de cette vie dont il ne veut plus. Suzanne attend patiemment le long de la route qu'une des rares voitures s'arrête pour s'enfuir à son bord. Elle refusera deux bons partis auxquels elle ne s'intéressera que par intérêt et pour réconforter sa mère.
Malgré tout, peut-on les blâmer au vu des conditions de vie qui sont les leurs ? Au fur et à mesure qu'on avance dans le roman, on finit par les comprendre et on se laisse attendrir. La plume de Marguerite Duras se fait plus assurée, plus constante, plus incisive et rageuse. La lettre de la mère aux agents du cadastre est un véritable bijou, un cri de colère délectable. La longueur des chapitres s'adapte au rythme des évènements et on ressent bien cette accélération dans la deuxième moitié du roman.
Le titre même du roman souligne le côté dérisoire de la situation : un seul petit barrage contre la force des flots d'un océan, reflet des efforts désespérés de la mère et qui semblent si insignifiants face aux obstacles de la vie : le pouvoir, les autorités, les éléments naturels, la société, la quête du bonheur, le dénuement matériel.
Au final, Un barrage contre le Pacifique est un roman qui déroute et qui nécessite, tout comme la mère, de la patience et de l'obstination pour découvrir derrière une façade d'ennui et de simplicité, un récit engagé dont l'inspiration autobiographique renforce la puissance et le tragique.
Lien : http://0z.fr/yGDpM
A l'occasion du centenaire Marguerite Duras, j'ai lu Un barrage contre le Pacifique et j'ai bien cru que j'en retirerai la même chose. D'une manière générale, j'ai trouvé ma lecture assez difficile, surtout au tout début. Il m'a fallu près de la moitié du roman pour me plonger dedans et m'adapter au style. J'étais assez perplexe, j'avais l'impression de lire un livre écrit à deux mains. Des passages au style pauvre et maladroit alternant avec des envolées de toute beauté. Les personnages sont au premier abord assez antipathiques et pas du tout attachants. Leur vulgarité et leur vénalité m'ont choquée presque plus que leur misérable condition et leur malchance.
La première moitié du roman se consacre principalement à mettre en place les personnages et leur situation : une femme ayant perdu très tôt son mari doit se débrouiller pour pourvoir à ses besoins et ceux de ses enfants. D'abord institutrice à sa venue en Indochine, elle a du trouver d'autres postes pour nourrir les siens et se constituer un petit capital. Ce capital, représentant une bonne dizaine d'années d'économies, elle décide de l'investir dans une concession qu'elle s'engage à mettre en valeur et à cultiver. Malheureusement, son terrain est régulièrement recouvert par de hautes marées rendant toute culture impossible. Sa mésaventure ne semble pas être un cas isolé mais plutôt une arnaque bien rôdée profitant aux agents du cadastre et à l'administration coloniale. La mère et ses enfants tentent de survivre comme ils peuvent et attendent.
Ce roman est celui de l'espoir et de l'attente, l'attente de l'événement qui viendra changer leur condition, le miracle qui leur permettra de partir et de vivre enfin. La mère se démène et s'entête : la construction des barrages, ses entreprises pour caser sa fille, toutes ses tentatives se soldent par des échecs. Mais elle persiste jusqu'à s'en rendre malade et son impuissance la mène jusqu'aux portes de la folie.
L'ennui que l'on peut ressentir à la lecture de cette première partie reflète celui de cette famille qui voit les jours passer dans cette même et pénible attente, dans la lenteur du temps qui s'écoule quotidiennement tantôt à l'ombre du bungalow, tantôt sous la chaleur écrasante du bord de piste.
Tous les détails relatifs à la vie dans la colonie sont passionnants. Marguerite Duras brosse un portrait de l'Indochine coloniale bien loin de toute vision idyllique : la corruption des fonctionnaires coloniaux, la misère des petits colons, celle des indigènes, la ségrégation géographique des villes coloniales. Elle se livre à une véritable étude sociologique de la population coloniale, des habitants permanents, des agents de passages, les colons qui ont su profiter de la manne coloniale : plantations de latex, de riz, marchands de textiles, diamantaires, ceux qui sont contraints au trafic pour survivre : contrebande d'alcool, trafic de l'opium … A travers le personnage du caporal, les indigènes ne sont pas oubliés : la faim, la prostitution, la forte mortalité des enfants, les maladies sont autant de calamités que les colons ne cherchent même pas à enrayer.
Je disais donc que j'avais eu des difficultés à prendre les personnages en sympathie. Hormis la mère, qui ne peut que susciter la compassion par sa force, son courage et son espoir obstiné, j'ai trouvé Suzanne, sa fille, et Joseph, son fils, effroyablement égoïstes, vulgaires et comme le dit également M.Jo : immoraux. Ils semblent se moquer des efforts de leur mère et ne cherchent leur salut que par la fuite. Joseph attend qu'une femme et l'amour l'emmènent loin de cette vie dont il ne veut plus. Suzanne attend patiemment le long de la route qu'une des rares voitures s'arrête pour s'enfuir à son bord. Elle refusera deux bons partis auxquels elle ne s'intéressera que par intérêt et pour réconforter sa mère.
Malgré tout, peut-on les blâmer au vu des conditions de vie qui sont les leurs ? Au fur et à mesure qu'on avance dans le roman, on finit par les comprendre et on se laisse attendrir. La plume de Marguerite Duras se fait plus assurée, plus constante, plus incisive et rageuse. La lettre de la mère aux agents du cadastre est un véritable bijou, un cri de colère délectable. La longueur des chapitres s'adapte au rythme des évènements et on ressent bien cette accélération dans la deuxième moitié du roman.
Le titre même du roman souligne le côté dérisoire de la situation : un seul petit barrage contre la force des flots d'un océan, reflet des efforts désespérés de la mère et qui semblent si insignifiants face aux obstacles de la vie : le pouvoir, les autorités, les éléments naturels, la société, la quête du bonheur, le dénuement matériel.
Au final, Un barrage contre le Pacifique est un roman qui déroute et qui nécessite, tout comme la mère, de la patience et de l'obstination pour découvrir derrière une façade d'ennui et de simplicité, un récit engagé dont l'inspiration autobiographique renforce la puissance et le tragique.
Lien : http://0z.fr/yGDpM
Un barrage contre le Pacifique, c'est l'histoire d'un vain travail herculéen, d'un châtiment digne de Sisyphe, le prix à payer pour un trop-plein de rêves et d'espoirs, pour un trop-peu d'argent qui, bien placé, aurait permis la fortune. C'est l'histoire d'une obstination et d'une défaite, celle de la mère, ancienne institutrice du nord de la France, attirée par les sirènes exotiques de la colonisation, qui tente avec son mari l'aventure indochinoise dans les années 20-30. Quinze ans d'économies investies dans l'acquisition d'une concession au bord de la mer de Chine. Investis, engloutis et perdus à jamais, car faute de pot-de-vin, l'administration leur a octroyé une parcelle stérile, noyée par l'eau salée à chaque mousson. Bientôt le mari meurt, laissant la mère seule au monde avec deux grands adolescents, Joseph et Suzanne.
Le récit commence peu après la tentative insensée (et avortée) de la mère de construire une digue pour protéger son lopin de la montée des eaux. La famille est désormais dans une misère noire, suant la rancoeur et le découragement dans cette ambiance suffocante infestée de moustiques. Il n'y a rien à faire, sauf attendre, le passage d'une belle femme dans sa belle auto, par hasard sur la piste déserte, qui emmènerait Joseph très loin, ou celui d'un homme riche, par hasard, qui voudrait épouser Suzanne. L'espoir renaît quand un jeune homme de bonne famille convoite Suzanne, mais on comprend bien vite que pour la jeune femme il ne sera pas question de sentiments, uniquement d'argent (qui a dit qu'il ne faisait pas le bonheur?), même s'il lui reste un peu de moralité qui la retient de se vendre totalement à lui.
Il ne se passe pas grand-chose dans ce roman (largement inspiré de l'histoire familiale de Duras) et on finit par ressentir ce qu'éprouvent les personnages : un mélange d'étouffement, d'agacement, d'apathie et d'impatience que quelque chose change. Peu de péripéties et beaucoup d'attente, ce qui n'empêche pas le texte d'être riche et complexe. Les thèmes sont nombreux : la corruption jusqu'à la moelle de l'administration coloniale ("un barrage contre le Pacifique c'est encore plus facile à faire tenir qu'à essayer de dénoncer votre ignominie"), la misère des colonisés et celle des colons trop pauvres ou pas assez audacieux pour se lancer dans la contrebande, l'injustice, les illusions perdues, le désespoir qui mène au bord de la folie ("Elle avait aimé démesurément la vie et c'était son espérance infatigable, incurable, qui en avait fait ce qu'elle était devenue, une désespérée de l'espoir même"). Une histoire d'envies d'ailleurs (la mère quittant la France, les jeunes rêvant de quitter la concession) et d'émancipation : il y a une sorte de fusion entre la mère et ses enfants, entre le frère et la soeur, telle qu'on se demande si, quand, comment ils vont devenir adultes, ou pas.
L'écriture est simple, fluide, et si les personnages n'ont rien de sympathique, on en vient à avoir pitié d'eux. Il n'est pas anodin que "la mère" n'ait pas de prénom, comme si le malheur et l'administration l'avaient déshumanisée. Alors c'est peut-être là que subsiste un brin d'espoir dans ce roman sombre, violent et désespérant : dans le fait que ses enfants aient un prénom.
Lien : https://voyagesaufildespages..
Le récit commence peu après la tentative insensée (et avortée) de la mère de construire une digue pour protéger son lopin de la montée des eaux. La famille est désormais dans une misère noire, suant la rancoeur et le découragement dans cette ambiance suffocante infestée de moustiques. Il n'y a rien à faire, sauf attendre, le passage d'une belle femme dans sa belle auto, par hasard sur la piste déserte, qui emmènerait Joseph très loin, ou celui d'un homme riche, par hasard, qui voudrait épouser Suzanne. L'espoir renaît quand un jeune homme de bonne famille convoite Suzanne, mais on comprend bien vite que pour la jeune femme il ne sera pas question de sentiments, uniquement d'argent (qui a dit qu'il ne faisait pas le bonheur?), même s'il lui reste un peu de moralité qui la retient de se vendre totalement à lui.
Il ne se passe pas grand-chose dans ce roman (largement inspiré de l'histoire familiale de Duras) et on finit par ressentir ce qu'éprouvent les personnages : un mélange d'étouffement, d'agacement, d'apathie et d'impatience que quelque chose change. Peu de péripéties et beaucoup d'attente, ce qui n'empêche pas le texte d'être riche et complexe. Les thèmes sont nombreux : la corruption jusqu'à la moelle de l'administration coloniale ("un barrage contre le Pacifique c'est encore plus facile à faire tenir qu'à essayer de dénoncer votre ignominie"), la misère des colonisés et celle des colons trop pauvres ou pas assez audacieux pour se lancer dans la contrebande, l'injustice, les illusions perdues, le désespoir qui mène au bord de la folie ("Elle avait aimé démesurément la vie et c'était son espérance infatigable, incurable, qui en avait fait ce qu'elle était devenue, une désespérée de l'espoir même"). Une histoire d'envies d'ailleurs (la mère quittant la France, les jeunes rêvant de quitter la concession) et d'émancipation : il y a une sorte de fusion entre la mère et ses enfants, entre le frère et la soeur, telle qu'on se demande si, quand, comment ils vont devenir adultes, ou pas.
L'écriture est simple, fluide, et si les personnages n'ont rien de sympathique, on en vient à avoir pitié d'eux. Il n'est pas anodin que "la mère" n'ait pas de prénom, comme si le malheur et l'administration l'avaient déshumanisée. Alors c'est peut-être là que subsiste un brin d'espoir dans ce roman sombre, violent et désespérant : dans le fait que ses enfants aient un prénom.
Lien : https://voyagesaufildespages..
Citations et extraits (143)
Voir plus
Ajouter une citation
C'était la grande époque. Des centaines de milliers de travailleurs indigènes saignaient les arbres des cent mille hectares de terres rouges, se saignaient à ouvrir les arbres des cent mille hectares des terres qui par hasard s'appelaient déjà rouges avant d'être la possession des quelques centaines de planteurs blancs aux colossales fortunes. Le latex coulait. Le sang aussi. Mais le latex seul était précieux, recueilli, et, recueilli, payait. Le sang se perdait. On évitait encore d'imaginer qu'il s'en trouverait un grand nombre pour venir un jour en demander le prix.
Dans le haut-quartier n'habitaient que les blancs qui avaient fait fortune. Pour marquer la mesure surhumaine de la démarche blanche, les rues et les trottoirs du haut-quartier étaient immenses. Un espace orgiaque, inutile était offert aux pas, négligents des puissants au repos. Et dans les avenues glissaient leurs autos caoutchoutées, suspendues, dans un demi-silence impressionnant.
Tout cela était asphalté, large, bordé de trottoirs plantés d'arbres rares et séparés en deux par des gazons et des parterres de fleurs le long desquels stationnaient les files rutilantes des taxis-torpédos. Arrosées plusieurs fois par jour, vertes, fleuries, ces rues étaient aussi bien entretenues que les allées d'un immense jardin zoologique où les espèces rares des blancs veillaient sur elles-mêmes. Le centre du haut-quartier était leur vrai sanctuaire. C'était au centre seulement qu'à l'ombre des tamariniers s'étalaient les immenses terrasses de leurs cafés. Là, le soir, ils se retrouvaient entre eux. Seuls les garçons de café étaient encore indigènes, mais déguisés en blancs, ils avaient été mis dans des smokings, de même qu'auprès d'eux les palmiers des terrasses étaient en pots. Jusque tard dans la nuit, installés dans des fauteuils en rotin derrière les palmiers et les garçons en pots et en smokings, on pouvait voir les blancs, suçant pernods, whisky-soda, ou martelperrier, se faire, en harnonie avec le reste, un foie bien colonial.
Tout cela était asphalté, large, bordé de trottoirs plantés d'arbres rares et séparés en deux par des gazons et des parterres de fleurs le long desquels stationnaient les files rutilantes des taxis-torpédos. Arrosées plusieurs fois par jour, vertes, fleuries, ces rues étaient aussi bien entretenues que les allées d'un immense jardin zoologique où les espèces rares des blancs veillaient sur elles-mêmes. Le centre du haut-quartier était leur vrai sanctuaire. C'était au centre seulement qu'à l'ombre des tamariniers s'étalaient les immenses terrasses de leurs cafés. Là, le soir, ils se retrouvaient entre eux. Seuls les garçons de café étaient encore indigènes, mais déguisés en blancs, ils avaient été mis dans des smokings, de même qu'auprès d'eux les palmiers des terrasses étaient en pots. Jusque tard dans la nuit, installés dans des fauteuils en rotin derrière les palmiers et les garçons en pots et en smokings, on pouvait voir les blancs, suçant pernods, whisky-soda, ou martelperrier, se faire, en harnonie avec le reste, un foie bien colonial.
Le soir tombait vraiment très vite dans ce pays. Dès que le soleil disparaissait derrière la montagne, les paysans allumaient des feux de bois vert pour se protéger des fauves et les enfants rentraient dans les cases en piaillant. Dès qu’ils étaient en âge de comprendre, on apprenait aux enfants à se méfier de la terrible nuit paludéenne et des fauves. Pourtant les tigres avaient bien moins faim que les enfants et ils en mangeaient très peu. En effet ce dont mouraient les enfants dans la plaine marécageuse de Kam, cernée d’un côté par la mer de Chine – que la mère d’ailleurs s’obstinait à nommer Pacifique, « mer de Chine » ayant a ses yeux quelque chose de provincial, et parce que jeune, c’était à l’océan Pacifique qu’elle avait rapporté ses rêves, et non à aucune des petites mers qui compliquent inutilement les choses – et murée vers l’Est par la très longue courbe descendante jusqu’au golfe de Siam où elle se noyait et réapparaissait encore en une multitude d’îles de plus en plus petites, mais toutes pareillement gonflées de la même sombre forêt tropicale, ce dont ils mouraient, ce n’était pas des tigres, c’était de la faim, des maladies de la faim et des aventures de la faim.
Il fait son Rudolf Valtino, disait-il, mais ce qui est triste, c'est qu'il a une tête plutôt dans le genre tête de veau.
(p.72)
C'était dans la zone située entre le haut quartier et les faubourgs indigènes que les blancs qui n'avaient pas fait fortune, les coloniaux indignes, se trouvaient relégués. Là, les rues étaient sans arbres, les pelouses disparaissaient.
(p.136)
Une vieille coloniale, Mme.Marthe, de soixante-cinq ans, venue en droite ligne d'un bordel du port, tenait l'Hotel Central. Elle avait une fille, Carmen, elle n'avait jamais pu savoir de qui et, n'ayant pas voulu lui réserver un sort pareil au sien, elle avait fait pendant les vingt ans de sa carrière des économies suffisantes pour acheter à la Société de l'Hotellerie coloniale la part d'actions qui lui avait valu la gérance de l'hôtel.
(p.137)
Carmen avait de la vie sa philosophie qui n'était pas amère, elle acceptait son sort, si l'on peut dire, d'un pied léger et elle se défendait farouchement de tout attachement qui aurait nui à son humeur. C'était une vraie fille de putain faite aux arrivées et aux départs incessants de ses compagnons, à la dureté du gain, à l'habitude d'une indépendance forcenée
(p.139)
Tant qu'il saurait la mère vivante, il ne pourrait d'ailleurs rien faire de bon dans la vie, rien entreprendre.
(p.225)
(p.72)
C'était dans la zone située entre le haut quartier et les faubourgs indigènes que les blancs qui n'avaient pas fait fortune, les coloniaux indignes, se trouvaient relégués. Là, les rues étaient sans arbres, les pelouses disparaissaient.
(p.136)
Une vieille coloniale, Mme.Marthe, de soixante-cinq ans, venue en droite ligne d'un bordel du port, tenait l'Hotel Central. Elle avait une fille, Carmen, elle n'avait jamais pu savoir de qui et, n'ayant pas voulu lui réserver un sort pareil au sien, elle avait fait pendant les vingt ans de sa carrière des économies suffisantes pour acheter à la Société de l'Hotellerie coloniale la part d'actions qui lui avait valu la gérance de l'hôtel.
(p.137)
Carmen avait de la vie sa philosophie qui n'était pas amère, elle acceptait son sort, si l'on peut dire, d'un pied léger et elle se défendait farouchement de tout attachement qui aurait nui à son humeur. C'était une vraie fille de putain faite aux arrivées et aux départs incessants de ses compagnons, à la dureté du gain, à l'habitude d'une indépendance forcenée
(p.139)
Tant qu'il saurait la mère vivante, il ne pourrait d'ailleurs rien faire de bon dans la vie, rien entreprendre.
(p.225)
[...] ... Il s'était de nouveau tourné vers la mère et il restait devant elle attendant toujours ce signe de paix qu'elle ne pouvait pas lui faire. Et il riait toujours. Son visage disait un tel bonheur qu'on ne le reconnaissait plus. Jamais personne, avant, même Suzanne, n'aurait pu croire ce visage si résolument fermé, capable de s'avouer, de se livrer avec une telle impudeur.
- "Merde," répétait Joseph, "je te le jure, je reviendrai, je laisse tout, même mes fusils
- Tu n'as plus besoin de tes fusils. Pars, Joseph."
Elle avait de nouveau fermé les yeux. Joseph la prit par les épaules et se mit à la secouer.
- "Puisque je te le jure, même si je voulais te laisser, je ne pourrais pas."
Elle était sûre qu'il partait pour toujours. Seul lui en doutait encore.
- "Embrasse-moi," dit la mère, " et pars."
Elle se laissait secouer par Joseph qui s'était mis à crier.
- "Dans les huit jours ! Quand vous aurez fini de m'emmerder ! Dans huit jours je serai revenu ! On dirait que vous ne me connaissez pas."
Il se tourna vers Suzanne.
- "Dis-lui, Nom de Dieu, dis-lui !
- T'en fais pas," dit Suzanne. "Dans huit jours, il sera là.
- Pars, Joseph," dit la mère.
Joseph se décida à aller dans sa chambre pour aller chercher ses affaires. L'auto attendait toujours, les phares éteints maintenant. Tiens, elle n'avait pas klaxonné une deuxième fois. Elle laissait du temps à Joseph, son temps. Elle savait que c'était difficile. Elle aurait attendu toute la nuit, c'était sûr, sans klaxonner une nouvelle fois.
Joseph revint chaussé de ses sandales de tennis. Il portait un paquet de linge qu'il avait dû préparer à l'avance. Il se précipita sur la mère, la souleva dans ses bras et l'embrassa de toutes ses forces, dans les cheveux. Il n'alla pas vers Suzanne mais il se força à la regarder et dans ses yeux il y avait de l'effroi et peut-être aussi de la honte. Puis brusquement, il passa entre elles et descendit les marches de l'escalier en courant. Les phares s'allumèrent peu après sur la piste, en direction de la ville. Puis l'auto démarra très doucement, sans qu'on l'entendît. Les phares se déplacèrent, s'éloignèrent encore, laissant derrière eux une marge toujours plus large de nuit, puis on ne vit plus rien.
La mère, les yeux fermés, était toujours dans la même position. Le bungalow était tellement silencieux que Suzanne pouvait entendre sa respiration rauque et désordonnée. ... [...]
- "Merde," répétait Joseph, "je te le jure, je reviendrai, je laisse tout, même mes fusils
- Tu n'as plus besoin de tes fusils. Pars, Joseph."
Elle avait de nouveau fermé les yeux. Joseph la prit par les épaules et se mit à la secouer.
- "Puisque je te le jure, même si je voulais te laisser, je ne pourrais pas."
Elle était sûre qu'il partait pour toujours. Seul lui en doutait encore.
- "Embrasse-moi," dit la mère, " et pars."
Elle se laissait secouer par Joseph qui s'était mis à crier.
- "Dans les huit jours ! Quand vous aurez fini de m'emmerder ! Dans huit jours je serai revenu ! On dirait que vous ne me connaissez pas."
Il se tourna vers Suzanne.
- "Dis-lui, Nom de Dieu, dis-lui !
- T'en fais pas," dit Suzanne. "Dans huit jours, il sera là.
- Pars, Joseph," dit la mère.
Joseph se décida à aller dans sa chambre pour aller chercher ses affaires. L'auto attendait toujours, les phares éteints maintenant. Tiens, elle n'avait pas klaxonné une deuxième fois. Elle laissait du temps à Joseph, son temps. Elle savait que c'était difficile. Elle aurait attendu toute la nuit, c'était sûr, sans klaxonner une nouvelle fois.
Joseph revint chaussé de ses sandales de tennis. Il portait un paquet de linge qu'il avait dû préparer à l'avance. Il se précipita sur la mère, la souleva dans ses bras et l'embrassa de toutes ses forces, dans les cheveux. Il n'alla pas vers Suzanne mais il se força à la regarder et dans ses yeux il y avait de l'effroi et peut-être aussi de la honte. Puis brusquement, il passa entre elles et descendit les marches de l'escalier en courant. Les phares s'allumèrent peu après sur la piste, en direction de la ville. Puis l'auto démarra très doucement, sans qu'on l'entendît. Les phares se déplacèrent, s'éloignèrent encore, laissant derrière eux une marge toujours plus large de nuit, puis on ne vit plus rien.
La mère, les yeux fermés, était toujours dans la même position. Le bungalow était tellement silencieux que Suzanne pouvait entendre sa respiration rauque et désordonnée. ... [...]
Videos de Marguerite Duras (249)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Marguerite Duras (95)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Marguerite DURAS
Quel est le bon titre de sa bibliographie ?
L'Homme assis dans le corridor
L'Homme assis dans le couloir
L'Homme assis dans le boudoir
L'Homme assis dans le fumoir
20 questions
190 lecteurs ont répondu
Thème :
Marguerite DurasCréer un quiz sur ce livre190 lecteurs ont répondu