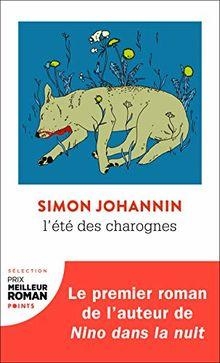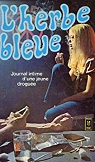Simon Johannin vient présenter son livre "Ici commence un amour", qui parle de l'amour, du vide laissé par ce dernier mais aussi de l'amour de soi. Dans le roman, Théo, le personnage principal, se lamente d'un amour qui se termine avec une jeune femme nommée Gloria. L'occasion pour lui d'envisager l'amour via un autre paradigme. Il se regarde, non plus à travers l'autre, mais à travers son propre regard, d'ordinaire très critique sur les choses qui l'entourent. Une manière pour lui de se questionner avec sincérité sur son évolution et sa place.
Pour Simon Johannin, le processus d'écriture a une dimension sensorielle. Il voit ça comme quelque chose de "charnel, presque sexuel". C'est une expérience de liberté dans laquelle il n'essaie pas uniquement de décrire, mais aussi de faire ressentir une expérience, un moment à travers des mots.
Retrouvez l'intégralité de l'interview ci-dessous :
https://www.france.tv/france-5/la-grande-librairie/

Simon Johannin
EAN : 9781030405843
Allia (05/01/2017)
/5
245 notesAllia (05/01/2017)
Résumé :
Ici c’est La Fourrière, un "village de nulle part" et c’est un enfant qui raconte : massacrer le chien de "la grosse conne de voisine", tuer le cochon avec les hommes du village, s’amuser au "jeu de l’arabe", rendre les coups et éviter ceux des parents.Ici on vit retiré, un peu hors-la-loi, pas loin de la misère aussi. Dans cette Guerre des boutons chez les rednecks, les bêtes sont partout, les enfants conduisent leurs parents ivres morts dans des voitures déglingué... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après L'été des charognesVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (47)
Voir plus
Ajouter une critique
L'été des charognes de Simon Johannin, décortique la décomposition de l'enfance dans une campagne rude et cruelle.
« J'ai grandi à La Fourrière, c'est le nom du bout de goudron qui finit en patte d'oie pleine de boue dans la forêt et meurt un peu plus loin après les premiers arbres. La Fourrière, c'est nulle part.
Le père il s'est mis là parce qu'il dit qu'au moins, à part ceux qui ont quelque chose à faire ici personne ne l'emmerde en passant sous ses fenêtres.
Il y a trois maisons, la mienne, celle de Jonas et sa famille et celle de la grosse conne qui a écrasé mon chat, celle à qui il était le chien qu'on a défoncé avec les pierres et qui vient que de temps en temps pour faire ses patates et pour faire chier. »
Ce qui frappe en premier lieu, c'est la violence brute qui s'exprime sur les animaux. Rien ne nous est épargné des miasmes et de la puanteur des corps en putréfaction. Pour cette famille d'éleveurs, pour qui l'élevage intensif et aseptisé n'est pas encore passé par là, il n'y a rien de plus naturel. La violence est quotidienne, et elle ne se contente pas d'être animale. Les coups tombent facilement : pas de temps pour la négociation, sauf si elle est commerciale, car il faut bien vivre de ses bêtes.
Les gamins doivent filer droit. Leur liberté, ils la trouveront dans les champs à jouer avec des cadavres, ou en collectionnant les plus beaux os qu'ils trouveront, peu importe les corps dont ils proviennent...
L'ambiance âpre de désolation est prégnante à travers les odeurs immondes, et les excréments. On se lave quand on peut, dans la rivière ou dans la ferme s'il reste de l'eau après avoir abreuver les animaux. On se rassure en humiliant ceux qui sont différents : les « gueux », ou les musulmans dont on se moque en jouant à « l'Arabe », beaucoup moins quand il s'agit de leur vendre des moutons.
Les gamins grandissent et mettent du Scorpion pour masquer les odeurs pestilentielles. Ils prennent le car scolaire qui les emmènera chez les grands, mais qui pue autant que l'équarrisseur quand il passe devant les usines de la région.
Dans ses « localités en fin de vie », dont ils en sont les « bouseux », on abat, dépèce et plume, « imprégnés de cette odeur de charogne » et au son du bruit des viscères qui tombent et du « cri que fait le sang quand il coule ». Heureusement il y a des moments de convivialité et de solidarité, même si les enfants finissent souvent par raccompagner leurs parent soûls comme des « bêtes molles dans du formol » en conduisant eux-mêmes les voitures sur les chemins vicinaux.
Un récit âpre et rude, presque infesté d'une atmosphère vénéneuse, qui ne peut qu'être conseillé à un public averti. Pourtant, c'est une écriture lumineuse qui éclaire sa lecture d'une poésie noire mais jubilatoire. le narrateur voit son enfance partir en fumée dans les effluves pestilentielles d'un monde en décomposition entre « les bêtes, les champs, et les cuites » et part se réchauffer au soleil de l'amour :
« Sont sortis partout de nous de l'énergie et des liquides, et sa mâchoire dictait la pulsation. Je suis tombé du bord du monde dans son odeur d'envoûtement, je suis allé et venu dans le noeud sous sa peau, j'ai pris le jus sur sa langue et avalé l'eau dans sa bouche, courbé le mouvement de sa nuque sur un rythme qui nous venait de ce qu'il y a derrière le désir.
Elle m'a traversé comme une cascade de lumière. »
L'occasion de découvrir la prose poétique de ce jeune auteur Simon Johannin, dans son premier roman, qui, s'il n'invente rien dans le genre du roman noir, le magnifie d’un style unique et poétique. Aussi hallucinée que lucide, son écriture prendra encore de l'ampleur avec Nino dans la nuit, co-écrit avec sa femme Capucine. Une plume acérée dans une encre vibrante à découvrir assurément.
« J'ai grandi à La Fourrière, c'est le nom du bout de goudron qui finit en patte d'oie pleine de boue dans la forêt et meurt un peu plus loin après les premiers arbres. La Fourrière, c'est nulle part.
Le père il s'est mis là parce qu'il dit qu'au moins, à part ceux qui ont quelque chose à faire ici personne ne l'emmerde en passant sous ses fenêtres.
Il y a trois maisons, la mienne, celle de Jonas et sa famille et celle de la grosse conne qui a écrasé mon chat, celle à qui il était le chien qu'on a défoncé avec les pierres et qui vient que de temps en temps pour faire ses patates et pour faire chier. »
Ce qui frappe en premier lieu, c'est la violence brute qui s'exprime sur les animaux. Rien ne nous est épargné des miasmes et de la puanteur des corps en putréfaction. Pour cette famille d'éleveurs, pour qui l'élevage intensif et aseptisé n'est pas encore passé par là, il n'y a rien de plus naturel. La violence est quotidienne, et elle ne se contente pas d'être animale. Les coups tombent facilement : pas de temps pour la négociation, sauf si elle est commerciale, car il faut bien vivre de ses bêtes.
Les gamins doivent filer droit. Leur liberté, ils la trouveront dans les champs à jouer avec des cadavres, ou en collectionnant les plus beaux os qu'ils trouveront, peu importe les corps dont ils proviennent...
L'ambiance âpre de désolation est prégnante à travers les odeurs immondes, et les excréments. On se lave quand on peut, dans la rivière ou dans la ferme s'il reste de l'eau après avoir abreuver les animaux. On se rassure en humiliant ceux qui sont différents : les « gueux », ou les musulmans dont on se moque en jouant à « l'Arabe », beaucoup moins quand il s'agit de leur vendre des moutons.
Les gamins grandissent et mettent du Scorpion pour masquer les odeurs pestilentielles. Ils prennent le car scolaire qui les emmènera chez les grands, mais qui pue autant que l'équarrisseur quand il passe devant les usines de la région.
Dans ses « localités en fin de vie », dont ils en sont les « bouseux », on abat, dépèce et plume, « imprégnés de cette odeur de charogne » et au son du bruit des viscères qui tombent et du « cri que fait le sang quand il coule ». Heureusement il y a des moments de convivialité et de solidarité, même si les enfants finissent souvent par raccompagner leurs parent soûls comme des « bêtes molles dans du formol » en conduisant eux-mêmes les voitures sur les chemins vicinaux.
Un récit âpre et rude, presque infesté d'une atmosphère vénéneuse, qui ne peut qu'être conseillé à un public averti. Pourtant, c'est une écriture lumineuse qui éclaire sa lecture d'une poésie noire mais jubilatoire. le narrateur voit son enfance partir en fumée dans les effluves pestilentielles d'un monde en décomposition entre « les bêtes, les champs, et les cuites » et part se réchauffer au soleil de l'amour :
« Sont sortis partout de nous de l'énergie et des liquides, et sa mâchoire dictait la pulsation. Je suis tombé du bord du monde dans son odeur d'envoûtement, je suis allé et venu dans le noeud sous sa peau, j'ai pris le jus sur sa langue et avalé l'eau dans sa bouche, courbé le mouvement de sa nuque sur un rythme qui nous venait de ce qu'il y a derrière le désir.
Elle m'a traversé comme une cascade de lumière. »
L'occasion de découvrir la prose poétique de ce jeune auteur Simon Johannin, dans son premier roman, qui, s'il n'invente rien dans le genre du roman noir, le magnifie d’un style unique et poétique. Aussi hallucinée que lucide, son écriture prendra encore de l'ampleur avec Nino dans la nuit, co-écrit avec sa femme Capucine. Une plume acérée dans une encre vibrante à découvrir assurément.
La Fourrière. C'est ici que je vis. Un hameau au bout d'une route qui finit en patte d'oie. Au moins ici, on est tranquille. C'est pour ça que le père s'est installé ici. Juste trois maisons : la mienne, celle de mon ami, Jonas, et de la grosse conne. Celle-là même qui a écrasé mon chat. du coup, pour se venger avec Jonas, on lui a buté son chien. À coups de pierre jusqu'à ce qu'il crève. de toute façon, des chiens, il y en a au moins une douzaine au hameau. Agressifs, en plus. Une vraie meute qui gueule sans arrêt. Une fois à la maison, il y avait mon père dans le jardin, en train de cuire des côtes de porc. le barbecue, l'été, c'est tous les jours. Pour éviter qu'il y ait trop de mouches dans la maison. L'été ne faisait que commencer et on allait bientôt plus pouvoir se baigner dans le ruisseau à cause des brebis que les chiens du hameau, rien qu'en gueulant, avaient tuées...
À l'instar de la couverture, Simon Johannin nous livre un roman profondément sombre, cruel et fangeux. À La Fourrière, le pays de nulle part, les gamins, livrés à eux-mêmes, collectionnent les os trouvés au cimetière, jouent au jeu de l'Arabe, squattent chez la seule voisine qui a la télé, tuent les agneaux, martyrisent les animaux ou ramènent leurs parents bourrés pour conduire. L'on est plongé dans une atmosphère glauque, violente, brumeuse et misérable. L'on a les pieds dans les merdes de chien ou la boue. L'on pourrait presque sentir ces odeurs de charognes bourdonnantes ou ces fumées noires des usines de croquettes pour chiens. Ce roman est divisé en deux parties bien distinctes : la première narre avec âpreté et rudesse l'enfance du narrateur au milieu des charognes ; la seconde évoque l'adolescence. L'écriture est à la fois poétique, dure et râpeuse. Un premier roman saisissant, sauvage et brut.
À l'instar de la couverture, Simon Johannin nous livre un roman profondément sombre, cruel et fangeux. À La Fourrière, le pays de nulle part, les gamins, livrés à eux-mêmes, collectionnent les os trouvés au cimetière, jouent au jeu de l'Arabe, squattent chez la seule voisine qui a la télé, tuent les agneaux, martyrisent les animaux ou ramènent leurs parents bourrés pour conduire. L'on est plongé dans une atmosphère glauque, violente, brumeuse et misérable. L'on a les pieds dans les merdes de chien ou la boue. L'on pourrait presque sentir ces odeurs de charognes bourdonnantes ou ces fumées noires des usines de croquettes pour chiens. Ce roman est divisé en deux parties bien distinctes : la première narre avec âpreté et rudesse l'enfance du narrateur au milieu des charognes ; la seconde évoque l'adolescence. L'écriture est à la fois poétique, dure et râpeuse. Un premier roman saisissant, sauvage et brut.
Un livre voulu noir, comme un profond ravin.
Ils se tiennent à son bord, sans savoir.
Un gouffre à chiens; rempli de carcasses de métal ou de calcium.
N'oubliez pas qu'ils sont avant tout charognards.
La morale n'est qu'une poudre d'os, envolée sans avoir existé.
On pourrait juger, c'est leur premier, mais tout vient rapidement se troubler, comme une nausée imposée.
…
L'ombre de mon vieil ami Petit Mat imprimée sur le creux du Vernoubre, où les truites ne viennent plus; il savait les attraper en les caressant, la main sous les ouïes, souriant timidement de ses dents pourries. Une jeunesse passée dans l'ombre de cette Montagne Noire, ventée et sans sommet. Des semaines poisseuses à attendre leurs fins, une photocopie dans la poche, l'InfoLine de la free-party comme futur enviable. On y allait, camion baladé vers les étoiles… mais lui n'en est jamais vraiment reparti.
…
Simon est plus jeune. On l'a peut-être aperçu, sous une capuche, derrière une cigarette ou un feu; plus tard, sûrement, parmi ces artistes qui veulent en apprendre, au creuset de la Cambre, moi qui pestait, partant embaucher dans cette usine à eurocrates, servant à leur ivresse convenue, muni de mon sourire tarifé, en équipe avec celles et ceux qui n'avaient pas réussi, malgré leurs talents, rétifs à ces photographies dignes de magazines; moins beaux, sûrement; que la jalousie rend encore plus répugnants.
…
Elle et Lui écrivent ensemble. Ils sont très beaux. Ils ont raison d'être suspects, on ne peut pas faire autrement. Les excès leur sont pardonnés, trop faciles à détester; tous ces vêtements, soignés ou imposés; cet éditeur, cérébral et branché; le reste pour être imaginé.
…
Ecris, jeunesse !, même si tu est incomprise. Les autres ont tout oublié.
Ce livre n'est pas « trop littéraire ». Les autres vous tireront vers le bas, vers une romance inacceptable qu'on ne peut qu'accepter, forcée de se montrer sans dénigrer. Donne-leur ce qu'ils attendent, choqués avant tout par cette souffrance animale . Inconsciente d'être seule.
…
Allusives, car faites de sentiments contradictoires, ces phrases se prêtent au jeu de la critique, sauvant ce qu'il reste de ces pages saturées d'immondices, de ce chien qui se contente des charognes qu'on lui laisse; voulant grandir, avide de ces quelques instants d'éternité, où le bonheur prend les couleurs d'un buvard de LSD.
…
Reflux coagulés de nos jeunesses cristallisés, la violence comme seule différence, son absence comme meilleure chance. La bienveillance située dans ces poulets courant toujours sans leurs têtes; poisseuse de sang, de plumes et de poils; grouillante de vies et de morts. Innocence perdue dans le regard des autres.
…
Lecture ultra-contrastée, ambivalence de la méfiance, sordidité excessive ? Doit-on vraiment tout contextualiser ? Ce couple de regards à la mode responsable de cette déification de papier glacé ?
Alors qu'on ne devrait que leur souhaiter l'amour et la réussite… Tous les autres, errant, les yeux vagues, âmes-chienne perdues le long d'un canal ou d'une voie ferrée, ce passage de la fin de l'été à jamais disparu.
Ils se tiennent à son bord, sans savoir.
Un gouffre à chiens; rempli de carcasses de métal ou de calcium.
N'oubliez pas qu'ils sont avant tout charognards.
La morale n'est qu'une poudre d'os, envolée sans avoir existé.
On pourrait juger, c'est leur premier, mais tout vient rapidement se troubler, comme une nausée imposée.
…
L'ombre de mon vieil ami Petit Mat imprimée sur le creux du Vernoubre, où les truites ne viennent plus; il savait les attraper en les caressant, la main sous les ouïes, souriant timidement de ses dents pourries. Une jeunesse passée dans l'ombre de cette Montagne Noire, ventée et sans sommet. Des semaines poisseuses à attendre leurs fins, une photocopie dans la poche, l'InfoLine de la free-party comme futur enviable. On y allait, camion baladé vers les étoiles… mais lui n'en est jamais vraiment reparti.
…
Simon est plus jeune. On l'a peut-être aperçu, sous une capuche, derrière une cigarette ou un feu; plus tard, sûrement, parmi ces artistes qui veulent en apprendre, au creuset de la Cambre, moi qui pestait, partant embaucher dans cette usine à eurocrates, servant à leur ivresse convenue, muni de mon sourire tarifé, en équipe avec celles et ceux qui n'avaient pas réussi, malgré leurs talents, rétifs à ces photographies dignes de magazines; moins beaux, sûrement; que la jalousie rend encore plus répugnants.
…
Elle et Lui écrivent ensemble. Ils sont très beaux. Ils ont raison d'être suspects, on ne peut pas faire autrement. Les excès leur sont pardonnés, trop faciles à détester; tous ces vêtements, soignés ou imposés; cet éditeur, cérébral et branché; le reste pour être imaginé.
…
Ecris, jeunesse !, même si tu est incomprise. Les autres ont tout oublié.
Ce livre n'est pas « trop littéraire ». Les autres vous tireront vers le bas, vers une romance inacceptable qu'on ne peut qu'accepter, forcée de se montrer sans dénigrer. Donne-leur ce qu'ils attendent, choqués avant tout par cette souffrance animale . Inconsciente d'être seule.
…
Allusives, car faites de sentiments contradictoires, ces phrases se prêtent au jeu de la critique, sauvant ce qu'il reste de ces pages saturées d'immondices, de ce chien qui se contente des charognes qu'on lui laisse; voulant grandir, avide de ces quelques instants d'éternité, où le bonheur prend les couleurs d'un buvard de LSD.
…
Reflux coagulés de nos jeunesses cristallisés, la violence comme seule différence, son absence comme meilleure chance. La bienveillance située dans ces poulets courant toujours sans leurs têtes; poisseuse de sang, de plumes et de poils; grouillante de vies et de morts. Innocence perdue dans le regard des autres.
…
Lecture ultra-contrastée, ambivalence de la méfiance, sordidité excessive ? Doit-on vraiment tout contextualiser ? Ce couple de regards à la mode responsable de cette déification de papier glacé ?
Alors qu'on ne devrait que leur souhaiter l'amour et la réussite… Tous les autres, errant, les yeux vagues, âmes-chienne perdues le long d'un canal ou d'une voie ferrée, ce passage de la fin de l'été à jamais disparu.
L'été qui se finit…avec l'évocation d'un fléau qui hante décidément des jeunes écrivains.
Sur fond du thème de l'enfance, dans leur premier roman, avec sans doute les émotions qui marquent au fer rouge, et qui les inspire…
Comme dans ce premier roman, publié en 2017, écrit par Simon Johannin, alors âgé de 23 ans, un fléau qui couve et va accompagner le passage d'une enfance rurale dans un hameau au bout d'une route, vers l'âge adulte ; qui prend corps avec le narrateur et sa bande de copains, turbulente, et plutôt désoeuvrée.
J'ai voulu relire ce journal intime - du début de ce siècle mais…- qui démarre dans « ce village de nulle part » du Sud-Ouest. Dans une atmosphère de violence.
Le quotidien à la ferme. Les animaux. Leurs jeux sauvages. Pas de règles. La vie dehors. Des enfants qui mûrissent, libres d'une certaine façon… Cet espace de liberté, l'auteur semble l'avoir puisé dans les souvenirs de sa propre enfance.
Une réalité crue : la misère ambiante et la précarité, avec l'alcool qui embrume le cerveau, l'âpreté et la rudesse des relations parents-enfants; la trivialité de la vie.
La crasse. Les odeurs de putréfaction.
Cela peut faire penser à la vie des rednecks du sud-américain dans « le Seigneur de porcheries ». On y tue le cochon aussi. On se bat, on rend les coups et on essaie d'éviter ceux des parents.
Des passages avec un peu de lumière, avec un peu de grâce. Système D pour s'en sortir.
L'enfance se dissout. Après la campagne, la ville. Les années collège sans Nike avec ses confrontations. Les filles. La drogue. L'ennui. Arrivent les grosses bêtises. La ville où tout se délite. Les angoisses de l'avenir. le délire avec les obsessions. La déchéance.
Des scènes brutales, servies par un style direct, rude où les phrases sont courtes et où les mots se bousculent. le parler d'un enfant sans fil directeur. Les touches d'humour s'effacent. Des changements de rythme qui déroutent. Vers des rêves hallucinés.
Cela prend à la gorge. On en ressort avec des sentiments contradictoires. Des interrogations sur le sens donné par l'auteur que je n'ai toujours pas résolues.
Sur fond du thème de l'enfance, dans leur premier roman, avec sans doute les émotions qui marquent au fer rouge, et qui les inspire…
Comme dans ce premier roman, publié en 2017, écrit par Simon Johannin, alors âgé de 23 ans, un fléau qui couve et va accompagner le passage d'une enfance rurale dans un hameau au bout d'une route, vers l'âge adulte ; qui prend corps avec le narrateur et sa bande de copains, turbulente, et plutôt désoeuvrée.
J'ai voulu relire ce journal intime - du début de ce siècle mais…- qui démarre dans « ce village de nulle part » du Sud-Ouest. Dans une atmosphère de violence.
Le quotidien à la ferme. Les animaux. Leurs jeux sauvages. Pas de règles. La vie dehors. Des enfants qui mûrissent, libres d'une certaine façon… Cet espace de liberté, l'auteur semble l'avoir puisé dans les souvenirs de sa propre enfance.
Une réalité crue : la misère ambiante et la précarité, avec l'alcool qui embrume le cerveau, l'âpreté et la rudesse des relations parents-enfants; la trivialité de la vie.
La crasse. Les odeurs de putréfaction.
Cela peut faire penser à la vie des rednecks du sud-américain dans « le Seigneur de porcheries ». On y tue le cochon aussi. On se bat, on rend les coups et on essaie d'éviter ceux des parents.
Des passages avec un peu de lumière, avec un peu de grâce. Système D pour s'en sortir.
L'enfance se dissout. Après la campagne, la ville. Les années collège sans Nike avec ses confrontations. Les filles. La drogue. L'ennui. Arrivent les grosses bêtises. La ville où tout se délite. Les angoisses de l'avenir. le délire avec les obsessions. La déchéance.
Des scènes brutales, servies par un style direct, rude où les phrases sont courtes et où les mots se bousculent. le parler d'un enfant sans fil directeur. Les touches d'humour s'effacent. Des changements de rythme qui déroutent. Vers des rêves hallucinés.
Cela prend à la gorge. On en ressort avec des sentiments contradictoires. Des interrogations sur le sens donné par l'auteur que je n'ai toujours pas résolues.
Le Nature writing français bien trash
*
Un roman noir violent et cru.
Voilà les 2 adjectifs qui me viennent immédiatement à l'esprit à l'évocation de cette lecture.
Ce livre, de format court, n'est pas à mettre entre toutes les mains. Je le conseillerais plutôt à des lecteurs aguerris aux scènes dérangeantes. Ce n'est pas un polar , pas de crime à l'horizon, pas (trop) de sang mais alors de la chair il y en a à profusion!
Même moi qui ai l'habitude de "trifouiller" dans les viscères, de ramasser le vomi et autres liquides organiques (infirmière en digestif, ça ne s'explique pas:), j'ai eu besoin de quelques moments d'accommodation à ces phrases trop/très suggestives.
Le style est poétique (malgré le sujet), tout en finesse et sensibilité. L'auteur ne mâche pas ses mots. Il les expose sur le papier sans filtres, sans ornements.
Attention aussi aux lecteurs sensibles à la cause des animaux car dès la première page, vous appellerez la SPA ! Ici , les charognes sont reines, cela déborde de partout. Et pourtant, il y a du respect envers ceux-ci (c'est subtil).
Et les enfants? Elevés comme des animaux domestiques, toujours en quête de jeux sauvages, nourris à la viande, fessés au moindre regard de travers.
La première partie évoque surtout les premières années du jeune garçon. Ses parties de jeux avec ses voisins (ils collectionnent tous types d'ossements même humains !), la débrouille dans cette cambrousse remplie de crasse mais aussi élevé à l'amour "je t'aime moi non plus" de ses parents. Puis l'adolescence à la ville où tout se délite.
*
Un récit que j'ai dévoré presque comme le gamin qui mastique et engloutit son bout de méchoui. Oui, c'est une pépite qui fracasse sec. Du lourd qui t'en met plein les mirettes et te donne la nausée. Les bêtes, la crasse, l'alcool mais aussi l'amour. C'est brutal et beau à la fois.
Puissant et évocateur (je l'ai déjà souligné mais j'insiste!)
Et puis l'édition Allia l'a proposé dans un bel écrin noir. What else?
Un auteur à suivre donc....
* Lu dans le cadre du challenge #theblacknovember
*
Un roman noir violent et cru.
Voilà les 2 adjectifs qui me viennent immédiatement à l'esprit à l'évocation de cette lecture.
Ce livre, de format court, n'est pas à mettre entre toutes les mains. Je le conseillerais plutôt à des lecteurs aguerris aux scènes dérangeantes. Ce n'est pas un polar , pas de crime à l'horizon, pas (trop) de sang mais alors de la chair il y en a à profusion!
Même moi qui ai l'habitude de "trifouiller" dans les viscères, de ramasser le vomi et autres liquides organiques (infirmière en digestif, ça ne s'explique pas:), j'ai eu besoin de quelques moments d'accommodation à ces phrases trop/très suggestives.
Le style est poétique (malgré le sujet), tout en finesse et sensibilité. L'auteur ne mâche pas ses mots. Il les expose sur le papier sans filtres, sans ornements.
Attention aussi aux lecteurs sensibles à la cause des animaux car dès la première page, vous appellerez la SPA ! Ici , les charognes sont reines, cela déborde de partout. Et pourtant, il y a du respect envers ceux-ci (c'est subtil).
Et les enfants? Elevés comme des animaux domestiques, toujours en quête de jeux sauvages, nourris à la viande, fessés au moindre regard de travers.
La première partie évoque surtout les premières années du jeune garçon. Ses parties de jeux avec ses voisins (ils collectionnent tous types d'ossements même humains !), la débrouille dans cette cambrousse remplie de crasse mais aussi élevé à l'amour "je t'aime moi non plus" de ses parents. Puis l'adolescence à la ville où tout se délite.
*
Un récit que j'ai dévoré presque comme le gamin qui mastique et engloutit son bout de méchoui. Oui, c'est une pépite qui fracasse sec. Du lourd qui t'en met plein les mirettes et te donne la nausée. Les bêtes, la crasse, l'alcool mais aussi l'amour. C'est brutal et beau à la fois.
Puissant et évocateur (je l'ai déjà souligné mais j'insiste!)
Et puis l'édition Allia l'a proposé dans un bel écrin noir. What else?
Un auteur à suivre donc....
* Lu dans le cadre du challenge #theblacknovember
critiques presse (5)
Un portrait saisissant de la France des invisibles.
Lire la critique sur le site : Bedeo
Pour sa première bande dessinée, Sylvain Bordesoules propose une vraie claque. Une lecture qui vous prend aux tripes et vous reste des jours durant, par sa justesse, sa violence, sa vision.
Lire la critique sur le site : BoDoi
Mais au-delà de sa cruauté, le propos, servi par un habile jeu de couleurs, résonne aussi comme un appel convaincant et poétique au pardon et à la rédemption.
Lire la critique sur le site : LeMonde
Si le thème n’est pas loin de ceux de Marie-Hélène Lafon, c’est avec la prose du Richard Millet de la Gloire des Pythres, ou celle du Règne animal de Del Amo que L’Été des charognes a le plus de proximité.
Lire la critique sur le site : Actualitte
Ce premier roman d'un jeune homme talentueux (né en 1993), Simon Johannin, est âpre et violent, douloureux mais singulièrement beau et bouleversant à bien des égards.
Lire la critique sur le site : Actualitte
Citations et extraits (61)
Voir plus
Ajouter une citation
On s'apprenait la vie comme on apprend l'anglais en faisant des maladresses, ça nous faisait briller les dents de rire, ça faisait une galaxie à deux bouches entre les poteaux de fer et le vieil asphalte.
La Terre a tremblé dans mon crâne quand elle m'a dit son prénom.
Elle était mon apparition à moi. Lou. J'étais comme une batterie d'artillerie, je crachais du feu sur le trottoir rouge. C'est elle qui un jour a décidé que ça serait comme ça, qu'elle et moi on allait baiser.
Soit on ouvrait son box du dortoir et on faisait ça par terre ou sur le bureau, soit dans les douches ou sur le matelas, mais aussi dans les parcs, ou derrière les voitures, ou dans les ascenseurs et les parkings et les halls d'immeubles, et les abribus ou sur des poubelles et dans les cabines d'essayage et les fumoirs des boîtes de nuit ou les galeries marchandes et les toilettes publiques, les aires de jeux pour enfants. J'aimais l'observer sans qu'elle le sache, je nageais dans un grand cliché.
Page 115, Allia, 2017.
La Terre a tremblé dans mon crâne quand elle m'a dit son prénom.
Elle était mon apparition à moi. Lou. J'étais comme une batterie d'artillerie, je crachais du feu sur le trottoir rouge. C'est elle qui un jour a décidé que ça serait comme ça, qu'elle et moi on allait baiser.
Soit on ouvrait son box du dortoir et on faisait ça par terre ou sur le bureau, soit dans les douches ou sur le matelas, mais aussi dans les parcs, ou derrière les voitures, ou dans les ascenseurs et les parkings et les halls d'immeubles, et les abribus ou sur des poubelles et dans les cabines d'essayage et les fumoirs des boîtes de nuit ou les galeries marchandes et les toilettes publiques, les aires de jeux pour enfants. J'aimais l'observer sans qu'elle le sache, je nageais dans un grand cliché.
Page 115, Allia, 2017.
Il faut s'asseoir en mangeant les odeurs qui font tourner la tête, et surtout fermer sa gueule car on ne parle pas à table nous les enfants.
On se contient tant que ça dure. On bouge les pieds en sous-marin pour ne pas être repérés dans le grand calme qui doit régner pendant qu'ils parlent au-dessus de nous, de la journée, des problèmes ou de ceux qui font la même chose dans la maison d'à côté. Du mal qu'ils ont dans le dos à force d'emmener tous les jours leur grosse existence au travail, et des échardes et des dards qu'ils ont dans les mains et qu'il faudra enlever avec une pince après le repas. Et nous on brûle de mordre et défoncer la viande, d'exploser la soupe mais on attend. On la ferme en bougeant des pieds sans faire trembler la table, sinon torgnole.
Page 74, Allia, 2017.
On se contient tant que ça dure. On bouge les pieds en sous-marin pour ne pas être repérés dans le grand calme qui doit régner pendant qu'ils parlent au-dessus de nous, de la journée, des problèmes ou de ceux qui font la même chose dans la maison d'à côté. Du mal qu'ils ont dans le dos à force d'emmener tous les jours leur grosse existence au travail, et des échardes et des dards qu'ils ont dans les mains et qu'il faudra enlever avec une pince après le repas. Et nous on brûle de mordre et défoncer la viande, d'exploser la soupe mais on attend. On la ferme en bougeant des pieds sans faire trembler la table, sinon torgnole.
Page 74, Allia, 2017.
J'étais assis à caresser un chat qui passait, et je les regardais tous les deux se parler doucement les yeux dans les yeux les mains dans la graisse du cochon. J'étais content qu'elle soit rentrée ma mère, ça mettait un peu de douceur et de sérieux dans l'oxygène, ça faisait stable autour, c'était de nouveau la sécurité du silence.
Ma mère elle a pas beaucoup de mots qui lui sortent de la bouche, elle nous fait plutôt des regards. Elle parle avec son visage et moi et mon frère on comprend tout.
Elle a des yeux fatigués comme des amandes sèches, pour dire des choses elle regarde et nous autour on sait qu'il faut pas l'emmerder ou glisser du couloir vers la chambre.
Ses bras il y a de la lassitude dedans mais ils sont jolis quand même, ils pèsent un peu gris. Parfois elle dit oui ou elle dit non, elle a toujours ce qu'elle veut parce que c'est le plus juste, se tromper elle sait pas faire.
Pages 39-40, Allia, 2017.
Ma mère elle a pas beaucoup de mots qui lui sortent de la bouche, elle nous fait plutôt des regards. Elle parle avec son visage et moi et mon frère on comprend tout.
Elle a des yeux fatigués comme des amandes sèches, pour dire des choses elle regarde et nous autour on sait qu'il faut pas l'emmerder ou glisser du couloir vers la chambre.
Ses bras il y a de la lassitude dedans mais ils sont jolis quand même, ils pèsent un peu gris. Parfois elle dit oui ou elle dit non, elle a toujours ce qu'elle veut parce que c'est le plus juste, se tromper elle sait pas faire.
Pages 39-40, Allia, 2017.
On est partis comme ça du devant de l'auberge chacun debout derrière le volant sous une belle grosse Lune, nos petits phares allumés en direction de la nuit qu'on allait suivre pour rentrer chez nous.
C'est souvent comme ça qu'on fait. Quand les parents sont bien trop bourrés, ils démarrent juste les autos en première et les enfants conduisent, comme ça c'est moins dangereux et nous ça va on aime bien conduire comme les distances sont pas très grandes. Sauf pendant les fêtes de village en bas, où là quand on les ramène c'est comme si on faisait une opération escargot, même que c'est très drôle de voir la tête des gens qui nous doublent quand ils nous voient conduire avec nos parents ivres morts la tête qui pend hors de la vitre.
Pages 32-33, Allia, 2017.
C'est souvent comme ça qu'on fait. Quand les parents sont bien trop bourrés, ils démarrent juste les autos en première et les enfants conduisent, comme ça c'est moins dangereux et nous ça va on aime bien conduire comme les distances sont pas très grandes. Sauf pendant les fêtes de village en bas, où là quand on les ramène c'est comme si on faisait une opération escargot, même que c'est très drôle de voir la tête des gens qui nous doublent quand ils nous voient conduire avec nos parents ivres morts la tête qui pend hors de la vitre.
Pages 32-33, Allia, 2017.
Les mouches, elles sont partout, elles font des guirlandes à travers les pièces le long des fils collants qu'on a installés là pour les piéger, et il y en a tellement qu'on voit très vite plus les fils. C'est comme des gros câbles noirs qui vibrent jusqu'à ce que tout le monde soit mort dessus. Il y en a partout, un bourdonnement sourd qui s'arrête jamais et qui le rend fou mon père alors c'est des grillades au jardin tous les jours.
Dans la maison elles sont même dans les penderies et derrière la cuisinière, on a beau tout couvrir avec des torchons, elles se mettent partout et pondent dans le beurre et les fromages.
Pages 12-13, Allia, 2017.
Dans la maison elles sont même dans les penderies et derrière la cuisinière, on a beau tout couvrir avec des torchons, elles se mettent partout et pondent dans le beurre et les fromages.
Pages 12-13, Allia, 2017.
Videos de Simon Johannin (47)
Voir plusAjouter une vidéo
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Simon Johannin (7)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (6 - polars et thrillers )
Roger-Jon Ellory : " **** le silence"
seul
profond
terrible
intense
20 questions
2866 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature
, thriller
, romans policiers et polarsCréer un quiz sur ce livre2866 lecteurs ont répondu