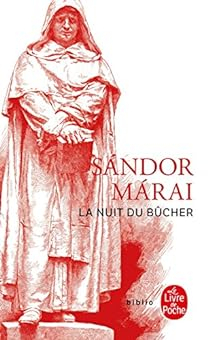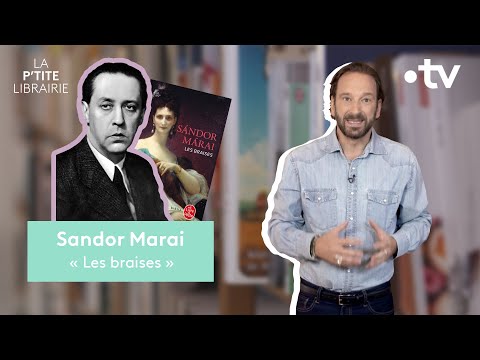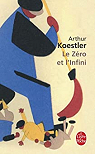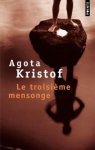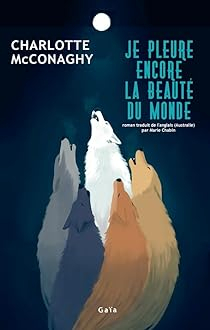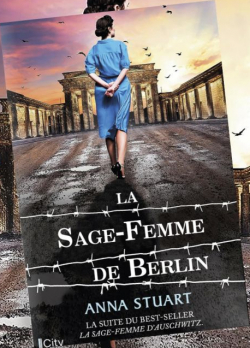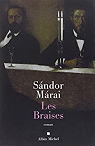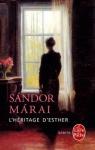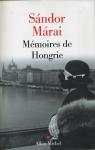Sándor MáraiCatherine Fay/5
94 notes
Résumé :
Rome, 1598. L'Inquisition sévit contre les hérétiques. Enfermés dans des cellules, affamés, torturés, ces derniers reçoivent à la veille de leur exécution sur le Campo dei Fiori la visite d'un inquisiteur pour les inciter à se repentir et à reconnaître publiquement leurs fautes.Venu prendre des « leçons d'Inquisition », un carme d'Avila demande à suivre la dernière nuit d'un condamné. Malgré sept ans de prison et de tortures, celui-ci ne s'est jamais repenti. Son no... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après La Nuit du bûcherVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (36)
Voir plus
Ajouter une critique
Après le magnifique billet d'Eduardo (Creisifiction), j'ai su que je lirai ce roman sur l'Inquisition : Une religion qui veut s'imposer comme moyen de gouverner le monde en tuant ceux qu'elle perçoit comme « hérétiques », ça rappelle encore malheureusement des choses aujourd'hui. L'expérience des uns ne sert visiblement pas de leçon aux autres…
Dans "La nuit du bûcher", un carme espagnol vient à Rome pour apprendre à débusquer plus efficacement les hérétiques qui simuleraient leur chrétienté, à mieux les torturer, mieux les convertir (c'est sûr que ça fait envie)… Et mieux les brûler ! Car on ne brûle pas de la même manière un hérétique converti et un non converti - ce dernier aura droit au bûcher de bois vert qui se consume extrêmement lentement.
Notre carme se fait donc une fierté d'apprendre avec les plus grands inquisiteurs afin de pouvoir propager ce savoir chez lui, comme par exemple comment exploiter la jeunesse malléable, les enfants des familles pour dénoncer les parents ou toute parole suspecte prononcée à la maison ou par des proches… L'un d'entre eux n'a-t-il pas fermé ses fenêtres devant le spectacle d'un bûcher ? Hérétique ! La délation est, de manière générale, un devoir pour prouver que l'on est un chrétien zélé pratiquant et non un vague semblant de converti.
Les simples sympathisants de l'Inquisition qui ne se mouillent pas - « Les personnes vivant dans le péché de l'indifférence, en d'autres terme : enclins à l'hérésie » - sont donc tués aussi, mais rassurez-vous ils ont des morts plus douces comme la pendaison. Et puis jamais d'écartèlement c'est interdit, on n'est pas des bêtes… « Nous appliquons consciencieusement ces préceptes de pitié et de compassion ».
L'idée est que « Tant que les hérétiques ne se rétracteront pas, tant que les païens ne se feront pas baptiser et tant qu'il n'y aura pas qu'un seul bercail et un seul berger, il n'y aura pas d'ordre dans toutes ces régions ».
Les livres sont évidemment les premiers craints et sacrifiés, qui permettent aux idées de se diffuser et, surtout, aux âmes libres de réfléchir par elles-mêmes, et donc de risquer de se détacher du dogme auquel on veut les attacher et les soumettre.
« Le véritable danger ce sont les livres (…). La méthode souveraine dans le combat contre l'hérésie était de réduire à néant tous les livres, auteurs et lecteurs louches parce qu'il n'y aurait pas d'ordre dans le monde tant que vivraient des hommes qui feraient l'expérience de penser par eux-mêmes. »
Et si pour arriver à cela, les bûchers individuels ne suffisent plus, qu'à cela ne tienne : il faudra interner les gens à grande échelle, pour les brûler par milliers…
Alors très vite, à travers les mots que fait prononcer Sandor Marai à son évêque pour défendre l'Inquisition de l'Eglise, le lecteur attentif percevra non-seulement, dans un premier temps, les failles et l'inhumanité d'un raisonnement poussé à l'extrême, que l'on retrouve aujourd'hui dans d'autres religions.
Mais, dans un second temps, il y percevra aussi une dénonciation plus large des méthodes et arguments avancés, qui ont pu être utilisés plus tard par d'autres dictatures politiques : En faisant parler de grands inquisiteurs, Sandor Marai suggère des superpositions de lieux, de temps et d'agissements, créant une réflexion plus vaste. La délation, les rafles, les corps brûlés, ça ne vous rappelle rien ? Voilà à quoi mènent toujours ces raisonnements et arguments, nous avertit-il de manière plus ou moins subliminale.
« Alors oui, avec le temps, il deviendra réellement un chrétien, c'est à dire une créature qui ne pose pas de questions et ne discute pas, parce qu'il a la certitude que l'univers de la chrétienté est le plus parfait de tous. C'est pourquoi il est souhaitable d'exclure tous ceux dont on peut supposer que le doute est resté vivant dans leur âme. Viendra un temps où il faudra enfermer les suspects en groupe, sans discernement, sans tenir compte de l'individu. »
« Arrivera une époque où l'on regroupera sans ambages ni perte de temps tous ceux qui seront soupçonnés d'hérésie à cause de leur origine ou pour d'autres raisons, dans des champs clos par des barrières de fer, pour des périodes plus ou moins longues. » « Quand le temps sera venu, il enverra les coupables non pas par un mais par groupes entiers, plusieurs centaines d'hommes à la fois, dans l'autre monde. »
Roman réflexion plus qu'émotion, il m'a peut-être manqué, pour en garder un plus grand souvenir à terme, de m'enflammer pour un personnage ou une intrigue. A la place, l'auteur instaure un léger suspense bienvenu sur l'issue de ce récit, et parvient à ne pas nous rendre antipathique son carme inquisiteur. D'une grande fluidité, ces 280 pages ont par ailleurs le bon goût de nous épargner nombre de détails, descriptions et pratiques de cette période. Vous n'y trouverez donc pas la reproduction de grands procès à sensation, ni de scènes insoutenables de torture. Mais en se focalisant sur celle emblématique du bûcher, la logique qui y mène ainsi que les méthodes utilisées pour y parvenir, l'auteur génère une réflexion qui demeure malheureusement universelle et intemporelle : A cette logique inquisitoriale, sous les mots des hauts dignitaires de l'Eglise qui la défendent et la propagent, se superposent les logiques, justifications et modèles d'autres types de dictatures comme par exemple les exterminations nazies, ou encore les extrémistes religieux actuellement. « Dieu a besoin du Diable ». A travers sa plume et ses tournures, Sandor Marai parvient même à nous transmettre le sentiment de sa propre ironie à travers les arguments qu'il prête aux inquisiteurs (comme dans l'extrait que j'ai posté à part en citation). Il tente ainsi de démontrer ce que l'on sent être pour lui la bêtise des arguments d'autorité de ceux qui exercent le pouvoir.
Le carme narrateur sera-t-il satisfait de sa formation romaine, ou le fait d'approfondir cette doctrine et de pousser ses idées au bout du raisonnement lui en fera-t-il voir les limites…? L'homme est-il fait pour être un mouton, ou un être doté du libre arbitre…?
En écrivant cette lettre au nom de son personnage, Sandor Marai écrit en réalité un réquisitoire contre l'inquisition et tous les pouvoirs totalitaires, qui reprennent à chaque fois les mêmes arguments d'autorité pour justifier leurs propres horreurs, copiées-collées.
« Car maintenant il ne s'agit pas de savoir qui a raison. Maintenant ce qui compte, c'est de savoir qui possède la force de faire croire au monde sa propre vérité. »
Dans "La nuit du bûcher", un carme espagnol vient à Rome pour apprendre à débusquer plus efficacement les hérétiques qui simuleraient leur chrétienté, à mieux les torturer, mieux les convertir (c'est sûr que ça fait envie)… Et mieux les brûler ! Car on ne brûle pas de la même manière un hérétique converti et un non converti - ce dernier aura droit au bûcher de bois vert qui se consume extrêmement lentement.
Notre carme se fait donc une fierté d'apprendre avec les plus grands inquisiteurs afin de pouvoir propager ce savoir chez lui, comme par exemple comment exploiter la jeunesse malléable, les enfants des familles pour dénoncer les parents ou toute parole suspecte prononcée à la maison ou par des proches… L'un d'entre eux n'a-t-il pas fermé ses fenêtres devant le spectacle d'un bûcher ? Hérétique ! La délation est, de manière générale, un devoir pour prouver que l'on est un chrétien zélé pratiquant et non un vague semblant de converti.
Les simples sympathisants de l'Inquisition qui ne se mouillent pas - « Les personnes vivant dans le péché de l'indifférence, en d'autres terme : enclins à l'hérésie » - sont donc tués aussi, mais rassurez-vous ils ont des morts plus douces comme la pendaison. Et puis jamais d'écartèlement c'est interdit, on n'est pas des bêtes… « Nous appliquons consciencieusement ces préceptes de pitié et de compassion ».
L'idée est que « Tant que les hérétiques ne se rétracteront pas, tant que les païens ne se feront pas baptiser et tant qu'il n'y aura pas qu'un seul bercail et un seul berger, il n'y aura pas d'ordre dans toutes ces régions ».
Les livres sont évidemment les premiers craints et sacrifiés, qui permettent aux idées de se diffuser et, surtout, aux âmes libres de réfléchir par elles-mêmes, et donc de risquer de se détacher du dogme auquel on veut les attacher et les soumettre.
« Le véritable danger ce sont les livres (…). La méthode souveraine dans le combat contre l'hérésie était de réduire à néant tous les livres, auteurs et lecteurs louches parce qu'il n'y aurait pas d'ordre dans le monde tant que vivraient des hommes qui feraient l'expérience de penser par eux-mêmes. »
Et si pour arriver à cela, les bûchers individuels ne suffisent plus, qu'à cela ne tienne : il faudra interner les gens à grande échelle, pour les brûler par milliers…
Alors très vite, à travers les mots que fait prononcer Sandor Marai à son évêque pour défendre l'Inquisition de l'Eglise, le lecteur attentif percevra non-seulement, dans un premier temps, les failles et l'inhumanité d'un raisonnement poussé à l'extrême, que l'on retrouve aujourd'hui dans d'autres religions.
Mais, dans un second temps, il y percevra aussi une dénonciation plus large des méthodes et arguments avancés, qui ont pu être utilisés plus tard par d'autres dictatures politiques : En faisant parler de grands inquisiteurs, Sandor Marai suggère des superpositions de lieux, de temps et d'agissements, créant une réflexion plus vaste. La délation, les rafles, les corps brûlés, ça ne vous rappelle rien ? Voilà à quoi mènent toujours ces raisonnements et arguments, nous avertit-il de manière plus ou moins subliminale.
« Alors oui, avec le temps, il deviendra réellement un chrétien, c'est à dire une créature qui ne pose pas de questions et ne discute pas, parce qu'il a la certitude que l'univers de la chrétienté est le plus parfait de tous. C'est pourquoi il est souhaitable d'exclure tous ceux dont on peut supposer que le doute est resté vivant dans leur âme. Viendra un temps où il faudra enfermer les suspects en groupe, sans discernement, sans tenir compte de l'individu. »
« Arrivera une époque où l'on regroupera sans ambages ni perte de temps tous ceux qui seront soupçonnés d'hérésie à cause de leur origine ou pour d'autres raisons, dans des champs clos par des barrières de fer, pour des périodes plus ou moins longues. » « Quand le temps sera venu, il enverra les coupables non pas par un mais par groupes entiers, plusieurs centaines d'hommes à la fois, dans l'autre monde. »
Roman réflexion plus qu'émotion, il m'a peut-être manqué, pour en garder un plus grand souvenir à terme, de m'enflammer pour un personnage ou une intrigue. A la place, l'auteur instaure un léger suspense bienvenu sur l'issue de ce récit, et parvient à ne pas nous rendre antipathique son carme inquisiteur. D'une grande fluidité, ces 280 pages ont par ailleurs le bon goût de nous épargner nombre de détails, descriptions et pratiques de cette période. Vous n'y trouverez donc pas la reproduction de grands procès à sensation, ni de scènes insoutenables de torture. Mais en se focalisant sur celle emblématique du bûcher, la logique qui y mène ainsi que les méthodes utilisées pour y parvenir, l'auteur génère une réflexion qui demeure malheureusement universelle et intemporelle : A cette logique inquisitoriale, sous les mots des hauts dignitaires de l'Eglise qui la défendent et la propagent, se superposent les logiques, justifications et modèles d'autres types de dictatures comme par exemple les exterminations nazies, ou encore les extrémistes religieux actuellement. « Dieu a besoin du Diable ». A travers sa plume et ses tournures, Sandor Marai parvient même à nous transmettre le sentiment de sa propre ironie à travers les arguments qu'il prête aux inquisiteurs (comme dans l'extrait que j'ai posté à part en citation). Il tente ainsi de démontrer ce que l'on sent être pour lui la bêtise des arguments d'autorité de ceux qui exercent le pouvoir.
Le carme narrateur sera-t-il satisfait de sa formation romaine, ou le fait d'approfondir cette doctrine et de pousser ses idées au bout du raisonnement lui en fera-t-il voir les limites…? L'homme est-il fait pour être un mouton, ou un être doté du libre arbitre…?
En écrivant cette lettre au nom de son personnage, Sandor Marai écrit en réalité un réquisitoire contre l'inquisition et tous les pouvoirs totalitaires, qui reprennent à chaque fois les mêmes arguments d'autorité pour justifier leurs propres horreurs, copiées-collées.
« Car maintenant il ne s'agit pas de savoir qui a raison. Maintenant ce qui compte, c'est de savoir qui possède la force de faire croire au monde sa propre vérité. »
Sándor Márai est sans aucun doute, avec Stefan Zweig, Joseph Roth et Arthur Schnitzler, un des plus grands écrivains issus de cette effervescence culturelle et artistique qui aura traversé la Mitteleuropa au début du XXe siècle. Témoin direct comme eux de la disparition de l'Empire austro-hongrois et, plus particulièrement comme Zweig et Roth, de la montée des totalitarismes, après avoir connu le succès et la reconnaissance de ses compatriotes, Sándor Márai sera lui-aussi contraint à l'exil, son oeuvre condamnée à un long oubli, avant d'être enfin réhabilitée (à titre posthume), reconnue et intégrée au patrimoine littéraire de son pays d'origine, la Hongrie.
Bénéficiant au départ, comme Zweig, d'une éducation bourgeoise (et aristocratique de surcroît, pour ce qui concerne Márai), à la fois cosmopolite, libérale et éclairée, il défendra longtemps un idéalisme dont les référentiels moraux et éthiques sont en train de se désagréger rapidement en Europe («Tant qu'on me laissera écrire, je montrerai qu'il fut une époque où l'on croyait en la victoire de la morale sur les instincts, en la force de l'esprit et en sa capacité de maîtriser les pulsions meurtrières de la horde», écrit-il, par exemple, en 1935).
Avec l'ascension progressive et spectaculaire des régimes fascistes et totalitaires sur une grande partie du continent européen, au fil des évènements dramatiques d'un siècle tourmenté et affichant le même âge que lui (Sándor Márai est né en 1900), son idéalisme, ancré dans de solides valeurs morales et dans la force de l'esprit humain, se verra peu à peu teinter d'un certain pessimisme et scepticisme quant aux capacités de l'homme à maîtriser ses pulsions de destruction.
LA NUIT DU BÛCHER (1974), n'est pas, malgré les apparences, une oeuvre dont les arcanes semblent totalement commodes à pénétrer, y compris par un lecteur avisé, habitué et amateur du genre. Présenté comme un roman historique autour de l'Inquisition à Rome à la toute fin du seizième siècle, rédigé sous la forme d'une longue missive adressée par un jeune carme, inquisiteur espagnol à ses frères condisciples de l'ordre crée depuis peu par St Jean de la Croix et qu'il avait laissés à Avila, d'où il était parti pour un long pèlerinage à Rome afin de venir s'instruire auprès de «l'Office suprême de l'Inquisition », haut-lieu «où on en savait davantage que partout ailleurs », ce récit pourtant tout à fait clair, classique, structuré, à la fois érudit et élégant (saluons au passage la belle traduction de Catherine Fay) risque néanmoins, une fois sa lecture entamée , de susciter très rapidement un vague sentiment de perplexité, voire de frustration chez le lecteur qui s'attendrait à un peu d'action, ou à des vrais récits de procès diligentés par le Saint Office, ou bien à des reconstitutions détaillées d'interrogatoires sous torture, voire pourquoi pas, à quelques dialogues chargés de sous-entendus entre inquisiteurs et hérétiques tout aussi emblématiques que celui pressenti par l'intervention ici de l'hérétique des hérétiques, Giordano Bruno , dont pourtant notre lecteur ayant déjà parcouru plus de deux tiers du volume, et probablement beaucoup moins vaillant qu'au départ, n'entendra en fin de compte le moindre son de voix !
C'est une lecture, de mon point de vue, qu'il ne faut pas balayer trop vite, à ne pas consommer trop «verte», au risque de paraître alors, non pas indigeste, mais tout de même quelque peu insipide...Certes, nous apprenons beaucoup de choses sur le protocole strict régissant la préparation des "giustizie" ("justices", nom donné aux exécutions publiques à Rome) et sur la confrérie chargée de leur encadrement. Néanmoins, il n'y pas d'intrigue à proprement parler, pas de grandes révélations ni de rebondissements spectaculaires, pas de héros clairement identifiables, pas la moindre trace de défiance envers la voix du maître, aucun acte ourdi dans l'ombre, aucun jugement silencieux susceptible de désavouer l'autorité suprême ou la doctrine du Saint-Office !
Sándor Márai, en fin observateur de l'âme et de la psychologie humaine, préfère attaquer le problème du mal par l'angle de la subjectivité de l'inquisiteur. Son approche se fait par le point de vue de l'homme qui a une croyance totale et absolue dans les valeurs qu'il prône et à qui «tout ce que le Saint-Office proclame et accomplit semblait naturel et juste, à l'instar d'un être raisonnable et sain d'esprit qui ne doute pas de la réalité de la nature, de la lumière du soleil ou de l'air».
Arrivé à Rome, notre jeune inquisiteur espagnol sera accueilli chaleureusement au sein de la charitable et sympathique Confraternita di San Giovanni Decollato. "Au couvent de Saint Jean-Décollé, ils attendaient minuit, le moment où arrivait l'émissaire avec la nouvelle qu'à l'aube il y aurait une giustizia sur quelque place publique à Rome et qu'on aurait besoin du travail des confortateurs cette nuit-là. Chacun de ces hommes était un croyant choisi pour sa dévotion. Aucun salaire n'étant attribué à cette besogne de la nuit, c'est gratuitement, avec générosité, qu'ils acceptaient d'accomplir, jusqu'à minuit et plus tard si nécessaire, le grand devoir qui consistait à fortifier l'âme de ceux qui partaient à la mort".
Le jeune carme espagnol (nous ne connaîtrons ni son nom, ni son âge exact) découvrira ainsi, peu à peu, lors d'un séjour fort agréable et instructif le fonctionnement de cette «confrérie charitable aux nobles intentions»!!
LA NUIT DU BÛCHER est généralement considéré comme un réquisitoire d'une grande subtilité contre toutes les formes de totalitarismes et contre l'emprise que ceux-ci sont susceptibles d'exercer sur la capacité de discernement des hommes. Fruit de l'expérience de vie de l'auteur, marqué profondément par la guerre, les régimes totalitaires, l'exil, la pertinence de cette analyse n'est absolument pas à être questionnée.
Il n'est pas nécessaire, semble-t-il, de rappeler qu'au cours de l'histoire de l'humanité aucun système de croyances institutionnalisé n'aura exterminé autant d'êtres humains que l'Eglise catholique. Les parallélismes idéologiques avec les systèmes totalitaires y sont nombreux : la déshumanisation de l'hérétique systématiquement recherchée, ce jusqu'au pied du bûcher, l'annihilation de toute volonté de résistance, les purges à grande échelle, la promotion de la délation, la condamnation de tout esprit critique et de toute diffusion d'un savoir s'opposant à la pensée unique... Sándor Márai nous rappelle d'ailleurs à propos de ce dernier point, en note de bas de page, le célèbre mot prononcé par Le Cardinal de Retz : «Les hommes ne croient rien tant que ce qu'ils ne comprennent pas». le message est clair : Circulez ! Il n'y a rien à comprendre, il suffit d'y croire !
Notre carme espagnol annonce d'entrée de jeu qu'il écrit sa lettre depuis Genève, en Helvétie. Pourquoi à la fin de son séjour romain, a-t-il décidé de ne plus rentrer en Espagne ? Serait-on en mesure d'espérer qu'un réveil de conscience sonne enfin pour notre "héros" inquisiteur ? A partir de quel moment le germe d'une dissidence peut s'instiller dans un esprit en état de «croyance absolue» ? Cesserait-on vraiment par ailleurs, d'une fois pour toutes, de croire en quelque chose d'absolu ? Quand l'homme cessera enfin de croire au mythe d'un «Seul Berger et un Seul Troupeau» ?
Et cessera-t-il un jour de vouloir créer, puis chasser l'hérétique ? Notre élève espagnol n'entendra-t-il au siège romain de l'Inquisition de la part de Son Excellence même, le Cardinal Bellarmino, que «bien que certains d'eux soient réduits en cendres, leur procès n'a pas de fin (...) il se peut que l'inquisiteur ait besoin de l'hérétique» ?
Au moment de sa condamnation, au bout de sept longues années de procès, Giordano Bruno n'intentera plus aucun recours, ne prononcera plus aucune parole. Tout au long de sa dernière nuit avant la giustizia, indifférent aux requêtes des confortateurs, il ne manifestera aucun repentir à l'approche du terrible supplice du bûcher, refusant d'embrasser le crucifix et de regarder ses bourreaux.
Sommes-nous irrémédiablement condamnés à la dialectique du maître et de l'esclave ? L'exil, qu'il soit extérieur ou intérieur, serait-il le seul moyen d'échapper à ce que Hegel avait appelé «la lutte à mort pour la reconnaissance» propre à la condition humaine?
«Chi' e vuol aper convien che prima mora» («Il y a une clarté que l'homme ne peut percevoir qu'au seuil de la mort») Michel-Ange.
LA NUIT DU BÛCHER est peut-être avant tout un roman de la maturité, de la lucidité et du désenchantement.
...
Bénéficiant au départ, comme Zweig, d'une éducation bourgeoise (et aristocratique de surcroît, pour ce qui concerne Márai), à la fois cosmopolite, libérale et éclairée, il défendra longtemps un idéalisme dont les référentiels moraux et éthiques sont en train de se désagréger rapidement en Europe («Tant qu'on me laissera écrire, je montrerai qu'il fut une époque où l'on croyait en la victoire de la morale sur les instincts, en la force de l'esprit et en sa capacité de maîtriser les pulsions meurtrières de la horde», écrit-il, par exemple, en 1935).
Avec l'ascension progressive et spectaculaire des régimes fascistes et totalitaires sur une grande partie du continent européen, au fil des évènements dramatiques d'un siècle tourmenté et affichant le même âge que lui (Sándor Márai est né en 1900), son idéalisme, ancré dans de solides valeurs morales et dans la force de l'esprit humain, se verra peu à peu teinter d'un certain pessimisme et scepticisme quant aux capacités de l'homme à maîtriser ses pulsions de destruction.
LA NUIT DU BÛCHER (1974), n'est pas, malgré les apparences, une oeuvre dont les arcanes semblent totalement commodes à pénétrer, y compris par un lecteur avisé, habitué et amateur du genre. Présenté comme un roman historique autour de l'Inquisition à Rome à la toute fin du seizième siècle, rédigé sous la forme d'une longue missive adressée par un jeune carme, inquisiteur espagnol à ses frères condisciples de l'ordre crée depuis peu par St Jean de la Croix et qu'il avait laissés à Avila, d'où il était parti pour un long pèlerinage à Rome afin de venir s'instruire auprès de «l'Office suprême de l'Inquisition », haut-lieu «où on en savait davantage que partout ailleurs », ce récit pourtant tout à fait clair, classique, structuré, à la fois érudit et élégant (saluons au passage la belle traduction de Catherine Fay) risque néanmoins, une fois sa lecture entamée , de susciter très rapidement un vague sentiment de perplexité, voire de frustration chez le lecteur qui s'attendrait à un peu d'action, ou à des vrais récits de procès diligentés par le Saint Office, ou bien à des reconstitutions détaillées d'interrogatoires sous torture, voire pourquoi pas, à quelques dialogues chargés de sous-entendus entre inquisiteurs et hérétiques tout aussi emblématiques que celui pressenti par l'intervention ici de l'hérétique des hérétiques, Giordano Bruno , dont pourtant notre lecteur ayant déjà parcouru plus de deux tiers du volume, et probablement beaucoup moins vaillant qu'au départ, n'entendra en fin de compte le moindre son de voix !
C'est une lecture, de mon point de vue, qu'il ne faut pas balayer trop vite, à ne pas consommer trop «verte», au risque de paraître alors, non pas indigeste, mais tout de même quelque peu insipide...Certes, nous apprenons beaucoup de choses sur le protocole strict régissant la préparation des "giustizie" ("justices", nom donné aux exécutions publiques à Rome) et sur la confrérie chargée de leur encadrement. Néanmoins, il n'y pas d'intrigue à proprement parler, pas de grandes révélations ni de rebondissements spectaculaires, pas de héros clairement identifiables, pas la moindre trace de défiance envers la voix du maître, aucun acte ourdi dans l'ombre, aucun jugement silencieux susceptible de désavouer l'autorité suprême ou la doctrine du Saint-Office !
Sándor Márai, en fin observateur de l'âme et de la psychologie humaine, préfère attaquer le problème du mal par l'angle de la subjectivité de l'inquisiteur. Son approche se fait par le point de vue de l'homme qui a une croyance totale et absolue dans les valeurs qu'il prône et à qui «tout ce que le Saint-Office proclame et accomplit semblait naturel et juste, à l'instar d'un être raisonnable et sain d'esprit qui ne doute pas de la réalité de la nature, de la lumière du soleil ou de l'air».
Arrivé à Rome, notre jeune inquisiteur espagnol sera accueilli chaleureusement au sein de la charitable et sympathique Confraternita di San Giovanni Decollato. "Au couvent de Saint Jean-Décollé, ils attendaient minuit, le moment où arrivait l'émissaire avec la nouvelle qu'à l'aube il y aurait une giustizia sur quelque place publique à Rome et qu'on aurait besoin du travail des confortateurs cette nuit-là. Chacun de ces hommes était un croyant choisi pour sa dévotion. Aucun salaire n'étant attribué à cette besogne de la nuit, c'est gratuitement, avec générosité, qu'ils acceptaient d'accomplir, jusqu'à minuit et plus tard si nécessaire, le grand devoir qui consistait à fortifier l'âme de ceux qui partaient à la mort".
Le jeune carme espagnol (nous ne connaîtrons ni son nom, ni son âge exact) découvrira ainsi, peu à peu, lors d'un séjour fort agréable et instructif le fonctionnement de cette «confrérie charitable aux nobles intentions»!!
LA NUIT DU BÛCHER est généralement considéré comme un réquisitoire d'une grande subtilité contre toutes les formes de totalitarismes et contre l'emprise que ceux-ci sont susceptibles d'exercer sur la capacité de discernement des hommes. Fruit de l'expérience de vie de l'auteur, marqué profondément par la guerre, les régimes totalitaires, l'exil, la pertinence de cette analyse n'est absolument pas à être questionnée.
Il n'est pas nécessaire, semble-t-il, de rappeler qu'au cours de l'histoire de l'humanité aucun système de croyances institutionnalisé n'aura exterminé autant d'êtres humains que l'Eglise catholique. Les parallélismes idéologiques avec les systèmes totalitaires y sont nombreux : la déshumanisation de l'hérétique systématiquement recherchée, ce jusqu'au pied du bûcher, l'annihilation de toute volonté de résistance, les purges à grande échelle, la promotion de la délation, la condamnation de tout esprit critique et de toute diffusion d'un savoir s'opposant à la pensée unique... Sándor Márai nous rappelle d'ailleurs à propos de ce dernier point, en note de bas de page, le célèbre mot prononcé par Le Cardinal de Retz : «Les hommes ne croient rien tant que ce qu'ils ne comprennent pas». le message est clair : Circulez ! Il n'y a rien à comprendre, il suffit d'y croire !
Notre carme espagnol annonce d'entrée de jeu qu'il écrit sa lettre depuis Genève, en Helvétie. Pourquoi à la fin de son séjour romain, a-t-il décidé de ne plus rentrer en Espagne ? Serait-on en mesure d'espérer qu'un réveil de conscience sonne enfin pour notre "héros" inquisiteur ? A partir de quel moment le germe d'une dissidence peut s'instiller dans un esprit en état de «croyance absolue» ? Cesserait-on vraiment par ailleurs, d'une fois pour toutes, de croire en quelque chose d'absolu ? Quand l'homme cessera enfin de croire au mythe d'un «Seul Berger et un Seul Troupeau» ?
Et cessera-t-il un jour de vouloir créer, puis chasser l'hérétique ? Notre élève espagnol n'entendra-t-il au siège romain de l'Inquisition de la part de Son Excellence même, le Cardinal Bellarmino, que «bien que certains d'eux soient réduits en cendres, leur procès n'a pas de fin (...) il se peut que l'inquisiteur ait besoin de l'hérétique» ?
Au moment de sa condamnation, au bout de sept longues années de procès, Giordano Bruno n'intentera plus aucun recours, ne prononcera plus aucune parole. Tout au long de sa dernière nuit avant la giustizia, indifférent aux requêtes des confortateurs, il ne manifestera aucun repentir à l'approche du terrible supplice du bûcher, refusant d'embrasser le crucifix et de regarder ses bourreaux.
Sommes-nous irrémédiablement condamnés à la dialectique du maître et de l'esclave ? L'exil, qu'il soit extérieur ou intérieur, serait-il le seul moyen d'échapper à ce que Hegel avait appelé «la lutte à mort pour la reconnaissance» propre à la condition humaine?
«Chi' e vuol aper convien che prima mora» («Il y a une clarté que l'homme ne peut percevoir qu'au seuil de la mort») Michel-Ange.
LA NUIT DU BÛCHER est peut-être avant tout un roman de la maturité, de la lucidité et du désenchantement.
...
Je n'aurais sans doute jamais chroniqué ce roman de Sandor Marai La nuit du bûcher si je n'avais pas lu l'excellente critique qu'en a fait Creisification sur Babelio. Talent méconnu de la littérature de la Mittleuropa, Sandor Marai mérite qu'on le lise à plus d'un égard. Il a eu en effet le triste privilège de connaître à travers l'histoire tourmentée de la Hongrie, les trois régimes totalitaires qui ont marqué le XXème siècle à savoir le fascisme italien le nazisme et le communisme. Deuxième raison pour lui rendre hommage, c'est une plume remarquable, incisive, subtile à tel point que j'ai relu en diagonale le roman pour mieux en apprécier les effets de style.
Ce roman contrairement à d'autres de ses écrits prend ses distances par rapport à L Histoire contemporaine car il nous transporte à Rome en 1598. L'Inquisition fait rage. On brûle allègrement les hérétiques. Et nous allons suivre les pérégrinations d'un jeune carme espagnol, mu par le désir de parfaire son expérience dans l'art de débusquer les hérétiques et leur faire subir le châtiment qui convient. L'un des moyens les plus "en vogue" en Italie est de faire "rôtir" les malheureux condamnés sur un bûcher sur la place de Campe de' Fiori, lors d'une "justizia", un vrai spectacle romain suivi avec ferveur aussi bien par les bourgeois que le petit peuple de Rome !
Cette peinture de la Rome inquisitoriale permet à l'auteur de rappeler les mécanismes à la base de tous les régimes totalitaires qu'ils soient d'origine religieuse ou politique :suspicion généralisée, pratique de la délation y compris au sein de la famille, condamnation de la littérature et de tout ce qui touche à la liberté de pensée et d'expression sans oublier bien sûr la pratique de la torture censée favoriser l'aveu d'une culpabilité qui ne fait aucun doute... pour les tortionnaires en tout cas.
J'ai vraiment apprécié la façon dont l'auteur nous fait entrer par glissements successifs dans la pensée des "gardiens de la Volonté Divine" - les hommes d'Eglise chargés de l'Inquisition - Il nous permet ainsi de suivre leurs grands discours où ils se coupent peu à peu de la réalité et s'enferment dans une logorrhée proche du délire. J'ai senti planer ainsi en arrière fond l'ombre de tous les "grands fous" de l'Histoire du XX ème et du XXI ème siècles.
Face à cette machine à broyer les corps et les esprits, un beau personnage de résistant : un prêtre apostat Leornardo qui va jusqu'au dernier moment refuser d'embrasser la Croix et offrir à ses bourreaux , son indifférence sans faille voire son mépris . L'acmé du roman sera pour moi cette magnifique scène d'une intensité poignante, où il renverra aux spectateurs l'image du Christ torturé sur la Croix. Temps suspendu, foule figée avant que ne s'abattent sur le supplicié les cris de haine... Derniers moments du supplicié qui ne regardera jamais vers le Ciel et restera seul dans sa solitude et son désespoir...
Dernier point sur lequel je voudrais insister c'est la lecture constamment décalée que l'on fait puisqu'à chaque instant le récit admiratif que le jeune carme nous offre est battu en brèche par la lecture critique que nous faisons de cette sombre période de notre Histoire européenne.
Cette contre-lecture est jouissive et c'est en partie pour cette raison que j'ai relu le roman en diagonale afin de mieux savourer tous les passages où à coup d'humour noir et au second degré l'auteur s'en donne à coeur joie !
Ce roman contrairement à d'autres de ses écrits prend ses distances par rapport à L Histoire contemporaine car il nous transporte à Rome en 1598. L'Inquisition fait rage. On brûle allègrement les hérétiques. Et nous allons suivre les pérégrinations d'un jeune carme espagnol, mu par le désir de parfaire son expérience dans l'art de débusquer les hérétiques et leur faire subir le châtiment qui convient. L'un des moyens les plus "en vogue" en Italie est de faire "rôtir" les malheureux condamnés sur un bûcher sur la place de Campe de' Fiori, lors d'une "justizia", un vrai spectacle romain suivi avec ferveur aussi bien par les bourgeois que le petit peuple de Rome !
Cette peinture de la Rome inquisitoriale permet à l'auteur de rappeler les mécanismes à la base de tous les régimes totalitaires qu'ils soient d'origine religieuse ou politique :suspicion généralisée, pratique de la délation y compris au sein de la famille, condamnation de la littérature et de tout ce qui touche à la liberté de pensée et d'expression sans oublier bien sûr la pratique de la torture censée favoriser l'aveu d'une culpabilité qui ne fait aucun doute... pour les tortionnaires en tout cas.
J'ai vraiment apprécié la façon dont l'auteur nous fait entrer par glissements successifs dans la pensée des "gardiens de la Volonté Divine" - les hommes d'Eglise chargés de l'Inquisition - Il nous permet ainsi de suivre leurs grands discours où ils se coupent peu à peu de la réalité et s'enferment dans une logorrhée proche du délire. J'ai senti planer ainsi en arrière fond l'ombre de tous les "grands fous" de l'Histoire du XX ème et du XXI ème siècles.
Face à cette machine à broyer les corps et les esprits, un beau personnage de résistant : un prêtre apostat Leornardo qui va jusqu'au dernier moment refuser d'embrasser la Croix et offrir à ses bourreaux , son indifférence sans faille voire son mépris . L'acmé du roman sera pour moi cette magnifique scène d'une intensité poignante, où il renverra aux spectateurs l'image du Christ torturé sur la Croix. Temps suspendu, foule figée avant que ne s'abattent sur le supplicié les cris de haine... Derniers moments du supplicié qui ne regardera jamais vers le Ciel et restera seul dans sa solitude et son désespoir...
Dernier point sur lequel je voudrais insister c'est la lecture constamment décalée que l'on fait puisqu'à chaque instant le récit admiratif que le jeune carme nous offre est battu en brèche par la lecture critique que nous faisons de cette sombre période de notre Histoire européenne.
Cette contre-lecture est jouissive et c'est en partie pour cette raison que j'ai relu le roman en diagonale afin de mieux savourer tous les passages où à coup d'humour noir et au second degré l'auteur s'en donne à coeur joie !
Fin du 16ème siècle en pleine Inquisition, un jeune carme espagnol quitte sa ville Avila avec d'autres pèlerins pour rejoindre Rome. Il a pour but de parfaire ses connaissances en matière de lutte contre les hérétiques auprès des Italiens. Il est reçu par le consulteur Robert Bellarmin qui accepte qu'il soit initié aux pratiques des hérétiques pour mieux les reconnaître et les punir, c'est-à-dire majoritairement les envoyer au bûcher…La force et l'intérêt de son récit c'est de décrire de l'intérieur l'état d'esprit de ces hommes, aveuglés par la foi, persuadés d'agir pour le bien de ceux qu'ils qualifient d'hérétiques, décrivant en toute bonne foi les tortures infligées pour les faire avouer, les procès expéditifs puis l'exécution en place publique. Aucune haine ne les anime, simplement une conviction d'agir pour sauver le monde et les hommes d'un fléau. Et pour cela tous les moyens sont bons : dénonciations, trahisons, enfants incités à dénoncer leurs parents, les voisins, les familles, tous doivent signaler le moindre faux pas, la moindre phrase suspecte…Un climat que l'on peut retrouver dans toute dictature basée sur la parole unique et la terreur. C'est là que l'histoire de Sándor Márai qui a connu le nazisme et le communisme rejoint celle de L'Inquisition car les mêmes mécanismes sont en oeuvre.
Mais à la fin de son séjour notre carme va suivre la dernière nuit d'un condamné resté célèbre dans l'Histoire, Giordano Bruno. Et là, face à cet homme libre, que huit années de procès n'ont pas fait renoncer à ses convictions, il va être saisi du sentiment de l'inutilité et peut-être de la monstruosité de sa tâche…renforcée par une dernière conversation avec Robert Bellarmin et la lecture du « Manuel de l'Inquisiteur » de Nicolau Eymerich. Jetant le livre à l'eau, il choisit l'exil.
Livre puissant qui souligne l'extrême cruauté des hommes envers leurs semblables particulièrement lorsqu'elle sert une cause divine ou politique, en fait un pouvoir absolu qui s'arroge un droit de vie ou de mort sur tout individu, utilise la censure car les livres sont plus dangereux que les armes et la croyance beaucoup plus utile que la connaissance, et règne par la division. Et malheureusement toujours terriblement d'actualité.
Mais à la fin de son séjour notre carme va suivre la dernière nuit d'un condamné resté célèbre dans l'Histoire, Giordano Bruno. Et là, face à cet homme libre, que huit années de procès n'ont pas fait renoncer à ses convictions, il va être saisi du sentiment de l'inutilité et peut-être de la monstruosité de sa tâche…renforcée par une dernière conversation avec Robert Bellarmin et la lecture du « Manuel de l'Inquisiteur » de Nicolau Eymerich. Jetant le livre à l'eau, il choisit l'exil.
Livre puissant qui souligne l'extrême cruauté des hommes envers leurs semblables particulièrement lorsqu'elle sert une cause divine ou politique, en fait un pouvoir absolu qui s'arroge un droit de vie ou de mort sur tout individu, utilise la censure car les livres sont plus dangereux que les armes et la croyance beaucoup plus utile que la connaissance, et règne par la division. Et malheureusement toujours terriblement d'actualité.
En 1598, un jeune moine castillan, originaire d'Avila, séjourne à Rome pour quelques mois chez ceux qui sont devenus maitres dans l'art de l'inquisition, il est là pour observer leur méthodes et les transmettre à ces frères en Espagne , nous appellerions cela "stage de perfectionnement" à notre époque . C'est un élève appliqué qui commence par apprendre l'italien puis assiste aux veilles des "confortateurs", des hommes , certains laïcs, qui se réunissent pour inciter au repentir les hérétiques et vérifier la sincérité des conversions .
L'inquisition, dans ce roman n'est en fait qu'un prétexte, un exemple historique du totalitarisme dans toutes ces formes, là, en l'occurrence la religion catholique pour un écrivain qui a fui sa Hongrie natale devenue communiste après avoir été nationaliste et proche du troisième Reich .
On ne peut s'empêcher de penser également à l'Holocauste lorsque le Padre Alessandro explique au jeune moine que les sentences individuelles ne suffiront pas ...
L'arrivée de l'imprimerie est perçue elle aussi comme dangereuse car échappant au contrôle de l'église et par la diffusion plus facile des oeuvres considérées comme hérétiques ou païennes , on est pas loin des bûchers de livres .
On sait d'emblée que le moine ne retournera pas à Avila, qu'il choisit l'exil à Genève ; les raisons de son revirement ne sont pas uniquement dues , comme le résumé de l'ouvrage le laisse supposer ou la traduction du titre, à la dernière nuit avant son exécution de Giordani Bruno , un religieux qui ne renie rien et ne se laisse pas fléchir par les propos des confortateurs , ce qui ébranle fortement le jeune castillan , c'est un processus beaucoup plus complexe , lent et insidieux qui, à mon avis, vient aussi de sa dernière conversation avec le cardinal Bellarmin, celui qui l'avait accueilli lors de son arrivée et dont les paroles avant son retour en Espagne ouvrent une brèche dans la certitude du jeune homme , cela rejoint les convictions de l'écrivain lorsqu'il a lui même choisi l'exil comme le moine dont il nous conte l'histoire : la liberté de penser que l'on ne peut ôter à l'homme même en l'incarcérant, en muselant sa parole ou en le condamnant au feu du bucher !
Une écriture remarquable et un sujet de réflexion qui est toujours , malheureusement d'actualité .
Je vous encourage à lire ce texte parfois un peu ardu mais si marquant .
L'inquisition, dans ce roman n'est en fait qu'un prétexte, un exemple historique du totalitarisme dans toutes ces formes, là, en l'occurrence la religion catholique pour un écrivain qui a fui sa Hongrie natale devenue communiste après avoir été nationaliste et proche du troisième Reich .
On ne peut s'empêcher de penser également à l'Holocauste lorsque le Padre Alessandro explique au jeune moine que les sentences individuelles ne suffiront pas ...
L'arrivée de l'imprimerie est perçue elle aussi comme dangereuse car échappant au contrôle de l'église et par la diffusion plus facile des oeuvres considérées comme hérétiques ou païennes , on est pas loin des bûchers de livres .
On sait d'emblée que le moine ne retournera pas à Avila, qu'il choisit l'exil à Genève ; les raisons de son revirement ne sont pas uniquement dues , comme le résumé de l'ouvrage le laisse supposer ou la traduction du titre, à la dernière nuit avant son exécution de Giordani Bruno , un religieux qui ne renie rien et ne se laisse pas fléchir par les propos des confortateurs , ce qui ébranle fortement le jeune castillan , c'est un processus beaucoup plus complexe , lent et insidieux qui, à mon avis, vient aussi de sa dernière conversation avec le cardinal Bellarmin, celui qui l'avait accueilli lors de son arrivée et dont les paroles avant son retour en Espagne ouvrent une brèche dans la certitude du jeune homme , cela rejoint les convictions de l'écrivain lorsqu'il a lui même choisi l'exil comme le moine dont il nous conte l'histoire : la liberté de penser que l'on ne peut ôter à l'homme même en l'incarcérant, en muselant sa parole ou en le condamnant au feu du bucher !
Une écriture remarquable et un sujet de réflexion qui est toujours , malheureusement d'actualité .
Je vous encourage à lire ce texte parfois un peu ardu mais si marquant .
Citations et extraits (37)
Voir plus
Ajouter une citation
Les vieux confortateurs ne soulevèrent aucune contradiction. Ils étaient d'accord : le livre représentait un énorme danger car, pour beaucoup de gens, il était susceptible de provoquer la terrifiante possibilité d'une réflexion indépendante. D'accord également quand le padre, soufflant et transpirant, déclara que le seul moyen de lutter efficacement contre le danger était d'incarcérer tous les suspects. D'accord aussi pour dire que la méthode souveraine dans le combat contre l'hérésie était de réduire à néant tous les livres, auteurs et lecteurs louches parce qu'il n'y aurait pas d'ordre dans le monde tant que vivraient des hommes qui feraient l'expérience de penser par eux-mêmes. (p. 84)
Tandis que j'attendais la mise à feu du bûcher au sein de cette foule impatiente du marché, je ne pus m'empêcher de penser à la bénédiction qu'était le christianisme qui avait canalisé les instincts sauvages de l'homme pour l'apprivoiser ainsi ! Oui, il n'existe plus trace ici à Rome des scènes qui, il y a un millénaire et demi, s'y déroulaient quotidiennement ! Par exemple, le repas des fauves sur la piste de cet abattoir nommé Colisée où l'on jetait des chrétiens à la gueule des lions, des ours et des chacals ! Ou au forum lorsque, au temps de la République de Rome et de Gracchus, on fourrait les opposants politiques dans des tonneaux bourrés de vipères ! (...) Comme tout est différent à présent ! Un simple bûcher installé au centre du Campo dei Fiori, un bûché élaboré avec savoir-faire dont quelqu'un comme moi, ayant assisté à quelques exécutions de ce genre, était à même de constater la qualité : le fagot était constitué de branche sèches (...), on pourrait être sûr que le bois prendrait vite, que tout serait fini rapidement et qu'ensuite nous pourrions aller dormir.
Je vis le visage de l'hérétique quelques instants.Ce n'était pas l'Enfer ou le Ciel qu'il fixait en regardant devant lui, non, ce qu'il regardait était le Néant, comme s'il avait compris que le Néant était la seule réalité et que le reste n'était qu'illusion. Et ce regard était plus terrifiant que s'il s'était lancé dans des malédictions. On aurait dit que cet homme savait qu'il n'existait aucun secours pour les humains. Il baissait les yeux sur la foule et à présent je peux le dire, en cet instant, le visage de l'homme attaché au poteau m'évoqua le visage torturé de Notre Seigneur Jésus Christ que, depuis un millénaire et demi, on a souvent sculpté dans la pierre, gravé dans le bois, peint sur les murs, la toile des tablettes, le visage de celui qui pardonne ce que les hommes font aux autres hommes mais qui demande en même temps à Dieu quelle est la raison pour laquelle il doit supporter tout ce qui se passe pour lui, être humain sur cette terre...
"Viendra le temps " , en disant cela, il écarquilla involontairement les yeux comme s'il lisait dans l'avenir, "viendra le temps où l'on ne pourra plus sévir de façon individuelle mais où il faudra réunir et mettre à part tous les suspects ensemble . Le diable fait des tours et des détours , il soumet tout le monde à la tentation. Arrivera une époque où l'on regroupera sans ambages ni perte de temps tous ceux qui seront soupçonnés de tomber un jour dans le péché d'hérésie , à cause de leur origine ou pour d'autres raisons , dans des champs clos par des barrières de fer pour des périodes plus ou moins longues ... mais en général il vaudra mieux que ce soit pour longtemps . Un tel lieu de détention ceinturé de barrières de fer , permettra de surveiller en même temps des groupes d'hommes plus importants ... Certes, il est vrai que les hommes ont les moyens de différencier le Bien du Mal avec leur intelligence . Mais pour cela il faut de la Miséricorde .
Dans la pénombre du petit matin d'hiver, dans la ville d Rome, l'homme était nu comme si on ne l'avait pas seulement dépouillé de sa chemise mais également de sa chair. Della carne ancor vestita : j'avais lu ces mots dans un recueil de vers du sculpteur et il me revint à l'esprit car le corps de l'homme ligoté au bûcher semblait n'être qu'une feuille de vigne recouvrant l'autre nudité, celle qui se trouve sous la peau et qui transparaissait à présent comme transparaît la vérité sous le mensonge. Ce fut le moment où les divers bruits de la foule, glapissements, murmures et mastications cessèrent brusquement. [...]
L'homme nu attaché à un poteau sur le bûcher n'abaissait pas son regard sur les fidèles. Il ne regardait pas non plus les fenêtres aux étages des maisons. Et je dois ajouter, aussi attristant que cela puisse être, qu'il ne levait pas non plus les yeux vers le ciel.
L'homme nu attaché à un poteau sur le bûcher n'abaissait pas son regard sur les fidèles. Il ne regardait pas non plus les fenêtres aux étages des maisons. Et je dois ajouter, aussi attristant que cela puisse être, qu'il ne levait pas non plus les yeux vers le ciel.
Videos de Sándor Márai (13)
Voir plusAjouter une vidéo
Retrouvez les derniers épisodes de la cinquième saison de la P'tite Librairie sur la plateforme france.tv :
https://www.france.tv/france-5/la-p-tite-librairie/
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos de la P'tite Librairie.
Avez-vous déjà vécu cette expérience terrible : quand l'amour entre en conflit avec l'amitié ? Mais savez-vous qu'il existe un roman formidable qui nous dit lequel de ces deux sentiments finit toujours par l'emporter ?
« Les braises », de Sandor Marai, c'est à lire au Livre de poche.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos de la P'tite Librairie.
Avez-vous déjà vécu cette expérience terrible : quand l'amour entre en conflit avec l'amitié ? Mais savez-vous qu'il existe un roman formidable qui nous dit lequel de ces deux sentiments finit toujours par l'emporter ?
« Les braises », de Sandor Marai, c'est à lire au Livre de poche.
autres livres classés : littérature hongroiseVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Sándor Márai (25)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Jésus qui est-il ?
Jésus était-il vraiment Juif ?
Oui
Non
Plutôt Zen
Catholique
10 questions
1830 lecteurs ont répondu
Thèmes :
christianisme
, religion
, bibleCréer un quiz sur ce livre1830 lecteurs ont répondu