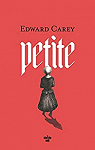Colin Thibert/5
24 notes
Résumé :
À Neuchâtel, principauté indépendante, on imprime les pamphlets et les libelles qui vont inspirer la Révolution de 1789. En attendant, le jeune et séduisant Alexandre-Joseph, mène une vie de bâton de chaise, jusqu'au jour où un meurtre accidentel le contraint à l'exil. Arrivé à Paris, manipulé par le lieutenant général de police, il est contraint d'espionner Mesmer, le médecin viennois à la mode, ainsi que madame de Vaupertuis dont le salon accueille les grands espr... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Le Chevalier fracasséVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (11)
Voir plus
Ajouter une critique
L'aventurier, l'inventeur et la Révolution
Dans ce nouveau roman historique Colin Thibert nous propose de suivre les tribulations d'un neuchâtelois monté à Paris à la veille de la Révolution. Son audace va lui permettre de grimper les échelons, mais l'entreprise n'est pas sans risques.
C'est dans les environs de Neuchâtel, alors prussienne, que Colin Thibert choisit de situer les premières scènes de ce savoureux roman. Alexandre-Joseph Martinet-Dubied a le malheur de croiser le père d'une jeune fille, féru des Écritures, qui lui demande réparation après qu'il ait joyeusement «déshonoré» cette dernière. Une balle entre les deux yeux de l'importun suffira à régler ce différend. le jeune homme a beau pouvoir se targuer d'avoir agi en légitime défense, il choisit de fuir. Avec une cargaison de livres séditieux imprimés par son père, il part pour Paris.
En quelques semaines, l'intrépide fuyard réussira à se faire une petite place dans la capitale sous le pseudonyme d'Alessandro Vesperelli. L'ironie de l'histoire veut que ce soit avec l'aide des autorités, qui n'ont pas tardé à repérer ce fanfaron. Engagé comme espion à la solde du lieutenant général de police, Alessandro est chargé de lui rapporter ce qui se dit dans les salons. Une tâche dont il s'acquitte fort bien. C'est ainsi que chez madame de Vaupertuis, il croise Mesmer, le médecin viennois qui fait fureur avec son traitement par les fluides. Alexandre-Joseph, qui sent le bon coup, va parvenir à le persuader de l'embaucher comme assistant. Mais la fortune qu'il attend de cet emploi tarde à venir. Qu'à cela ne tienne ! Dans le tourbillon d'idées nouvelles qui électrisent Paris à la fin du XVIIIe siècle, il va vite trouver un autre moyen de réussir. Il a en effet fait la connaissance d'un homme féru de sciences, le marquis de Faverolles, qui le fascine par ses trouvailles. À ses côtés, il découvre certaines applications dans le domaine de l'optique et s'imagine déjà riche en développant une invention propre à déplacer les foules, sorte d'ancêtre de la photographie, mêlant art et lumière. Avec son nouveau protecteur et amant, il imagine un bâtiment circulaire qui, éclairé de manière ciblée, donnerait littéralement au visiteur l'impression d'entrer dans le décor. La construction de ce qu'il nomme Panthéome va alors occuper toutes ses journées. Il va trouver artistes et architectes de renom, maître d'oeuvre, maçon et charpentier afin d'ériger cet édifice révolutionnaire. Ce dernier qualificatif va toutefois faire capoter le projet. Car les ouvriers délaissent le chantier pour aller détruire un autre édifice. Nous sommes le 14 juillet 1789 et la prise de la Bastille marque le début de la Révolution française.
Notre aventurier ne voit toutefois dans cet assaut qu'un fâcheux contretemps et décide de mettre à profit cette parenthèse pour exercer ses talents d'espion à Londres. Une activité lucrative, car il en profite de ses traversées pour faire de la contrebande. Incidemment, il entend parler du Panorama et se dit que son Panthéome y ressemble furieusement. Soupçonnant le plagiat, il va voir toutes ses illusions et ses rêves de gloire s'envoler lorsqu'il remet les pieds en France.
Comme dans Torrentius, Colin Thibert mêle avec bonheur le romanesque et L Histoire. Fort bien documenté, il nous entraîne avec gourmandise dans cette époque frénétique où les idées volent aussi vite que les têtes, où l'aristocratie voit s'envoler tous ses pouvoirs et où les rêves de gloire s'envolent en fumée. le style est allègre, le rythme entraînant, l'humour dispensé avec finesse. Alors même le drame prend des allures de joyeuse épopée !
Lien : https://collectiondelivres.w..
Dans ce nouveau roman historique Colin Thibert nous propose de suivre les tribulations d'un neuchâtelois monté à Paris à la veille de la Révolution. Son audace va lui permettre de grimper les échelons, mais l'entreprise n'est pas sans risques.
C'est dans les environs de Neuchâtel, alors prussienne, que Colin Thibert choisit de situer les premières scènes de ce savoureux roman. Alexandre-Joseph Martinet-Dubied a le malheur de croiser le père d'une jeune fille, féru des Écritures, qui lui demande réparation après qu'il ait joyeusement «déshonoré» cette dernière. Une balle entre les deux yeux de l'importun suffira à régler ce différend. le jeune homme a beau pouvoir se targuer d'avoir agi en légitime défense, il choisit de fuir. Avec une cargaison de livres séditieux imprimés par son père, il part pour Paris.
En quelques semaines, l'intrépide fuyard réussira à se faire une petite place dans la capitale sous le pseudonyme d'Alessandro Vesperelli. L'ironie de l'histoire veut que ce soit avec l'aide des autorités, qui n'ont pas tardé à repérer ce fanfaron. Engagé comme espion à la solde du lieutenant général de police, Alessandro est chargé de lui rapporter ce qui se dit dans les salons. Une tâche dont il s'acquitte fort bien. C'est ainsi que chez madame de Vaupertuis, il croise Mesmer, le médecin viennois qui fait fureur avec son traitement par les fluides. Alexandre-Joseph, qui sent le bon coup, va parvenir à le persuader de l'embaucher comme assistant. Mais la fortune qu'il attend de cet emploi tarde à venir. Qu'à cela ne tienne ! Dans le tourbillon d'idées nouvelles qui électrisent Paris à la fin du XVIIIe siècle, il va vite trouver un autre moyen de réussir. Il a en effet fait la connaissance d'un homme féru de sciences, le marquis de Faverolles, qui le fascine par ses trouvailles. À ses côtés, il découvre certaines applications dans le domaine de l'optique et s'imagine déjà riche en développant une invention propre à déplacer les foules, sorte d'ancêtre de la photographie, mêlant art et lumière. Avec son nouveau protecteur et amant, il imagine un bâtiment circulaire qui, éclairé de manière ciblée, donnerait littéralement au visiteur l'impression d'entrer dans le décor. La construction de ce qu'il nomme Panthéome va alors occuper toutes ses journées. Il va trouver artistes et architectes de renom, maître d'oeuvre, maçon et charpentier afin d'ériger cet édifice révolutionnaire. Ce dernier qualificatif va toutefois faire capoter le projet. Car les ouvriers délaissent le chantier pour aller détruire un autre édifice. Nous sommes le 14 juillet 1789 et la prise de la Bastille marque le début de la Révolution française.
Notre aventurier ne voit toutefois dans cet assaut qu'un fâcheux contretemps et décide de mettre à profit cette parenthèse pour exercer ses talents d'espion à Londres. Une activité lucrative, car il en profite de ses traversées pour faire de la contrebande. Incidemment, il entend parler du Panorama et se dit que son Panthéome y ressemble furieusement. Soupçonnant le plagiat, il va voir toutes ses illusions et ses rêves de gloire s'envoler lorsqu'il remet les pieds en France.
Comme dans Torrentius, Colin Thibert mêle avec bonheur le romanesque et L Histoire. Fort bien documenté, il nous entraîne avec gourmandise dans cette époque frénétique où les idées volent aussi vite que les têtes, où l'aristocratie voit s'envoler tous ses pouvoirs et où les rêves de gloire s'envolent en fumée. le style est allègre, le rythme entraînant, l'humour dispensé avec finesse. Alors même le drame prend des allures de joyeuse épopée !
Lien : https://collectiondelivres.w..
Le chevalier fracassé confirme mon coup de coeur pour Colin Thibert qui navigue avec virtuosité dans plusieurs univers pas si éloignés que cela d'ailleurs. Après le récit des mésaventures hilarantes de trois bras cassés dans Mon frère ce zéro, il nous raconte une nouvelle fois les aventures d'un anti-héros bien sympathique mais cette fois-ci au XVIIIE siècle.
Alexandre-Joseph, fougueux jeunot séduisant, est contraint de quitter sa région et sa famille suite à un malencontreux coup de sang. Cet événement inattendu va le conduire - et il en est plutôt ravi à défaut d'en être marri - à changer d'identité - le chevalier Vesperelli, ça en jette, se dit-il.
Nouvelle vie (adieu les injonctions paternelles) pour notre héros qui va se retrouver embarqué vers des aventures qu'il ne maîtrisera pas toujours - et c'est tant mieux pour le lecteur - au regard des évènements qui l'entourent. Car, après avoir été espion malgré lui, le voici, encore une fois malgré lui, amant d'un vieux marquis excentrique, fréquentation ō combien dangereuse dans ces temps où ça chauffait pour les aristocrates et leurs sympathisants.
Un roman historique avec pour (anti-)héros un personnage attachant. Des dialogues pleins de verve. Un style parfait. Tout pour plaire.
Merci aux éditions Héroïnes d'Ormesson et à la Masse Critique de Babelio de m'avoir permis de découvrir ce très bon roman.
Alexandre-Joseph, fougueux jeunot séduisant, est contraint de quitter sa région et sa famille suite à un malencontreux coup de sang. Cet événement inattendu va le conduire - et il en est plutôt ravi à défaut d'en être marri - à changer d'identité - le chevalier Vesperelli, ça en jette, se dit-il.
Nouvelle vie (adieu les injonctions paternelles) pour notre héros qui va se retrouver embarqué vers des aventures qu'il ne maîtrisera pas toujours - et c'est tant mieux pour le lecteur - au regard des évènements qui l'entourent. Car, après avoir été espion malgré lui, le voici, encore une fois malgré lui, amant d'un vieux marquis excentrique, fréquentation ō combien dangereuse dans ces temps où ça chauffait pour les aristocrates et leurs sympathisants.
Un roman historique avec pour (anti-)héros un personnage attachant. Des dialogues pleins de verve. Un style parfait. Tout pour plaire.
Merci aux éditions Héroïnes d'Ormesson et à la Masse Critique de Babelio de m'avoir permis de découvrir ce très bon roman.
Lors de la dernier masse critique, j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour ce petit roman d'aventures qui se passe en France pendant les événements liés à la révolution française.
Alexandre-Joseph, beau jeune homme de province est à la suite d'un accident malheureux contraint de fuir sa ville pour la capitale. Loin de se laisser abattre, il y voit l'occasion de mener enfin la vie à laquelle il aspire.
Décrit comme extrêmement beau et intelligent, il n'aura de cesse de manoeuvrer, manipuler et comploter auprès des riches puissants pour atteindre ses objectifs de gloire et fortune !
Un personnage détestable ? Et bien non, justement pas.Malgré tous ses défauts, celui qui va réussir à devenir le chevalier Vesperelli, est un personnage attachant, qui a su garder une part de naïveté et être à la fois moteur et soumis aux événements qui vont se jouer. Entouré d'une galerie de personnage haut en couleur, on ne peut que se prendre d'affection pour lui et le soutenir dans ses aventures.
D'autant plus, qu'aux moments les plus sombres de l'histoire, il va savoir faire preuve de compassion... Même si celle-ci débouchera sur quelque chose de moins heureux.
Une chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est qu'il y a une bonne dose de comique sous-jacent à pas mal de situation : la description de certains personnages joyeusement égratignés, les mesquineries des uns et des autres...
Les événements tragiques du roman sont également traités de cette manière, ce qui donne une certaine légèreté aux situations et en ôte (presque) toute horreur. Cette construction m'a beaucoup plu.
Le livre est court (200 pages seulement) mais extrêmement riche en termes de scénario. J'ai beaucoup apprécié que l'auteur grâce à si peu de mots puisse arriver à transmettre au lecteur autant de choses.
A aucun moment, je me suis ennuyée, la construction du roman va à l'essentiel, mais arrive à nous embarquer complètement dans le récit.
La plume de l'auteur est fabuleuse, avec une grande richesse, ou chaque mot choisi semble avoir été mûrement réfléchi. Il y a presque une sonorité poétique dans certaines phrases.
Je l'ai lu quasiment d'une traite et j'ai adoré ! J'ai passé un excellent moment.
Merci aux Éditions Héloïse d'Ormesson et à Babélio.
Alexandre-Joseph, beau jeune homme de province est à la suite d'un accident malheureux contraint de fuir sa ville pour la capitale. Loin de se laisser abattre, il y voit l'occasion de mener enfin la vie à laquelle il aspire.
Décrit comme extrêmement beau et intelligent, il n'aura de cesse de manoeuvrer, manipuler et comploter auprès des riches puissants pour atteindre ses objectifs de gloire et fortune !
Un personnage détestable ? Et bien non, justement pas.Malgré tous ses défauts, celui qui va réussir à devenir le chevalier Vesperelli, est un personnage attachant, qui a su garder une part de naïveté et être à la fois moteur et soumis aux événements qui vont se jouer. Entouré d'une galerie de personnage haut en couleur, on ne peut que se prendre d'affection pour lui et le soutenir dans ses aventures.
D'autant plus, qu'aux moments les plus sombres de l'histoire, il va savoir faire preuve de compassion... Même si celle-ci débouchera sur quelque chose de moins heureux.
Une chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est qu'il y a une bonne dose de comique sous-jacent à pas mal de situation : la description de certains personnages joyeusement égratignés, les mesquineries des uns et des autres...
Les événements tragiques du roman sont également traités de cette manière, ce qui donne une certaine légèreté aux situations et en ôte (presque) toute horreur. Cette construction m'a beaucoup plu.
Le livre est court (200 pages seulement) mais extrêmement riche en termes de scénario. J'ai beaucoup apprécié que l'auteur grâce à si peu de mots puisse arriver à transmettre au lecteur autant de choses.
A aucun moment, je me suis ennuyée, la construction du roman va à l'essentiel, mais arrive à nous embarquer complètement dans le récit.
La plume de l'auteur est fabuleuse, avec une grande richesse, ou chaque mot choisi semble avoir été mûrement réfléchi. Il y a presque une sonorité poétique dans certaines phrases.
Je l'ai lu quasiment d'une traite et j'ai adoré ! J'ai passé un excellent moment.
Merci aux Éditions Héloïse d'Ormesson et à Babélio.
Bonheur de voir le roman historique revenir doucement à la mode! L'écriture du chevalier fracassé est une réussite. A la fois classique et sarcastique, elle dépoussière l'époque de la Révolution avec cruauté. Un roman ramassé, qui se lit d'une traite et on quitte le beau chevalier avec tristesse.
Je remercie tout d'abord La Masse critique de Babelio et les éditions Heloïse d'Ormesson pour l'envoi du roman "le chevalier fracassé".
C'est l'histoire d'un séduisant aventurier qui rêve de fortune facile, alors que la France bascule dans l'époque tourmentée et violente de la Révolution de 1789.
Alexandre-Joseph est un jeune homme issu d'une famille aisée de Neufchâtel, aux moeurs légères, qui commet un crime. de là, on suit ses aventures à Paris sous l'identité d'Alessandro, en tant qu'espion auprès du médecin Mesmer, de Mme de Vaupertuis, et enfin en tant que chevalier auprès du marquis de Faverolles.
Le jeune homme est ambitieux et s'apprête à lancer un projet imaginé par l'excentrique marquis de Faverolles, mais la Révolution, telle une faucheuse, va réduire ses espoirs à néant et le faire revenir au bercail, sans le sous, et la gueule "fracassée"...
On suit l'évolution d'un "anti-héros", sans états d'âme et cherchant la facilité, auxquelles les circonstances vont donner plus de consistance et un peu plus d'humanité.
Je n'ai pas particulièrement accroché, je m'attendais à plus de rebondissements compte tenu de la période historique choisie, la Révolution, et une approche plus psychologique des personnages.
C'est l'histoire d'un séduisant aventurier qui rêve de fortune facile, alors que la France bascule dans l'époque tourmentée et violente de la Révolution de 1789.
Alexandre-Joseph est un jeune homme issu d'une famille aisée de Neufchâtel, aux moeurs légères, qui commet un crime. de là, on suit ses aventures à Paris sous l'identité d'Alessandro, en tant qu'espion auprès du médecin Mesmer, de Mme de Vaupertuis, et enfin en tant que chevalier auprès du marquis de Faverolles.
Le jeune homme est ambitieux et s'apprête à lancer un projet imaginé par l'excentrique marquis de Faverolles, mais la Révolution, telle une faucheuse, va réduire ses espoirs à néant et le faire revenir au bercail, sans le sous, et la gueule "fracassée"...
On suit l'évolution d'un "anti-héros", sans états d'âme et cherchant la facilité, auxquelles les circonstances vont donner plus de consistance et un peu plus d'humanité.
Je n'ai pas particulièrement accroché, je m'attendais à plus de rebondissements compte tenu de la période historique choisie, la Révolution, et une approche plus psychologique des personnages.
Citations et extraits (4)
Ajouter une citation
Victime d’un succès croissant, Mesmer se met en quête de locaux plus spacieux. Il les trouve en l’hôtel Bullion, à l’angle des rues Coq-Héron et Orléans-Saint-Honoré. Il y fait installer la première des quatre machines qu’un ébéniste et un serrurier ont fabriquées d’après ses plans. Imaginez un large baquet octogonal, constitué de panneaux de noyer vernis, doublé de feuilles d’étain. Au centre, dissimulée aux regards, une grosse bouteille de Leyde reposant sur une couche de verre pilé et de limaille de fer, entourée d’autres flacons plus petits, remplis jusqu’au goulot d’eau magnétisée ; des bouquets d’hysope et de lavande – deux plantes connues pour accroître les effets bénéfiques de l’électricité – complètent le dispositif. Ce baquet est hérissé de tiges métalliques recourbées ; il en sort aussi des cordes, dont une extrémité baigne dans ce liquide chargé d’ions. On peut appliquer les premières sur les organes ou les membres douloureux ; les secondes servent à relier entre eux les patients, de sorte que le fluide universel les irrigue tous de manière égale.
Grave et concentré, le médecin va de l’un à l’autre pour pratiquer ses « passes ». Elles ne sont pas sans rappeler les gracieux mouvements du toréador. Mesmer effleure les cous, les épaules, les ventres et les gorges. Sous l’effet de ces caresses virtuelles, certains patients gémissent, d’autres frissonnent, tressautent, d’autres encore claquent des dents, convulsent ou éclatent d’un rire démoniaque : le baquet thérapeutique devient alors chaudron de sorcière.
Alessandro suggère quelques améliorations.
– L’on gagnerait à obscurcir un peu la pièce, avance-t-il. Les prêtres savent depuis longtemps qu’un demi-jour est propice au recueillement, qu’il exalte le mystère. De plus, certains débordements s’accommoderaient mieux d’un peu d’obscurité…
– Bien raisonné, mon ami ! le félicite Mesmer.
Il fait exécuter, dans un beau velours d’Utrecht couleur parme, d’épaisses tentures dont on voilera les fenêtres. Alessandro invite ensuite le patron à troquer son modeste habit vert-de-gris contre un costume de soie lilas ; il prétend même le coiffer d’un chapeau pointu. Mesmer se rebiffe :
– Je suis médecin, pas saltimbanque !
– Croyez-moi, monsieur, un tel accessoire fera forte impression, l’assure Alessandro.
Grave et concentré, le médecin va de l’un à l’autre pour pratiquer ses « passes ». Elles ne sont pas sans rappeler les gracieux mouvements du toréador. Mesmer effleure les cous, les épaules, les ventres et les gorges. Sous l’effet de ces caresses virtuelles, certains patients gémissent, d’autres frissonnent, tressautent, d’autres encore claquent des dents, convulsent ou éclatent d’un rire démoniaque : le baquet thérapeutique devient alors chaudron de sorcière.
Alessandro suggère quelques améliorations.
– L’on gagnerait à obscurcir un peu la pièce, avance-t-il. Les prêtres savent depuis longtemps qu’un demi-jour est propice au recueillement, qu’il exalte le mystère. De plus, certains débordements s’accommoderaient mieux d’un peu d’obscurité…
– Bien raisonné, mon ami ! le félicite Mesmer.
Il fait exécuter, dans un beau velours d’Utrecht couleur parme, d’épaisses tentures dont on voilera les fenêtres. Alessandro invite ensuite le patron à troquer son modeste habit vert-de-gris contre un costume de soie lilas ; il prétend même le coiffer d’un chapeau pointu. Mesmer se rebiffe :
– Je suis médecin, pas saltimbanque !
– Croyez-moi, monsieur, un tel accessoire fera forte impression, l’assure Alessandro.
(Les premières pages du livre)
UN ÉPAIS COUSSIN DE BRUME stagne au fond du vallon. Les mélèzes suintent, le sol est détrempé, le jour peine à se lever. Au premier étage de la ferme d’Abram Bourquin, un volet s’ouvre en grinçant. Apparaissent une jambe, une seconde, puis le corps entier d’un jeune homme qui porte des souliers à boucle, des bas, une culotte et une veste de bonne coupe. Un gilet brodé, or et magenta, apporte une note vive dans un tableau presque uniformément gris. Son visage est encadré par une abondante chevelure brune, sa peau mate, ses cils aussi longs que ceux d’une fille. Il s’assoit sur l’appui de la fenêtre, prêt à se laisser choir, une toise et demie plus bas, dans l’épaisse couche de fumier qui tapisse le sol. Deux bras viennent alors ceindre son torse. Deux bras aussi blancs que dodus, ceux de Rosalie, la fille unique d’Abram Bourquin. Ployant le cou, qu’il a long et gracieux, le garçon roule à la belle une ultime et savante galoche avant de sauter, d’un bond leste, dans la cour. Rosalie incline le buste – découvrant généreusement sa gorge dans le mouvement –, et, du bout des doigts, lui envoie une pluie de baisers.
– Reviens-moi vite, mon chéri !
Le chéri emporte avec lui cette vision exquise. Il se hâte. Le sentier qu’il suit est incertain, ses élégants souliers glissent dans la boue, prennent l’eau. « À l’orée du bois, lui a précisé Rosalie, tu tomberas sur le chemin, tu prends à main gauche, tu seras à Neuchâtel en une heure. » La pauvre fille ne pouvait se douter que son père, armé de sa fourche et d’une sainte colère, se tiendrait en embuscade, attendant le séducteur de pied ferme.
Abram Bourquin est un homme aussi austère, aussi rugueux que cette terre truffée de cailloux à laquelle il arrache, jour après jour, sa subsistance. Il pratique une religion sans nuances et sans fioritures. La Bible lui tient lieu de viatique pour son voyage terrestre. Il abhorre le péché et craint Dieu dont il se réjouit, néanmoins, d’intégrer le royaume. Il y est attendu à bras ouverts, mais n’anticipons pas.
Dans l’immédiat, Abram Bourquin lance un échantillon profus d’anathèmes et de malédictions, agitant sa fourche comme Poséidon son trident. Le spectacle serait comique si le bonhomme n’était pas résolu à clouer le godelureau au tronc du premier résineux venu, et à punir sa pécheresse de fille comme il convient : « On fera sortir la jeune femme à l’entrée de la maison de son père ; elle sera lapidée par les gens de la ville, et elle mourra, parce qu’elle a commis une infamie en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » (Deutéronome, 22:21) À moins qu’il ne décide de la livrer aux flammes : « Environ trois mois après, on vint dire à Juda : Tamar, ta belle-fille, s’est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Juda dit : Faites-la sortir, et qu’elle soit brûlée. » (Genèse, 38:24)
– Monsieur ! Monsieur ! plaide le jeune homme, sautillant de gauche et de droite pour esquiver les dents de l’instrument avec lequel l’autre s’efforce de l’embrocher. De grâce !
Mais rien ni personne ne saurait fléchir la détermination de Bourquin qui entend faire honneur à son prénom. L’amant de sa fille est, par chance, souple et vif. Et comme il connaît le Livre aussi bien que son adversaire, il lance :
– Souvenez-vous que « la colère de l’homme n’accomplit pas la justice de Dieu ! » (Jacques, 1:19-20)
– Comment oses-tu ?! répète Bourquin, outré de voir le débauché lui rendre, en quelque sorte, la monnaie de sa pièce.
– « L’homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante sicles d’argent ; et, parce qu’il l’a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer, tant qu’il vivra » (Deutéronome, 22:29), poursuit le suborneur. Je l’épouserai ! Je vous le promets !
Ce mensonge patent déchaîne la fureur d’Abram Bourquin qui réplique en poussant une sorte de mugissement :
– « Écarte de ta bouche la fausseté, Éloigne de tes lèvres les détours. » (Proverbes, 4:24)
– Entre personnes de bonne volonté, l’on peut toujours s’entendre, insiste le jeune homme. Mon père possède quelque bien, il vous dédommagera.
– « Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse ! » (Jérémie, 9:23), réplique Abram. Les dents de l’instrument griffent la veste, y causant une longue déchirure. Bourquin ajoute pour faire bon poids :
– « Tu ne recevras point de présent ; car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. » (Exode, 23:8)
Lancée d’un bras qu’anime un juste courroux, la fourche se plante alors en vibrant dans un épicéa, libérant une averse de gouttelettes. Tandis qu’Abram s’efforce de récupérer son arme fichée dans l’écorce, le jeune homme se résout à exhiber la sienne : un pistolet moins gros qu’une tabatière, un joujou, dans lequel il introduit, d’une main tremblante, la poudre et une balle de plomb qu’il tasse fébrilement avec l’écouvillon. Abram, dans l’intervalle, est parvenu à récupérer l’instrument dont il menace à nouveau le suborneur.
– « Ils répondirent : il mérite la mort ! » (Matthieu, 26:66), hurle-t-il.
Il découvre alors, braqué sur lui, le pistolet. Le jeune homme a relevé le chien, saupoudré le bassinet d’une pincée de poudre noire.
– Reculez ou je tire ! menace-t-il.
Face à cette arme miniature, à ce freluquet habillé comme une gravure de mode qui doit peser moitié moins que lui et qui prétend l’intimider, l’ombre d’un sourire éclaire le visage sévère et barbu du paysan-prophète. Si ce n’était péché, il rirait. Au lieu de quoi, il brandit sa fourche. Le jeune homme appuie sur la détente. Une détonation sèche, le coup part ; considérant l’humidité ambiante, on pourrait presque parler de miracle. La balle frappe Bourquin entre les deux yeux. Il fronce les sourcils, comme s’il cherchait dans sa mémoire un verset de circonstance, n’en trouve pas, vacille et s’effondre.
– Monsieur ? Oh ! Monsieur Bourquin ? Monsieur ?
Alexandre-Joseph Martinet-Dubied a gagné ce pistolet à l’issue d’une partie de piquet, il ne s’en était encore jamais servi ; qui plus est, il n’a jamais tué qui que ce soit, il manque donc singulièrement de pratique. Circonspect, il se penche sur le gros homme inerte. Se peut-il que la vie soit vraiment en train de s’échapper par ce trou minuscule qui saigne à peine ? Il y aurait là, sans doute, matière à philosopher, mais la situation ne s’y prête guère. Alexandre-Joseph s’éloigne à grandes enjambées du lieu de son crime, l’esprit en tumulte. Quoique pauvre, Bourquin est honorablement connu ; sa mort brutale va en choquer plus d’un, une enquête sera diligentée. Qui sait si le jeune homme n’a pas été aperçu se glissant, au crépuscule, dans la ferme des Bourquin. Qui sait si Rosalie, sous le coup de la peur ou du chagrin, ne le trahira pas ? Je suis dans de très sales draps ! frissonne Alexandre-Joseph, conscient que sa réputation de noceur va lui nuire et que ni l’argent, ni la notoriété de son père ne le sauveront de la prison, voire du gibet. Trébuchant et glissant dans le sentier bourbeux, il tente d’élaborer un plan de conduite.
2
L’IMPRIMERIE MARTINET-DUBIED est installée dans les anciens locaux d’un vigneron, faubourg de l’hôpital. Les presses ont remplacé les foudres, l’odeur de l’encre a supplanté, progressivement, celle des moûts. Les volumes imprimés sont reliés sur place et mis en caisses avant d’être acheminés en France par des chemins détournés, car Louis Martinet-Dubied publie, pour l’essentiel, une littérature subversive, de ces brûlots politiques qui, tôt ou tard, finiront par mettre le feu aux poudres dans la France voisine. La ville de Neuchâtel est sous l’autorité du roi de Prusse qui ferme benoîtement les yeux parce que cette activité lui rapporte des taxes ; et puis, dans la mesure où ça contrarie le roi de France, il serait dommage de s’en priver. Frédéric II se contente d’interdire que l’on appose le nom de la ville au frontispice de ces ouvrages séditieux, il a une réputation à tenir.
Louis Martinet-Dubied n’est pas seulement imprimeur. Il exploite des vignobles, il a créé une fabrique d’indiennes, il a investi des fonds dans diverses affaires bancaires et siège au Petit Conseil, c’est dire l’importance du personnage. Depuis la mort de son épouse, sa vie est exclusivement consacrée au travail, il ne débande jamais, il aura tout le temps de se reposer une fois au paradis. En gestionnaire avisé, Louis a d’ailleurs planifié l’avenir : Pierre-Louis et Claude-Henri, les aînés, dirigeront les entreprises, on cherchera de solides partis pour Jeanne et Agathe, quant à Alexandre-Joseph, le petit dernier, il le verrait bien dans la finance, à Paris, ou à Londres. Mais jusqu’à présent, le garçon a déçu les attentes de son père : au contraire de ses frères, blonds et sanguins comme lui, il a hérité de la beauté brune et délicate de feue sa mère, de son tempérament imprévisible. Là où les deux aînés tracent droit leur sillon, comme les bœufs dont ils ont la patience et la lourdeur, Alexandre-Joseph papillonne. Imperméable à la crainte du Jugement qu’on lui a pourtant inculquée depuis sa plus tendre enfance, il n’en fait qu’à sa tête et il apparaît que cette tête est aussi légère que ses mœurs. Le gamin ne pense qu’à s’amuser, à courir les jupons, dans un pays où plane encore l’ombre des réformateurs. « Il est impossible qu’il n’arrive pas des scandales ; mais malheur à celui par qui ils arrivent ! » (Luc 17:1) Un jour ou l’autre, a prédit Louis, ça lui attirera des ennuis. Ce jour est arrivé.
Alexandre-Joseph comptait regagner ses appartements en toute discrétion pour remettre un peu d’ordre dans sa tenue autant que dans ses idées. C’est raté. À peine a-t-il gravi quelques marches de l’escalier que son père se dresse devant lui :
– D’où viens-tu ? Qu’est-il arrivé à tes vêtements ?
Le jeune homme rougit, c’est sa faiblesse. Ce qui ne l’empêche pas de mentir :
– J’herborisais, papa. (La maison Martinet-Dubied vient de
UN ÉPAIS COUSSIN DE BRUME stagne au fond du vallon. Les mélèzes suintent, le sol est détrempé, le jour peine à se lever. Au premier étage de la ferme d’Abram Bourquin, un volet s’ouvre en grinçant. Apparaissent une jambe, une seconde, puis le corps entier d’un jeune homme qui porte des souliers à boucle, des bas, une culotte et une veste de bonne coupe. Un gilet brodé, or et magenta, apporte une note vive dans un tableau presque uniformément gris. Son visage est encadré par une abondante chevelure brune, sa peau mate, ses cils aussi longs que ceux d’une fille. Il s’assoit sur l’appui de la fenêtre, prêt à se laisser choir, une toise et demie plus bas, dans l’épaisse couche de fumier qui tapisse le sol. Deux bras viennent alors ceindre son torse. Deux bras aussi blancs que dodus, ceux de Rosalie, la fille unique d’Abram Bourquin. Ployant le cou, qu’il a long et gracieux, le garçon roule à la belle une ultime et savante galoche avant de sauter, d’un bond leste, dans la cour. Rosalie incline le buste – découvrant généreusement sa gorge dans le mouvement –, et, du bout des doigts, lui envoie une pluie de baisers.
– Reviens-moi vite, mon chéri !
Le chéri emporte avec lui cette vision exquise. Il se hâte. Le sentier qu’il suit est incertain, ses élégants souliers glissent dans la boue, prennent l’eau. « À l’orée du bois, lui a précisé Rosalie, tu tomberas sur le chemin, tu prends à main gauche, tu seras à Neuchâtel en une heure. » La pauvre fille ne pouvait se douter que son père, armé de sa fourche et d’une sainte colère, se tiendrait en embuscade, attendant le séducteur de pied ferme.
Abram Bourquin est un homme aussi austère, aussi rugueux que cette terre truffée de cailloux à laquelle il arrache, jour après jour, sa subsistance. Il pratique une religion sans nuances et sans fioritures. La Bible lui tient lieu de viatique pour son voyage terrestre. Il abhorre le péché et craint Dieu dont il se réjouit, néanmoins, d’intégrer le royaume. Il y est attendu à bras ouverts, mais n’anticipons pas.
Dans l’immédiat, Abram Bourquin lance un échantillon profus d’anathèmes et de malédictions, agitant sa fourche comme Poséidon son trident. Le spectacle serait comique si le bonhomme n’était pas résolu à clouer le godelureau au tronc du premier résineux venu, et à punir sa pécheresse de fille comme il convient : « On fera sortir la jeune femme à l’entrée de la maison de son père ; elle sera lapidée par les gens de la ville, et elle mourra, parce qu’elle a commis une infamie en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » (Deutéronome, 22:21) À moins qu’il ne décide de la livrer aux flammes : « Environ trois mois après, on vint dire à Juda : Tamar, ta belle-fille, s’est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Juda dit : Faites-la sortir, et qu’elle soit brûlée. » (Genèse, 38:24)
– Monsieur ! Monsieur ! plaide le jeune homme, sautillant de gauche et de droite pour esquiver les dents de l’instrument avec lequel l’autre s’efforce de l’embrocher. De grâce !
Mais rien ni personne ne saurait fléchir la détermination de Bourquin qui entend faire honneur à son prénom. L’amant de sa fille est, par chance, souple et vif. Et comme il connaît le Livre aussi bien que son adversaire, il lance :
– Souvenez-vous que « la colère de l’homme n’accomplit pas la justice de Dieu ! » (Jacques, 1:19-20)
– Comment oses-tu ?! répète Bourquin, outré de voir le débauché lui rendre, en quelque sorte, la monnaie de sa pièce.
– « L’homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante sicles d’argent ; et, parce qu’il l’a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer, tant qu’il vivra » (Deutéronome, 22:29), poursuit le suborneur. Je l’épouserai ! Je vous le promets !
Ce mensonge patent déchaîne la fureur d’Abram Bourquin qui réplique en poussant une sorte de mugissement :
– « Écarte de ta bouche la fausseté, Éloigne de tes lèvres les détours. » (Proverbes, 4:24)
– Entre personnes de bonne volonté, l’on peut toujours s’entendre, insiste le jeune homme. Mon père possède quelque bien, il vous dédommagera.
– « Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse ! » (Jérémie, 9:23), réplique Abram. Les dents de l’instrument griffent la veste, y causant une longue déchirure. Bourquin ajoute pour faire bon poids :
– « Tu ne recevras point de présent ; car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. » (Exode, 23:8)
Lancée d’un bras qu’anime un juste courroux, la fourche se plante alors en vibrant dans un épicéa, libérant une averse de gouttelettes. Tandis qu’Abram s’efforce de récupérer son arme fichée dans l’écorce, le jeune homme se résout à exhiber la sienne : un pistolet moins gros qu’une tabatière, un joujou, dans lequel il introduit, d’une main tremblante, la poudre et une balle de plomb qu’il tasse fébrilement avec l’écouvillon. Abram, dans l’intervalle, est parvenu à récupérer l’instrument dont il menace à nouveau le suborneur.
– « Ils répondirent : il mérite la mort ! » (Matthieu, 26:66), hurle-t-il.
Il découvre alors, braqué sur lui, le pistolet. Le jeune homme a relevé le chien, saupoudré le bassinet d’une pincée de poudre noire.
– Reculez ou je tire ! menace-t-il.
Face à cette arme miniature, à ce freluquet habillé comme une gravure de mode qui doit peser moitié moins que lui et qui prétend l’intimider, l’ombre d’un sourire éclaire le visage sévère et barbu du paysan-prophète. Si ce n’était péché, il rirait. Au lieu de quoi, il brandit sa fourche. Le jeune homme appuie sur la détente. Une détonation sèche, le coup part ; considérant l’humidité ambiante, on pourrait presque parler de miracle. La balle frappe Bourquin entre les deux yeux. Il fronce les sourcils, comme s’il cherchait dans sa mémoire un verset de circonstance, n’en trouve pas, vacille et s’effondre.
– Monsieur ? Oh ! Monsieur Bourquin ? Monsieur ?
Alexandre-Joseph Martinet-Dubied a gagné ce pistolet à l’issue d’une partie de piquet, il ne s’en était encore jamais servi ; qui plus est, il n’a jamais tué qui que ce soit, il manque donc singulièrement de pratique. Circonspect, il se penche sur le gros homme inerte. Se peut-il que la vie soit vraiment en train de s’échapper par ce trou minuscule qui saigne à peine ? Il y aurait là, sans doute, matière à philosopher, mais la situation ne s’y prête guère. Alexandre-Joseph s’éloigne à grandes enjambées du lieu de son crime, l’esprit en tumulte. Quoique pauvre, Bourquin est honorablement connu ; sa mort brutale va en choquer plus d’un, une enquête sera diligentée. Qui sait si le jeune homme n’a pas été aperçu se glissant, au crépuscule, dans la ferme des Bourquin. Qui sait si Rosalie, sous le coup de la peur ou du chagrin, ne le trahira pas ? Je suis dans de très sales draps ! frissonne Alexandre-Joseph, conscient que sa réputation de noceur va lui nuire et que ni l’argent, ni la notoriété de son père ne le sauveront de la prison, voire du gibet. Trébuchant et glissant dans le sentier bourbeux, il tente d’élaborer un plan de conduite.
2
L’IMPRIMERIE MARTINET-DUBIED est installée dans les anciens locaux d’un vigneron, faubourg de l’hôpital. Les presses ont remplacé les foudres, l’odeur de l’encre a supplanté, progressivement, celle des moûts. Les volumes imprimés sont reliés sur place et mis en caisses avant d’être acheminés en France par des chemins détournés, car Louis Martinet-Dubied publie, pour l’essentiel, une littérature subversive, de ces brûlots politiques qui, tôt ou tard, finiront par mettre le feu aux poudres dans la France voisine. La ville de Neuchâtel est sous l’autorité du roi de Prusse qui ferme benoîtement les yeux parce que cette activité lui rapporte des taxes ; et puis, dans la mesure où ça contrarie le roi de France, il serait dommage de s’en priver. Frédéric II se contente d’interdire que l’on appose le nom de la ville au frontispice de ces ouvrages séditieux, il a une réputation à tenir.
Louis Martinet-Dubied n’est pas seulement imprimeur. Il exploite des vignobles, il a créé une fabrique d’indiennes, il a investi des fonds dans diverses affaires bancaires et siège au Petit Conseil, c’est dire l’importance du personnage. Depuis la mort de son épouse, sa vie est exclusivement consacrée au travail, il ne débande jamais, il aura tout le temps de se reposer une fois au paradis. En gestionnaire avisé, Louis a d’ailleurs planifié l’avenir : Pierre-Louis et Claude-Henri, les aînés, dirigeront les entreprises, on cherchera de solides partis pour Jeanne et Agathe, quant à Alexandre-Joseph, le petit dernier, il le verrait bien dans la finance, à Paris, ou à Londres. Mais jusqu’à présent, le garçon a déçu les attentes de son père : au contraire de ses frères, blonds et sanguins comme lui, il a hérité de la beauté brune et délicate de feue sa mère, de son tempérament imprévisible. Là où les deux aînés tracent droit leur sillon, comme les bœufs dont ils ont la patience et la lourdeur, Alexandre-Joseph papillonne. Imperméable à la crainte du Jugement qu’on lui a pourtant inculquée depuis sa plus tendre enfance, il n’en fait qu’à sa tête et il apparaît que cette tête est aussi légère que ses mœurs. Le gamin ne pense qu’à s’amuser, à courir les jupons, dans un pays où plane encore l’ombre des réformateurs. « Il est impossible qu’il n’arrive pas des scandales ; mais malheur à celui par qui ils arrivent ! » (Luc 17:1) Un jour ou l’autre, a prédit Louis, ça lui attirera des ennuis. Ce jour est arrivé.
Alexandre-Joseph comptait regagner ses appartements en toute discrétion pour remettre un peu d’ordre dans sa tenue autant que dans ses idées. C’est raté. À peine a-t-il gravi quelques marches de l’escalier que son père se dresse devant lui :
– D’où viens-tu ? Qu’est-il arrivé à tes vêtements ?
Le jeune homme rougit, c’est sa faiblesse. Ce qui ne l’empêche pas de mentir :
– J’herborisais, papa. (La maison Martinet-Dubied vient de
Si extravagant soit-il, le costume est l'expression du pouvoir. Il l'assoit, il le pérennise. Voyez le pape et ses cardinaux : la tiare pontificale, les mitres, les dalmatiques chamarrées, les chasubles brodées ! Quel accoutrement ! Personne, pourtant, ne songerait à en rire.
Si extravagant soit-il, le costume est l'expression du pouvoir. Il l'assoit, il le pérennise. Voyez le pape et ses cardinaux : la tiare pontificale, les mitres, les dalmatiques chamarrées, les chasubles brodées ! Quel accoutrement ! Personne, pourtant, ne songerait à en rire.
Videos de Colin Thibert (22)
Voir plusAjouter une vidéo
Colin-Thibert vous présente son ouvrage "Une saison à Montparnasse" aux éditions Héloïse d'Ormesson.
Retrouvez le livre : https://www.mollat.com/livres/3047604/colin-thibert-une-saison-a-montparnasse
Note de musique : © mollat Sous-titres générés automatiquement en français par YouTube.
Visitez le site : http://www.mollat.com/ Suivez la librairie mollat sur les réseaux sociaux : Instagram : https://instagram.com/librairie_mollat/ Facebook : https://www.facebook.com/Librairie.mollat?ref=ts Twitter : https://twitter.com/LibrairieMollat Linkedin : https://www.linkedin.com/in/votre-libraire-mollat/ Soundcloud: https://soundcloud.com/librairie-mollat Pinterest : https://www.pinterest.com/librairiemollat/ Vimeo : https://vimeo.com/mollat
Retrouvez le livre : https://www.mollat.com/livres/3047604/colin-thibert-une-saison-a-montparnasse
Note de musique : © mollat Sous-titres générés automatiquement en français par YouTube.
Visitez le site : http://www.mollat.com/ Suivez la librairie mollat sur les réseaux sociaux : Instagram : https://instagram.com/librairie_mollat/ Facebook : https://www.facebook.com/Librairie.mollat?ref=ts Twitter : https://twitter.com/LibrairieMollat Linkedin : https://www.linkedin.com/in/votre-libraire-mollat/ Soundcloud: https://soundcloud.com/librairie-mollat Pinterest : https://www.pinterest.com/librairiemollat/ Vimeo : https://vimeo.com/mollat
+ Lire la suite
autres livres classés : révolution françaiseVoir plus
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Colin Thibert (27)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Le bus 666 de Colin Thibert
Comment s'appelle le personnage principale ?
Chloé
Zorgo
Alice
Agathe
4 questions
12 lecteurs ont répondu
Thème : Le bus 666 de
Colin ThibertCréer un quiz sur ce livre12 lecteurs ont répondu