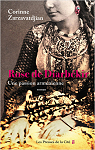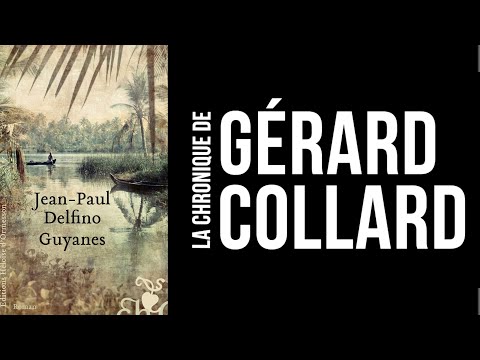Jean-Paul Delfino/5
58 notes
Résumé :
Paris, 1870. Clara, gamine de quinze ans, est cueillie sur les barricades de la Commune et condamnée comme pétroleuse à huit ans de bagne.
Au même moment, Mané, esclave, rentre de la guerre qui a opposé le Brésil au Paraguay. L’empereur Dom Pedro II lui a promis la liberté. Il n’a pas tenu parole. Mané s’enfuit donc vers cette terre de liberté voisine, une terre nommée Guyane.
Alphonse de Saint-Cussien, rejeton d’une famille de parvenus, multiplie le... >Voir plus
Au même moment, Mané, esclave, rentre de la guerre qui a opposé le Brésil au Paraguay. L’empereur Dom Pedro II lui a promis la liberté. Il n’a pas tenu parole. Mané s’enfuit donc vers cette terre de liberté voisine, une terre nommée Guyane.
Alphonse de Saint-Cussien, rejeton d’une famille de parvenus, multiplie le... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après GuyanesVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (16)
Voir plus
Ajouter une critique
Clara, Mané et Alphonse font route vers la Guyane
Le souffle romanesque de Jean-Paul Delfino nous entraîne en Guyane à la fin du XIXe siècle. On y suit trois personnages bien décidés à ne pas subir le funeste sort qui leur est réservé, le bagne, l'esclavage et la ruine. Vous n'oublierez pas de sitôt Clara, Mané et Alphonse !
Le jury du Prix du livre de plage, présidé par Jean-Christophe Rufin, a eu l'excellente idée de choisir Jean-Paul Delfino comme lauréat 2023. Souhaitons que ce coup de projecteur, à la veille de l'été, permette à Guyanes de devenir LE roman de cet été. Il serait bien dommage en effet de le voir disparaitre des étals à la rentrée sans avoir trouvé son public, car ce roman entier, total plaira, j'en suis sûr, à tous ceux qui l'ouvriront. Ne vous effrayez pas de ces quelque 600 pages et laissez-vous entraîner dans ce récit historique plein de bruit et de fureur, page turner par excellence.
On commence par ici croiser Clara qui a eu la malchance de croire aux rêves nés sur les barricades de la Commune et qui a fini, à la suite d'une parodie de procès par être condamnée au bagne. On la retrouve, au milieu de ses compagnes d'infortune, sur la route qui la mène d'Aix-en-Provence au bagne de Toulon. Là elle fera la connaissance d'Amandine, une Martiniquaise qui envisage de fuir de Cayenne pour gagner sa terre natale et redonne de l'espoir à Clara au moment d'embarquer pour la Guyane. Lors de l'escale d'Alger les deux femmes seront toutefois séparées et Amandine prendra la direction de la Nouvelle-Calédonie.
Au même moment, à des milliers de kilomètres de là, on fait la connaissance de Mané. Enrôlé dans l'armée brésilienne, il rentre de la guerre du Paraguay avec la promesse d'être affranchi. Mais pour le frère de son Maître disparu, il n'est pas question d'honorer cette promesse. Il a besoin de ses esclaves et surtout de la force de travail de Mané. Mais ce dernier va faire une rencontre qui va changer sa vie. Au marché de São Luís, il fait la connaissance de la pétulante Matilda, qui va l'aider à se délester de ses chaînes. En lui offrant quelques heures de liberté, il va pouvoir s'enfuir et trouver un refuge provisoire sur la côte avant d'embarquer pour la Guyane. La France ayant aboli l'esclavage, il peut rêver de jours meilleurs.
Toujours au même moment, Alphonse de Saint-Cussien, le rejeton d'une famille ayant réussi à s'extraire de la misère par le négoce et un mariage bien arrangé, essaie de suivre la même recette. Il épouse la fille d'un riche propriétaire, mais ne tarde pas à dilapider sa nouvelle fortune au jeu. Acculé par les dettes, il entrevoit la possibilité de se refaire en fuyant ses créanciers. Muni d'un titre de propriété en Guyane, il embarque à Bordeaux pour ce nouvel Eldorado. Ses compagnons de voyage ne vont pourtant pas tarder à doucher ses espoirs, lui décrivant plutôt un enfer sur terre.
On l'aura compris, Clara, Mané et Alphonse vont finir par se croiser. Mais il aura fallu pour cela bien des péripéties. Clara, qui se refusait au marin qui la reluquait, a failli mourir avant de poser les pieds à Saint-Laurent du Maroni. Mané a trouvé Mariki lors de son voyage le long des côtes brésiliennes et en a fait sa femme. Il pensait s'arrêter en chemin et fonder une famille jusqu'au jour où il a assisté impuissant à l'assassinat de son amour par un groupe de soldats. Il a alors repris la route vers la Guyane et finira lui aussi à Saint-Laurent. Alphonse aura voyagé plus calmement jusqu'à Cayenne où il comprendra vite que son titre de propriété n'est que le résultat d'une escroquerie. Fort heureusement pour lui, on va lui offrir un poste d'administrateur.
Dans la seconde partie du roman, Jean-Paul Delfino va déployer son roman autour de ces trois destins, montrer combien la force de caractère – et les circonstances – peuvent transformer une vie, surtout sur des terres certes hostiles, mais où tout reste à écrire. Il faut aussi souligner qu'au fil des années et des difficultés rencontrées, chacun des trois personnages principaux de ce roman foisonnant aura mûri, beaucoup subi et sera passé très près du gouffre. Alors, lorsqu'enfin leurs chemins se croisent, ils ont appris de leurs erreurs passées. Et à profiter des circonstances. Loin de Paris, ils savent combien les décisions politiques sont susceptibles de se heurter au terrain et comment le besoin de développer la colonie française peut servir leur ambition, quitte à oublier les grands principes moraux. À moins qu'ils ne finissent par les rattraper…
Depuis Au bagne d'Albert Londres, on sait combien les conditions de détention et la vie des condamnés est difficile. Avec le Papillon d'Henri Charrière, on sait aussi combien il faut de force mentale pour se sortir d'un tel enfer. Si Jean-Paul Delfino s'appuie sur ces récits, il nous propose d'élargir la focale et d'ancrer son roman dans la plus vaste réalité de l'environnement extérieur, du voisin brésilien aux rêves de gloire des responsables politiques qui entendent profiter et développer un Empire qui est alors encore en développement. Avec lui, on comprend mieux les enjeux et on se retrouve, près d'un siècle et demi plus tard, à constater l'actualité des questions soulevées ici. Pour passe run excellent moment et pour ne pas bronzer idiot, pensez à Guyanes !
Lien : https://collectiondelivres.w..
Le souffle romanesque de Jean-Paul Delfino nous entraîne en Guyane à la fin du XIXe siècle. On y suit trois personnages bien décidés à ne pas subir le funeste sort qui leur est réservé, le bagne, l'esclavage et la ruine. Vous n'oublierez pas de sitôt Clara, Mané et Alphonse !
Le jury du Prix du livre de plage, présidé par Jean-Christophe Rufin, a eu l'excellente idée de choisir Jean-Paul Delfino comme lauréat 2023. Souhaitons que ce coup de projecteur, à la veille de l'été, permette à Guyanes de devenir LE roman de cet été. Il serait bien dommage en effet de le voir disparaitre des étals à la rentrée sans avoir trouvé son public, car ce roman entier, total plaira, j'en suis sûr, à tous ceux qui l'ouvriront. Ne vous effrayez pas de ces quelque 600 pages et laissez-vous entraîner dans ce récit historique plein de bruit et de fureur, page turner par excellence.
On commence par ici croiser Clara qui a eu la malchance de croire aux rêves nés sur les barricades de la Commune et qui a fini, à la suite d'une parodie de procès par être condamnée au bagne. On la retrouve, au milieu de ses compagnes d'infortune, sur la route qui la mène d'Aix-en-Provence au bagne de Toulon. Là elle fera la connaissance d'Amandine, une Martiniquaise qui envisage de fuir de Cayenne pour gagner sa terre natale et redonne de l'espoir à Clara au moment d'embarquer pour la Guyane. Lors de l'escale d'Alger les deux femmes seront toutefois séparées et Amandine prendra la direction de la Nouvelle-Calédonie.
Au même moment, à des milliers de kilomètres de là, on fait la connaissance de Mané. Enrôlé dans l'armée brésilienne, il rentre de la guerre du Paraguay avec la promesse d'être affranchi. Mais pour le frère de son Maître disparu, il n'est pas question d'honorer cette promesse. Il a besoin de ses esclaves et surtout de la force de travail de Mané. Mais ce dernier va faire une rencontre qui va changer sa vie. Au marché de São Luís, il fait la connaissance de la pétulante Matilda, qui va l'aider à se délester de ses chaînes. En lui offrant quelques heures de liberté, il va pouvoir s'enfuir et trouver un refuge provisoire sur la côte avant d'embarquer pour la Guyane. La France ayant aboli l'esclavage, il peut rêver de jours meilleurs.
Toujours au même moment, Alphonse de Saint-Cussien, le rejeton d'une famille ayant réussi à s'extraire de la misère par le négoce et un mariage bien arrangé, essaie de suivre la même recette. Il épouse la fille d'un riche propriétaire, mais ne tarde pas à dilapider sa nouvelle fortune au jeu. Acculé par les dettes, il entrevoit la possibilité de se refaire en fuyant ses créanciers. Muni d'un titre de propriété en Guyane, il embarque à Bordeaux pour ce nouvel Eldorado. Ses compagnons de voyage ne vont pourtant pas tarder à doucher ses espoirs, lui décrivant plutôt un enfer sur terre.
On l'aura compris, Clara, Mané et Alphonse vont finir par se croiser. Mais il aura fallu pour cela bien des péripéties. Clara, qui se refusait au marin qui la reluquait, a failli mourir avant de poser les pieds à Saint-Laurent du Maroni. Mané a trouvé Mariki lors de son voyage le long des côtes brésiliennes et en a fait sa femme. Il pensait s'arrêter en chemin et fonder une famille jusqu'au jour où il a assisté impuissant à l'assassinat de son amour par un groupe de soldats. Il a alors repris la route vers la Guyane et finira lui aussi à Saint-Laurent. Alphonse aura voyagé plus calmement jusqu'à Cayenne où il comprendra vite que son titre de propriété n'est que le résultat d'une escroquerie. Fort heureusement pour lui, on va lui offrir un poste d'administrateur.
Dans la seconde partie du roman, Jean-Paul Delfino va déployer son roman autour de ces trois destins, montrer combien la force de caractère – et les circonstances – peuvent transformer une vie, surtout sur des terres certes hostiles, mais où tout reste à écrire. Il faut aussi souligner qu'au fil des années et des difficultés rencontrées, chacun des trois personnages principaux de ce roman foisonnant aura mûri, beaucoup subi et sera passé très près du gouffre. Alors, lorsqu'enfin leurs chemins se croisent, ils ont appris de leurs erreurs passées. Et à profiter des circonstances. Loin de Paris, ils savent combien les décisions politiques sont susceptibles de se heurter au terrain et comment le besoin de développer la colonie française peut servir leur ambition, quitte à oublier les grands principes moraux. À moins qu'ils ne finissent par les rattraper…
Depuis Au bagne d'Albert Londres, on sait combien les conditions de détention et la vie des condamnés est difficile. Avec le Papillon d'Henri Charrière, on sait aussi combien il faut de force mentale pour se sortir d'un tel enfer. Si Jean-Paul Delfino s'appuie sur ces récits, il nous propose d'élargir la focale et d'ancrer son roman dans la plus vaste réalité de l'environnement extérieur, du voisin brésilien aux rêves de gloire des responsables politiques qui entendent profiter et développer un Empire qui est alors encore en développement. Avec lui, on comprend mieux les enjeux et on se retrouve, près d'un siècle et demi plus tard, à constater l'actualité des questions soulevées ici. Pour passe run excellent moment et pour ne pas bronzer idiot, pensez à Guyanes !
Lien : https://collectiondelivres.w..
Quelle belle surprise que ce roman ! de Delfino, j'avais déjà apprécié Assassins et, si je ne doutais pas, au regard de sa belle écriture, que Guyanes allait me procurer de bons moments de lecture, la découverte fut savoureuse et passionnante !
J'ai dévoré cette saga flamboyante qui mêle la grande histoire aux histoires intimes de trois personnages et apprécié la manière dont Delfino raconte la destinée de chacun d'eux, tout d'abord de manière individuelle jusqu'à les réunir par une construction narrative très judicieuse et romanesque.
Empruntant les ressorts des romans feuilletons du 19 ème siècle et leurs personnages bien typés et représentatifs de leurs microcosmes respectifs, Delfino insufle à son roman suspens et rebondissements.
Il y a Clara, une gamine de 15 ans, parisienne des faubourgs pauvres, digne héroïne de Zola. Avec son amoureux, elle a rejoint les combattants de la Commune. La voici maintenant enchaînée comme un animal, en route pour la Guyane, condamnée à huit longues années d'enfer au bagne, elle qui avait vécu cette révolution avant tout par amour, dans la joie, l'allégresse, sans aucune conscience politique.
Il y a Mané, jeune métis, esclave au Brésil. Toute la journée, il sue sang et eau dans les champs de coton. Il a combattu pour son pays contre le Paraguay. Malgré cela, la liberté qu'on lui avait promis à son retour était un leurre. Lui aussi, il est en route vers La Guyane ou, plus exactement, il fuit vers cette terre où l'esclavage a été aboli.
Il y a Alphonse, jeune homme issu d'une famille de parvenus. Digne personnage De Balzac, il a l'ambition de Rastignac sans le talent et se rapprocherait plutôt d'un Victorien d'Esprignon sans le prestige. Veule et intéressé, il fuit Paris, sa femme et sa belle-famille qu'il a ruinées à cause de son vice, le jeu.
Arrivés en Guyane après un long périple, ces trois personnages vont voir leurs destinées se télescoper par d'habiles péripéties. Des histoires d'amour lumineuses, douloureuses, des amitiés, des trahisons, des espoirs, des déceptions, il y a tout cela dans ce roman.
Le fil romanesque tissé par Delfino constitue une trame solide et passionnante. Outre son don de conteur, Delfino, en fin connaisseur du Brésil, et plus généralement de l'histoire du colonialisme et de l'asservissement des peuples les plus pauvres par les peuples les plus riches, raconte par le prisme du destin de Clara, Mané et Alphonse, la triste et sombre histoire de la Guyane, longtemps lieu de déportation des opposants politiques, petits délinquants, prostituées, et tout simplements des pauvres gens dont la Métropole voulait se débarrasser.
La misère, la crasse, la corruption, la violence qui régnaient dans ces geôles sont très bien décrites par Delfino. Rappelons que ces déportations n'ont pris fin qu'après la seconde guerre mondiale lors de la fermeture du bagne et, qu'aujourd'hui, la Guyane est le plus pauvre des départements français ou du moins il fait partie de ceux qui sont le plus en difficulté.
J'ai dévoré cette saga flamboyante qui mêle la grande histoire aux histoires intimes de trois personnages et apprécié la manière dont Delfino raconte la destinée de chacun d'eux, tout d'abord de manière individuelle jusqu'à les réunir par une construction narrative très judicieuse et romanesque.
Empruntant les ressorts des romans feuilletons du 19 ème siècle et leurs personnages bien typés et représentatifs de leurs microcosmes respectifs, Delfino insufle à son roman suspens et rebondissements.
Il y a Clara, une gamine de 15 ans, parisienne des faubourgs pauvres, digne héroïne de Zola. Avec son amoureux, elle a rejoint les combattants de la Commune. La voici maintenant enchaînée comme un animal, en route pour la Guyane, condamnée à huit longues années d'enfer au bagne, elle qui avait vécu cette révolution avant tout par amour, dans la joie, l'allégresse, sans aucune conscience politique.
Il y a Mané, jeune métis, esclave au Brésil. Toute la journée, il sue sang et eau dans les champs de coton. Il a combattu pour son pays contre le Paraguay. Malgré cela, la liberté qu'on lui avait promis à son retour était un leurre. Lui aussi, il est en route vers La Guyane ou, plus exactement, il fuit vers cette terre où l'esclavage a été aboli.
Il y a Alphonse, jeune homme issu d'une famille de parvenus. Digne personnage De Balzac, il a l'ambition de Rastignac sans le talent et se rapprocherait plutôt d'un Victorien d'Esprignon sans le prestige. Veule et intéressé, il fuit Paris, sa femme et sa belle-famille qu'il a ruinées à cause de son vice, le jeu.
Arrivés en Guyane après un long périple, ces trois personnages vont voir leurs destinées se télescoper par d'habiles péripéties. Des histoires d'amour lumineuses, douloureuses, des amitiés, des trahisons, des espoirs, des déceptions, il y a tout cela dans ce roman.
Le fil romanesque tissé par Delfino constitue une trame solide et passionnante. Outre son don de conteur, Delfino, en fin connaisseur du Brésil, et plus généralement de l'histoire du colonialisme et de l'asservissement des peuples les plus pauvres par les peuples les plus riches, raconte par le prisme du destin de Clara, Mané et Alphonse, la triste et sombre histoire de la Guyane, longtemps lieu de déportation des opposants politiques, petits délinquants, prostituées, et tout simplements des pauvres gens dont la Métropole voulait se débarrasser.
La misère, la crasse, la corruption, la violence qui régnaient dans ces geôles sont très bien décrites par Delfino. Rappelons que ces déportations n'ont pris fin qu'après la seconde guerre mondiale lors de la fermeture du bagne et, qu'aujourd'hui, la Guyane est le plus pauvre des départements français ou du moins il fait partie de ceux qui sont le plus en difficulté.
Tout le monde connait ce territoire français d'outre-mer qu'est la Guyane mais que sait-on de son histoire, de ses modes de vie et de son fonctionnement très particulier qui imposa une administration française aux populations locales.
Alors il faut se plonger dans ce grand roman historique que nous offre Jean-Paul Delfino pour tout découvrir et comprendre pourquoi ce pays de l'autre bout du monde qui possède tant de facettes, compose en fait plusieurs Guyanes.
Ce sont trois personnages qui partent en 1872 dans trois voyages totalement différents et vont converger vers un même endroit, Saint-Laurent-du-Maroni, après une succession d'événements s'inscrivant dans l'Histoire de cette colonisation.
Clara, jeune idéaliste originaire d'Aix en Provence, a été arrêtée à 18 ans pour sa participation dans la révolte de la Commune de Paris et se voit condamnée au bagne pour 8 ans d'exil.
Mané, un esclave noir de 24 ans, s'est échappé de sa plantation du Brésil et tente de rejoindre le territoire français.
Alphonse de Saint-Cussien, le jeune fils d'un marchand de vin, joueur et faiseur perclus de dettes, fuit la ville de Bordeaux et sa famille pour aller revendre une terre guyanaise dont il a hérité.
Ce grand roman d'aventure nous entraîne sur leurs traces, nous racontant aussi bien les incroyables voyages en bateau depuis le continent européen, le bagne des femmes appelé le Couvent, l'orpaillage sauvage le long du fleuve Lawa, la vie des indiens natifs d'Amazonie, les associations diverses entre trafiquants et les nombreuses dérives de l'administration coloniale.
Le voyage dans lequel nous embarquons, avec Guyanes, contient à lui tout seul un cocktail de sensations et de connaissances qui nous fait découvrir la vie au XIXème siècle de cette colonie.
Il m'a transportée avec passion dans ce petit territoire français d'Amérique du Sud et n'a pas fini de nourrir mes rêves des images, des odeurs et des goûts qui s'échappent de chaque page. J'ai laissé, au fil de l'histoire, mon imagination s'envoler vers cette lointaine contrée et je crois que je vais y rester encore un peu, totalement sous le charme de ce roman envoûtant.
Alors il faut se plonger dans ce grand roman historique que nous offre Jean-Paul Delfino pour tout découvrir et comprendre pourquoi ce pays de l'autre bout du monde qui possède tant de facettes, compose en fait plusieurs Guyanes.
Ce sont trois personnages qui partent en 1872 dans trois voyages totalement différents et vont converger vers un même endroit, Saint-Laurent-du-Maroni, après une succession d'événements s'inscrivant dans l'Histoire de cette colonisation.
Clara, jeune idéaliste originaire d'Aix en Provence, a été arrêtée à 18 ans pour sa participation dans la révolte de la Commune de Paris et se voit condamnée au bagne pour 8 ans d'exil.
Mané, un esclave noir de 24 ans, s'est échappé de sa plantation du Brésil et tente de rejoindre le territoire français.
Alphonse de Saint-Cussien, le jeune fils d'un marchand de vin, joueur et faiseur perclus de dettes, fuit la ville de Bordeaux et sa famille pour aller revendre une terre guyanaise dont il a hérité.
Ce grand roman d'aventure nous entraîne sur leurs traces, nous racontant aussi bien les incroyables voyages en bateau depuis le continent européen, le bagne des femmes appelé le Couvent, l'orpaillage sauvage le long du fleuve Lawa, la vie des indiens natifs d'Amazonie, les associations diverses entre trafiquants et les nombreuses dérives de l'administration coloniale.
Le voyage dans lequel nous embarquons, avec Guyanes, contient à lui tout seul un cocktail de sensations et de connaissances qui nous fait découvrir la vie au XIXème siècle de cette colonie.
Il m'a transportée avec passion dans ce petit territoire français d'Amérique du Sud et n'a pas fini de nourrir mes rêves des images, des odeurs et des goûts qui s'échappent de chaque page. J'ai laissé, au fil de l'histoire, mon imagination s'envoler vers cette lointaine contrée et je crois que je vais y rester encore un peu, totalement sous le charme de ce roman envoûtant.
1871, trois personnages se rendent en Guyane: Clara, la pétroleuse de 18 ans, condamnée à 8 ans de bagne pour avoir participé à la Commune, Mané, esclave Brésilien en fuite et Alfonse, petit bourgeois fuyant ses dettes de jeu. L'écriture n'est pas géniale, manque de tripas y corazon, trop distancée, trop académique. Et puis j'ai eu peur d'une intrigue à l'eau de rose, à la Ken Follett. En fait non, c'est bien. Je me suis finalement attachée à ces personnages. J'ai aimé l'histoire des communards, des bagnards, des esclaves, des libérés, des élites corrompues, des Indiens et même de la quinine. Une bonne expérience de lecture, dépaysante et instructive, divertissante aussi tout en étant crédible. le racisme décomplexé y est choquant mais rend compte d'une époque.
Je n'aime pas lorsque l'auteur se paye le lecteur et c'est le cas ici.
Autant de pages à vouloir brandir l'excuse au nom de l'Histoire et le tout sans y toucher, seulement du bout des doigts !
Gonflés d'arrogance les mots, les phrases, sans répit, toujours et encore "en veux-tu, en voilà", il s'écoute écrire ! Il se mire en écrivant !
Et ce style de plus en plus insupportable cuistre et condescendant, et les notes, la ribambelle de notes !
Cette "saga" n'a rien de flamboyant comme le stipule la 4ème de couverture, elle est partagée entre le lénifiant et le délirant.
Incapable d'une réelle investigation, ce roman dénonce et s'insurge, vite fait, comme un entrefilet dans le journal local.
N'est pas Albert Londres qui veut.
Et aller écrire un couplet de Brel, en introduction, la chanson "Et la ville s'endormait", écrite en Polynésie pour d'autres raisons, à une autre époque et dans d'autres circonstances bien évidemment, quel est le rapport ? Aucun, bien entendu.
L'irrespect va se nicher même là.
Inapte à choisir un écrit laissé parmi tous les Guyanais de toutes corporations confondues.
Autant de pages à vouloir brandir l'excuse au nom de l'Histoire et le tout sans y toucher, seulement du bout des doigts !
Gonflés d'arrogance les mots, les phrases, sans répit, toujours et encore "en veux-tu, en voilà", il s'écoute écrire ! Il se mire en écrivant !
Et ce style de plus en plus insupportable cuistre et condescendant, et les notes, la ribambelle de notes !
Cette "saga" n'a rien de flamboyant comme le stipule la 4ème de couverture, elle est partagée entre le lénifiant et le délirant.
Incapable d'une réelle investigation, ce roman dénonce et s'insurge, vite fait, comme un entrefilet dans le journal local.
N'est pas Albert Londres qui veut.
Et aller écrire un couplet de Brel, en introduction, la chanson "Et la ville s'endormait", écrite en Polynésie pour d'autres raisons, à une autre époque et dans d'autres circonstances bien évidemment, quel est le rapport ? Aucun, bien entendu.
L'irrespect va se nicher même là.
Inapte à choisir un écrit laissé parmi tous les Guyanais de toutes corporations confondues.
critiques presse (1)
Une fresque historique plantée dans la Guyane des années 1870.
Lire la critique sur le site : LeFigaro
Citations et extraits (9)
Voir plus
Ajouter une citation
Vue du ciel, Saint-Laurent-du-Maroni faisait tout pour se donner une allure de ville métropole.Créée de toutes pièces en 1858 par le gouverneur Laurent Baudin, la cité ne comptait encore, en 1872, que quelques centaines d'habitants, tous liés par le grand projet mis en place sous le Second Empire : débarrasser la métropole de ses indésirables, que ceux-ci fussent prisonniers politiques, de droit commun ou simples récidivistes.Une expérience similaire avait été prise en exemple. Pour nettoyer Londres de ce que l'Angleterre qualifiait de rebuts de sa société, la Couronne britannique avait porté son dévolu sur l'Australie, terre coloniale. Là-bas, dans le lieu-dit de Botany Bay, elle avait fondé une colonie pénitentiaire et l'avait emplie jusqu'à la gueule d'individus en rupture de ban. Ce faisant, elle avait vidé de son mauvais sang les quartiers infectés de sa capitale, tout en fournissant à sa terre du bout du monde les bras des hommes et les ventres des femmes. Sous la surveillance de l'armée, et avec la bénédiction urbi et orbi de l'Église, les prisonniers pouvaient ainsi, tout à la fois, suivre un hypothétique chemin menant à la rédemption, et peupler à moindre coût ce territoire immense auprès duquel la perfide Albion faisait figure de simple confetti.
(Les premières pages du livre)
Chapitre I
« Les riches font ce qu’ils veulent. Les pauvres font ce qu’ils peuvent. »
Proverbe guyanais
« Silence, Dans les rangs! La prochaine que j’attrape à parler, je lui colle trois jours de mitard. Vous m’avez bien compris? Le mitard, avant la cale et le pays des singes verts. Vous ferez moins les bravaches que sur les barricades. Allez, garces! On file, on file! On file et on se tait!»
Les mots de l’argousin avaient claqué dans le matin comme autant de gifles sèches. Sur la petite route qui menait d’Aix-en-Provence à Toulon, la cohorte des bagnardes replongea aussitôt dans son mutisme. En ce mois déjà étouffant de juin 1872, l’on n’entendit plus alors que les galoches de bois sur le chemin de pierres. Ces bêtes de somme, une trentaine tout au plus, piétinaient sous la surveillance étroite de soldats placés à intervalles réguliers.
Après avoir essuyé la sueur qui coulait de son front, le gardien enfouit son mouchoir dans la poche de sa veste et reprit, cette fois pour lui-même: « Et dire que c’est cette chienlit qui voulait faire la révolution. Même le bagne, pour ces gredines, c’est encore trop bon.– Salopard... »
Malgré la crainte du cachot, Clara n’avait pas réussi à emprisonner dans sa gorge ces trois syllabes hérissées de mépris. Le maton, en réalité un bon papa dans le civil, ne les entendit d’ailleurs pas – ou peut-être fit-il seulement semblant. Il avait trop de métier pour répondre à la première provocation. Pour lui, ces femmes-là ne comptaient pas plus qu’un simple troupeau de chèvres. Son rôle était de les conduire d’Aix-en-Provence jusqu’au bagne de Toulon, avec le moins de casse possible.
Sur le même ton martial, il jappa une nouvelle fois: «On avance ! Et en silence !»
À main gauche, la silhouette lourde du massif de Sainte-Victoire semblait s’être assoupie, pelotonnée en gros chat. À droite, sur l’éperon rocheux du village de Fuveau, se détachait en contre-jour l’église Saint-Michel, que les paroissiens du cru désignaient volontiers, avec une fierté non feinte, sous l’appellation de basilique. Entre les deux, une plaine fertile où les parcelles d’oliviers, de blé et de vignes se disputaient le moindre mètre carré. L’angélus de sept heures avait sonné depuis longtemps déjà et, courbés sur leurs travaux de peine, les quelques paysans disséminés de part et d’autre de la route ne levèrent pas même les yeux sur ce convoi de poussière qui ne faisait que passer. Depuis la fin de la Commune, près de deux années s’étaient écoulées. Au début, le spectacle des bagnards, hommes ou femmes, avait bien un peu excité la curiosité. On avait délaissé les outils et la tâche pour les voir se traîner dans la pierraille, eux qui tiraient la chaîne jusqu’à Toulon avant d’embarquer pour la Guyane ou la Nouvelle-Calédonie. On leur avait lancé des insultes, des quolibets. Puis, à force d’habitude, l’on n’y avait même plus prêté attention. Chacun portait sa croix. Celle de la terre à enfanter n’était guère plus légère que celle de la justice à rendre. Qu’il pleuve ou qu’il vente, les cohortes des réprouvés avaient continué à se succéder. Il n’y avait plus désormais que les enfants les plus jeunes qui, parfois, s’asseyaient sur les talus herbeux des bas-côtés afin de profiter tout à leur aise de ce spectacle gratuit, celui de la désespérance en marche.
Placée en tête de la chaîne processionnaire, Clara se retourna tandis que le convoi obliquait vers le Sud, en direction du hameau de la Bouilladisse. D’un seul regard, elle embrassa le ciel pur de Provence, le moutonnement des champs grillés par le soleil, l’échine blanche et indigo de Sainte-Victoire.
Sous leurs masques de peine et de souffrance, elle reconnut le visage de chacune des filles qui lui emboîtaient le pas. Toutes étaient passées par le même calvaire, toutes arboraient des rictus douloureux figés par la colère, indifférentes à la honte, à la chaleur. L’enthousiasme de la Commune et les espoirs fous d’un nouveau monde à naître, les réunions enfiévrées des cercles, les amitiés et les amours naissantes sur les flancs des barricades, la confraternité d’une classe se soulevant contre le capitalisme, tout cela était désormais loin. Presque une autre vie. La cruauté imbécile d’Adolphe Thiers avait tranché dans le vif. Paris s’était dressée contre Paris ? Il avait répondu au peuple par le feu, la poudre et le sang. Chacun en avait eu son compte. Clara non plus n’avait pas abandonné sa part aux chiens. Clara, mais aussi toutes ces bagnardes qui la suivaient. Blanchisseuses, dentellières, brodeuses, piqueuses de bottines, cigarières, simples journalières ou paysannes montées à la capitale pour inventer un nouveau monde sur les cendres encore chaudes du précédent : toutes y avaient cru. Elles avaient joué, elles avaient perdu. Le coup avait été dur, mais régulier. Dans le train pénitentiaire qui les avait conduites de Paris à l’étang de Berre, puis de celui-ci à Aix-en-Provence, il n’y avait eu ni soulèvement ni tentative d’évasion. Aucune plainte ne s’était élevée – sinon pour maudire les maladroites qui, d’un coup de pied, manquaient parfois de renverser le pot d’aisance, plein jusqu’à la gueule. Celles qui avaient eu besoin de pleurer l’avaient fait en silence. Pour l’heure, elles étaient encore des femmes. Parvenues à Toulon, elles savaient de façon confuse qu’elles deviendraient autre chose. La Cour de Versailles leur avait assez rabâché qu’elles étaient la lie de la société. À Toulon, elles entreraient, de gré ou de force, dans la peau de leur nouvelle existence.
Ce ne fut qu’une fois étendue sur son bat-flanc, le corps brisé par une marche qui avait duré deux jours entiers, que Clara prit le temps de se remémorer les raisons pour lesquelles, à pas même dix-huit ans, elle avait atterri au bagne de Toulon. Celles-ci ne possédaient rien de rare. Si la Commune n’était pas venue pousser de la corne dans son quotidien de misère, Clara n’aurait jamais tâté de la chaîne. Elle était née le 16 décembre 1854, à Aix-en-Provence, le jour même de la mise en service du barrage François Zola. Son père, terrassier né à Bari, s’était crevé la paillasse afin que cet ouvrage pût voir le jour et que les Aixois, hiver comme été, pussent boire jusqu’à plus soif. Deux ans plus tard, imitant le concepteur du barrage, il était mort d’une mauvaise pleurésie, abandonnant dans leur taudis de la ruelle La Baratanque une femme noueuse comme un pied de vigne et une ribambelle d’enfants malingres, méchants et pétris de vices, passés maîtres dans l’art du chapardage.
«Dame... Il fallait bien manger.»
À la mort du père, la mère prénommée Giuseppina avait fait de son mieux, plaçant plusieurs de ses filles à l’usine de savon. Les garçons, eux, avaient trouvé à se louer dans les campagnes des alentours, du côté des Granettes ou du Val de l’Arc. Elle, avait redoublé d’efforts dans la minuscule échoppe de passementerie qui l’employait depuis déjà une dizaine d’années, rue Fabrot. Là, en compagnie de sa fille Clara dont elle avait obtenu l’embauche en tant qu’apprentie, elle ne comptait plus ses heures, tirant sur le fil jusqu’à la nausée, le front bas, les lèvres scellées. Dès le premier jour, la patronne lui avait dit son fait, sans haine et sans mépris, comme la chose la plus naturelle du monde. Elle n’était qu’une Italienne, une immigrée venant voler le travail et le pain des Français et, si elle tenait à garder sa place, ce n’était que justice qu’elle fut taillable et corvéable à merci. Giuseppina n’avait pas répondu. Puisque Dieu lui avait donné ces cartes, quand bien même étaient-elles mauvaises, il ne lui restait plus qu’à les jouer. Ses enfants, peut-être, se bâtiraient une vie meilleure, si elle acceptait de souffrir pour eux. Ses enfants ou, plus sûrement, les enfants de ses enfants.
À l’hiver 1868, une porte avait semblé s’ouvrir sur le quotidien de la veuve. Une lointaine cousine issue de son village natal, Caraglio, avait croisé sa route sur le cours Mirabeau, lors de la procession mariale de l’Immaculée Conception. Cette parente possédait une sœur, Francesca, qui avait poussé le voyage depuis l’Italie jusqu’à Paris afin de s’y établir. Sur la butte Montmartre, elle avait ouvert une petite gargote pour les ouvriers du bâtiment qui, contre une pièce ou deux, pouvaient s’offrir une chopine de vin et une assiette de ragoût trempé de pain bis. Avec les travaux incessants décidés par le baron Haussmann, Paris était devenu un immense chantier, les manœuvres et les gâcheurs de plâtre avaient afflué de l’Europe entière et l’affaire de Francesca s’était agrandie en conséquence. Elle avait alors eu besoin de bras. Giuseppina n’avait pas hésité une seconde. La semaine suivante, Clara partait pour la capitale avec, en poche, quelques mots de recommandation et l’adresse du caboulot – au Tabouret percé – griffonnés sur un bout de papier. Au moment de quitter la cité du Roy René, les derniers conseils maternels avaient sonné à ses oreilles: il lui fallait se méfier des hommes qui étaient tous des porcs. Seul Dieu pouvait la sauver des flammes de l’enfer. Et, si cette Francesca acceptait de l’embaucher, sa reconnaissance se devrait d’être éternelle.
« Ma pauvre maman... »
Dans les gémissements des taulardes ne parvenant pas à trouver le sommeil, au bord de la suffocation à cause des odeurs fortes, animales, produites par les corps trempés de transpiration et de crasse, Clara ouvrit les yeux sur la nuit, tout juste trouée par un quinquet à huile qui grésillait, à l’autre bout du dortoir. Elle se revit en train de poser son sabot sur le marchepied de la voiture. Elle n’était alors qu’un moineau, une mésange. Toute de nerfs et d’os, avec une chevelure abondante d’un noir de jais et de grands yeux charbonneux. Clara n’était pas ce que l’on pouvait appeler une belle fille, non. Elle faisait plutôt songer à une ombre, une rescapée de naufrage, tant ses joues étaient creusées, ses lèvres amères, ses membres grêles.
Lorsque Francesca, dans le petit matin de
Chapitre I
« Les riches font ce qu’ils veulent. Les pauvres font ce qu’ils peuvent. »
Proverbe guyanais
« Silence, Dans les rangs! La prochaine que j’attrape à parler, je lui colle trois jours de mitard. Vous m’avez bien compris? Le mitard, avant la cale et le pays des singes verts. Vous ferez moins les bravaches que sur les barricades. Allez, garces! On file, on file! On file et on se tait!»
Les mots de l’argousin avaient claqué dans le matin comme autant de gifles sèches. Sur la petite route qui menait d’Aix-en-Provence à Toulon, la cohorte des bagnardes replongea aussitôt dans son mutisme. En ce mois déjà étouffant de juin 1872, l’on n’entendit plus alors que les galoches de bois sur le chemin de pierres. Ces bêtes de somme, une trentaine tout au plus, piétinaient sous la surveillance étroite de soldats placés à intervalles réguliers.
Après avoir essuyé la sueur qui coulait de son front, le gardien enfouit son mouchoir dans la poche de sa veste et reprit, cette fois pour lui-même: « Et dire que c’est cette chienlit qui voulait faire la révolution. Même le bagne, pour ces gredines, c’est encore trop bon.– Salopard... »
Malgré la crainte du cachot, Clara n’avait pas réussi à emprisonner dans sa gorge ces trois syllabes hérissées de mépris. Le maton, en réalité un bon papa dans le civil, ne les entendit d’ailleurs pas – ou peut-être fit-il seulement semblant. Il avait trop de métier pour répondre à la première provocation. Pour lui, ces femmes-là ne comptaient pas plus qu’un simple troupeau de chèvres. Son rôle était de les conduire d’Aix-en-Provence jusqu’au bagne de Toulon, avec le moins de casse possible.
Sur le même ton martial, il jappa une nouvelle fois: «On avance ! Et en silence !»
À main gauche, la silhouette lourde du massif de Sainte-Victoire semblait s’être assoupie, pelotonnée en gros chat. À droite, sur l’éperon rocheux du village de Fuveau, se détachait en contre-jour l’église Saint-Michel, que les paroissiens du cru désignaient volontiers, avec une fierté non feinte, sous l’appellation de basilique. Entre les deux, une plaine fertile où les parcelles d’oliviers, de blé et de vignes se disputaient le moindre mètre carré. L’angélus de sept heures avait sonné depuis longtemps déjà et, courbés sur leurs travaux de peine, les quelques paysans disséminés de part et d’autre de la route ne levèrent pas même les yeux sur ce convoi de poussière qui ne faisait que passer. Depuis la fin de la Commune, près de deux années s’étaient écoulées. Au début, le spectacle des bagnards, hommes ou femmes, avait bien un peu excité la curiosité. On avait délaissé les outils et la tâche pour les voir se traîner dans la pierraille, eux qui tiraient la chaîne jusqu’à Toulon avant d’embarquer pour la Guyane ou la Nouvelle-Calédonie. On leur avait lancé des insultes, des quolibets. Puis, à force d’habitude, l’on n’y avait même plus prêté attention. Chacun portait sa croix. Celle de la terre à enfanter n’était guère plus légère que celle de la justice à rendre. Qu’il pleuve ou qu’il vente, les cohortes des réprouvés avaient continué à se succéder. Il n’y avait plus désormais que les enfants les plus jeunes qui, parfois, s’asseyaient sur les talus herbeux des bas-côtés afin de profiter tout à leur aise de ce spectacle gratuit, celui de la désespérance en marche.
Placée en tête de la chaîne processionnaire, Clara se retourna tandis que le convoi obliquait vers le Sud, en direction du hameau de la Bouilladisse. D’un seul regard, elle embrassa le ciel pur de Provence, le moutonnement des champs grillés par le soleil, l’échine blanche et indigo de Sainte-Victoire.
Sous leurs masques de peine et de souffrance, elle reconnut le visage de chacune des filles qui lui emboîtaient le pas. Toutes étaient passées par le même calvaire, toutes arboraient des rictus douloureux figés par la colère, indifférentes à la honte, à la chaleur. L’enthousiasme de la Commune et les espoirs fous d’un nouveau monde à naître, les réunions enfiévrées des cercles, les amitiés et les amours naissantes sur les flancs des barricades, la confraternité d’une classe se soulevant contre le capitalisme, tout cela était désormais loin. Presque une autre vie. La cruauté imbécile d’Adolphe Thiers avait tranché dans le vif. Paris s’était dressée contre Paris ? Il avait répondu au peuple par le feu, la poudre et le sang. Chacun en avait eu son compte. Clara non plus n’avait pas abandonné sa part aux chiens. Clara, mais aussi toutes ces bagnardes qui la suivaient. Blanchisseuses, dentellières, brodeuses, piqueuses de bottines, cigarières, simples journalières ou paysannes montées à la capitale pour inventer un nouveau monde sur les cendres encore chaudes du précédent : toutes y avaient cru. Elles avaient joué, elles avaient perdu. Le coup avait été dur, mais régulier. Dans le train pénitentiaire qui les avait conduites de Paris à l’étang de Berre, puis de celui-ci à Aix-en-Provence, il n’y avait eu ni soulèvement ni tentative d’évasion. Aucune plainte ne s’était élevée – sinon pour maudire les maladroites qui, d’un coup de pied, manquaient parfois de renverser le pot d’aisance, plein jusqu’à la gueule. Celles qui avaient eu besoin de pleurer l’avaient fait en silence. Pour l’heure, elles étaient encore des femmes. Parvenues à Toulon, elles savaient de façon confuse qu’elles deviendraient autre chose. La Cour de Versailles leur avait assez rabâché qu’elles étaient la lie de la société. À Toulon, elles entreraient, de gré ou de force, dans la peau de leur nouvelle existence.
Ce ne fut qu’une fois étendue sur son bat-flanc, le corps brisé par une marche qui avait duré deux jours entiers, que Clara prit le temps de se remémorer les raisons pour lesquelles, à pas même dix-huit ans, elle avait atterri au bagne de Toulon. Celles-ci ne possédaient rien de rare. Si la Commune n’était pas venue pousser de la corne dans son quotidien de misère, Clara n’aurait jamais tâté de la chaîne. Elle était née le 16 décembre 1854, à Aix-en-Provence, le jour même de la mise en service du barrage François Zola. Son père, terrassier né à Bari, s’était crevé la paillasse afin que cet ouvrage pût voir le jour et que les Aixois, hiver comme été, pussent boire jusqu’à plus soif. Deux ans plus tard, imitant le concepteur du barrage, il était mort d’une mauvaise pleurésie, abandonnant dans leur taudis de la ruelle La Baratanque une femme noueuse comme un pied de vigne et une ribambelle d’enfants malingres, méchants et pétris de vices, passés maîtres dans l’art du chapardage.
«Dame... Il fallait bien manger.»
À la mort du père, la mère prénommée Giuseppina avait fait de son mieux, plaçant plusieurs de ses filles à l’usine de savon. Les garçons, eux, avaient trouvé à se louer dans les campagnes des alentours, du côté des Granettes ou du Val de l’Arc. Elle, avait redoublé d’efforts dans la minuscule échoppe de passementerie qui l’employait depuis déjà une dizaine d’années, rue Fabrot. Là, en compagnie de sa fille Clara dont elle avait obtenu l’embauche en tant qu’apprentie, elle ne comptait plus ses heures, tirant sur le fil jusqu’à la nausée, le front bas, les lèvres scellées. Dès le premier jour, la patronne lui avait dit son fait, sans haine et sans mépris, comme la chose la plus naturelle du monde. Elle n’était qu’une Italienne, une immigrée venant voler le travail et le pain des Français et, si elle tenait à garder sa place, ce n’était que justice qu’elle fut taillable et corvéable à merci. Giuseppina n’avait pas répondu. Puisque Dieu lui avait donné ces cartes, quand bien même étaient-elles mauvaises, il ne lui restait plus qu’à les jouer. Ses enfants, peut-être, se bâtiraient une vie meilleure, si elle acceptait de souffrir pour eux. Ses enfants ou, plus sûrement, les enfants de ses enfants.
À l’hiver 1868, une porte avait semblé s’ouvrir sur le quotidien de la veuve. Une lointaine cousine issue de son village natal, Caraglio, avait croisé sa route sur le cours Mirabeau, lors de la procession mariale de l’Immaculée Conception. Cette parente possédait une sœur, Francesca, qui avait poussé le voyage depuis l’Italie jusqu’à Paris afin de s’y établir. Sur la butte Montmartre, elle avait ouvert une petite gargote pour les ouvriers du bâtiment qui, contre une pièce ou deux, pouvaient s’offrir une chopine de vin et une assiette de ragoût trempé de pain bis. Avec les travaux incessants décidés par le baron Haussmann, Paris était devenu un immense chantier, les manœuvres et les gâcheurs de plâtre avaient afflué de l’Europe entière et l’affaire de Francesca s’était agrandie en conséquence. Elle avait alors eu besoin de bras. Giuseppina n’avait pas hésité une seconde. La semaine suivante, Clara partait pour la capitale avec, en poche, quelques mots de recommandation et l’adresse du caboulot – au Tabouret percé – griffonnés sur un bout de papier. Au moment de quitter la cité du Roy René, les derniers conseils maternels avaient sonné à ses oreilles: il lui fallait se méfier des hommes qui étaient tous des porcs. Seul Dieu pouvait la sauver des flammes de l’enfer. Et, si cette Francesca acceptait de l’embaucher, sa reconnaissance se devrait d’être éternelle.
« Ma pauvre maman... »
Dans les gémissements des taulardes ne parvenant pas à trouver le sommeil, au bord de la suffocation à cause des odeurs fortes, animales, produites par les corps trempés de transpiration et de crasse, Clara ouvrit les yeux sur la nuit, tout juste trouée par un quinquet à huile qui grésillait, à l’autre bout du dortoir. Elle se revit en train de poser son sabot sur le marchepied de la voiture. Elle n’était alors qu’un moineau, une mésange. Toute de nerfs et d’os, avec une chevelure abondante d’un noir de jais et de grands yeux charbonneux. Clara n’était pas ce que l’on pouvait appeler une belle fille, non. Elle faisait plutôt songer à une ombre, une rescapée de naufrage, tant ses joues étaient creusées, ses lèvres amères, ses membres grêles.
Lorsque Francesca, dans le petit matin de
Clara avait vécu tout cela. Elle avait connu la mélodie irrésistible de la révolution en marche, ses gros coups de tambour et ses trilles flûtées. En revanche, elle ne s’était pas vraiment penchée sur la signification des paroles qui se mariaient avec ce chant. Elle avait remplacé, dans son cœur qui aimait pour la première fois, les revendications par des mots de tendresse, des serments et des promesses qui prenaient son Bamboche pour seule cible. Il était son amour, son amant, sa révolution à elle. Auprès de lui, elle était heureuse et se sentait capable de renverser le monde. Pourtant, dans un coin de sa tête, elle se reprochait de ne pas avoir pu ni su faire plus pour la cause, pour la Commune. Elle devinait, de façon tout aussi désagréable qu’insistante, qu’elle n’avait pas compris l’importance réelle de cette guerre civile. C’était la raison pour laquelle, dès qu’elle le pouvait, durant les trente minutes de promenade du matin ou de l’après-midi, et lors des heures infinies où on la forçait à effilocher de l’étoupe ou à confectionner des chaussons idiots, elle venait se pendre aux lèvres d’Amandine Idéïous. Celle-ci savait. Clara voulait apprendre, apprendre pour comprendre.
En abattant la Commune, les bourgeois de Versailles ont abattu le peuple de Paris, le peuple de France. Nous, on voulait un autre monde. Pas un monde où les riches font ce qu’ils veulent et les pauvres, hélas, ne font que ce qu’ils peuvent. Mais c’est eux qui ont gagné. Et comme l’Histoire est toujours écrite par les vainqueurs, va-t’en savoir ce qu’il restera de nous, pour les générations qui viendront après qu’on sera parties.
- Ecoutez-moi bien, jeune homme. Notre ami Mac Mahon possède une bonne majorité et il lui reste deux ans de pouvoir présidentiel. Et je peux vous dire, tout à fait entre nous, qu'il se fout de la Guyane comme de sa première chemise. D'ailleurs, Paris se fout de la Guyane. La France entière se fout de la Guyane. Personne ne pourrait même le situer sur une carte, ce pet de mouche que l'on nomme Guyanne !
Videos de Jean-Paul Delfino (33)
Voir plusAjouter une vidéo
Guyanes de Jean-Paul Delfino aux éditions Héloïse d'Ormesson
https://www.lagriffenoire.com/guyanes.html
•
•
•
Chinez & découvrez nos livres coups d'coeur dans notre librairie en ligne lagriffenoire.com
•
Notre chaîne Youtube : Griffenoiretv
•
Notre Newsletter https://www.lagriffenoire.com/?fond=n...
•
Vos libraires passionnés,
Gérard Collard & Jean-Edgar Casel
•
•
•
#lagriffenoire #bookish #bookgeek #bookhoarder #igbooks #bookstagram #instabook #booklover #novel #lire #livres #conseillecture #editionsheloisedormesson
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Jean-Paul Delfino (30)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3182 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3182 lecteurs ont répondu