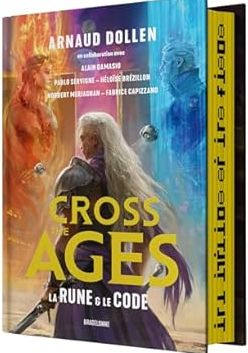Tanith LeeDominique Bellec
Iawa Tate (Traducteur)/5 13 notes
Iawa Tate (Traducteur)/5 13 notes
Résumé :
En 1987, Tanith Lee imagine un monde où l'extérieur représente un danger mortel.
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Pleurons sous la pluieVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (7)
Voir plus
Ajouter une critique
Fonctionnant beaucoup mieux que le mythique ruissellement vers les pauvres de la richesse accaparée par les nantis : celui des retombées nucléaires. Une novella choc de 1987.
Sur le blog Charybde 27 : https://charybde2.wordpress.com/2024/04/14/note-de-lecture-pleurons-sous-la-pluie-tanith-lee/
Le spectre des retombées nucléaires, des contaminations, des surmortalités et des dégâts génétiques qu'elles induisent n'a pas disparu avec les pics de la Guerre Froide et de la Destruction Mutuelle Assurée (dont l'acronyme américain si curieusement explicite, MAD, ne peut pourtant pas nous faire oublier qu'elle fut un temps la doctrine officielle valant challenge entre les deux superpuissances issues de la deuxième guerre mondiale). Tchernobyl et Fukushima demeurent dans toutes les mémoires à peu près raisonnables, les risques de prolifération militaire ne semblent hélas pas localisés uniquement dans les fictions des techno-thrillers, et même les installations civiles les plus sûres restent dans de nombreux cas à la merci de programmes de cost reduction à vue beaucoup trop courte et à l'avidité contagieuse qui sous-tend – on ne le sait que trop – de larges pans du capitalisme tardif.
L'originalité de cette novella de Tanith Lee (que l'on connaît sans doute davantage en France pour sa fantasy que pour sa science-fiction électique et rusée), novella publiée en 1987 (un an après Tchernobyl, donc) et traduite par Iawa Tate en 1988 pour l'anthologie Univers 1988 de J'ai Lu (avant d'être rééditée en février 2024 chez le Passager Clandestin), tient sans doute, sur ce thème science-fictif ayant longtemps alimenté craintes et angoisses, à tort parfois mais aussi à raison, à la fermeté et à l'ingéniosité avec lesquelles elle mêle les conséquences sanitaires à moyen et long terme de retombées nucléaires massives aux organisations sociales et politiques d'époque (et toujours très contemporaines – que l'on se rassure, si l'on ose dire) en matière de ségrégation portée par l'argent et par le pouvoir qui en découle inévitablement – poussant la logique de la gated community englobante à un degré que ne renierait sans doute pas le film « Bienvenue à Gattaca » (1997) d'Andrew Niccol, pourtant construit sur des prémisses bien différentes.
Dans « Pleurons sous la pluie », le ruissellement des nucléotides et des rayonnements fonctionne beaucoup mieux que celui, toujours fantasmé encore de nos jours, de la richesse, et atterrit bien in fine et avant tout sur les corps des moins nantis et des authentiquement pauvres, réduits à monnayer une santé forcément provisoire et devant tout à la chance (et aux écarts-types statistiques) auprès de celles et ceux qui vivent sous cloche, dans le luxe (absolu ou relatif, c'est affaire d'appréciation et de goût), en tout cas à l'abri. L'ironie subtile, la tonalité benoîtement désespérée et le sentiment de sort inéluctable – et accepté – qu'a su établir ici l'autrice britannique de « Ne mords pas le soleil » et de « La forêt électrique », pour ne citer que deux titres majeurs d'une créatrice beaucoup trop sous-estimée de nos jours, forcent l'admiration.
On devrait dire beaucoup plus souvent sur ce blog (et on tâchera de le faire dans les mois qui viennent) tout le bien que l'on pense de la collection Dyschroniques conçue il y a maintenant plus de dix ans par les éditions le Passager Clandestin (transmises en 2019 à trois jeunes éditrices sous forme de SCOP) : en rééditant ou en traduisant parfois pour la première fois en français des textes courts à forte implication sociale et politique, parus pour leur grande majorité entre 1945 et 1980, elles montrent comme bien peu, non pas le pouvoir prophétique de la science-fiction (pouvoir supposé qui n'a au fond que bien peu d'intérêt réel, lorsqu'il n'est pas simplement accidentel – l'art n'a pas nécessairement pour vocation première de se faire le substitut de la prospective ou du scenario planning lorsqu'ils sont défaillants), mais la capacité justement de ce genre littéraire particulier (dont les frontières sont heureusement plus que jamais mouvantes) à signifier l'inaction systémique que le capitalisme produit lorsqu'il n'y a pas de perspectives solides de profit à court (ou parfois à moyen) terme : sur bon nombre de thèmes, ces textes d'anticipation parfois fort sauvages ou foncièrement dramatiques, nous montrent a contrario pourquoi et comment rien ne change – ou dans le sens de la dégradation, bien entendu – là où cela devrait pourtant absolument bouger.
Que ce soit à propos d'informatique (chez le Murray Leinster de « Un logique nommé Joe » en 1946, chez le Fritz Leiber de « le pense-bête » en 1962, chez le Roger Zelazny de « le temps d'un souffle, je m'attarde » en 1966, par exemple), d'emprise délirante de l'économie (chez la Ann Warren Griffith de « Audience captive » en 1953, chez le Robert Sheckley de « La montagne sans nom » en 1955, chez le Mack Reynolds de « le mercenaire » en 1962, parmi bien d'autres) ou encore de surveillance et de répression du « subversif » (chez le Lino Aldani de « 37° centigrades », chez le Mack Reynolds de « Les gaspilleurs » – dont on vous parlera prochainement sur ce blog -, ou encore chez le Steven Saylor de « Insecticide » en 1986), ou de tant d'autres thèmes essentiels, les Dyschroniques proposent des lectures particulièrement précieuses pour mieux appréhender dans le temps long ce qui se passe ici et maintenant – et mobiliser en conséquence notre sentiment d'urgence.
Lien : https://charybde2.wordpress...
Sur le blog Charybde 27 : https://charybde2.wordpress.com/2024/04/14/note-de-lecture-pleurons-sous-la-pluie-tanith-lee/
Le spectre des retombées nucléaires, des contaminations, des surmortalités et des dégâts génétiques qu'elles induisent n'a pas disparu avec les pics de la Guerre Froide et de la Destruction Mutuelle Assurée (dont l'acronyme américain si curieusement explicite, MAD, ne peut pourtant pas nous faire oublier qu'elle fut un temps la doctrine officielle valant challenge entre les deux superpuissances issues de la deuxième guerre mondiale). Tchernobyl et Fukushima demeurent dans toutes les mémoires à peu près raisonnables, les risques de prolifération militaire ne semblent hélas pas localisés uniquement dans les fictions des techno-thrillers, et même les installations civiles les plus sûres restent dans de nombreux cas à la merci de programmes de cost reduction à vue beaucoup trop courte et à l'avidité contagieuse qui sous-tend – on ne le sait que trop – de larges pans du capitalisme tardif.
L'originalité de cette novella de Tanith Lee (que l'on connaît sans doute davantage en France pour sa fantasy que pour sa science-fiction électique et rusée), novella publiée en 1987 (un an après Tchernobyl, donc) et traduite par Iawa Tate en 1988 pour l'anthologie Univers 1988 de J'ai Lu (avant d'être rééditée en février 2024 chez le Passager Clandestin), tient sans doute, sur ce thème science-fictif ayant longtemps alimenté craintes et angoisses, à tort parfois mais aussi à raison, à la fermeté et à l'ingéniosité avec lesquelles elle mêle les conséquences sanitaires à moyen et long terme de retombées nucléaires massives aux organisations sociales et politiques d'époque (et toujours très contemporaines – que l'on se rassure, si l'on ose dire) en matière de ségrégation portée par l'argent et par le pouvoir qui en découle inévitablement – poussant la logique de la gated community englobante à un degré que ne renierait sans doute pas le film « Bienvenue à Gattaca » (1997) d'Andrew Niccol, pourtant construit sur des prémisses bien différentes.
Dans « Pleurons sous la pluie », le ruissellement des nucléotides et des rayonnements fonctionne beaucoup mieux que celui, toujours fantasmé encore de nos jours, de la richesse, et atterrit bien in fine et avant tout sur les corps des moins nantis et des authentiquement pauvres, réduits à monnayer une santé forcément provisoire et devant tout à la chance (et aux écarts-types statistiques) auprès de celles et ceux qui vivent sous cloche, dans le luxe (absolu ou relatif, c'est affaire d'appréciation et de goût), en tout cas à l'abri. L'ironie subtile, la tonalité benoîtement désespérée et le sentiment de sort inéluctable – et accepté – qu'a su établir ici l'autrice britannique de « Ne mords pas le soleil » et de « La forêt électrique », pour ne citer que deux titres majeurs d'une créatrice beaucoup trop sous-estimée de nos jours, forcent l'admiration.
On devrait dire beaucoup plus souvent sur ce blog (et on tâchera de le faire dans les mois qui viennent) tout le bien que l'on pense de la collection Dyschroniques conçue il y a maintenant plus de dix ans par les éditions le Passager Clandestin (transmises en 2019 à trois jeunes éditrices sous forme de SCOP) : en rééditant ou en traduisant parfois pour la première fois en français des textes courts à forte implication sociale et politique, parus pour leur grande majorité entre 1945 et 1980, elles montrent comme bien peu, non pas le pouvoir prophétique de la science-fiction (pouvoir supposé qui n'a au fond que bien peu d'intérêt réel, lorsqu'il n'est pas simplement accidentel – l'art n'a pas nécessairement pour vocation première de se faire le substitut de la prospective ou du scenario planning lorsqu'ils sont défaillants), mais la capacité justement de ce genre littéraire particulier (dont les frontières sont heureusement plus que jamais mouvantes) à signifier l'inaction systémique que le capitalisme produit lorsqu'il n'y a pas de perspectives solides de profit à court (ou parfois à moyen) terme : sur bon nombre de thèmes, ces textes d'anticipation parfois fort sauvages ou foncièrement dramatiques, nous montrent a contrario pourquoi et comment rien ne change – ou dans le sens de la dégradation, bien entendu – là où cela devrait pourtant absolument bouger.
Que ce soit à propos d'informatique (chez le Murray Leinster de « Un logique nommé Joe » en 1946, chez le Fritz Leiber de « le pense-bête » en 1962, chez le Roger Zelazny de « le temps d'un souffle, je m'attarde » en 1966, par exemple), d'emprise délirante de l'économie (chez la Ann Warren Griffith de « Audience captive » en 1953, chez le Robert Sheckley de « La montagne sans nom » en 1955, chez le Mack Reynolds de « le mercenaire » en 1962, parmi bien d'autres) ou encore de surveillance et de répression du « subversif » (chez le Lino Aldani de « 37° centigrades », chez le Mack Reynolds de « Les gaspilleurs » – dont on vous parlera prochainement sur ce blog -, ou encore chez le Steven Saylor de « Insecticide » en 1986), ou de tant d'autres thèmes essentiels, les Dyschroniques proposent des lectures particulièrement précieuses pour mieux appréhender dans le temps long ce qui se passe ici et maintenant – et mobiliser en conséquence notre sentiment d'urgence.
Lien : https://charybde2.wordpress...
« Quand les futurs d'hier racontent notre présent. » : la phrase qui clôt la présentation de la collection « Dyschroniques » des éditions le passager clandestin résume à elle seule cette novella de Tanith Lee. En 1987, l'autrice britannique imagine un monde où la chaleur est devenue la norme et où les pluies sont si nocives qu'elles obligent la population à rester confinée. Mais aujourd'hui, Greena et sa mère ont rendez-vous au Centre avec un homme, un nanti, de ceux qui vivent sous le dôme qui les protège des feux ardents du soleil et de la contamination des pluies. le Centre est une société à l'abri de la détérioration du monde, un espace préservé où la nature et les humains peuvent s'épanouir, un monde reconstitué et surtout un espoir pour ceux qui n'ont pas la chance, ou plutôt les moyens d'y résider. La seule façon pour eux d'y entrer, de s'y faire une place est de se faire repérer, de s'y faire admettre, de se faire acheter. Aujourd'hui Greena ne doit pas laisser passer sa chance.
Ce bref et terrifiant récit qui met en lumière les différences de classe, encore accentuées dans un monde gagné par la pollution. L'argent ne fait peut-être pas le bonheur mais il contribue ici à préserver un mode de vie pour ceux qui en ont les moyens, pendant que les autres composent tant bien que mal avec ce qui leur reste. À l'heure où le dérèglement climatique n'est plus un récit de science-fiction, Pleurons sous la pluie fai écho à l'actualité et à l'avenir proche de manière saisissante.
Le point fort de cette petite collection, en plus d' « exhumer des nouvelles de science-fiction et d'anticipation », est la contextualisation qu'elle propose, situant aussi bien les auteurs dans leur courant que l'écriture du texte dans l'actualité de son époque. Une jolie découverte à tous les niveaux !
Ce bref et terrifiant récit qui met en lumière les différences de classe, encore accentuées dans un monde gagné par la pollution. L'argent ne fait peut-être pas le bonheur mais il contribue ici à préserver un mode de vie pour ceux qui en ont les moyens, pendant que les autres composent tant bien que mal avec ce qui leur reste. À l'heure où le dérèglement climatique n'est plus un récit de science-fiction, Pleurons sous la pluie fai écho à l'actualité et à l'avenir proche de manière saisissante.
Le point fort de cette petite collection, en plus d' « exhumer des nouvelles de science-fiction et d'anticipation », est la contextualisation qu'elle propose, situant aussi bien les auteurs dans leur courant que l'écriture du texte dans l'actualité de son époque. Une jolie découverte à tous les niveaux !
Une nouvelle d'une quarantaine de pages, suivie d'environ vingt-cinq pages de contexte sur l'autrice, le texte proprement dit et la période à laquelle il a été publié initialement. Cette formule permet à l'éditeur, le passager clandestin, de proposer à petits prix des textes un peu anciens (du début des années soixante à la fin des années quatre-vingt-dix environ), choisis en principe parce qu'ils traitent de problèmes qui n'en étaient pas encore tout à fait au moment de leur écriture. La présentation de la collection se conclut ainsi par la jolie formule "quand les futurs d'hier annoncent notre présent".
La nouvelle de Tanith Lee décrit ainsi un avenir bien sombre, sur un fond classique de retombées radioactives et de partition entre riches-sous-cloche et pauvres-qui-se-débrouillent-dehors. Elle vaut surtout pour le récit à la première personne d'une jeune fille qui aurait pu être présentée comme une victime et se révèle plutôt satisfaite d'un destin qu'elle n'a pas choisi. C'est bien écrit, ni trop long ni trop court, et le texte a plutôt bien vieilli. On notera tout de même que la traduction n'a pas été revue depuis la première traduction en français, dans Univers 1988.
La nouvelle de Tanith Lee décrit ainsi un avenir bien sombre, sur un fond classique de retombées radioactives et de partition entre riches-sous-cloche et pauvres-qui-se-débrouillent-dehors. Elle vaut surtout pour le récit à la première personne d'une jeune fille qui aurait pu être présentée comme une victime et se révèle plutôt satisfaite d'un destin qu'elle n'a pas choisi. C'est bien écrit, ni trop long ni trop court, et le texte a plutôt bien vieilli. On notera tout de même que la traduction n'a pas été revue depuis la première traduction en français, dans Univers 1988.
Dans cette nouvelle, Tanith Lee nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui vit avec sa mère et ses frères et soeurs dans un futur où les pluies sont radioactives et un risque mortel. Seuls les riches sont capables de s'en protéger tandis que les pauvres doivent tenter de survivre comme ils le peuvent. Mais la mère de l'héroïne a un plan et prépare depuis longtemps sa fille à épouser quelqu'un de riche pour lui permettre, elle aussi, de survivre.
Nouvelle fascinante imbibée des craintes nucléaires et de leurs retombées mais aussi écologiques de l'époque à laquelle elle a été écrite (un dossier passionnant vient d'ailleurs éclairer le sujet à la fin de la nouvelle), le récit est d'autant plus intéressant et terrifiant qu'il reste très actuel. J'ai été particulièrement saisie par la voix de cette jeune fille qui accepte son destin avec une grande facilité et une certaine joie, par cette mère aux manières glaçantes et pourtant capable d'amour et de compassion. C'est tout à fait inhabituel dans un récit du genre, et ainsi très déstabilisant. Mais c'est aussi sans doute pour cela que j'ai particulièrement aimé cette nouvelle, malgré une fin un peu abrupte. Je découvre Tanith Lee avec ce petit livre, j'ai maintenant très envie d'aller en lire plus de cette autrice. Merci beaucoup au Passager Clandestin et à Babelio pour cette découverte dans le cadre de Masse Critique !
Nouvelle fascinante imbibée des craintes nucléaires et de leurs retombées mais aussi écologiques de l'époque à laquelle elle a été écrite (un dossier passionnant vient d'ailleurs éclairer le sujet à la fin de la nouvelle), le récit est d'autant plus intéressant et terrifiant qu'il reste très actuel. J'ai été particulièrement saisie par la voix de cette jeune fille qui accepte son destin avec une grande facilité et une certaine joie, par cette mère aux manières glaçantes et pourtant capable d'amour et de compassion. C'est tout à fait inhabituel dans un récit du genre, et ainsi très déstabilisant. Mais c'est aussi sans doute pour cela que j'ai particulièrement aimé cette nouvelle, malgré une fin un peu abrupte. Je découvre Tanith Lee avec ce petit livre, j'ai maintenant très envie d'aller en lire plus de cette autrice. Merci beaucoup au Passager Clandestin et à Babelio pour cette découverte dans le cadre de Masse Critique !
Pleurons sous la pluie est une nouvelle dystopique de l'autrice anglaise Tanith Lee. Publié en 1987, ce récit vient d'être réédité aux éditions du Passager Clandestin dans la collection dyschroniques, agrémentée de la traditionnelle postface synchronique caractéristique de ladite collection.
Avec Pleurons sous la pluie, Tanith Lee nous offre un récit d'un féminisme subtil et discret, sans militantisme ostentatoire, laissant toute sa place à l'empathie du lecteur/trice. Si cette histoire a quelque chose de sidérant, c'est sans nul doute parce qu'elle semble à la fois totalement irréelle et parfaitement crédible. Et si on parvient à y croire, c'est qu'il doit y avoir un peu de vrai dans cette représentation d'un monde où, encore aujourd'hui, être jeune et jolie semble rester un atout majeur dans bien des domaines. Un atout, ou une contrainte…
Chronique complète sur le blog !
Lien : http://les-carnets-dystopiqu..
Avec Pleurons sous la pluie, Tanith Lee nous offre un récit d'un féminisme subtil et discret, sans militantisme ostentatoire, laissant toute sa place à l'empathie du lecteur/trice. Si cette histoire a quelque chose de sidérant, c'est sans nul doute parce qu'elle semble à la fois totalement irréelle et parfaitement crédible. Et si on parvient à y croire, c'est qu'il doit y avoir un peu de vrai dans cette représentation d'un monde où, encore aujourd'hui, être jeune et jolie semble rester un atout majeur dans bien des domaines. Un atout, ou une contrainte…
Chronique complète sur le blog !
Lien : http://les-carnets-dystopiqu..
critiques presse (1)
Si seuls les riches sont en mesure de se protéger, les pauvres, eux, peinent à se cacher pour survivre, fatalité que seul le mariage permet de vaincre. Jamais la collection « Dyschroniques » du Passager clandestin n’aura autant mérité son nom.
Lire la critique sur le site : LeMonde
Citations et extraits (4)
Ajouter une citation
Ma mère avait oublié sa mélancolie. Elle était comme une pile électrique. Elle décida tout à trac qu’il était grand temps d’aller inspecter le poulailler. Ces derniers temps, les œufs n’étaient jamais conformes. Y avait-il une fuite dans les parois étanches de l’enclos ?
Il fallut se frayer un chemin entre les alignements de laitues. Dérangées dans leur sommeil, les poules s’égaillèrent en caquetant. Ma mère se hissa péniblement au sommet d’une échelle afin d’examiner la toiture.
– Je ne vois rien, répéta-t-elle à plusieurs reprises.
Elle descendit enfin. Haletante, elle dut prendre appui contre l’échelle. La torche électrique pendait au bout de son bras, inutilement allumée au risque d’épuiser la pile.
– Maman… ? Tu as oublié d’éteindre la torche.
Elle éteignit la torche et la suspendit à un montant.
Soudain, elle s’avança vers moi. Elle me saisit aux épaules. Ses yeux crevaient mes yeux.
– Greena, as-tu compris ce qui s’était passé aujourd’hui, avec cet homme ?
– Oui, maman.
Elle me secoua avec colère, mais sans violence.
– C’est inévitable. Sais-tu pourquoi ?
– Je sais, maman. Ça m’est égal. Il me plaît.
Ses yeux avaient encore changé. Ils s’emplirent de larmes brûlantes et le cœur me manqua. Ce fut comme si le sol se dérobait. Il y avait une infinie douceur dans son regard affolé.
– Écoute-moi bien, Greena. J’ai eu trente ans la semaine passée.
– Je sais…
– Tais-toi. Écoute. J’ai subi le contrôle de routine. Je suis foutue, Greena.
Nous échangeâmes un long regard. Ce n’était pas vraiment une surprise. Tout le monde doit en passer par là. Elle pouvait même s’estimer heureuse d’être arrivée jusqu’à trente ans. À l’extérieur, l’espérance de vie moyenne n’excédait pas vingt-cinq ans.
– Je voulais attendre un peu pour t’en parler. Mon hospitalisation n’est pas prévue avant trois mois. La douleur commence seulement à se faire sentir. Heureusement, il y a l’assurance. J’ai les moyens de m’offrir un analgésique dernier cri.
– Maman…
– Ne m’interromps pas. Nous avons un tas de choses à mettre au point. As-tu conscience de tes responsabilités ? Vis-à-vis des enfants, bien sûr. Vous êtes frères et sœurs, ne l’oublie jamais.
– Ne t’inquiète pas. Je m’occuperai d’eux.
– Il t’aidera, il le faut. Il est vraiment mordu, Greena. Pauvre Alexander, il n’a pas eu de chance. Sa fiancée est morte. Native du Centre et tout et tout, ça ne l’a pas empêchée de claquer à dix-huit ans. Une aubaine pour nous, soit dit en passant. Je ne me féliciterai jamais assez de t’avoir fait suivre le programme de stérilisation quand tu étais gamine. Il n’a pas le droit de coucher avec une fille féconde, tu saisis ? Trop de risques de malformations congénitales. À le voir, on ne s’en douterait pas.
– Je comprends. Je connais la loi sur la reproduction.
Pas de gifle. Pas de cri. Ma réponse hardie n’avait d’autre but que de la rassurer, elle s’en rendait compte. Oui, je comprenais la situation. Alexander avait un problème, ce n’était pas difficile à deviner. Sinon, pourquoi serait-il allé chercher une fille de l’extérieur ?
Il fallut se frayer un chemin entre les alignements de laitues. Dérangées dans leur sommeil, les poules s’égaillèrent en caquetant. Ma mère se hissa péniblement au sommet d’une échelle afin d’examiner la toiture.
– Je ne vois rien, répéta-t-elle à plusieurs reprises.
Elle descendit enfin. Haletante, elle dut prendre appui contre l’échelle. La torche électrique pendait au bout de son bras, inutilement allumée au risque d’épuiser la pile.
– Maman… ? Tu as oublié d’éteindre la torche.
Elle éteignit la torche et la suspendit à un montant.
Soudain, elle s’avança vers moi. Elle me saisit aux épaules. Ses yeux crevaient mes yeux.
– Greena, as-tu compris ce qui s’était passé aujourd’hui, avec cet homme ?
– Oui, maman.
Elle me secoua avec colère, mais sans violence.
– C’est inévitable. Sais-tu pourquoi ?
– Je sais, maman. Ça m’est égal. Il me plaît.
Ses yeux avaient encore changé. Ils s’emplirent de larmes brûlantes et le cœur me manqua. Ce fut comme si le sol se dérobait. Il y avait une infinie douceur dans son regard affolé.
– Écoute-moi bien, Greena. J’ai eu trente ans la semaine passée.
– Je sais…
– Tais-toi. Écoute. J’ai subi le contrôle de routine. Je suis foutue, Greena.
Nous échangeâmes un long regard. Ce n’était pas vraiment une surprise. Tout le monde doit en passer par là. Elle pouvait même s’estimer heureuse d’être arrivée jusqu’à trente ans. À l’extérieur, l’espérance de vie moyenne n’excédait pas vingt-cinq ans.
– Je voulais attendre un peu pour t’en parler. Mon hospitalisation n’est pas prévue avant trois mois. La douleur commence seulement à se faire sentir. Heureusement, il y a l’assurance. J’ai les moyens de m’offrir un analgésique dernier cri.
– Maman…
– Ne m’interromps pas. Nous avons un tas de choses à mettre au point. As-tu conscience de tes responsabilités ? Vis-à-vis des enfants, bien sûr. Vous êtes frères et sœurs, ne l’oublie jamais.
– Ne t’inquiète pas. Je m’occuperai d’eux.
– Il t’aidera, il le faut. Il est vraiment mordu, Greena. Pauvre Alexander, il n’a pas eu de chance. Sa fiancée est morte. Native du Centre et tout et tout, ça ne l’a pas empêchée de claquer à dix-huit ans. Une aubaine pour nous, soit dit en passant. Je ne me féliciterai jamais assez de t’avoir fait suivre le programme de stérilisation quand tu étais gamine. Il n’a pas le droit de coucher avec une fille féconde, tu saisis ? Trop de risques de malformations congénitales. À le voir, on ne s’en douterait pas.
– Je comprends. Je connais la loi sur la reproduction.
Pas de gifle. Pas de cri. Ma réponse hardie n’avait d’autre but que de la rassurer, elle s’en rendait compte. Oui, je comprenais la situation. Alexander avait un problème, ce n’était pas difficile à deviner. Sinon, pourquoi serait-il allé chercher une fille de l’extérieur ?
– Monsieur Alexander, bonjour. Nous ne sommes pas trop en avance ?
– Pas le moins du monde, fit une voix masculine, presque trop jeune. Votre fille est avec vous ? C’est parfait. Donnez-vous la peine d’entrer.
J’avançai dans le sillage de ma mère, foulant le tapis couleur de gazon. Je vis plusieurs sièges disposés autour d’un bureau. Puis ma mère s’effaça pour me présenter.
– Voici ma fille, Monsieur Alexander. Greena. C’est elle.
Il ne devait pas avoir plus de vingt-deux ans et je pouvais me vanter d’avoir de la chance dans la mesure où la population du Centre bénéficie d’une extrême longévité, jusqu’à des cinquante ou soixante ans, cela s’est vu. Et même, bien souvent, ceux qui sont nés sous les coupoles s’en vont mourir ailleurs, c’était le changement de vie, disait volontiers ma mère, ils ne supportaient pas.
Celui-ci était bronzé, vêtu avec soin, pantalon et chemise de coton naturel. Il portait un bracelet en argent dont la plaque rouge confirmait son jeune âge. Tout entier maître de soi et belle apparence, tel était monsieur Alexander, vivante incarnation de l’hygiène bien comprise et de la santé. À croquer de la tête aux pieds. Son regard me scrutait. Je détournai le mien en vitesse.
– Asseyez-vous, je vous en prie.
Ma mère se vit offrir trois doigts de gin en provenance des distilleries du Centre. Il ajouta des glaçons et des tranches de citron. Souriant, il me proposa un milk-shake à la framboise, avec du lait véritable, s’il vous plaît. J’étais trop angoissée pour avoir envie de quoi que ce soit, je ne me sentais pas en état de savourer son milk-shake, mais comment refuser pareil délice ? Cela ne se fait pas, tout simplement.
Enfin, nanties du gin et du milk-shake, nous nous installâmes raidement à l’extrémité de nos sièges. Monsieur Alexander ne buvait pas. Assis face à nous sur le bureau, il balançait une jambe dans le vide. Il prit une cigarette dans le coffret et l’alluma. Il aspira une longue bouffée.
– Tout d’abord, je tiens à vous remercier d’être venues de si loin, dit-il à ma mère sur le ton plaisant d’une conversation mondaine. Un jour d’alerte, de surcroît. En fait, ce n’était pas grand-chose, n’est-ce pas ? Une simple averse.
– Nous sommes arrivées bien avant, répliqua vivement ma mère.
Elle tenait à mettre les points sur les i. La fleur était intacte, aucune goutte de pluie ne l’avait souillée.
– Je sais. Le Parloir m’a renseigné.
Il avait dû se faire communiquer nos coefficients. Au fond, c’était son droit le plus strict. S’il avait l’intention de m’acheter, il voulait s’assurer que son acquisition lui ferait un peu d’usage, quoi de plus normal.
– Permettez-moi de vous dire dès à présent que votre fille semble présenter toutes les qualités requises pour l’emploi auquel nous la destinons. Elle est charmante, pleine de réserve et de correction.
L’allusion à un hypothétique emploi n’est là que pour la frime, pensai-je. Mais peut-être, pour commencer, me demanderait-on vraiment d’effectuer un travail quelconque ?
Ma mère avait dû passer sa petite annonce dès l’automne dernier, tout de suite après que nous fûmes allées rendre visite à ce photographe du Centre. Je portais ma petite culotte de dentelle en nylon et pas grand-chose d’autre. Une photo qui ne cachait rien, comme celle que l’on prend tous les dix ans, à l’occasion du contrôle médical. Toujours, les petites annonces de ce type étaient accompagnées de photos du genre déshabillé. Pratique parfaitement illégale, mais personne n’en avait cure. Trois ans auparavant, au moyen d’un stratagème identique, un garçon qui habitait notre rue s’était trouvé une place dans le Centre. Il avait passé la petite annonce lui-même, il s’était occupé de tout. Joli garçon, il n’avait qu’un défaut, des cheveux déjà clairsemés comme les miens, laissant présager une calvitie précoce. Selon toute apparence, ce détail n’avait gêné personne.
Ma mère avait-elle reçu d’autres réponses ou seulement celle de ce jeune homme hâlé au regard intense ?
– Pas le moins du monde, fit une voix masculine, presque trop jeune. Votre fille est avec vous ? C’est parfait. Donnez-vous la peine d’entrer.
J’avançai dans le sillage de ma mère, foulant le tapis couleur de gazon. Je vis plusieurs sièges disposés autour d’un bureau. Puis ma mère s’effaça pour me présenter.
– Voici ma fille, Monsieur Alexander. Greena. C’est elle.
Il ne devait pas avoir plus de vingt-deux ans et je pouvais me vanter d’avoir de la chance dans la mesure où la population du Centre bénéficie d’une extrême longévité, jusqu’à des cinquante ou soixante ans, cela s’est vu. Et même, bien souvent, ceux qui sont nés sous les coupoles s’en vont mourir ailleurs, c’était le changement de vie, disait volontiers ma mère, ils ne supportaient pas.
Celui-ci était bronzé, vêtu avec soin, pantalon et chemise de coton naturel. Il portait un bracelet en argent dont la plaque rouge confirmait son jeune âge. Tout entier maître de soi et belle apparence, tel était monsieur Alexander, vivante incarnation de l’hygiène bien comprise et de la santé. À croquer de la tête aux pieds. Son regard me scrutait. Je détournai le mien en vitesse.
– Asseyez-vous, je vous en prie.
Ma mère se vit offrir trois doigts de gin en provenance des distilleries du Centre. Il ajouta des glaçons et des tranches de citron. Souriant, il me proposa un milk-shake à la framboise, avec du lait véritable, s’il vous plaît. J’étais trop angoissée pour avoir envie de quoi que ce soit, je ne me sentais pas en état de savourer son milk-shake, mais comment refuser pareil délice ? Cela ne se fait pas, tout simplement.
Enfin, nanties du gin et du milk-shake, nous nous installâmes raidement à l’extrémité de nos sièges. Monsieur Alexander ne buvait pas. Assis face à nous sur le bureau, il balançait une jambe dans le vide. Il prit une cigarette dans le coffret et l’alluma. Il aspira une longue bouffée.
– Tout d’abord, je tiens à vous remercier d’être venues de si loin, dit-il à ma mère sur le ton plaisant d’une conversation mondaine. Un jour d’alerte, de surcroît. En fait, ce n’était pas grand-chose, n’est-ce pas ? Une simple averse.
– Nous sommes arrivées bien avant, répliqua vivement ma mère.
Elle tenait à mettre les points sur les i. La fleur était intacte, aucune goutte de pluie ne l’avait souillée.
– Je sais. Le Parloir m’a renseigné.
Il avait dû se faire communiquer nos coefficients. Au fond, c’était son droit le plus strict. S’il avait l’intention de m’acheter, il voulait s’assurer que son acquisition lui ferait un peu d’usage, quoi de plus normal.
– Permettez-moi de vous dire dès à présent que votre fille semble présenter toutes les qualités requises pour l’emploi auquel nous la destinons. Elle est charmante, pleine de réserve et de correction.
L’allusion à un hypothétique emploi n’est là que pour la frime, pensai-je. Mais peut-être, pour commencer, me demanderait-on vraiment d’effectuer un travail quelconque ?
Ma mère avait dû passer sa petite annonce dès l’automne dernier, tout de suite après que nous fûmes allées rendre visite à ce photographe du Centre. Je portais ma petite culotte de dentelle en nylon et pas grand-chose d’autre. Une photo qui ne cachait rien, comme celle que l’on prend tous les dix ans, à l’occasion du contrôle médical. Toujours, les petites annonces de ce type étaient accompagnées de photos du genre déshabillé. Pratique parfaitement illégale, mais personne n’en avait cure. Trois ans auparavant, au moyen d’un stratagème identique, un garçon qui habitait notre rue s’était trouvé une place dans le Centre. Il avait passé la petite annonce lui-même, il s’était occupé de tout. Joli garçon, il n’avait qu’un défaut, des cheveux déjà clairsemés comme les miens, laissant présager une calvitie précoce. Selon toute apparence, ce détail n’avait gêné personne.
Ma mère avait-elle reçu d’autres réponses ou seulement celle de ce jeune homme hâlé au regard intense ?
La journée ne faisait que commencer, mais une alerte météorologique nous tenait tous confinés à la maison. Les enfants regardaient la chaîne payante tandis que je donnais à manger aux volailles dans le poulailler intérieur. Il devait être neuf heures du matin. Ma mère a surgi, elle s’est arrêtée sur le seuil de l’enclos. Je n’oublierai jamais l’expression de ses yeux posés sur moi. Je connaissais ce regard, et bien qu’il se fut toujours passé de commentaire, je savais parfaitement à quoi m’en tenir. C’était ainsi qu’elle estimait le poids des volailles ou qu’elle inspectait les casiers de semis. Ce jour-là, pourtant, ce n’était pas tout à fait le même regard. La nuance ne m’échappait pas et je savais aussi comment l’interpréter. J’étais à point, semblait-il.
– Greena, dit ma mère.
En trois enjambées puissantes, elle fut au milieu de l’enclos, jetant un œil indifférent à nos décevantes poules. Nous n’avions recueilli que trois œufs cette semaine, dont l’un n’était même pas conforme à la norme. Trop haut. Ma mère s’en moquait, elle avait pour l’instant d’autres chats à fouetter.
– Greena, dit-elle. Ce matin, nous irons au Centre.
– Et l’alerte, maman ?
– Laissons cela. Ces imbéciles se trompent si souvent. D’ailleurs la pluie ne devrait pas tomber avant midi. D’ici là, le ciel restera dégagé et nous serons arrivées bien avant les premières gouttes.
– As-tu pensé aux bus, maman ? Ils ne fonctionnent jamais quand la météo est mauvaise. Nous serons obligées d’y aller à pied.
Elle me regarda avec sa figure farouche, ravagée, fermée comme un poing, ce masque bouffé par la vie et l’ardeur de vivre.
– Et après ? Nous irons à pied. Ne discute pas, Greena. Les jambes, c’est fait pour marcher, que je sache.
J’inclinai la casserole pour répandre le reliquat de nourriture. Je me dirigeai vers la porte de l’escalier.
– À propos de jambes, dit-elle, tu me feras le plaisir de mettre tes bas. Et tous les trucs que nous avons achetés la dernière fois.
C’étaient toujours les mêmes sempiternels chichis. Sous le prétexte des caméras, bien sûr. En particulier celles qui se trouvent dans les salles de bains du Parloir. On se déshabille et tous les vêtements filent dans la machine à laver. On les récupère à la sortie. Mais les vigiles ou les médecins, personne ne les empêche de se rincer l’œil sur les écrans et, dans le meilleur des cas, de se sentir émoustillés par ce qu’ils voient. Alors on se fait un devoir de mettre ses plus beaux atours, des choses que l’on peut exhiber sans honte et que même un médecin du Centre pourra reluquer sans haut-le-cœur. Ma mère est ainsi, elle ne badine pas avec les convenances. J’allai prendre une douche et me faire un shampooing. Je me saupoudrai de talc, celui parfumé à l’essence de rose que nous avions acheté au Centre. Je devais être nickel de la tête aux pieds en prévision de la douche et du shampooing qui me seraient administrés dans la salle de bains du Parloir. J’enfilai mes dessous les plus flatteurs, ma robe blanche et mes bas. Je me chaussai. Je n’oubliai pas de glisser dans mon sac la boîte de talc à l’essence de rose.
Ma mère était déjà prête ; elle m’attendait lorsque je me présentai devant les portes donnant sur la rue. Elle ne me fit aucun reproche. Elle avait exigé le grand jeu ; le grand jeu prend du temps.
– Greena, dit ma mère.
En trois enjambées puissantes, elle fut au milieu de l’enclos, jetant un œil indifférent à nos décevantes poules. Nous n’avions recueilli que trois œufs cette semaine, dont l’un n’était même pas conforme à la norme. Trop haut. Ma mère s’en moquait, elle avait pour l’instant d’autres chats à fouetter.
– Greena, dit-elle. Ce matin, nous irons au Centre.
– Et l’alerte, maman ?
– Laissons cela. Ces imbéciles se trompent si souvent. D’ailleurs la pluie ne devrait pas tomber avant midi. D’ici là, le ciel restera dégagé et nous serons arrivées bien avant les premières gouttes.
– As-tu pensé aux bus, maman ? Ils ne fonctionnent jamais quand la météo est mauvaise. Nous serons obligées d’y aller à pied.
Elle me regarda avec sa figure farouche, ravagée, fermée comme un poing, ce masque bouffé par la vie et l’ardeur de vivre.
– Et après ? Nous irons à pied. Ne discute pas, Greena. Les jambes, c’est fait pour marcher, que je sache.
J’inclinai la casserole pour répandre le reliquat de nourriture. Je me dirigeai vers la porte de l’escalier.
– À propos de jambes, dit-elle, tu me feras le plaisir de mettre tes bas. Et tous les trucs que nous avons achetés la dernière fois.
C’étaient toujours les mêmes sempiternels chichis. Sous le prétexte des caméras, bien sûr. En particulier celles qui se trouvent dans les salles de bains du Parloir. On se déshabille et tous les vêtements filent dans la machine à laver. On les récupère à la sortie. Mais les vigiles ou les médecins, personne ne les empêche de se rincer l’œil sur les écrans et, dans le meilleur des cas, de se sentir émoustillés par ce qu’ils voient. Alors on se fait un devoir de mettre ses plus beaux atours, des choses que l’on peut exhiber sans honte et que même un médecin du Centre pourra reluquer sans haut-le-cœur. Ma mère est ainsi, elle ne badine pas avec les convenances. J’allai prendre une douche et me faire un shampooing. Je me saupoudrai de talc, celui parfumé à l’essence de rose que nous avions acheté au Centre. Je devais être nickel de la tête aux pieds en prévision de la douche et du shampooing qui me seraient administrés dans la salle de bains du Parloir. J’enfilai mes dessous les plus flatteurs, ma robe blanche et mes bas. Je me chaussai. Je n’oubliai pas de glisser dans mon sac la boîte de talc à l’essence de rose.
Ma mère était déjà prête ; elle m’attendait lorsque je me présentai devant les portes donnant sur la rue. Elle ne me fit aucun reproche. Elle avait exigé le grand jeu ; le grand jeu prend du temps.
Dans ma petite enfance, reste ce souvenir précis. Un matin, il pleuvait comme jamais. Je devais avoir six ou sept ans. Le nez collé contre la vitre Securit, je tentais de discerner les formes de l’univers interdit. À travers le matériau déformant, les trombes se dissolvaient en un rideau frémissant. Soudain, je vis quelque chose de vraiment extraordinaire. Je poussai un cri.
autres livres classés : science-fictionVoir plus
Les plus populaires : Imaginaire
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Tanith Lee (58)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les plus grands classiques de la science-fiction
Qui a écrit 1984
George Orwell
Aldous Huxley
H.G. Wells
Pierre Boulle
10 questions
4877 lecteurs ont répondu
Thèmes :
science-fictionCréer un quiz sur ce livre4877 lecteurs ont répondu