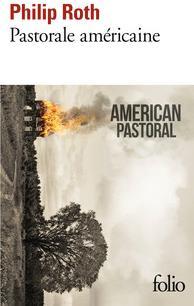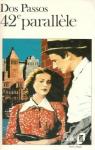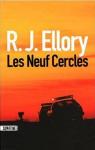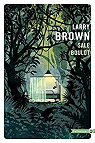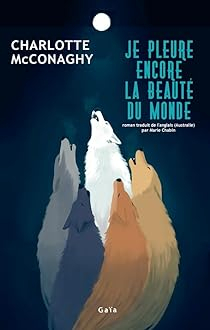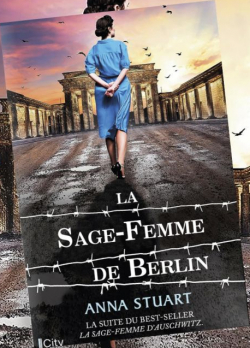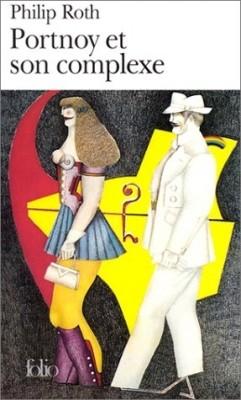Philip Roth
Josée Kamoun (Traducteur)/5 1317 notes
Josée Kamoun (Traducteur)/5 1317 notes
Résumé :
La vie de Seymour Levov ressemble à un cliché noir et blanc des années cinquante, un portrait de famille figé dans le bonheur. Petit-fils d'immigré juif parfaitement assimilé à l'American Way of Life, une réussite sociale exemplaire, une épouse ex-Miss New Jersey composent le tableau idyllique d'une histoire lacérée au couteau. À jamais chassé du paradis terrestre par un cancer qui le ronge : la dérive violente et jusqu'au-boutiste de sa fille Merry devenue terroris... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Pastorale américaineVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (139)
Voir plus
Ajouter une critique
De cette plongée dans l'Amérique héroïque de l'après-guerre et en s'attardant largement sur les années 60, Philip Roth fait émerger une force poétique pour dénoncer un monde d'illusions qui se désagrège.
Il peint un méticuleux tableau moral disséquant l'Amérique, pointant ses contradictions et lui donnant une inflexion historique, pour se pencher sur quelques-uns des grands moments de crise de la gauche américaine.
La toile de fond est la trajectoire ascendante d'immigrants de la classe moyenne juive qui avaient comme valeurs principales la force du travail et obéissaient aux règles et préceptes, obligations et interdictions envers et contre tout.
Ils étaient jeunes, beaux, et croyaient au rêve américain.
Les contes de fées finissent mal en général…
Le personnage principal, le géant aux pieds d'argile voit tout dégringoler autour de lui, ses certitudes, ses valeurs et sa morale. Sa vie explose littéralement lorsque sa fille pulvérise les normes commettant l'inimaginable mais il se bat pour continuer à paraître tout lisse dehors même si est totalement tourmenté dedans.
Culpabilité, remords, obsessions, déchéance, la dégringolade sera lente mais puissante.
Philip Roth évite la tragédie larmoyante pour se concentrer sur les questions de morale et de l'échec du rêve américain et compose un récit à son image.
Entre regard sur l'intime et l'analyse de la société, ce roman a un grand potentiel subversif et dérangeant.
Il peint un méticuleux tableau moral disséquant l'Amérique, pointant ses contradictions et lui donnant une inflexion historique, pour se pencher sur quelques-uns des grands moments de crise de la gauche américaine.
La toile de fond est la trajectoire ascendante d'immigrants de la classe moyenne juive qui avaient comme valeurs principales la force du travail et obéissaient aux règles et préceptes, obligations et interdictions envers et contre tout.
Ils étaient jeunes, beaux, et croyaient au rêve américain.
Les contes de fées finissent mal en général…
Le personnage principal, le géant aux pieds d'argile voit tout dégringoler autour de lui, ses certitudes, ses valeurs et sa morale. Sa vie explose littéralement lorsque sa fille pulvérise les normes commettant l'inimaginable mais il se bat pour continuer à paraître tout lisse dehors même si est totalement tourmenté dedans.
Culpabilité, remords, obsessions, déchéance, la dégringolade sera lente mais puissante.
Philip Roth évite la tragédie larmoyante pour se concentrer sur les questions de morale et de l'échec du rêve américain et compose un récit à son image.
Entre regard sur l'intime et l'analyse de la société, ce roman a un grand potentiel subversif et dérangeant.
Il a été salué d'un prix Pulitzer, ce grand roman qui nous parle des fractures de l'Amérique, dans une époque marquée par la guerre du Vietnam, et des émeutes raciales .
Philip Roth nous raconte l'effondrement du rêve américain presque comme un journaliste, avec l'histoire particulière de Seymour Levov, dit le Suédois, et sa fille devenue terroriste qui illustre celle plus globale de la génération 68 . C'est sa manière de nous parler de conflit de génération et de rupture historique. Comme toujours chez lui, fiction et réel sont extrêmement proches.
C'est Nathan Zuckerman, le double de fiction de Roth qui recueille les paroles et porte pour nous cette douloureuse histoire d'une famille frappée de plus qu'un deuil, celui d'avoir une enfant qui porte la mort au nom d'une idéologie, rejetant toutes les valeurs auxquelles son père est attaché.
Roth ne se contente pas de la surface des choses. Il fouille et analyse chacun des membres de cette famille, comme s'ils étaient des voisins, des parents ou des amis. On peut lire des pages magnifiques sur l'amour paternel, la vie idyllique à la campagne, un artisanat minutieux. On touche du doigt les fêlures de chacun d'entre eux, puis le délitement des relations à l'épreuve du pire. Que faire lorsque celui ou celle qu'on aime est un bourreau...
C'est déchirant, parfois insoutenable, car toute tentative d'explication échoue sur le mur d'une réalité complexe qui se dérobe sans cesse. Il y a un peu de Kafka dans cette quête au bout du sordide de la fille perdue, criminelle, folle peut-être, pour la sauver d'elle même et de ses démons, la ramener dans le troupeau.
Si ce roman nous touche aussi, c'est qu'au delà du contexte local, il y a dans le personnage du Suédois , le mythe plus ancien de l'homme qui défie trop les dieux, en voulant être créateur de sa vie . Il préfigure sans doute le personnage de Coleman Silk, qui dans « La Tache » assume pleinement ses transgressions avec son isomorphisme . Dialogue compliqué entre apparence, identité et enracinement ...
Ce n'est pas une lecture facile, mais la prose magnifique, les dialogues incisifs de Philip Roth nous emmènent assez loin dans mille et unes nuances de la douleur .
Philip Roth nous raconte l'effondrement du rêve américain presque comme un journaliste, avec l'histoire particulière de Seymour Levov, dit le Suédois, et sa fille devenue terroriste qui illustre celle plus globale de la génération 68 . C'est sa manière de nous parler de conflit de génération et de rupture historique. Comme toujours chez lui, fiction et réel sont extrêmement proches.
C'est Nathan Zuckerman, le double de fiction de Roth qui recueille les paroles et porte pour nous cette douloureuse histoire d'une famille frappée de plus qu'un deuil, celui d'avoir une enfant qui porte la mort au nom d'une idéologie, rejetant toutes les valeurs auxquelles son père est attaché.
Roth ne se contente pas de la surface des choses. Il fouille et analyse chacun des membres de cette famille, comme s'ils étaient des voisins, des parents ou des amis. On peut lire des pages magnifiques sur l'amour paternel, la vie idyllique à la campagne, un artisanat minutieux. On touche du doigt les fêlures de chacun d'entre eux, puis le délitement des relations à l'épreuve du pire. Que faire lorsque celui ou celle qu'on aime est un bourreau...
C'est déchirant, parfois insoutenable, car toute tentative d'explication échoue sur le mur d'une réalité complexe qui se dérobe sans cesse. Il y a un peu de Kafka dans cette quête au bout du sordide de la fille perdue, criminelle, folle peut-être, pour la sauver d'elle même et de ses démons, la ramener dans le troupeau.
Si ce roman nous touche aussi, c'est qu'au delà du contexte local, il y a dans le personnage du Suédois , le mythe plus ancien de l'homme qui défie trop les dieux, en voulant être créateur de sa vie . Il préfigure sans doute le personnage de Coleman Silk, qui dans « La Tache » assume pleinement ses transgressions avec son isomorphisme . Dialogue compliqué entre apparence, identité et enracinement ...
Ce n'est pas une lecture facile, mais la prose magnifique, les dialogues incisifs de Philip Roth nous emmènent assez loin dans mille et unes nuances de la douleur .
Ce premier livre de la Trilogie Americaine de Roth est une chronique de la fracture du reve americain, fin des annees 60 du siecle dernier. Son principal protagoniste, Seymour Levov, dit “le suedois", est le symbole de ce reve. Grand athlete blond admire de tous, ce petit-fils d'immigrants juifs d'Europe de l'Est est un modele pour tous ses congeneres de Newark. Bon fils, prospere directeur de la fabrique de gants qu'il a herite et qu'il a fait fleurir, marie avec heur (bon) a une Miss New Jersey catholique, habitant en campagne une ancestrale et solide maison en pierre, bon pere pour son unique fille, Merry. “Le suedois" est l'epicentre d'une certaine mythologie americaine: la preuve par neuf que deux generations de travail acharne peuvent mener au firmament de la societe; que l'Amerique est la terre de toutes les opportunites.
Et puis un jour, sans preavis, tout s'effondre. Ou plutot tout explose. Ses certitudes, ses convictions, sa confiance en soi et en autrui, sa suffisance, le microcosme qu'il s'etait bati et le macrocosme alentour. Avec l'explosion du magasin du coin que sa propre fille, sa petite fille choyee de 16 ans, a fait sauter a la dynamite, tuant une personne. Parce qu'elle s'opposait a la guerre au Vietnam? Pour protester contre le systeme capitaliste americain? Pour s'elever contre une societe injuste? Parce qu'elle haissait ses parents et ce qu'ils representaient? Comment comprendre son acte? Comment le supporter? Comment elle en etait arrivee la? Comment avait-elle ete indoctrinee? Et par qui? Pour “le suedois" c'est la descente aux enfers, bien qu'il essaye de n'en rien laisser paraitre.
Je laisse la parole a Roth: “…survient la fille perdue, la fille en cavale, cette Américaine de la quatrième génération censée reproduire en plus parfait encore l'image de son père, lui-même image du sien en plus parfait et ainsi de suite… survient la fille en colère, la malgracieuse, qui crache sur son monde et se fiche éperdument de prendre sa place dans la lignée Levov en pleine ascension sociale, sa fille, enfin, qui le débusque comme un fugitif, qui le pousse la première dans la transhumance d'une tout autre Amérique ; sa fille et ces années soixante qui font voler en éclats le type d'utopie qui lui est cher, à lui. Voilà la mort rouge qui contamine le château du Suédois, et personne n'en réchappe. Voilà sa fille qui l'exile de sa pastorale américaine tant désirée pour le précipiter dans un univers hostile qui en est le parfait contraire, dans la fureur, la violence, le désespoir d'un chaos infernal qui n'appartient qu'à l'Amérique”.
Et plus loin: “Pour elle, être américaine, c'était haïr l'Amérique. Mais, lui, il ne pouvait pas plus cesser d'aimer l'Amérique que cesser d'aimer père et mère, ou abandonner tout code de conduite. Comment pouvait-elle détester un pays alors qu'elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'il était ? Comment sa propre enfant pouvait-elle s'aveugler au point de vouer aux gémonies le « système pourri » qui avait donné toutes les chances de succès à sa famille ? Comment pouvait-elle traîner dans la boue ses « capitalistes » de parents comme si leur fortune était le produit d'autre chose que de trois générations industrieuses et tenaces ? Trois générations d'hommes, dont lui, qui avaient trimé dans la crasse et la puanteur d'une tannerie. Elle avait débuté dans une tannerie, aux côtés des derniers des derniers, cette famille qu'elle appelait désormais les « chiens capitalistes ». Il n'y avait pas grande différence, et elle le savait, entre haïr l'Amérique et les haïr eux-mêmes. Il aimait l'Amérique qu'elle haïssait, tenait pour responsable de toutes les imperfections de la vie, et voulait renverser par la violence ; il aimait les prétendues « valeurs bourgeoises » qu'elle abhorrait, ridiculisait et voulait subvertir ; il aimait la mère qu'elle détestait, et qu'elle avait failli faire mourir en commettant l'acte qu'elle avait commis. Petite salope ignare!”
C'est la fin d'un monde pour le suedois. Avec lui Roth decrit les fractures de l'Amerique au dernier tiers du XXe siecle. Aux anciennes et non resolues fractures raciales se sont rajoutees des fractures politiques importantes qui ont ranime les latentes fractures economiques et sociales. Mais Roth n'est pas un sociologue, il est romancier, et son roman, qui eclaire une periode de crise, m'a fait surtout vivre le cauchemar d'un homme, sa decomposition face a l'ecroulement de tous ses criteres. Pas seulement comprendre, mais accompagner, vivre avec son personnage son desespoir. Roth est un tres grand ecrivain, et cette Pastorale un grand livre. Une page d'histoire, brillamment romancee. le naufrage d'un homme, profondement rendu.
Et puis un jour, sans preavis, tout s'effondre. Ou plutot tout explose. Ses certitudes, ses convictions, sa confiance en soi et en autrui, sa suffisance, le microcosme qu'il s'etait bati et le macrocosme alentour. Avec l'explosion du magasin du coin que sa propre fille, sa petite fille choyee de 16 ans, a fait sauter a la dynamite, tuant une personne. Parce qu'elle s'opposait a la guerre au Vietnam? Pour protester contre le systeme capitaliste americain? Pour s'elever contre une societe injuste? Parce qu'elle haissait ses parents et ce qu'ils representaient? Comment comprendre son acte? Comment le supporter? Comment elle en etait arrivee la? Comment avait-elle ete indoctrinee? Et par qui? Pour “le suedois" c'est la descente aux enfers, bien qu'il essaye de n'en rien laisser paraitre.
Je laisse la parole a Roth: “…survient la fille perdue, la fille en cavale, cette Américaine de la quatrième génération censée reproduire en plus parfait encore l'image de son père, lui-même image du sien en plus parfait et ainsi de suite… survient la fille en colère, la malgracieuse, qui crache sur son monde et se fiche éperdument de prendre sa place dans la lignée Levov en pleine ascension sociale, sa fille, enfin, qui le débusque comme un fugitif, qui le pousse la première dans la transhumance d'une tout autre Amérique ; sa fille et ces années soixante qui font voler en éclats le type d'utopie qui lui est cher, à lui. Voilà la mort rouge qui contamine le château du Suédois, et personne n'en réchappe. Voilà sa fille qui l'exile de sa pastorale américaine tant désirée pour le précipiter dans un univers hostile qui en est le parfait contraire, dans la fureur, la violence, le désespoir d'un chaos infernal qui n'appartient qu'à l'Amérique”.
Et plus loin: “Pour elle, être américaine, c'était haïr l'Amérique. Mais, lui, il ne pouvait pas plus cesser d'aimer l'Amérique que cesser d'aimer père et mère, ou abandonner tout code de conduite. Comment pouvait-elle détester un pays alors qu'elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'il était ? Comment sa propre enfant pouvait-elle s'aveugler au point de vouer aux gémonies le « système pourri » qui avait donné toutes les chances de succès à sa famille ? Comment pouvait-elle traîner dans la boue ses « capitalistes » de parents comme si leur fortune était le produit d'autre chose que de trois générations industrieuses et tenaces ? Trois générations d'hommes, dont lui, qui avaient trimé dans la crasse et la puanteur d'une tannerie. Elle avait débuté dans une tannerie, aux côtés des derniers des derniers, cette famille qu'elle appelait désormais les « chiens capitalistes ». Il n'y avait pas grande différence, et elle le savait, entre haïr l'Amérique et les haïr eux-mêmes. Il aimait l'Amérique qu'elle haïssait, tenait pour responsable de toutes les imperfections de la vie, et voulait renverser par la violence ; il aimait les prétendues « valeurs bourgeoises » qu'elle abhorrait, ridiculisait et voulait subvertir ; il aimait la mère qu'elle détestait, et qu'elle avait failli faire mourir en commettant l'acte qu'elle avait commis. Petite salope ignare!”
C'est la fin d'un monde pour le suedois. Avec lui Roth decrit les fractures de l'Amerique au dernier tiers du XXe siecle. Aux anciennes et non resolues fractures raciales se sont rajoutees des fractures politiques importantes qui ont ranime les latentes fractures economiques et sociales. Mais Roth n'est pas un sociologue, il est romancier, et son roman, qui eclaire une periode de crise, m'a fait surtout vivre le cauchemar d'un homme, sa decomposition face a l'ecroulement de tous ses criteres. Pas seulement comprendre, mais accompagner, vivre avec son personnage son desespoir. Roth est un tres grand ecrivain, et cette Pastorale un grand livre. Une page d'histoire, brillamment romancee. le naufrage d'un homme, profondement rendu.
1968, Merry Levov, jeune fille de 16 ans fait exploser une bombe dans la poste locale de Newark et tue un homme, un acte terroriste pour manifester son rejet de la guerre du Viêt-Nam. Après l'attentat Merry s'enfuit et entre dans la clandestinité, ses parents n'auront plus de nouvelles d'elle pendant 5 ans.
Merry est issue d'une famille juive parfaitement ancrée dans les bonnes moeurs de l'Amérique, son père Seymour, un patron respecté et droit, incarne le modèle de réussite. Il est marié à Dawn une très belle irlandaise, catholique, ancienne Miss New Jersey. Tout semble idéal, la famille Levov représente le cliché du « rêve américain » alors qu'est-ce qui amène cette adolescente à bousculer ce tableau idyllique en commettant cet acte terroriste…
Le père essaie de comprendre pourquoi sa fille à basculer dans l'extrémisme. A-t-elle été manipulée, influencée, ou est-elle perturbée, Seymour ne peut imaginer que sa fille chérie soit une terroriste, une militante engagée prête à tuer.
Seymour est profondément atteint par l'acte de Merry, la culpabilité le gagne, il cherche à savoir quelle faille a-t-il commis dans l'éducation de sa fille. Mais cet événement le sort de sa naïveté et de son conformisme, il ouvre les yeux et découvre un autre horizon de l'Amérique, il porte également un regard interrogateur sur sa vie si parfaite. Seymour prend conscience de l'hypocrisie de la société américaine, de ses amies et de ses relations.
Tous les codes moraux de Seymour Levov sont entachés, « sa pastorale » est brisée et devient un paradis perdu.
Philipp Roth donne la parole au narrateur écrivain Nathan Zuckerman. Tout le roman est construit sur le point de vue de ce narrateur qui analyse la société américaine des années 1940 à 1970 et dissèque la psychologie de Seymour personnage central du roman. Un livre qui effleure le militantisme, mais Philipp Roth ne prend pas position, et visite avec réserve les travers d'une Amérique divisée.
Un grand coup coeur.
Merry est issue d'une famille juive parfaitement ancrée dans les bonnes moeurs de l'Amérique, son père Seymour, un patron respecté et droit, incarne le modèle de réussite. Il est marié à Dawn une très belle irlandaise, catholique, ancienne Miss New Jersey. Tout semble idéal, la famille Levov représente le cliché du « rêve américain » alors qu'est-ce qui amène cette adolescente à bousculer ce tableau idyllique en commettant cet acte terroriste…
Le père essaie de comprendre pourquoi sa fille à basculer dans l'extrémisme. A-t-elle été manipulée, influencée, ou est-elle perturbée, Seymour ne peut imaginer que sa fille chérie soit une terroriste, une militante engagée prête à tuer.
Seymour est profondément atteint par l'acte de Merry, la culpabilité le gagne, il cherche à savoir quelle faille a-t-il commis dans l'éducation de sa fille. Mais cet événement le sort de sa naïveté et de son conformisme, il ouvre les yeux et découvre un autre horizon de l'Amérique, il porte également un regard interrogateur sur sa vie si parfaite. Seymour prend conscience de l'hypocrisie de la société américaine, de ses amies et de ses relations.
Tous les codes moraux de Seymour Levov sont entachés, « sa pastorale » est brisée et devient un paradis perdu.
Philipp Roth donne la parole au narrateur écrivain Nathan Zuckerman. Tout le roman est construit sur le point de vue de ce narrateur qui analyse la société américaine des années 1940 à 1970 et dissèque la psychologie de Seymour personnage central du roman. Un livre qui effleure le militantisme, mais Philipp Roth ne prend pas position, et visite avec réserve les travers d'une Amérique divisée.
Un grand coup coeur.
Qu'étaient venus chercher tous ces immigrants qui débarquaient aux portes de New York au début du vingtième siècle ou même un peu avant ? Quels espoirs les habitaient quand ils foulaient, pour la première fois, le sol américain ? Au terme d'une traversée périlleuse et dans des conditions innommables, ils demandaient à travailler, à subvenir aux besoins des familles, à ne plus connaître la misère, à manger à leur faim et à vivre sans peur, sans persécutions, sans être victimes d'une race, d'une religion, d'une origine...
Si l'on garde cela en tête, la "Pastorale américaine" est une lecture percutante qui vous met à terre.
En un cliché - au sens photographique du terme - , Philip Roth nous dit l'histoire d'une famille sur quatre générations, du premier pas de celui qui a choisi cette terre porteuse d'espoirs, en 1890, jusqu'à la fin des années soixante, années de questionnements et de chaos, années de bouleversements et d'affrontements, années terribles desquelles le pays ne se remettra véritablement jamais.
Car la bombe que la jeune Merry pose au nom d'une idéologie, entre manifestations pacifistes contre la guerre du Vietnam et heurs autour de la réalité des Droits civiques, en dynamitant le coeur vital du bourg d'habitation, anéantit, avec une onde rémanente, les fondements de cette famille qui croyait avoir atteint la félicité.
Merry qui cherche une place dans une société qui se révèle incapable d'englober toutes ses différences, toutes ses pensées, toutes ses convictions.
Je ne serai pas trop bavarde, bon nombre de très belles critiques permettent de découvrir le livre, déjà, mais peut-être ne vaut-il mieux pas trop lire d'avis avant d'entamer la lecture, et décider de se laisser guider par l'écrivain et accepter d'être bousculé par les différents virages du récit.
Par la façon dont Philip Roth introduit le récit, en faisant intervenir son "double", le personnage de Nathan Zuckerman, sorte de "reflet littéraire dans les mots", je n'ai pu m'empêcher de penser à un autre écrivain américain qui fait aussi référence à son "double littéraire"- écrivain comme lui, dans certains de ses livres : Paul Auster que j'ai lu davantage.
Et le lieu où se déroule la "Pastorale américaine" ainsi que le milieu dans lequel elle prend place ne pouvaient pas ne pas évoquer cet autre grand écrivain.
Là où Paul Auster témoigne de la bienveillance à l'égard de ses personnages, les guidant vers la lumière, les aidant à trouver la sérénité, Philip Roth donne l'impression de laisser glisser un regard froid dénué d‘émotion sur les siens. Il ne les embellit pas, ne leur cherche pas d'excuses, ils sont bourrés de défauts, ils ont tant de manquements et on a l'impression que Philip Roth n'attend rien de la nature humaine à la différence de Paul Auster qui espère encore.
Cela fait du récit un tableau comme passé au scalpel, tranchant, dur, sans atermoiements. Les personnages se débattent mais on comprend très vite qu'il n'y pas d'issue heureuse….
C'est assez désespérée comme vision.
C'est brillant, le lecteur est comme aimanté, comme attiré par les phrases, le rythme du récit. En même temps, la lecture devient, par moments, nauséeuse entre la situation sociale qui ne trouvera aucune solution d'apaisement et l'intimité feinte dans son bonheur des personnages, on se sent mal à l'aise, on se sent voyeur d'un désastre, de l'effondrement d'une famille qui avait rejoint les nantis, de l'effondrement d'une société qui peine à trouver une place pour tous, qui peine à écouter chacun.
On est obligé de poser le livre un moment, et de le reprendre ensuite, on reprend son souffle…
C'est l'Histoire qui s'immisce dans une famille, qui s'y incarne même, L Histoire et le destin de cette famille comme en miroir l'une de l'autre, dans une narration romancée. C'est l'antithèse du Rêve américain.
C'est extrêmement captivant, à la fois le récit et l'écriture.
C'était ma première rencontre avec l'écriture de Philip Roth, je l'avais longtemps repoussée, parce qu'appréhendée, ne me sentant pas à la hauteur… C'est la gentillesse d'une amie babéliote sollicitée – larmordbm – qui m'a convaincue d'entrer dans cet univers, qu'il me soit donc permis de vous remercier, Dominique, pour m'avoir conseillée et m'avoir guidée pour ce premier choix.
J'ai découvert un écrivain que je vais lire, et relire, en espaçant les lectures pour profiter longtemps et pleinement.
Si l'on garde cela en tête, la "Pastorale américaine" est une lecture percutante qui vous met à terre.
En un cliché - au sens photographique du terme - , Philip Roth nous dit l'histoire d'une famille sur quatre générations, du premier pas de celui qui a choisi cette terre porteuse d'espoirs, en 1890, jusqu'à la fin des années soixante, années de questionnements et de chaos, années de bouleversements et d'affrontements, années terribles desquelles le pays ne se remettra véritablement jamais.
Car la bombe que la jeune Merry pose au nom d'une idéologie, entre manifestations pacifistes contre la guerre du Vietnam et heurs autour de la réalité des Droits civiques, en dynamitant le coeur vital du bourg d'habitation, anéantit, avec une onde rémanente, les fondements de cette famille qui croyait avoir atteint la félicité.
Merry qui cherche une place dans une société qui se révèle incapable d'englober toutes ses différences, toutes ses pensées, toutes ses convictions.
Je ne serai pas trop bavarde, bon nombre de très belles critiques permettent de découvrir le livre, déjà, mais peut-être ne vaut-il mieux pas trop lire d'avis avant d'entamer la lecture, et décider de se laisser guider par l'écrivain et accepter d'être bousculé par les différents virages du récit.
Par la façon dont Philip Roth introduit le récit, en faisant intervenir son "double", le personnage de Nathan Zuckerman, sorte de "reflet littéraire dans les mots", je n'ai pu m'empêcher de penser à un autre écrivain américain qui fait aussi référence à son "double littéraire"- écrivain comme lui, dans certains de ses livres : Paul Auster que j'ai lu davantage.
Et le lieu où se déroule la "Pastorale américaine" ainsi que le milieu dans lequel elle prend place ne pouvaient pas ne pas évoquer cet autre grand écrivain.
Là où Paul Auster témoigne de la bienveillance à l'égard de ses personnages, les guidant vers la lumière, les aidant à trouver la sérénité, Philip Roth donne l'impression de laisser glisser un regard froid dénué d‘émotion sur les siens. Il ne les embellit pas, ne leur cherche pas d'excuses, ils sont bourrés de défauts, ils ont tant de manquements et on a l'impression que Philip Roth n'attend rien de la nature humaine à la différence de Paul Auster qui espère encore.
Cela fait du récit un tableau comme passé au scalpel, tranchant, dur, sans atermoiements. Les personnages se débattent mais on comprend très vite qu'il n'y pas d'issue heureuse….
C'est assez désespérée comme vision.
C'est brillant, le lecteur est comme aimanté, comme attiré par les phrases, le rythme du récit. En même temps, la lecture devient, par moments, nauséeuse entre la situation sociale qui ne trouvera aucune solution d'apaisement et l'intimité feinte dans son bonheur des personnages, on se sent mal à l'aise, on se sent voyeur d'un désastre, de l'effondrement d'une famille qui avait rejoint les nantis, de l'effondrement d'une société qui peine à trouver une place pour tous, qui peine à écouter chacun.
On est obligé de poser le livre un moment, et de le reprendre ensuite, on reprend son souffle…
C'est l'Histoire qui s'immisce dans une famille, qui s'y incarne même, L Histoire et le destin de cette famille comme en miroir l'une de l'autre, dans une narration romancée. C'est l'antithèse du Rêve américain.
C'est extrêmement captivant, à la fois le récit et l'écriture.
C'était ma première rencontre avec l'écriture de Philip Roth, je l'avais longtemps repoussée, parce qu'appréhendée, ne me sentant pas à la hauteur… C'est la gentillesse d'une amie babéliote sollicitée – larmordbm – qui m'a convaincue d'entrer dans cet univers, qu'il me soit donc permis de vous remercier, Dominique, pour m'avoir conseillée et m'avoir guidée pour ce premier choix.
J'ai découvert un écrivain que je vais lire, et relire, en espaçant les lectures pour profiter longtemps et pleinement.
Citations et extraits (160)
Voir plus
Ajouter une citation
Seymour Levov, dit «le Suédois», ancien athlète, bon citoyen admiré de tous, est un homme brisé. Merry, sa fille adorée, est devenue une terroriste. A-t-il été un bon père?
"Or survient la fille perdue, la fille en cavale, cette Américaine de la quatrième génération censée reproduire en plus parfait encore l'image de son père, lui-même image du sien en plus parfait et ainsi de suite... survient la fille en colère, la malgracieuse, qui crache sur son monde et se fiche éperdument de prendre sa place dans la lignée Levov en pleine ascension sociale, sa fille, enfin, qui le débusque comme un fugitif, qui le pousse la première dans la transhumance d'une tout autre Amérique; sa fille et ces années soixante qui font voler en éclats le type d'utopie qui lui est cher, à lui. Voilà la mort rouge qui contamine le château du Suédois, et personne n'en réchappe. Voilà sa fille qui l'exile de sa pastorale américaine tant désirée pour le précipiter dans un univers hostile qui en est le parfait contraire, dans la fureur, la violence, le désespoir d'un chaos infernal qui n'appartient qu'à l'Amérique.
C'est le dysfonctionnement total du commerce entre les générations comme on l'a vécu naguère, où chacun connaissait son rôle et prenait les règles très au sérieux, c'est la fin des échanges qui nous avaient acculturés depuis l'enfance, tous tant que nous sommes; la lutte pour la réussite des fils d'immigrés, jusque-là rituelle, vient de prendre un tour pathologique. Et où, je vous le demande? Dans le manoir d'un gentleman-farmer, notre Suédois hyperbanal, un type d'équerre comme un paquet de cartes, qui attendait une évolution diamétralement opposée des choses, et qui n'était en rien préparé à ce qui allait se produire. Comment aurait-il pu deviner, avec toute sa bonté soigneusement calibrée, qu'il fallait payer si cher pour vivre dans l'obéissance? L'obéissance, on la choisit pour faire baisser les enjeux, au contraire. Belle épouse. Belle maison. L'affaire se porte comme un charme. Son tyran de père, il le manipule assez bien. Il en jouit un maximum, de son paradis personnel. Ainsi vivent les gens qui réussissent. Ce sont de bons citoyens. Ils ont conscience de leur chance. Ils en sont reconnaissants. Dieu leur sourit. Quand il y a des problèmes, on s'adapte. Or, subitement tout change, et ça devient impossible. Plus rien ne sourit à personne. Et alors qui peut s'adapter? Voilà quelqu'un qui n'est pas fait pour que la vie batte de l'aile - ne parlons pas de l'invraisemblable. D'ailleurs qui est fait pour l'invraisemblable? Personne. Qui est fait pour la tragédie et la souffrance absurde? Personne. La tragédie de l'homme qui n'était pas fait pour la tragédie, c'est la tragédie de tout homme.
Il ne cessait de se regarder vivre de l'extérieur. La lutte de sa vie, c'était d'enfouir ce drame. Mais comment faire? De toute sa vie il n'avait jamais eu l'occasion de se demander:
«Pourquoi est-ce que les choses sont ce qu'elles sont?» Pourquoi se tourmenter lorsque les choses vont toujours à merveille. «Pourquoi les choses sont-elles ce qu'elles sont?» C'est la question sans réponse, et, jusque-là, il avait eu le bonheur d'ignorer même que cette question se posait.
Après toute la tension et l'effervescence qu'il nous avait fallu à nous, gens sur le retour, pour remonter le cours du temps jusqu'à cette heure où son passage nous indifférait tout à fait, et ressusciter ainsi l'innocence de notre promotion au milieu du siècle, l'allégresse de l'après-midi commençait à faire long feu, et je commençais à entrevoir la chose même qui avait dû laisser perplexe le Suédois jusqu'à l'instant de sa mort: comment avait-il pu devenir le jouet de l'histoire? L'histoire, l'Histoire de l'Amérique, celle qu'on lit dans les livres, qu'on apprend à l'école, était parvenue au vieux village paisible d'Old Rimrock dans le New Jersey, dans une cambrousse où on ne l'avait jamais vue pointer le nez depuis que l'armée de Washington avait pris deux fois ses quartiers d'hiver sur les hauteurs de Morristown. L'histoire, qui n'avait pas mordu de façon radicale sur le quotidien du petit peuple depuis la guerre d'Indépendance, avait retrouvé le chemin de ces collines enclavées et, contre toute attente, avec son génie de l'imprévu, elle avait mis à sac la demeure bien rangée des Seymour Levov, n'y laissant que décombres. On se représente toujours l'histoire comme un processus à long terme, mais, en réalité, c'est un agent très soudain.
Sérieusement, tout en évoluant avec Joy sur cette musique désuète, je me mis à m'imaginer pour ma gouverne ce qui avait bien pu définir au héros de Weequahic une destinée en tout point contraire à celle qu'on lui aurait imaginée du temps que cette musique et son invite sentimentale étaient de saison, et que le Suédois, son quartier, sa ville et son pays connaissaient leur âge d'or, le sommet de leur assurance, avec toutes les illusions dont l'espoir est porteur. Tout en tenant serrée dans mes bras Joy Halpern qui pleurait sans bruit sur la vieille rengaine qui nous enjoignait à nous tous, sexagénaires, de «rêver pour que les rêves se réalisent», je fis entrer le Suédois sur la piste. Ce soir-là, Chez Vincent, pour mille raisons excellentes, il n'avait pu se résoudre à me le demander. Pour autant que je sache, il n'avait pas l'intention de me le demander. La raison de sa présence n'était peut-être nullement de me faire écrire son histoire. C'était peut-être plutôt moi qui me trouvais là pour le faire.
Ça n'a rien à voir avec le basket.
Lorsque j'étais gosse, il était bien le seul à m'avoir inspiré, comme à tant de gamins, le désir d'être un autre. Mais se vouloir dans la gloire d'un autre, qu'on soit enfant ou adulte, est intenable pour des raisons psychologiques si l'on n'est pas écrivain, et pour des raisons esthétiques si on l'est. En revanche, embrasser son héros dans sa descente aux enfers, se laisser envahir par sa vie au moment où tout conspire à le diminuer, s'imaginer en proie à la même infortune, s'impliquer non pas dans son triomphe en cette heure irréfléchie où il polarise notre adulation, mais dans le désarroi de sa chute tragique, voilà qui mérite réflexion.
Me voici donc sur la piste de danse avec Joy, et je pense au Suédois, à ce qui est arrivé à son pays en l'espace d'à peine vingt-cinq ans, entre les années triomphales de la guerre au lycée de Weequahic et le moment où sa fille a fait exploser une bombe, en 1968; je pense à cette mystérieuse, cette troublante, cette extraordinaire transition historique. Je pense aux années soixante et au désordre causé par la guerre du Vietnam, aux familles qui ont perdu leurs enfants, et à celles qui ne les ont pas perdus; mais les Seymour Levov font partie des premières. C'étaient des familles progressistes, pleines de tolérance, de gentillesse, de bonne volonté, qui, justement, ont eu des enfants déchaînés, qui sont allés en prison, qui ont pris le maquis, qui sont passés en Suède ou au Canada. Je pense à la chute vertigineuse du Suédois, qui a dû s'en imputer la responsabilité. C'est par là qu'il faut commencer. Il n'y est pour rien, qu'à cela ne tienne. Il se tient quand même pour responsable. C'est ainsi depuis toujours, il porte des responsabilités monstrueuses, il se contrôle, mais il contrôle aussi tout ce qui menace de déborder, il donne le meilleur de lui-même pour que son monde ne se défasse pas. Oui, pour lui, il va de soi que la cause du désastre est une transgression. Quelle autre explication pourrait-il trouver? Il faut que ce soit une transgression, une seule, même s'il n'y a que lui pour la reconnaître comme telle. Le désastre qui le frappe tient à un manquement de sa part, croit-il.
Mais voilà, lequel?
Je dissipai l'aura du dîner Chez Vincent, où je m'étais empressé de conclure étourdiment que tout était aussi simple qu'il y paraissait, et je fis monter sur scène le jeune homme que nous allions tous suivre en Amérique, notre chef de file sur la voie de l'intégration, qui se sentait ici chez lui à la manière même des wasps, qui était américain sans se forcer: non pas parce que c'était le Juif qui trouve un vaccin, le Juif de la Cour suprême, le plus brillant, le plus éminent ou le plus fort, mais au contraire en vertu de son isomorphisme avec le monde wasp où il trouvait sa place par sa banalité, son naturel, son côté américain moyen. Sur les accords sirupeux de Dream, je m'arrachai à moi-même et à la fête des retrouvailles, et je me mis à rêver. Je rêvai une chronique réaliste. J'entrepris de jeter les yeux sur sa vie; non pas sa vie de dieu ou de demi-dieu dont les triomphes nous faisaient exulter gamins, mais sa vie d'homme aussi vulnérable qu'un autre. C'est ainsi que sans savoir pourquoi - or voici que, comme on dirait ailleurs - je le trouvai à Deal, New Jersey, dans la villa de bord de mer, l'été des onze ans de sa fille, du temps qu'elle ne décollait pas de ses genoux, l'affublait de toutes sortes de tendres sobriquets et ne pouvait «résister», comme elle disait, à l'envie d'explorer du bout du doigt ses oreilles si parfaitement collées à son crâne. Entortillée dans une serviette, elle traversait la maison en courant pour prendre un maillot sec sur la corde à linge, et criait: «Me regardez pas, vous autres!»; plusieurs soirs, elle avait fait irruption dans la salle de bains au moment où il se lavait, et s'était écriée à sa vue: «Oh pardonnez-moi, j'ai pensé que...», à quoi il avait rétorqué: «Ouste! Veux-tu bien fiche-le-camper.» Cet été-là, un soir qu'ils rentraient de la plage en voiture, ivre de soleil, affalée contre son épaule nue, elle avait levé les yeux vers lui et lui avait demandé avec un mélange d'innocence et d'audace, en jouant à la grande avant l'heure: «Papa, embbbbrasse-moi comme tu embbrasses mmmmaman!» Saoulé de soleil lui aussi, plein d'une fatigue voluptueuse après une matinée passée à se laisser rouler par les grosses vagues avec elle, il avait constaté en baissant les yeux dans sa direction que la bretel
"Or survient la fille perdue, la fille en cavale, cette Américaine de la quatrième génération censée reproduire en plus parfait encore l'image de son père, lui-même image du sien en plus parfait et ainsi de suite... survient la fille en colère, la malgracieuse, qui crache sur son monde et se fiche éperdument de prendre sa place dans la lignée Levov en pleine ascension sociale, sa fille, enfin, qui le débusque comme un fugitif, qui le pousse la première dans la transhumance d'une tout autre Amérique; sa fille et ces années soixante qui font voler en éclats le type d'utopie qui lui est cher, à lui. Voilà la mort rouge qui contamine le château du Suédois, et personne n'en réchappe. Voilà sa fille qui l'exile de sa pastorale américaine tant désirée pour le précipiter dans un univers hostile qui en est le parfait contraire, dans la fureur, la violence, le désespoir d'un chaos infernal qui n'appartient qu'à l'Amérique.
C'est le dysfonctionnement total du commerce entre les générations comme on l'a vécu naguère, où chacun connaissait son rôle et prenait les règles très au sérieux, c'est la fin des échanges qui nous avaient acculturés depuis l'enfance, tous tant que nous sommes; la lutte pour la réussite des fils d'immigrés, jusque-là rituelle, vient de prendre un tour pathologique. Et où, je vous le demande? Dans le manoir d'un gentleman-farmer, notre Suédois hyperbanal, un type d'équerre comme un paquet de cartes, qui attendait une évolution diamétralement opposée des choses, et qui n'était en rien préparé à ce qui allait se produire. Comment aurait-il pu deviner, avec toute sa bonté soigneusement calibrée, qu'il fallait payer si cher pour vivre dans l'obéissance? L'obéissance, on la choisit pour faire baisser les enjeux, au contraire. Belle épouse. Belle maison. L'affaire se porte comme un charme. Son tyran de père, il le manipule assez bien. Il en jouit un maximum, de son paradis personnel. Ainsi vivent les gens qui réussissent. Ce sont de bons citoyens. Ils ont conscience de leur chance. Ils en sont reconnaissants. Dieu leur sourit. Quand il y a des problèmes, on s'adapte. Or, subitement tout change, et ça devient impossible. Plus rien ne sourit à personne. Et alors qui peut s'adapter? Voilà quelqu'un qui n'est pas fait pour que la vie batte de l'aile - ne parlons pas de l'invraisemblable. D'ailleurs qui est fait pour l'invraisemblable? Personne. Qui est fait pour la tragédie et la souffrance absurde? Personne. La tragédie de l'homme qui n'était pas fait pour la tragédie, c'est la tragédie de tout homme.
Il ne cessait de se regarder vivre de l'extérieur. La lutte de sa vie, c'était d'enfouir ce drame. Mais comment faire? De toute sa vie il n'avait jamais eu l'occasion de se demander:
«Pourquoi est-ce que les choses sont ce qu'elles sont?» Pourquoi se tourmenter lorsque les choses vont toujours à merveille. «Pourquoi les choses sont-elles ce qu'elles sont?» C'est la question sans réponse, et, jusque-là, il avait eu le bonheur d'ignorer même que cette question se posait.
Après toute la tension et l'effervescence qu'il nous avait fallu à nous, gens sur le retour, pour remonter le cours du temps jusqu'à cette heure où son passage nous indifférait tout à fait, et ressusciter ainsi l'innocence de notre promotion au milieu du siècle, l'allégresse de l'après-midi commençait à faire long feu, et je commençais à entrevoir la chose même qui avait dû laisser perplexe le Suédois jusqu'à l'instant de sa mort: comment avait-il pu devenir le jouet de l'histoire? L'histoire, l'Histoire de l'Amérique, celle qu'on lit dans les livres, qu'on apprend à l'école, était parvenue au vieux village paisible d'Old Rimrock dans le New Jersey, dans une cambrousse où on ne l'avait jamais vue pointer le nez depuis que l'armée de Washington avait pris deux fois ses quartiers d'hiver sur les hauteurs de Morristown. L'histoire, qui n'avait pas mordu de façon radicale sur le quotidien du petit peuple depuis la guerre d'Indépendance, avait retrouvé le chemin de ces collines enclavées et, contre toute attente, avec son génie de l'imprévu, elle avait mis à sac la demeure bien rangée des Seymour Levov, n'y laissant que décombres. On se représente toujours l'histoire comme un processus à long terme, mais, en réalité, c'est un agent très soudain.
Sérieusement, tout en évoluant avec Joy sur cette musique désuète, je me mis à m'imaginer pour ma gouverne ce qui avait bien pu définir au héros de Weequahic une destinée en tout point contraire à celle qu'on lui aurait imaginée du temps que cette musique et son invite sentimentale étaient de saison, et que le Suédois, son quartier, sa ville et son pays connaissaient leur âge d'or, le sommet de leur assurance, avec toutes les illusions dont l'espoir est porteur. Tout en tenant serrée dans mes bras Joy Halpern qui pleurait sans bruit sur la vieille rengaine qui nous enjoignait à nous tous, sexagénaires, de «rêver pour que les rêves se réalisent», je fis entrer le Suédois sur la piste. Ce soir-là, Chez Vincent, pour mille raisons excellentes, il n'avait pu se résoudre à me le demander. Pour autant que je sache, il n'avait pas l'intention de me le demander. La raison de sa présence n'était peut-être nullement de me faire écrire son histoire. C'était peut-être plutôt moi qui me trouvais là pour le faire.
Ça n'a rien à voir avec le basket.
Lorsque j'étais gosse, il était bien le seul à m'avoir inspiré, comme à tant de gamins, le désir d'être un autre. Mais se vouloir dans la gloire d'un autre, qu'on soit enfant ou adulte, est intenable pour des raisons psychologiques si l'on n'est pas écrivain, et pour des raisons esthétiques si on l'est. En revanche, embrasser son héros dans sa descente aux enfers, se laisser envahir par sa vie au moment où tout conspire à le diminuer, s'imaginer en proie à la même infortune, s'impliquer non pas dans son triomphe en cette heure irréfléchie où il polarise notre adulation, mais dans le désarroi de sa chute tragique, voilà qui mérite réflexion.
Me voici donc sur la piste de danse avec Joy, et je pense au Suédois, à ce qui est arrivé à son pays en l'espace d'à peine vingt-cinq ans, entre les années triomphales de la guerre au lycée de Weequahic et le moment où sa fille a fait exploser une bombe, en 1968; je pense à cette mystérieuse, cette troublante, cette extraordinaire transition historique. Je pense aux années soixante et au désordre causé par la guerre du Vietnam, aux familles qui ont perdu leurs enfants, et à celles qui ne les ont pas perdus; mais les Seymour Levov font partie des premières. C'étaient des familles progressistes, pleines de tolérance, de gentillesse, de bonne volonté, qui, justement, ont eu des enfants déchaînés, qui sont allés en prison, qui ont pris le maquis, qui sont passés en Suède ou au Canada. Je pense à la chute vertigineuse du Suédois, qui a dû s'en imputer la responsabilité. C'est par là qu'il faut commencer. Il n'y est pour rien, qu'à cela ne tienne. Il se tient quand même pour responsable. C'est ainsi depuis toujours, il porte des responsabilités monstrueuses, il se contrôle, mais il contrôle aussi tout ce qui menace de déborder, il donne le meilleur de lui-même pour que son monde ne se défasse pas. Oui, pour lui, il va de soi que la cause du désastre est une transgression. Quelle autre explication pourrait-il trouver? Il faut que ce soit une transgression, une seule, même s'il n'y a que lui pour la reconnaître comme telle. Le désastre qui le frappe tient à un manquement de sa part, croit-il.
Mais voilà, lequel?
Je dissipai l'aura du dîner Chez Vincent, où je m'étais empressé de conclure étourdiment que tout était aussi simple qu'il y paraissait, et je fis monter sur scène le jeune homme que nous allions tous suivre en Amérique, notre chef de file sur la voie de l'intégration, qui se sentait ici chez lui à la manière même des wasps, qui était américain sans se forcer: non pas parce que c'était le Juif qui trouve un vaccin, le Juif de la Cour suprême, le plus brillant, le plus éminent ou le plus fort, mais au contraire en vertu de son isomorphisme avec le monde wasp où il trouvait sa place par sa banalité, son naturel, son côté américain moyen. Sur les accords sirupeux de Dream, je m'arrachai à moi-même et à la fête des retrouvailles, et je me mis à rêver. Je rêvai une chronique réaliste. J'entrepris de jeter les yeux sur sa vie; non pas sa vie de dieu ou de demi-dieu dont les triomphes nous faisaient exulter gamins, mais sa vie d'homme aussi vulnérable qu'un autre. C'est ainsi que sans savoir pourquoi - or voici que, comme on dirait ailleurs - je le trouvai à Deal, New Jersey, dans la villa de bord de mer, l'été des onze ans de sa fille, du temps qu'elle ne décollait pas de ses genoux, l'affublait de toutes sortes de tendres sobriquets et ne pouvait «résister», comme elle disait, à l'envie d'explorer du bout du doigt ses oreilles si parfaitement collées à son crâne. Entortillée dans une serviette, elle traversait la maison en courant pour prendre un maillot sec sur la corde à linge, et criait: «Me regardez pas, vous autres!»; plusieurs soirs, elle avait fait irruption dans la salle de bains au moment où il se lavait, et s'était écriée à sa vue: «Oh pardonnez-moi, j'ai pensé que...», à quoi il avait rétorqué: «Ouste! Veux-tu bien fiche-le-camper.» Cet été-là, un soir qu'ils rentraient de la plage en voiture, ivre de soleil, affalée contre son épaule nue, elle avait levé les yeux vers lui et lui avait demandé avec un mélange d'innocence et d'audace, en jouant à la grande avant l'heure: «Papa, embbbbrasse-moi comme tu embbrasses mmmmaman!» Saoulé de soleil lui aussi, plein d'une fatigue voluptueuse après une matinée passée à se laisser rouler par les grosses vagues avec elle, il avait constaté en baissant les yeux dans sa direction que la bretel
On lutte contre sa propre superficialité, son manque de profondeur, pour essayer d’arriver devant autrui sans attente irréaliste, sans cargaison de préjugés, d’espoirs, d’arrogance; on ne veut pas faire le tank, on laisse son canon, ses mitrailleuses et son blindage; on arrive devant autrui sans le menacer, on marche pieds nus sur ses dix orteils au lieu d’écraser la pelouse sous ses chenilles; on arrive l’esprit ouvert, pour l’aborder d’égal à égal, d’homme à homme comme on disait jadis. Et, avec tout ça, on se trompe à tous les coups. Comme si on n’avait pas plus de cervelle qu’un tank. On se trompe avant même avant même de rencontrer les gens, quand on imagine la rencontre avec eux; on se trompe quand on est avec eux; et puis quand on rentre chez soi, et qu’on raconte la rencontre à quelque un d’autre, on se trompe de nouveau. Or, comme la réciproque est généralement vraie, personne n’y voit que du feu, ce n’est qu’illusion, malentendu qui confine à la farce. Pourtant, comment s’y prendre dans cette affaire si importante- les autres- qui se vide de toute la signification que nous lui supposons et sombre dans le ridicule, tant nous sommes mal équipés pour nous représenter le fonctionnement intérieur d’autrui et ses mobiles cachés? Est-ce qu’il faut pour autant que chacun s’en aille de son côté ,s’enferme dans sa tour d’ivoire , isolée de tout bruit, comme les écrivains solitaires, et fasse naître les gens à partir de mots, pour postuler ensuite que ces êtres de mots sont plus vrais que les vrais, que nous massacrons tous les jours par notre ignorance? Le fait est que comprendre les autres n’est pas la règle, dans la vie. L’histoire de la vie, c’est de se tromper sur leur compte, encore et encore, encore et toujours, avec acharnement et, après y avoir bien réfléchi, se tromper à nouveau. C’est même comme ça qu’on sait qu’on est vivant: on se trompe. Peut être que le mieux serait de renoncer à avoir tort ou raison sur autrui, et continuer, rien que pour la balade. Mais si vous y arrivez, vous..alors vous avez de la chance.
Aussi bien, cette réunion de famille n’avait lieu qu’une fois l’an, pour Thanksgiving, fête neutre, vidée de son contenu religieux, où tout le monde mange la même chose, et personne ne va se cacher pour consommer des mets bizarres, style kugel, gefillte fish, et herbes amères. Deux cent cinquante millions de personnes mangent une dinde unique et colossale, qui nourrit tout le pays. On met entre parenthèses les mets bizarres, les pratiques bizarres et les particularismes religieux, entre parenthèses la nostalgie trimillénaire des Juifs, et chez les chrétiens le Christ, sa croix et sa crucifixion ; chacun, dans le New Jersey et ailleurs, met son irrationalité en veilleuse mieux que tout le reste de l’année. On met entre parenthèses griefs et ressentiments, et pas seulement les Dwyer et les Levov, mais tous ceux qui, en Amérique, soupçonnent leur voisin. C’est la pastorale américaine par excellence ; ça dure vingt-quatre heures.
« On lutte contre sa propre superficialité, son manque de profondeur, pour essayer d'arriver devant autrui sans attente irréaliste, sans cargaison de préjugés, d'espoirs, d'arrogance, ; on ne veut pas faire le tank, on laisse son canon, ses mitrailleuses et son blindage ; on arrive devant autrui sans le menacer on marche pieds nus sur ses dix orteils au lieu d'écraser la pelouse sous ses chenilles ; on arrive l'esprit ouvert, pour l'aborder d'égal à égal , d'homme à homme, comme on le disait jadis. Et, avec tout ça, on se trompe à tous les coups. Comme si on avait pas plus de cervelle qu'un tank.On se trompe avant même de rencontrer les gens, quand on imagine la rencontre avec eux ; on se trompe quand on est avec eux ; et puis quand on rentre chez soi, et qu'on raconte la rencontre à quelqu'un, on se trompe de nouveau. Or, comme la réciproque est généralement vraie, personne n'y voit que du feu, ce n'est illusion, malentendu qui confine à la farce.Pourtant, comment s'y prendre sans cette affaire si importante- les autres – qui se vide de toute la signification que nous lui supposons et sombre dans le ridicule, tant nous sommes mal équipés pour nous représenter le fonctionnement intérieur d'autrui et ses mobiles cachés ? Est-ce qu'il faut pour autant que chacun s'en aille de son côté, s'enferme dans sa tour d'ivoire, isolée de tout bruit, comme les écrivains solitaires, et fasse naître les gens à partir des mots pour postuler ensuite que ces êtres de mots sont plus vrais que les vrais, que nous massacrons tous les jours par notre ignorance ?
Le fait est que comprendre les autres n'est pas la règle, dans la vie.
L'histoire de la vie , c'est de se tromper sur leur compte, encore et encore, encore et toujours, avec acharnement et, après y avoir bien réfléchi, se tromper à nouveau.
C'est même comme ça qu'on sait qu'on est vivant : on se trompe.
Peut -être que le mieux serait de renoncer à avoir tord ou raison sur autrui, et continuer que pour la balade. Mais si vous y arrivez vous...alors vous avez de la chance »
Philip Roth. Pastorale américaine, Le paradis de la mémoire. Extrait.
Le fait est que comprendre les autres n'est pas la règle, dans la vie.
L'histoire de la vie , c'est de se tromper sur leur compte, encore et encore, encore et toujours, avec acharnement et, après y avoir bien réfléchi, se tromper à nouveau.
C'est même comme ça qu'on sait qu'on est vivant : on se trompe.
Peut -être que le mieux serait de renoncer à avoir tord ou raison sur autrui, et continuer que pour la balade. Mais si vous y arrivez vous...alors vous avez de la chance »
Philip Roth. Pastorale américaine, Le paradis de la mémoire. Extrait.
Il s’en retournait, à grandes enjambées, jusque chez lui, longeant les palissades blanches qu’il aimait, les prés vallonnés qu’il aimait, les champs de maïs, les champs de navets, les granges, les chevaux, les vaches, les mares, les rivières, les sources, les cascades, le cresson sauvage, les osiers, les prairies, les kilomètres de forêt qu’il adorait avec l’affection naïve d’un citadin pour la nature, jusqu’à ce qu’il atteignît les érables centenaires qu’il adorait, la vieille maison de pierre imposante qu’il adorait — en faisant semblant, sur son chemin, de semer partout des pépins de pommes. […] Ce qu’il faisait, là-bas, sur la route (mais, comme si c’était une occupation futile ou honteuse, il ne pouvait se résoudre à l’avouer, même à Dawn), il faisait l’amour à sa vie.
Videos de Philip Roth (54)
Voir plusAjouter une vidéo
Nouvel horaire pour l'émission "Le coup de coeur des libraires" sur les Ondes de Sud Radio. Valérie Expert et Gérard Collard vous donne rendez-vous chaque dimanche à 13h30 pour vous faire découvrir leurs passions du moment !
•
Retrouvez leurs dernières sélections de livres ici !
•
•
le Géant empêtré de Anne de Tinguy aux éditions Perrin
https://www.lagriffenoire.com/le-geant-empetre.html
•
le Grand Théâtre du pouvoir de Catherine Nay aux éditions Bouquins
https://www.lagriffenoire.com/le-grand-theatre-du-pouvoir.-quarante-ans-de-vie-politique.html
•
Histoire intime de la V République: La belle époque (2) de Franz-Olivier Giesbert aux éditions Gallimard
https://www.lagriffenoire.com/histoire-intime-de-la-v-republique-vol02-la-belle-epoque.html
•
Une route de Richard Paul Evans et Pierre Simon aux éditions Actes Sud
https://www.lagriffenoire.com/une-route.html
•
Super hôte de Kate Russo et Severine Weiss aux éditions J'ai Lu
https://www.lagriffenoire.com/super-hote-1.html
•
La Malédiction de la Madone de Philippe Vilain aux éditions Robert Laffont
https://www.lagriffenoire.com/la-malediction-de-la-madone.html
•
DOG de Clémentine Dabadie aux éditions Gallimard
https://www.lagriffenoire.com/dog.html
•
La Splendeur et l'Infamie de Erik Larson et Hubert Tézenas aux éditions Livredepoche
https://www.lagriffenoire.com/la-splendeur-et-l-infamie-1.html
•
Churchill de Andrew Roberts et Antoine Capet aux éditions Perrin
https://www.lagriffenoire.com/churchill.html
•
Pamela de Stéphanie des Horts aux éditions Livre de Poche
https://www.lagriffenoire.com/pamela.html
•
À ma table créole: Recettes iconiques des îles de Suzy Palatin aux éditions Hachette Pratique
https://www.lagriffenoire.com/a-ma-table-creole-recettes-iconiques-des-iles.html
•
Hitler et Churchill de Andrew Roberts et Antoine Capet aux éditions Perrin
https://www.lagriffenoire.com/hitler-et-churchill-secrets-de-meneurs-d-hommes.html
•
La Dame du Ritz de Melanie Benjamin aux éditions Livre de Poche
https://www.lagriffenoire.com/la-dame-du-ritz-2.html
•
Les Sorcières: L'encyclopédie du merveilleux de Cécile Roumiguière et Benjamin Lacombe aux éditions Albin Michel
https://www.lagriffenoire.com/les-sorcieres-l-encyclopedie-du-merveilleux.html
•
Les Fées: L'encyclopédie du merveilleux de Sébastien Perez et Bluebirdy aux éditions Albin Michel
https://www.lagriffenoire.com/les-fees-l-encyclopedie-du-merveilleux.html
•
+ Lire la suite
autres livres classés : Guerre du Viet-Nam (1961-1975)Voir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus

50 romans pour 50 états
Thyuig
50 livres

Les 100 romans du Monde
Cronos
100 livres

Le roman américain
HerveB
101 livres
Autres livres de Philip Roth (44)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quel froid !
Que signifie l'expression "jeter un froid" ?
Provoquer une situation désagréable de gêne où les personnes présentes ne savent pas comment réagir
Etre en désaccord ou avoir un conflit avec quelqu'un
Lancer des boules de neige sur quelqu'un
12 questions
763 lecteurs ont répondu
Thèmes :
culture générale
, littérature
, écrivain
, roman
, politiqueCréer un quiz sur ce livre763 lecteurs ont répondu