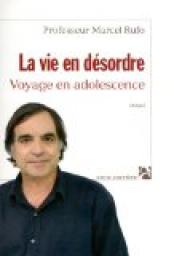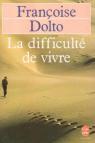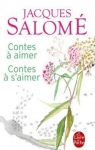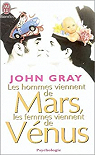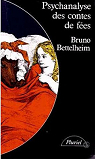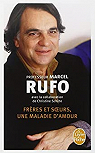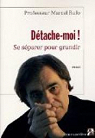Marcel Rufo/5
33 notes
Résumé :
On envie les adolescents pour leur jeunesse et ses promesses, mais on oublie un peu vite qu'il s'agit aussi d'une période douloureuse,
parce qu'elle représente une perte : perte de la pensée magique de l'enfance, des illusions sur soi et sur le monde. Il faut apprendre à
accepter ses propres limites et se résoudre à
être toujours un peu moins glorieux que ce que l'on avait imaginé. On comprend alors pourquoi l'adolescence constitue un terrain fa... >Voir plus
parce qu'elle représente une perte : perte de la pensée magique de l'enfance, des illusions sur soi et sur le monde. Il faut apprendre à
accepter ses propres limites et se résoudre à
être toujours un peu moins glorieux que ce que l'on avait imaginé. On comprend alors pourquoi l'adolescence constitue un terrain fa... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après La vie en désordre : Voyage en adolescenceVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (6)
Voir plus
Ajouter une critique
Dans cet ouvrage, l'auteur évoque beaucoup "La maison de Solenn" créée surtout pour venir en aide aux adolescentes anorexiques mais qui réserve des lits pour d'autres pathologies.
Ce livre est une étude de cas bien particuliers d'adolescents confrontés à des difficultés psychiques parfois liées à des pathologies (cancer, diabète, ;;;). le praticien évoque des cas cliniques qu'il a pu rencontrer tout au long de sa carrière, il parle aussi de ses maîtres, professeurs de médecine, dont l'humanisme a su l'interpeller. Marcel Rufo réfléchit aussi au suicide, au passage à l'acte et va jusqu'à mettre en avant sa responsabilité, vivant cela comme un échec personnel.
Beaucoup d'empathie dans ce livre, l'impression que le médecin est très proche de ses patients, pas seulement par l'écoute mais aussi par un lien affectif.
Un médecin qui sait se remettre en cause, et qui ne croit pas que le but est atteint une fois pour toute. Ceci, il l'exprime très bien au tout début de sa "Conclusion provisoire" : Je me souviens de l'un de mes maîtres qui, à un âge avancé, disait toujours : "Au stade où j'en suis de ma formation..." A l'époque, jeune interne pressé de montrer qu'il savait déjà tout, je le trouvais un peu ridicule dans sa posture d'éternel apprenti, et je le soupçonnais de fausse humilité. A présent, je le comprends et je pourrais prendre à mon compte les mots qu'il prononçait. Ma formation est loin d'être terminée. le sera-t-elle jamais? Je sais qu'on n'en finit jamais d'apprendre.
Oui, on n'en finit jamais d'apprendre... C'est aussi la raison pour laquelle, même si notre adolescence est très loin derrière nous, il est bon de lire de tels ouvrages, qui soulèvent parfois le voile sur un lointain passé ou nous font mieux appréhender les jeunes que nous rencontrons avec leurs doutes, leurs attentes, leurs fragilités...
Ce livre est une étude de cas bien particuliers d'adolescents confrontés à des difficultés psychiques parfois liées à des pathologies (cancer, diabète, ;;;). le praticien évoque des cas cliniques qu'il a pu rencontrer tout au long de sa carrière, il parle aussi de ses maîtres, professeurs de médecine, dont l'humanisme a su l'interpeller. Marcel Rufo réfléchit aussi au suicide, au passage à l'acte et va jusqu'à mettre en avant sa responsabilité, vivant cela comme un échec personnel.
Beaucoup d'empathie dans ce livre, l'impression que le médecin est très proche de ses patients, pas seulement par l'écoute mais aussi par un lien affectif.
Un médecin qui sait se remettre en cause, et qui ne croit pas que le but est atteint une fois pour toute. Ceci, il l'exprime très bien au tout début de sa "Conclusion provisoire" : Je me souviens de l'un de mes maîtres qui, à un âge avancé, disait toujours : "Au stade où j'en suis de ma formation..." A l'époque, jeune interne pressé de montrer qu'il savait déjà tout, je le trouvais un peu ridicule dans sa posture d'éternel apprenti, et je le soupçonnais de fausse humilité. A présent, je le comprends et je pourrais prendre à mon compte les mots qu'il prononçait. Ma formation est loin d'être terminée. le sera-t-elle jamais? Je sais qu'on n'en finit jamais d'apprendre.
Oui, on n'en finit jamais d'apprendre... C'est aussi la raison pour laquelle, même si notre adolescence est très loin derrière nous, il est bon de lire de tels ouvrages, qui soulèvent parfois le voile sur un lointain passé ou nous font mieux appréhender les jeunes que nous rencontrons avec leurs doutes, leurs attentes, leurs fragilités...
Ce qui est intéressant avec Marcel Ruffo, c'est que dans cet ouvrage, il s'adresse aux parents avec un language que tous peuvent appréhender. Comme dans toutes ses oeuvres, il reste d'une modestie incroyable et trouve toujours les mots justes. Ce Voyage en Adolescence est un parcours très enrichissant et passionnant qui nous entraîne dans l'esprit un peu bousculé de l'adolescent et nous apprend simplement à nous, parents, à trouver les pistes qui nous aideront juste à les accompagner un bout de chemin. Marcel Ruffo ne nous donne pas les solutions, mais nous donne les clés pour envisager un voyage le moins turbulent possible avec nos adolescents. C'est bien écrit, et cela nous conforte dans l'idée qu'être parent d'adolescent est aussi un parcours fragile mais que nous avons tous une chance de le suivre au mieux.
Quelle déception. Rufo, plutôt que de parler d'adolescence, ne fait que dire à quel point il est bon médecin, psychiatre efficace, homme bienveillant... Tout ce que je savais déjà mais que je n'avais pas besoin de lire de sa plume.
Ouvrage de renforcement narcissique qui ne tient pas ses engagements.
Ouvrage de renforcement narcissique qui ne tient pas ses engagements.
Le professeur Marcel Rufo est un psychiatre trés connu, spécialiste des troubles de l'adolescence.
Je pensais que son livre m'apporterait davantage de connaissances sur sa vie et son oeuvre
J'ai donc été déçue car ce livre ne m'a rien apporté de nouveau.
Par contre, cette lecture m'a conforté quant à la profonde humanité de cet homme, ses compétences et sa volonté de briser le carcan qui entourait la psychiatrie. Avec humilité, il nous fait part de ses doutes.
Un livre qui tente de nous aider à cerner le mal vivre des adolescents.
Je pensais que son livre m'apporterait davantage de connaissances sur sa vie et son oeuvre
J'ai donc été déçue car ce livre ne m'a rien apporté de nouveau.
Par contre, cette lecture m'a conforté quant à la profonde humanité de cet homme, ses compétences et sa volonté de briser le carcan qui entourait la psychiatrie. Avec humilité, il nous fait part de ses doutes.
Un livre qui tente de nous aider à cerner le mal vivre des adolescents.
Je ne connais pas fondamentalement la compétence de Marcel Rufo, mais une chose m'a beaucoup parlé dans ce livre trouvé en boîte à livres : une certaine humilité exprimée. Ici Rufo reconnaît que la psychiatrie, de manière générale mais surtout face à l'adolescence, n'est pas une science exacte. Il parle des errances passées de la discipline, des erreurs qu'il a essayé de corriger avec "La maison de Solenn". Il parle de ses propres doutes, de ses tentatives, certaines couronnées de succès, mais il n'élude absolument pas la dévastation des échecs. J'ai apprécié cette posture intelligente sur les troubles alimentaires, les tentatives de suicide. Rufo ne se pose jamais en sachant, tout juste en homme de quelques expériences et en expérimentateur. Une lecture intéressante et humaine.
Citations et extraits (8)
Voir plus
Ajouter une citation
En médecine, les premières morts que l'on affronte sont toujours terribles, presque terrifiantes. Elles viennent mettre à mal la fougue de la jeunesse, ce sentiment un peu naïf de toute-puissance que certains peuvent avoir. Pourquoi choisir d'entamer des études de médecine, si ce n'est dans l'espoir un peu fou de soigner et de guérir, donc de combattre la mort et de réussir à faire triompher la vie? La mort d'un patient non seulement nous confronte aux limites de notre propre compétence et à celles de la science médicale en général, mais elle entraîne aussi un sentiment de culpabilité. Ai-je fait tout ce qui était possible? Ne suis-je pas en partie responsable? Ai-je été assez présent, assez proche? Le patient s'est-il senti vraiment soutenu ou, au contraire, a-t-il eu l'impression qu'on l'abandonnait? La leçon est toujours rude : contrairement à ce que l'on voulait croire, on ne peut pas tout maîtriser ; il faut pouvoir admettre que la maladie est parfois plus forte que notre science médicale.
Je suis un vieux pédopsychiatre, un "archéopsy", dis-je parfois. Mais il se pourrait bien que l'âge, considéré trop souvent comme un handicap, représente un atout dans ce métier si particulier. Parce qu'il est synomyme de temps, il permet l'expérience, une expérience faite de rencontres, d'interrogations, de doutes, d'erreurs, de progrès, d'échecs, de remises en question, d'approfondissements, de changements... et de quelques succès aussi, quand même. Ce temps passé, ces expériences accumulées autorisent à avoir un regard, une vue d'ensemble - sur ma vie, sur ma pratique, sur l'évolution de la pédopsychiatrie, cette drôle de spécialité qui en est encore à ses débuts.
Il m'apparaît que toutes ces années passées n'ont eu, paradoxalement, qu'un fil conducteur : le désordre. Désordre de la vie, avec ses découvertes, ses ruptures, ses deuils, ses imprévus. Désordre du psychisme et de ses va-et-vient permanents pour tenter de trouver un équilibre entre ses différentes instances : le ça, le surmoi et le moi, afin de vivre le plus harmonieusement possible avec soi-même mais aussi avec les autres.
Il m'apparaît que toutes ces années passées n'ont eu, paradoxalement, qu'un fil conducteur : le désordre. Désordre de la vie, avec ses découvertes, ses ruptures, ses deuils, ses imprévus. Désordre du psychisme et de ses va-et-vient permanents pour tenter de trouver un équilibre entre ses différentes instances : le ça, le surmoi et le moi, afin de vivre le plus harmonieusement possible avec soi-même mais aussi avec les autres.
L'asile, c'était autant de moments ahurissants, d'images inoubliables, dans un monde entre Goya et Jérôme Bosch, où les patients, entassés dans des salles communes, entre des murs gris, étaient condamnés à ne rien attendre ni rien espérer. Une galerie de personnages bouleversants, dont on finissait peut-être par oublier la souffrance.
Mais ce qui est vrai pour le médecin, cardiologue, cancérologue, gastro-entérologue, ou autre, est sensiblement différent pour le psychiatre, car, excepté les cas où une pathologie somatique vient se greffer au trouble psychique, la mort en psychiatrie, c'est toujours le suicide. L'agressivité que cet acte exprime vis-à-vis de l'entourage, familial et amical, n'épargne pas le soignant, à qui il vient signifier son incompétence, ses failles. C'est en tout cas comme cela que je le ressens. Le suicide d'un patient est un échec dont je ne peux guérir.
L'image de soi se construit dans l'enfance, essentiellement à travers le regard des autres. C'est parce que la mère (et les autres figures d'attachement) aime son enfant qu'elle lui donne le sentiment d'être aimable. Ainsi, la capacité de s'aimer et d'aimer les autres dépend de la façon dont on a été aimé et regardé dans les premiers temps de notre vie, où va se constituer notre capital narcissique.
Videos de Marcel Rufo (12)
Voir plusAjouter une vidéo
"Le livre des délices", les plats préférés des célébrités !
#JoelDicker #LeLivreDesDélices #Cuisine
Dans une mise en page soignée et illustrée de photographies à la mise en scène élégante, ce livre de recettes pas comme les autres nous fait pénétrer les cuisines secrètes de grandes personnalités, de Philippe Geluck à Bernard Pivot en passant par Patrick Poivre d'Arvor.
Platon philosophait pendant son Banquet, Rabelais fit de son Gargantua un goinfre légendaire, Alexandre Dumas classa méthodiquement ses plats préférés dans son Grand dictionnaire de cuisine… Mais les célébrités d'aujourd'hui, qu'aiment-elles ? Comment mangent-elles ? Préfèrent-elles des recettes élaborées ou les menus plus simples ? Et surtout, pourquoi ? Souvenir d'enfance ou récente découverte, recette de famille ou popote improvisée ?
Trente personnalités dévoilent ici leur plat préféré et disent leur relation à cette recette fétiche. Passés à la casserole experte du chef exécutive Benjamin Brial, les plats ont été revisités dans l'espoir de vous donner envie de vous mettre en cuisine et de déguster ces mets si appréciés par Joël Dicker, Kad Merad, Sempé, Marcel Rufo, Tatiana de Rosnay, Bernard Pivot et bien d'autres !
https://www.lisez.com/actualites/le-livre-des-delices-les-plats-preferes-des-celebrites/1932 https://www.instagram.com/editions_archipel/ https://m.facebook.com/larchipel/
Dans une mise en page soignée et illustrée de photographies à la mise en scène élégante, ce livre de recettes pas comme les autres nous fait pénétrer les cuisines secrètes de grandes personnalités, de Philippe Geluck à Bernard Pivot en passant par Patrick Poivre d'Arvor.
Platon philosophait pendant son Banquet, Rabelais fit de son Gargantua un goinfre légendaire, Alexandre Dumas classa méthodiquement ses plats préférés dans son Grand dictionnaire de cuisine… Mais les célébrités d'aujourd'hui, qu'aiment-elles ? Comment mangent-elles ? Préfèrent-elles des recettes élaborées ou les menus plus simples ? Et surtout, pourquoi ? Souvenir d'enfance ou récente découverte, recette de famille ou popote improvisée ?
Trente personnalités dévoilent ici leur plat préféré et disent leur relation à cette recette fétiche. Passés à la casserole experte du chef exécutive Benjamin Brial, les plats ont été revisités dans l'espoir de vous donner envie de vous mettre en cuisine et de déguster ces mets si appréciés par Joël Dicker, Kad Merad, Sempé, Marcel Rufo, Tatiana de Rosnay, Bernard Pivot et bien d'autres !
https://www.lisez.com/actualites/le-livre-des-delices-les-plats-preferes-des-celebrites/1932 https://www.instagram.com/editions_archipel/ https://m.facebook.com/larchipel/
+ Lire la suite
Dans la catégorie :
Troubles psychiatriquesVoir plus
>Maladies>Maladies du système nerveux. Troubles psychiques>Troubles psychiatriques (235)
autres livres classés : psychologieVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Marcel Rufo (23)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Freud et les autres...
Combien y a-t-il de leçons sur la psychanalyse selon Freud ?
3
4
5
6
10 questions
434 lecteurs ont répondu
Thèmes :
psychologie
, psychanalyse
, sciences humainesCréer un quiz sur ce livre434 lecteurs ont répondu