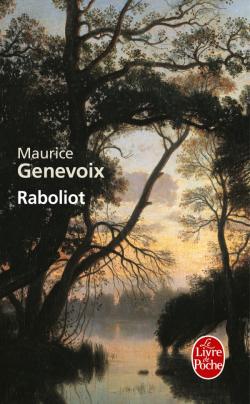Maurice Genevoix/5
377 notes
Résumé :
Notre guerre... Vous et moi, quelques hommes, une centaine que j'ai connus... Je ne sais que cela, les gestes que nous avons faits, notre souffrance et notre gaîté, les mots que nous disions, les visages que nous avions parmi les autres visages, et votre mort.
1er août 1914 : la France décrète la mobilisation générale. Le 2 août, Genevoix, brillant normalien qui n'a pas 24 ans, rejoint le 106e régiment d'infanterie comme sous-lieutenant... Neuf mois p... >Voir plus
1er août 1914 : la France décrète la mobilisation générale. Le 2 août, Genevoix, brillant normalien qui n'a pas 24 ans, rejoint le 106e régiment d'infanterie comme sous-lieutenant... Neuf mois p... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Ceux de 14Voir plus
Critiques, Analyses et Avis (61)
Voir plus
Ajouter une critique
Est-ce que la paix a jamais été réelle, a jamais existé ? Est-ce qu'il fut un temps où les hommes étaient libres ? Libres de leurs gestes, de leur temps, de leurs rêves, de leurs pensées ?
Dans ces forêts d'Argonne où ne cheminent plus les hardes silencieuses, où les arbres ne sont que squelettes de bois, ne portant plus feuilles, ne murmurant plus réponse au vent, dans ces bois où les oiseaux ont fui, seule la boue chuinte, hurle, agrippe et ensevelit.
Cette matière indomptable à l'image de l'Histoire qui s'écrit mot à mot au milieu de ces compagnies, de ces bataillons, s'approprie les corps, pénétrant les vêtements, autant qu'elle s'immisce dans les esprits, paralysant les pensées et les espoirs. Quand ces hommes espèrent le froid, c'est pour s'échapper d'elle, de sa gangue possessive pour mieux embrasser le mordant de la gelée, la douceur froide, tranchante, et trompeuse de la neige ou du grésil qui ajoutent à leurs souffrances.
Ils sont milliers mais ne sont qu'un : celui qui peine sous la charge du havresac, celui qui tremble des heures à venir, celui qui regarde angoissé l'éphémère protection des parapets, celui qui s'envole auprès des êtres aimés sans savoir quand il les serrera à nouveau dans les bras, sans savoir même s'il lui sera permis à nouveau de le faire...
Ils attendant au rythme des jours et surtout des nuits, ils espèrent la relève, ils redoutent le retour aux tranchées, ils observent les obus qui strient le ciel, les balles meurtrières qui viennent sans bruit à leurs oreilles fracassées et ôtent la vie du voisin, du compagnon, de celui avec qui ils venaient juste de partager une cigarette pour tromper le temps, le froid. Ils ont faim quand l'escarpement, la boue et l'alerte éloignent les cuisines, quand la chaleur ne leur sera pas offerte encore cette fois, quand il faut attendre encore...
Maurice Genevoix dit avec beaucoup de pudeur ce qu'ont été ces premières heures du conflit le plus meurtrier du pays, durant ces mois qui séparent son engagement de sa blessure aux Eparges.
S'il dit l'attente, il dit la misère des conditions de celle-ci, le froid, la boue, accentuant l'évidence de la fragilité déjà extrême des existences. S'il dit la montée au front, il parle des ordres absurdes ou insensés que l'agent de liaison dépose devant lui au risque de sa vie, tout autant que ses camarades de tranchées.
Maurice Genevoix ne juge pas, ne s'apitoie pas, décrit sans grandiloquence ces quelques mois. S'il insiste, c'est sur la résignation qui se faufile et gagne tous les esprits, résignation à obéir autant qu'à accepter que le doigt de la mort désigne le prochain à s'effacer...
Les pages bouleversantes de cette offensive que l'on sait, au début du récit, imminente sont de celles qui accrochent le coeur, de celles qui labourent les âmes. Ces hommes deviennent nôtres dans leurs souffrances, dans la fatalité qui les guide. Beaucoup tombent, peu reviennent et s'ils ont cette destinée, ils ne peuvent s'empêcher de penser que le sort distribue au hasard, à chacun sans distinction, à celui-là la vie encore pour combien de temps, à cet autre une agonie terrifiante pour lui et ceux qui l'entendent appeler.
Les mots de Maurice Genevoix sont tissés d'acuité, même s'il s'est battu avec courage, faisant preuve de beaucoup d'empathie envers ses hommes, de cette solidarité qui guide pas et décisions, il n'en reste pas moins lucide sur l'ineptie des actes et des combats de ses hommes éreintés et anéantis de fatigue et de désillusion, trop intimes de cette mort qui s'identifie comme leur plus proche compagne.
L'absurdité des guerres est une évidence mais plus encore ce conflit qui s'incarne en un chaos monstrueux, broyant les existences, amputant les corps et les âmes, réinventant les vies désormais autres. Devant tant de souffrance, tant de cris silencieux de ces êtres parcourant les tranchées pour monter au front, obligation nous est faite de nous imprégner de ce livre pour dire un respect, pour garder leurs visages dans les pensées, pour ne pas oublier cette génération offerte au sacrifice. Celui-là choisi justement parce que le style dit dans sa simplicité l'existence réelle de ceux qui ont foulé ces terres et ces bois en ce premier hiver du conflit, celui-là parce qu'il parvient si bien à nous faire épeler le mot "Paix".
Maurice Genevoix a écrit d'autres récits souvent portés par une évocation essentielle de la nature, des bois, de ceux qui les animent, de ceux qui en sont le frémissement de vie – chevreuils, oiseaux ou arbres... Sans doute, est-ce la plume d'un être qui avait contemplé l'extrême cruauté des hommes et qui ne parvenait à la chasser de son esprit, qui traçait les mots de ces histoires fabuleuses emplies du sentiment si précieux de la paix.
Dans ces forêts d'Argonne où ne cheminent plus les hardes silencieuses, où les arbres ne sont que squelettes de bois, ne portant plus feuilles, ne murmurant plus réponse au vent, dans ces bois où les oiseaux ont fui, seule la boue chuinte, hurle, agrippe et ensevelit.
Cette matière indomptable à l'image de l'Histoire qui s'écrit mot à mot au milieu de ces compagnies, de ces bataillons, s'approprie les corps, pénétrant les vêtements, autant qu'elle s'immisce dans les esprits, paralysant les pensées et les espoirs. Quand ces hommes espèrent le froid, c'est pour s'échapper d'elle, de sa gangue possessive pour mieux embrasser le mordant de la gelée, la douceur froide, tranchante, et trompeuse de la neige ou du grésil qui ajoutent à leurs souffrances.
Ils sont milliers mais ne sont qu'un : celui qui peine sous la charge du havresac, celui qui tremble des heures à venir, celui qui regarde angoissé l'éphémère protection des parapets, celui qui s'envole auprès des êtres aimés sans savoir quand il les serrera à nouveau dans les bras, sans savoir même s'il lui sera permis à nouveau de le faire...
Ils attendant au rythme des jours et surtout des nuits, ils espèrent la relève, ils redoutent le retour aux tranchées, ils observent les obus qui strient le ciel, les balles meurtrières qui viennent sans bruit à leurs oreilles fracassées et ôtent la vie du voisin, du compagnon, de celui avec qui ils venaient juste de partager une cigarette pour tromper le temps, le froid. Ils ont faim quand l'escarpement, la boue et l'alerte éloignent les cuisines, quand la chaleur ne leur sera pas offerte encore cette fois, quand il faut attendre encore...
Maurice Genevoix dit avec beaucoup de pudeur ce qu'ont été ces premières heures du conflit le plus meurtrier du pays, durant ces mois qui séparent son engagement de sa blessure aux Eparges.
S'il dit l'attente, il dit la misère des conditions de celle-ci, le froid, la boue, accentuant l'évidence de la fragilité déjà extrême des existences. S'il dit la montée au front, il parle des ordres absurdes ou insensés que l'agent de liaison dépose devant lui au risque de sa vie, tout autant que ses camarades de tranchées.
Maurice Genevoix ne juge pas, ne s'apitoie pas, décrit sans grandiloquence ces quelques mois. S'il insiste, c'est sur la résignation qui se faufile et gagne tous les esprits, résignation à obéir autant qu'à accepter que le doigt de la mort désigne le prochain à s'effacer...
Les pages bouleversantes de cette offensive que l'on sait, au début du récit, imminente sont de celles qui accrochent le coeur, de celles qui labourent les âmes. Ces hommes deviennent nôtres dans leurs souffrances, dans la fatalité qui les guide. Beaucoup tombent, peu reviennent et s'ils ont cette destinée, ils ne peuvent s'empêcher de penser que le sort distribue au hasard, à chacun sans distinction, à celui-là la vie encore pour combien de temps, à cet autre une agonie terrifiante pour lui et ceux qui l'entendent appeler.
Les mots de Maurice Genevoix sont tissés d'acuité, même s'il s'est battu avec courage, faisant preuve de beaucoup d'empathie envers ses hommes, de cette solidarité qui guide pas et décisions, il n'en reste pas moins lucide sur l'ineptie des actes et des combats de ses hommes éreintés et anéantis de fatigue et de désillusion, trop intimes de cette mort qui s'identifie comme leur plus proche compagne.
L'absurdité des guerres est une évidence mais plus encore ce conflit qui s'incarne en un chaos monstrueux, broyant les existences, amputant les corps et les âmes, réinventant les vies désormais autres. Devant tant de souffrance, tant de cris silencieux de ces êtres parcourant les tranchées pour monter au front, obligation nous est faite de nous imprégner de ce livre pour dire un respect, pour garder leurs visages dans les pensées, pour ne pas oublier cette génération offerte au sacrifice. Celui-là choisi justement parce que le style dit dans sa simplicité l'existence réelle de ceux qui ont foulé ces terres et ces bois en ce premier hiver du conflit, celui-là parce qu'il parvient si bien à nous faire épeler le mot "Paix".
Maurice Genevoix a écrit d'autres récits souvent portés par une évocation essentielle de la nature, des bois, de ceux qui les animent, de ceux qui en sont le frémissement de vie – chevreuils, oiseaux ou arbres... Sans doute, est-ce la plume d'un être qui avait contemplé l'extrême cruauté des hommes et qui ne parvenait à la chasser de son esprit, qui traçait les mots de ces histoires fabuleuses emplies du sentiment si précieux de la paix.
Voilà un témoignage absolument irremplaçable sur la Grande guerre.
J'ai commencé ma lecture avec un mélange d'impatience mais aussi d'appréhension, après avoir été décontenancé par le lyrisme stratosphérique de la Forêt perdue. Heureusement, il n'y a ici rien de cela : si la langue est belle, le ton et la narration sont sans la moindre affectation, au plus près des hommes qui ont entouré Genevoix sur le front.
On ne doit pas s'attendre à une quelconque dramatisation du récit : c'est un journal de guerre, extraordinairement lucide et bien écrit, mais sans autre scénario que celui de la guerre, au jour le jour, dans toute son humanité et son inhumanité. Cela s'étend sur près de huit cent pages, racontant l'horreur par le menu, mais également la monotonie de l'horreur. Car la guerre se définit aussi par une addition de temps vides, peuplés d'ennui, habités par la répétition des mêmes gestes, des mêmes moments, des mêmes rituels, avec des variations aussi subtiles qu'infinies. Entre le temps à tuer et le temps qui tue, les soldats cherchent désespérément à raviver le souvenir de leur vie d'avant. Parfois, ils portent comme une croix le remords d'avoir un jour mal agi, et de ne peut-être jamais pouvoir se faire pardonner. Ces pages-là serrent souvent le coeur.
Le lecteur impatient pourrait être tenté d'aller tout droit au quatrième et dernier volume de l'ensemble, Les Éparges. C'est le plus célèbre, le plus violent et spectaculaire, le plus conforme en un mot à ce que l'on croit savoir de la Première Guerre mondiale. Faire l'économie des premiers tomes serait à mon avis une grave erreur, qui priverait de la compréhension profonde de l'oeuvre : les huit cents pages qui mènent à l'apocalypse des Éparges sont un chemin qu'il faut accepter de parcourir pour espérer en saisir le sens, si tant est qu'une abomination telle que celle-là puisse avoir un sens.
Les héros sont sacrifiés par la patrie, vite enterrés, aussi vite remplacés, promis certes à une gloire collective mais à l'oubli individuel. Genevoix leur rend ici justice : ils sont une centaine, dit-il, qui l'ont accompagné dans cette guerre. Une centaine de destins brisés, de vies interrompues ou mutilées. Des croix, des fosses, des photos pâlies... Et Genevoix qui leur redonne le souffle, qui leur rend un visage et les fait parler de nouveau. Le plus bel hommage qu'un ami et que la littérature pouvaient leur rendre.
J'ai commencé ma lecture avec un mélange d'impatience mais aussi d'appréhension, après avoir été décontenancé par le lyrisme stratosphérique de la Forêt perdue. Heureusement, il n'y a ici rien de cela : si la langue est belle, le ton et la narration sont sans la moindre affectation, au plus près des hommes qui ont entouré Genevoix sur le front.
On ne doit pas s'attendre à une quelconque dramatisation du récit : c'est un journal de guerre, extraordinairement lucide et bien écrit, mais sans autre scénario que celui de la guerre, au jour le jour, dans toute son humanité et son inhumanité. Cela s'étend sur près de huit cent pages, racontant l'horreur par le menu, mais également la monotonie de l'horreur. Car la guerre se définit aussi par une addition de temps vides, peuplés d'ennui, habités par la répétition des mêmes gestes, des mêmes moments, des mêmes rituels, avec des variations aussi subtiles qu'infinies. Entre le temps à tuer et le temps qui tue, les soldats cherchent désespérément à raviver le souvenir de leur vie d'avant. Parfois, ils portent comme une croix le remords d'avoir un jour mal agi, et de ne peut-être jamais pouvoir se faire pardonner. Ces pages-là serrent souvent le coeur.
Le lecteur impatient pourrait être tenté d'aller tout droit au quatrième et dernier volume de l'ensemble, Les Éparges. C'est le plus célèbre, le plus violent et spectaculaire, le plus conforme en un mot à ce que l'on croit savoir de la Première Guerre mondiale. Faire l'économie des premiers tomes serait à mon avis une grave erreur, qui priverait de la compréhension profonde de l'oeuvre : les huit cents pages qui mènent à l'apocalypse des Éparges sont un chemin qu'il faut accepter de parcourir pour espérer en saisir le sens, si tant est qu'une abomination telle que celle-là puisse avoir un sens.
Les héros sont sacrifiés par la patrie, vite enterrés, aussi vite remplacés, promis certes à une gloire collective mais à l'oubli individuel. Genevoix leur rend ici justice : ils sont une centaine, dit-il, qui l'ont accompagné dans cette guerre. Une centaine de destins brisés, de vies interrompues ou mutilées. Des croix, des fosses, des photos pâlies... Et Genevoix qui leur redonne le souffle, qui leur rend un visage et les fait parler de nouveau. Le plus bel hommage qu'un ami et que la littérature pouvaient leur rendre.
A travers ces 4 livres dont l'auteur entame l'écriture dès sa démobilisation, Maurice Genevoix nous fait partager d'abord l'espoir qui porte les jeunes gens de 1914 qui partent en plein été pour une guerre qu'ils croient encore brève.
On partage le quotidien des combattants, à hauteur d'homme, des environs de Bar le Duc pendant la bataille de la Marne, jusqu'au nord de la Meuse et aux Eparges dont la boue a englouti tant d'hommes.
A l'espoir des débuts succède la désillusion et le dégoût de cette guerre abominable où les hommes sont lancés à l'assaut de positions imprenables, où les offensives inutiles se succèdent et emportent chaque fois sont lot de vies.
Lorsque l'on termine Ceux de 14, il en reste bien des choses après l'avoir achevé. On ne voit plus le site des Eparges de la même façon après ce récit. En particulier lorsque l'on localise la tombe du lieutenant Porchon au cimetière du trottoir, situé en contrebas du piton.
Genevoix,à travers son récit, son art de la description, nous fait vivre les moments qu'il a traversés jusqu'à sa blessure en avril 15, celle là même qui l'a sauvé.
Beaucoup d'émotion dans ce livre qui est ce que j'ai lu de meilleur sur ce sujet.
On partage le quotidien des combattants, à hauteur d'homme, des environs de Bar le Duc pendant la bataille de la Marne, jusqu'au nord de la Meuse et aux Eparges dont la boue a englouti tant d'hommes.
A l'espoir des débuts succède la désillusion et le dégoût de cette guerre abominable où les hommes sont lancés à l'assaut de positions imprenables, où les offensives inutiles se succèdent et emportent chaque fois sont lot de vies.
Lorsque l'on termine Ceux de 14, il en reste bien des choses après l'avoir achevé. On ne voit plus le site des Eparges de la même façon après ce récit. En particulier lorsque l'on localise la tombe du lieutenant Porchon au cimetière du trottoir, situé en contrebas du piton.
Genevoix,à travers son récit, son art de la description, nous fait vivre les moments qu'il a traversés jusqu'à sa blessure en avril 15, celle là même qui l'a sauvé.
Beaucoup d'émotion dans ce livre qui est ce que j'ai lu de meilleur sur ce sujet.
Je viens de passer un mois au coeur de la première guerre mondiale et je ne suis pas près d'oublier. Après la lecture magnifique du "Chemin des âmes" de J. Boyden, j'ai eu envie d'entendre la voix d'un combattant. Et je crois que Maurice Genevoix est celui qu'il faut écouter. " Ceux de 14" est à mon avis un chef d'oeuvre: d'abord parce que l'écriture de l'auteur par sa force évocatrice nous plonge dans des moments vécus et nous les fait partager pudiquement certes mais aussi fortement, ensuite car c'est un vrai témoignage et que chaque personnage a vraiment existé: ils ne sont pas des personnages mais des témoins et Genevoix leur a donné ce qui leur a manqué à tous: la parole. C'est par moments presqu'insoutenable mais Genevoix décrit aussi une telle humanité au milieu de la barbarie que c'en est une leçon. A lire absolument.
Ceux de 14 de Maurice GENEVOIX
(Flammarion – 2013)
4e de couverture : 1er août 1914 : la France décrète la mobilisation générale. le 2 août, Genevoix, brillant normalien qui n'a pas 24 ans, rejoint le 106e régiment d'infanterie comme sous-lieutenant.. neuf mois plus tard, il est grièvement blessé et est réformé. Fin de la guerre pour le jeune Genevoix.
Entre ce mois d'août 1914 et les trois balles qui l'atteignent, le 25 avril 1015 dans la Tranchée de Calonne, le jeune homme aura participé à la bataille de la Marne, marché sur Verdun et, surtout, pendant quatre longs mois, défendu les Éparges. Sur cette colline meurtrière, les combats se font au corps-à-corps, à la grenade, et sous le feu des obus. Entre l'été et le printemps revenu, il vit le quotidien du fantassin, la boue, le sang, la mort, alors que le commandement croit encore à une guerre courte.
Mon avis : On est d'accord c'est un sacré pavé (il réunit plusieurs livres en un), mais il ne faut pas s'y arrêter, c'est tellement addictif qu'on le lit facilement (j'allais dire d'une traite, mais faut pas exagérer quand même) !
Je ne suis pas particulièrement fan des récits de guerre et pourtant. C'est incroyable ! Grâce à Maurice Genevoix, on vit dans les tranchées. Et on suit ces pauvres malheureux qui devaient avancer coûte que coûte et parfois reculer. Sont consignés dans ces carnets, les avancées, les reculades, les ordres incohérents, les difficultés d'approvisionnement, l'incompréhension, le froid, la faim, et puis, l'Histoire, pas toujours aussi noble que dans les livres scolaires.
Quelle idée merveilleuse d'avoir consigné ainsi toutes ces journées de galères, d'espoirs et de déconvenues.
Surtout ne pas se laisser effrayer par la grosseur du livre, c'est une lecture enrichissante et pleine d'humanité. Je vous la recommande vivement !
À lire avec un bon casse-croûte et un verre de vin rouge en écoutant une marche militaire.
Instagram @la_cath_a_strophes
(Flammarion – 2013)
4e de couverture : 1er août 1914 : la France décrète la mobilisation générale. le 2 août, Genevoix, brillant normalien qui n'a pas 24 ans, rejoint le 106e régiment d'infanterie comme sous-lieutenant.. neuf mois plus tard, il est grièvement blessé et est réformé. Fin de la guerre pour le jeune Genevoix.
Entre ce mois d'août 1914 et les trois balles qui l'atteignent, le 25 avril 1015 dans la Tranchée de Calonne, le jeune homme aura participé à la bataille de la Marne, marché sur Verdun et, surtout, pendant quatre longs mois, défendu les Éparges. Sur cette colline meurtrière, les combats se font au corps-à-corps, à la grenade, et sous le feu des obus. Entre l'été et le printemps revenu, il vit le quotidien du fantassin, la boue, le sang, la mort, alors que le commandement croit encore à une guerre courte.
Mon avis : On est d'accord c'est un sacré pavé (il réunit plusieurs livres en un), mais il ne faut pas s'y arrêter, c'est tellement addictif qu'on le lit facilement (j'allais dire d'une traite, mais faut pas exagérer quand même) !
Je ne suis pas particulièrement fan des récits de guerre et pourtant. C'est incroyable ! Grâce à Maurice Genevoix, on vit dans les tranchées. Et on suit ces pauvres malheureux qui devaient avancer coûte que coûte et parfois reculer. Sont consignés dans ces carnets, les avancées, les reculades, les ordres incohérents, les difficultés d'approvisionnement, l'incompréhension, le froid, la faim, et puis, l'Histoire, pas toujours aussi noble que dans les livres scolaires.
Quelle idée merveilleuse d'avoir consigné ainsi toutes ces journées de galères, d'espoirs et de déconvenues.
Surtout ne pas se laisser effrayer par la grosseur du livre, c'est une lecture enrichissante et pleine d'humanité. Je vous la recommande vivement !
À lire avec un bon casse-croûte et un verre de vin rouge en écoutant une marche militaire.
Instagram @la_cath_a_strophes
critiques presse (1)
Le jeune Maurice, normalien de 24 ans, avait rejoint le 106e régiment d'infanterie le 2 août 1914 comme sous-lieutenant. Il sera grièvement blessé neuf mois plus tard et raconte son quotidien de fantassin à Verdun ou aux Eparges.
Lire la critique sur le site : Culturebox
Citations et extraits (107)
Voir plus
Ajouter une citation
"Alors comme ça, que l' lieutenant m'a dit, voilà qu't'écris chez toi ?
- Mais oui, mon lieutenant, à ma femme.
- T'es marié" qu'i' continue.
"Là-d'sus, vous comprenez, j'rigol. J'lui dis qu'on est seulement ensemble ; mais réguliers ; qu'on a même un gosse...
"Ah ! dit l'lieutenant, t'as un gosse ?
- Oui, mon lieutenant.
- Un garçon, une fille ?
- Une fille.
- Et quel âge qu'elle a, c't'enfant ?
- Deux ans tout juste el quinze de c' mois.
- Et elle est mignonne, hein ?
- Ah ! mon lieutenant !..."
"Quand i' m' dit ça, me v'là parti. Ses yeux, ses ch'veux, ses magnes gentilles, son parler qui commence... Enfin tout, I' m'écoutait sans ouvrir la bouche : i' m' laissait filer, filer, en faisant oui, des fois, avec son menton. Tant qu'à la fin, comme i' s' taisait toujours, j'ai pas pu m'empêcher d'lui dire :
'A quoi qu'vous pensez, mon lieutenant ?
- Mon vieux, qu'i' m'a répondu, pour aimer ta fille, j'suis bien tranquille que t'aimes ta fille... Et tu l'as reconnue, c'te p'tite, depuis 2 ans ?
- Pour parler franchement, mon lieutenant, non.
- Ah ! qu'i' fait ; et qu'Est-ce qui t'en a empêché ?"
"I' m'avait rien r'proché, n'est-ce pas ? Malgré ça, j'étais mal à mon aise. J'aurais bien voulu y expliquer, mais rien n'venait. Comprenez ça ! C'était comme si j'avais senti qu'i' pensait d'avance avec moi : "T'es pourtant un honnête homme ? Tu caches pas des mauvaises pensées ? Alors ?...
"Pourtant, l'idée m'est v'nue qu'l'Etat leur payait la location, pareil que pour les gens mariés. Et ça, je l'ai dit au lieutenant.
"Bon, qu'i' fait ; et si t'es tué ?"
"Ca alors !... Ca m'a foutu un coup. J'en ai resté idiot un moment à répéter : "Si j' suis tué... Si j' suis tué...
- Tu sais pourtant que c' malheur là peut nous arriver à tous, à toi comme à moi, aujourd'hui ou d'main... T'as donc jamais pensé à ça ?"
"Et i' m'a parlé du courage qu'est pas seulement celui du combat ; des lois, qu'étaient comme elles étaient et que j' pouvais pas changer. J'ai p'têt' pas saisi tous ses mots, mais dans l'fond, je l'ai bien compris. Ca fait que quand il est parti, j'étais décidé à écrire.
"Et puis voilà... Y a toutes ces idées qui m'trottaient dans la cervelle, qui s'mélangeaient, l'mariage, la paternité, la pension aux veuves, la mauvaise blessure ; et y toutes ces marmites qui m'empêchaient d'les démêler : Ecoute-nous. Suffirait d'une..." J'ai peiné d'bonne volonté pour arriver à rien du tout. Et c'est cause qu'à présent j'me sens un gros poids sur le cœur... Faudrait qu' j'écrive. Ca me l'ôterait... Et dire que j'peux pas, mon lieutenant ! J'peux pas !... J'peux pas !... J'suis un pauv'e couillon."
Bernardet, les coudes aux genoux, serrant ses tempes de ses deux paumes, secoue la tête avec accablement. Sur son visage noyé d'ombre, je devine deux larmes qui roulent.
"Allons ! Allons !... Veux-tu qu'on essaie, tous les deux ?
- Si j' veux ! Ah ! merci, mon lieutenant !... Mais on n'y voit pus. Attendez, j'ai un bout d' chandelle dans ma poche... Et mon crayon qu' j'ai j'té tout à l'heure ! C'est malin, ça, encore !
- Prends le mien"
Bernardet, ayant allumé la chandelle, l'a fichée entre deux pierres de la voûte, derrière lui. Ainsi, elle éclaire en plein la feuille de papier qu'il appuie sur sa jambe pliée, comme tout à l'heure.
"On y va, mon lieutenant ?
- Oui... Veux-tu me relire ce que tu as écrit ?"
Il lit, d'une voix anônnante, comme en ont les enfants qui récitent une leçon :
"Ma chère Catherine, c'est pour te dire que ça va toujours tant qu'à peu près..."
Et quand il a terminé :
"On va l' refaire, hein ? c' commencement...
- Non mon vieux.
- A cause ?
- A cause qu'il est bien comme il est." (p 367-369)
- Mais oui, mon lieutenant, à ma femme.
- T'es marié" qu'i' continue.
"Là-d'sus, vous comprenez, j'rigol. J'lui dis qu'on est seulement ensemble ; mais réguliers ; qu'on a même un gosse...
"Ah ! dit l'lieutenant, t'as un gosse ?
- Oui, mon lieutenant.
- Un garçon, une fille ?
- Une fille.
- Et quel âge qu'elle a, c't'enfant ?
- Deux ans tout juste el quinze de c' mois.
- Et elle est mignonne, hein ?
- Ah ! mon lieutenant !..."
"Quand i' m' dit ça, me v'là parti. Ses yeux, ses ch'veux, ses magnes gentilles, son parler qui commence... Enfin tout, I' m'écoutait sans ouvrir la bouche : i' m' laissait filer, filer, en faisant oui, des fois, avec son menton. Tant qu'à la fin, comme i' s' taisait toujours, j'ai pas pu m'empêcher d'lui dire :
'A quoi qu'vous pensez, mon lieutenant ?
- Mon vieux, qu'i' m'a répondu, pour aimer ta fille, j'suis bien tranquille que t'aimes ta fille... Et tu l'as reconnue, c'te p'tite, depuis 2 ans ?
- Pour parler franchement, mon lieutenant, non.
- Ah ! qu'i' fait ; et qu'Est-ce qui t'en a empêché ?"
"I' m'avait rien r'proché, n'est-ce pas ? Malgré ça, j'étais mal à mon aise. J'aurais bien voulu y expliquer, mais rien n'venait. Comprenez ça ! C'était comme si j'avais senti qu'i' pensait d'avance avec moi : "T'es pourtant un honnête homme ? Tu caches pas des mauvaises pensées ? Alors ?...
"Pourtant, l'idée m'est v'nue qu'l'Etat leur payait la location, pareil que pour les gens mariés. Et ça, je l'ai dit au lieutenant.
"Bon, qu'i' fait ; et si t'es tué ?"
"Ca alors !... Ca m'a foutu un coup. J'en ai resté idiot un moment à répéter : "Si j' suis tué... Si j' suis tué...
- Tu sais pourtant que c' malheur là peut nous arriver à tous, à toi comme à moi, aujourd'hui ou d'main... T'as donc jamais pensé à ça ?"
"Et i' m'a parlé du courage qu'est pas seulement celui du combat ; des lois, qu'étaient comme elles étaient et que j' pouvais pas changer. J'ai p'têt' pas saisi tous ses mots, mais dans l'fond, je l'ai bien compris. Ca fait que quand il est parti, j'étais décidé à écrire.
"Et puis voilà... Y a toutes ces idées qui m'trottaient dans la cervelle, qui s'mélangeaient, l'mariage, la paternité, la pension aux veuves, la mauvaise blessure ; et y toutes ces marmites qui m'empêchaient d'les démêler : Ecoute-nous. Suffirait d'une..." J'ai peiné d'bonne volonté pour arriver à rien du tout. Et c'est cause qu'à présent j'me sens un gros poids sur le cœur... Faudrait qu' j'écrive. Ca me l'ôterait... Et dire que j'peux pas, mon lieutenant ! J'peux pas !... J'peux pas !... J'suis un pauv'e couillon."
Bernardet, les coudes aux genoux, serrant ses tempes de ses deux paumes, secoue la tête avec accablement. Sur son visage noyé d'ombre, je devine deux larmes qui roulent.
"Allons ! Allons !... Veux-tu qu'on essaie, tous les deux ?
- Si j' veux ! Ah ! merci, mon lieutenant !... Mais on n'y voit pus. Attendez, j'ai un bout d' chandelle dans ma poche... Et mon crayon qu' j'ai j'té tout à l'heure ! C'est malin, ça, encore !
- Prends le mien"
Bernardet, ayant allumé la chandelle, l'a fichée entre deux pierres de la voûte, derrière lui. Ainsi, elle éclaire en plein la feuille de papier qu'il appuie sur sa jambe pliée, comme tout à l'heure.
"On y va, mon lieutenant ?
- Oui... Veux-tu me relire ce que tu as écrit ?"
Il lit, d'une voix anônnante, comme en ont les enfants qui récitent une leçon :
"Ma chère Catherine, c'est pour te dire que ça va toujours tant qu'à peu près..."
Et quand il a terminé :
"On va l' refaire, hein ? c' commencement...
- Non mon vieux.
- A cause ?
- A cause qu'il est bien comme il est." (p 367-369)
Et voici qu'à un tournant, très loin, une troupe d'hommes apparut, s'allongea, ondula à ma rencontre. Son allure était lasse, presque accablée : ce devait être une troupe de vieux territoriaux, une compagnie de travailleurs qui rentraient au cantonnement, une fois achevée la besogne du jour.
J'approchais, étonné de ne pas reconnaître les silhouettes épaisses et frustes, le profil des outils jetés sur les épaules. Les corps de ces hommes m'apparaissaient fluets, à peine virils. Et quand, plus près encore, je pus distinguer les visages je m'aperçus que c'étaient des visages d'enfants, de chairs rondes, mais lasses et meurtries, comme salies d'une excessive fatigue. Un officier marchait à leur tête. Il me reconnut, s'exclama :
"Toi ici !... Tu as déserté, ou quoi ?"
C'était le grand Sève, de la 1re . Arrêté, les bras ouverts, il maintenait le troupeau fourbu dont les rangs refluaient mollement dans le bruit des chaussures traînées. Je lui demandai :
"Classe 14 ?
- Tu vois", me dit-il.
Et plus bas, avec une moue :
"C'est plein de bonne volonté, ça veut bien faire...Mais ça ne tient pas, ça se vanne tout de suite... Trop jeunes ; réellement trop."
Et c'était vrai. Une surprise pénible me tenait au bord de la chaussée, immobile, tandis qu'ils défilaient, derrière Sève. Leurs capotes trop larges glissaient à leurs épaules. Le sac haut monté leur écrasait la nuque : ils tendaient le cou et regardaient la route fixement, les uns pâles et les yeux creux, d'autres trop rouges, et de grosses gouttes de sueur aux tempes malgré le froid
que le soir avivait.
Quelques sous-officiers marchaient au flanc de la colonne. Et de ceux-là je reconnaissais les visages hâlés, les pommettes sèches, d'allure tranquille et longue. Ceux-là se ressemblaient entre eux. Je les avais quitté le matin, j'allais les retrouver tout à l'heure. Depuis des mois, ils étaient les seuls hommes avec qui j'eusse vécu, hommes de toutes classes, de toutes provinces, chacun lui-même parmi les autres, mais tous guerriers sous leurs vieilles défroques aux plaques d'usure identiques, sous le harnais de cuirs ternes, sous la visière avachie des képis - des guerriers fraternels par l'habitude de souffrir et de résister dans leur chair, par quelque chose de courageux et de résigné qui les 'incorporait" mieux encore que la misère de leur uniforme.
Tandis que les autres ! Tous ces jeunes qui passaient, rang par rang, à n'en plus finir ! Calicots, comptables, maraîchers des banlieues, vignerons champenois, ils étaient bruns ou blonds comme on l'étaient naguère, laids quelques uns, d'autres sales, d'autres restés jolis et se souvenant de l'être. Quatre par quatre ils se suivaient, apparus brusquement, disparus. J'aurais voulu tourner la tête, les mêler tous en un regard, les voir soldats comme cela devait être, et secouer ainsi le douloureux malaise qui me tenait cloué sur le bord de cette route, m'obligeait à les voir les uns après les autres, à les compter malgré moi quatre, et puis quatre, et puis quatre... jusqu'à quand ?
Voici qu'ils étaient là, de partout arrachés, mis en tas. On retrouvait sur eux, encore, des lambeaux de ce qu'avait été leur vie. "Mais nous ? me disais-je. Mais nous ?"... Ah ! nous, ce n'était pas la même chose. Le 2 août, le délire énorme, la rafale de folie, tournoyant sur l'Europe entière, les trains hurlants, les mouchoirs frénétiques.... En vérité, ce n'était pas la même chose.
Ceux-ci maintenant, après nous, bientôt comme nous, perdus.... Et c'étaient des nôtres qui étaient allés vers eux, pour les "instruire", pour les mieux prendre...
Je m'étais retourné. Là-bas, en tête de la troupe, la dominant de son longue taille, Sève allait, indifférent, en balançant les épaules. J'avais envie de courir vers lui, de le rappeler : "Reviens avec moi, Sève, rentre avec moi.... Ce n'est pas bien, ce que tu fais là."
Quatre ; et puis quatre.... Ils défilaient toujours. Il devait y en avoir tout un bataillon. Derrière moi, au fond de la forêt, des coups de canon se boursouflaient lourdement : ils les entendaient de la tête aux pieds ; je les entendais à cause d'eux.
C'était loin, encore loin. Mais ne savaient-ils pas qu'ils en étaient à la dernière halte, qu'on ne les lâcheraient plus puisqu'on les avaient pris, qu'il allait falloir avancer vers cela qu'on entendait, achever la dernière étape, être arrivés ?
Et je me demandais avec un affreux serrement de cœur, en regardant cette foule harassée, ces reins ployés, ces fronts inclinés vers la terre, lesquels de ces enfants habillés en soldats portaient déjà ce soir, leur cadavre sur leur dos.
J'approchais, étonné de ne pas reconnaître les silhouettes épaisses et frustes, le profil des outils jetés sur les épaules. Les corps de ces hommes m'apparaissaient fluets, à peine virils. Et quand, plus près encore, je pus distinguer les visages je m'aperçus que c'étaient des visages d'enfants, de chairs rondes, mais lasses et meurtries, comme salies d'une excessive fatigue. Un officier marchait à leur tête. Il me reconnut, s'exclama :
"Toi ici !... Tu as déserté, ou quoi ?"
C'était le grand Sève, de la 1re . Arrêté, les bras ouverts, il maintenait le troupeau fourbu dont les rangs refluaient mollement dans le bruit des chaussures traînées. Je lui demandai :
"Classe 14 ?
- Tu vois", me dit-il.
Et plus bas, avec une moue :
"C'est plein de bonne volonté, ça veut bien faire...Mais ça ne tient pas, ça se vanne tout de suite... Trop jeunes ; réellement trop."
Et c'était vrai. Une surprise pénible me tenait au bord de la chaussée, immobile, tandis qu'ils défilaient, derrière Sève. Leurs capotes trop larges glissaient à leurs épaules. Le sac haut monté leur écrasait la nuque : ils tendaient le cou et regardaient la route fixement, les uns pâles et les yeux creux, d'autres trop rouges, et de grosses gouttes de sueur aux tempes malgré le froid
que le soir avivait.
Quelques sous-officiers marchaient au flanc de la colonne. Et de ceux-là je reconnaissais les visages hâlés, les pommettes sèches, d'allure tranquille et longue. Ceux-là se ressemblaient entre eux. Je les avais quitté le matin, j'allais les retrouver tout à l'heure. Depuis des mois, ils étaient les seuls hommes avec qui j'eusse vécu, hommes de toutes classes, de toutes provinces, chacun lui-même parmi les autres, mais tous guerriers sous leurs vieilles défroques aux plaques d'usure identiques, sous le harnais de cuirs ternes, sous la visière avachie des képis - des guerriers fraternels par l'habitude de souffrir et de résister dans leur chair, par quelque chose de courageux et de résigné qui les 'incorporait" mieux encore que la misère de leur uniforme.
Tandis que les autres ! Tous ces jeunes qui passaient, rang par rang, à n'en plus finir ! Calicots, comptables, maraîchers des banlieues, vignerons champenois, ils étaient bruns ou blonds comme on l'étaient naguère, laids quelques uns, d'autres sales, d'autres restés jolis et se souvenant de l'être. Quatre par quatre ils se suivaient, apparus brusquement, disparus. J'aurais voulu tourner la tête, les mêler tous en un regard, les voir soldats comme cela devait être, et secouer ainsi le douloureux malaise qui me tenait cloué sur le bord de cette route, m'obligeait à les voir les uns après les autres, à les compter malgré moi quatre, et puis quatre, et puis quatre... jusqu'à quand ?
Voici qu'ils étaient là, de partout arrachés, mis en tas. On retrouvait sur eux, encore, des lambeaux de ce qu'avait été leur vie. "Mais nous ? me disais-je. Mais nous ?"... Ah ! nous, ce n'était pas la même chose. Le 2 août, le délire énorme, la rafale de folie, tournoyant sur l'Europe entière, les trains hurlants, les mouchoirs frénétiques.... En vérité, ce n'était pas la même chose.
Ceux-ci maintenant, après nous, bientôt comme nous, perdus.... Et c'étaient des nôtres qui étaient allés vers eux, pour les "instruire", pour les mieux prendre...
Je m'étais retourné. Là-bas, en tête de la troupe, la dominant de son longue taille, Sève allait, indifférent, en balançant les épaules. J'avais envie de courir vers lui, de le rappeler : "Reviens avec moi, Sève, rentre avec moi.... Ce n'est pas bien, ce que tu fais là."
Quatre ; et puis quatre.... Ils défilaient toujours. Il devait y en avoir tout un bataillon. Derrière moi, au fond de la forêt, des coups de canon se boursouflaient lourdement : ils les entendaient de la tête aux pieds ; je les entendais à cause d'eux.
C'était loin, encore loin. Mais ne savaient-ils pas qu'ils en étaient à la dernière halte, qu'on ne les lâcheraient plus puisqu'on les avaient pris, qu'il allait falloir avancer vers cela qu'on entendait, achever la dernière étape, être arrivés ?
Et je me demandais avec un affreux serrement de cœur, en regardant cette foule harassée, ces reins ployés, ces fronts inclinés vers la terre, lesquels de ces enfants habillés en soldats portaient déjà ce soir, leur cadavre sur leur dos.
Quarante heures que nous sommes dans un fossé plein d'eau. Le toit de branches, tressé en hâte sur nos têtes et calfeutré de quelques brins de paille, a été transpercé en un instant par l'ondée furieuse. Depuis, c'est un ruissellement continu autour de nous et sur nous (...) A présent, il fait jour. Nous venons de manger des morceaux de viande froide, mouillée, affadie, aussi quelques pommes de terre vertes trouvées dans un champ et qui ont cuit un peu sous les cendres. On nous a annoncé la relève pour ce soir. Moi je ne l'espère plus. Je ne sais plus. Nous sommes là depuis un très long, très long temps. On nous a mis là ; on nous y a oubliés. Personne ne viendra. Personne ne pourra nous remplacer à la lisière de ce bois, dans ce fossé, sous cette pluie. Nous ne verrons plus de maisons avec les claires flambées dans l'âtre, plus de granges bien closes où le foin s'entasse et ne mouille jamais. Nous ne nous déshabilleront plus pour délasser nos corps et les délivrer de cette étreinte glacée. Et d'ailleurs, à quoi bon ? Mes vêtements englués de boue, mes bandes molletières qui broient mes jambes, mes chaussures brûlées et raides, les courroies de mon équipement, est-ce que tout cela maintenant ne fait pas partie de ma souffrance ? Cela colle à moi. L'eau, qui a pénétré jusqu'à ma peau d'abord, coule maintenant dans mes veines. Maintenant je suis une masse boueuse, et prise par l'eau, et qui a froid jusqu'au plus profond d'elle, froid comme la paille qui nous abritait et dont les brins s'agglutinent et pourrissent, froid comme les bois dont chaque feuille ruisselle et tremble, froid comme la terre des champs qui peu à peu se délaye et fond.
Maurice Genevoix, Ceux de 14, sous Verdun, ch. V
Maurice Genevoix, Ceux de 14, sous Verdun, ch. V
C'est alors que ce 210 est tombé. Je l' ai senti à la fois sur ma nuque, assené en massue formidable, et devant moi, fournaise rouge et grondante. Voilà comment un obus vous tue. Je ne bougerai pas mes mains pour les fourrer dans ma poitrine ouverte; si je pouvais les ramener vers moi, j'enfoncerais mes deux mains dans la tiédeur de mes viscères à nu ; si j'étais debout devant moi, je verrais ma trachée pâle, mes poumons et mon coeur à travers mes côtes défoncées. Pas un geste, par pitié pour moi ! Les yeux fermés, comme Laviolette, et mourir seul.
Je vis, absurdement. Cela ne m'étonne plus: tout est absurde. A travers le drap rêche de ma capote bien close, je sens battre mon coeur au fond de ma poitrine. Et je me rappelle tout: ce flot flambant et rouge qui s'est rué loin en moi, me brûlant les entrailles d'un attouchement si net que j'ai cru mon corps éventré large, comme celui d'un bétail à l'éventaire d'un boucher; cette forme sombre qui a plané devant mes yeux, horizontale et déployée, me cachant tout le ciel de sa vaste envergure... Elle est retombée là, sur le parados, bras repliés, cassés, jambes groupées sous le corps, et tremblante toujours, jusqu'à ce que Bouaré soit mort. Ils courent, derrière Richomme qui hurle, un à un sautent pardessus moi: Gaubert, Vidal, Dorizon... ah! je les reconnais tous! Attendez-moi... Je ne peux pas les suivre... Qu'est-ce qui appuie sur moi, si lourd, et m'empêche de me lever ? Mon front saigne: ce n'est rien, mes deux mains sont criblées de grains sombres, de minuscules brûlures rapprochées; et sur cette main-ci, la mienne, plaquée chaude et gluante une langue colle, qu'il me faut secouer sur la boue.
Je suis libre depuis ce geste; et je puis me lever, maintenant que le corps de Lardin vient de basculer doucement. Il mangeait, un quignon de pain aux doigts; il n'a pas changé de visage, les yeux ouverts encore derrière les verres de ses binocles; il saigne un peu par chaque narine, deux minces filets foncés qui vont se perdre sous sa moustache. Petitbru passe, à quatre pattes, poussant une longue plainte béante ; Biloray passe, debout, à pas menus et la tête sur l'épaule ; le sang goutte au bout de son nez; il va, les bras pendant le long du corps, attentif et silencieux, comme s'il avait peur de renverser sa vie en route...
Je vis, absurdement. Cela ne m'étonne plus: tout est absurde. A travers le drap rêche de ma capote bien close, je sens battre mon coeur au fond de ma poitrine. Et je me rappelle tout: ce flot flambant et rouge qui s'est rué loin en moi, me brûlant les entrailles d'un attouchement si net que j'ai cru mon corps éventré large, comme celui d'un bétail à l'éventaire d'un boucher; cette forme sombre qui a plané devant mes yeux, horizontale et déployée, me cachant tout le ciel de sa vaste envergure... Elle est retombée là, sur le parados, bras repliés, cassés, jambes groupées sous le corps, et tremblante toujours, jusqu'à ce que Bouaré soit mort. Ils courent, derrière Richomme qui hurle, un à un sautent pardessus moi: Gaubert, Vidal, Dorizon... ah! je les reconnais tous! Attendez-moi... Je ne peux pas les suivre... Qu'est-ce qui appuie sur moi, si lourd, et m'empêche de me lever ? Mon front saigne: ce n'est rien, mes deux mains sont criblées de grains sombres, de minuscules brûlures rapprochées; et sur cette main-ci, la mienne, plaquée chaude et gluante une langue colle, qu'il me faut secouer sur la boue.
Je suis libre depuis ce geste; et je puis me lever, maintenant que le corps de Lardin vient de basculer doucement. Il mangeait, un quignon de pain aux doigts; il n'a pas changé de visage, les yeux ouverts encore derrière les verres de ses binocles; il saigne un peu par chaque narine, deux minces filets foncés qui vont se perdre sous sa moustache. Petitbru passe, à quatre pattes, poussant une longue plainte béante ; Biloray passe, debout, à pas menus et la tête sur l'épaule ; le sang goutte au bout de son nez; il va, les bras pendant le long du corps, attentif et silencieux, comme s'il avait peur de renverser sa vie en route...
Aucun d'eux n'osera plus parler : on a touché au plus profond, au plus secret d'eux-mêmes. Cela palpite en chacun d'eux. Et chacun, même ce soir, huit jours avant l'assaut qui menace, est le maître ombrageux de son cœur.
Leurs pensées... Qui se vantera de jamais les connaître ? Je sais que nous nous ressemblons tous. Je sais aussi que j'ai voulu être près d'eux, et qu'ils me sentissent près d'eux : à cause de cela, parfois, j'ai cru que leurs yeux se livraient. Leurs pensées... Est-ce que je sais ? Ce qui m'a ému dans leurs yeux, n'était-ce pas un reflet de moi-même ? ... Eux et moi, chacun de nous et tous les autres. Et pour moi seul, ce monde caché de souvenirs et d'espoirs, ce monde prodigieux qui mourra si je meurs. Et pour chacun d'eux tous, un autre monde, que je ne connaîtrai jamais. Visage des souvenirs, murmures des voix qu'on est seul à entendre, tiédeur des rêves, formes légères d'espoirs glissant parmi les souvenirs... Ils me ressemblent, leurs yeux me l'ont dit quelquefois : mais rien de plus, dans l'échange furtif d'un regard ; rien qu'une lueur émouvante, entre deux infinis de silence et de nuit.
Les Eparges, Février 1915.
Leurs pensées... Qui se vantera de jamais les connaître ? Je sais que nous nous ressemblons tous. Je sais aussi que j'ai voulu être près d'eux, et qu'ils me sentissent près d'eux : à cause de cela, parfois, j'ai cru que leurs yeux se livraient. Leurs pensées... Est-ce que je sais ? Ce qui m'a ému dans leurs yeux, n'était-ce pas un reflet de moi-même ? ... Eux et moi, chacun de nous et tous les autres. Et pour moi seul, ce monde caché de souvenirs et d'espoirs, ce monde prodigieux qui mourra si je meurs. Et pour chacun d'eux tous, un autre monde, que je ne connaîtrai jamais. Visage des souvenirs, murmures des voix qu'on est seul à entendre, tiédeur des rêves, formes légères d'espoirs glissant parmi les souvenirs... Ils me ressemblent, leurs yeux me l'ont dit quelquefois : mais rien de plus, dans l'échange furtif d'un regard ; rien qu'une lueur émouvante, entre deux infinis de silence et de nuit.
Les Eparges, Février 1915.
Videos de Maurice Genevoix (28)
Voir plusAjouter une vidéo
https://www.laprocure.com/product/1049468/genevoix-maurice-rrou
Maurice Genevoix, illustrations Gérard Dubois rroû Éditions La Table ronde
« On craque pour ce livre illustré de rroû de Maurice Genevoix aux éditions La Table ronde. Une petite merveille illustrée par Gérard Dubois qui est multi-primé en tant que dessinateur pour le Newyorker et le New York Times entre autres. Évidemment, Maurice Genevoix, c'est celui qui a été connu et reconnu pour Ceux de quatorze où il décrivait ses blessures de guerre et la guerre en elle-même, qui est un texte majeur en littérature française, puis qui avait eu le prix Goncourt pour Raboliot. Et ce texte-là, magnifique, n'est pas seulement l'histoire d'un chat, c'est bien plus que ça... » Marie-Joseph, libraire à La Procure de Paris
Maurice Genevoix, illustrations Gérard Dubois rroû Éditions La Table ronde
« On craque pour ce livre illustré de rroû de Maurice Genevoix aux éditions La Table ronde. Une petite merveille illustrée par Gérard Dubois qui est multi-primé en tant que dessinateur pour le Newyorker et le New York Times entre autres. Évidemment, Maurice Genevoix, c'est celui qui a été connu et reconnu pour Ceux de quatorze où il décrivait ses blessures de guerre et la guerre en elle-même, qui est un texte majeur en littérature française, puis qui avait eu le prix Goncourt pour Raboliot. Et ce texte-là, magnifique, n'est pas seulement l'histoire d'un chat, c'est bien plus que ça... » Marie-Joseph, libraire à La Procure de Paris
+ Lire la suite
autres livres classés : première guerre mondialeVoir plus
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus

Les romans les mieux notés
heros_pitch
195 livres

Grande Guerre 14-18
Rik13
55 livres

Les romans historiques
GabySensei
166 livres
Autres livres de Maurice Genevoix (76)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3179 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3179 lecteurs ont répondu