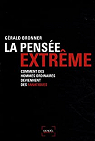Gérald Bronner/5
106 notes
Résumé :
"Longtemps, je n'ai pas su de quel milieu je venais. Pendant ma prime enfance, même, j'ai pensé que je venais d'un milieu social aisé. À un moment, j'ai compris : ma famille et moi, nous étions pauvres."
Les origines : voilà un "grand mot" pour répondre à la question de nos identités et de nos devenirs. Sommes-nous la somme des déterminations biologiques et sociales dont nous avons hérité ? Si, en revanche, l'identité se construit au fil de la vie, q... >Voir plus
Les origines : voilà un "grand mot" pour répondre à la question de nos identités et de nos devenirs. Sommes-nous la somme des déterminations biologiques et sociales dont nous avons hérité ? Si, en revanche, l'identité se construit au fil de la vie, q... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Les originesVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (17)
Voir plus
Ajouter une critique
La question que pose Gérald Bronner, dans son livre Les Origines, me paraît à la fois captivante, réductrice et mal posée. En effet, le sous-titre indique : « Pourquoi devient-on qui l'on est ? »
Captivante, indubitablement, elle l'est, car, chaque fois que l'on se prend à renrouler la destinée de tel(le) ou tel(le), parmi les personnages célèbres, on s'aperçoit qu'un nombre étonnant d'entre eux sont « déviants » par rapport à ce que la logique eût pu leur prédire.
Réductrice, elle l'est également, car, si l'on se borne aux personnes célèbres et/ou à celles qui ont « réussi » à déjouer les attentes normales du destin, on oublie nécessairement dans l'échantillonnage tous ceux qui ne dévient pas de la trajectoire « attendue » et qui sont très nombreux.
Mal posée, car si je dis « pourquoi », cela sous-entend qu'il y a une causalité, un faisceau d'événements conduisant logiquement d'un point A à un point B, une sorte de chemin balisé : si j'ai tel et tel et tel ingrédients dans ma compote, j'obtiendrais tel et tel et tel résultats.
Même dans l'expression plus que courante et fourre-tout « chercher le pourquoi du comment », la question du « Pourquoi ? » n'est jamais dissociée de celle du « Comment ? » : prenons un exemple. Si je pose la question : Pourquoi des émigrants cherchent-ils à rejoindre le Royaume-Uni ?, j'obtiendrais certes des réponses multiples mais toutes relativement convergentes. J'ai bien mon point A et mon point B, je suis contente.
Cependant, si par malheur j'essaie de compléter ma question avec un : « Comment rejoignent-ils le Royaume-Uni ? », là je risque fort d'être confrontée à une multiplicité de cas difficilement réductibles. Un continuum immense va se dessiner entre ceux qui auraient voulu et qui ont renoncé dès leur position de départ, ceux qui ont entamé le processus mais se sont fait arrêter d'une façon ou d'une autre (la mort pouvant être une de ces façons), ceux qui ont réussi à émigrer, mais sans pour autant atteindre le Royaume-Uni, et enfin, ceux, qui, après maintes et maintes péripéties, ont finalement bouclé la boucle.
Eh bien, c'est un peu ça que j'ai ressenti à la lecture du livre de Gérald Bronner. Cette volonté de synthèse me semble mal appropriée à la question même. Relevant moi-même du sous-groupe des transclasses auquel l'auteur s'intéresse, je ne me suis pas toujours, voire pas souvent, reconnue dans son analyse. C'est un exercice difficile, j'en conviens, que de vouloir embrasser cette question, et l'ouvrage est loin d'être inintéressant selon moi, d'où mon appréciation globalement positive.
Dans son prologue, tout d'abord, l'auteur examine, en général, la question des origines, et notamment au travers des mythes fondateurs de telle ou telle population humaine, actuels ou passés. Ensuite, Gérald Bronner commence par envisager la question du « dolorisme », c'est-à-dire, le fait que l'expérience de changer de classe sociale puisse être vécu comme une forme de douleur, de déchirure. Il se positionne là-dessus. Selon lui, il y aurait comme une espèce de tendance, voire de mauvaise foi du transclasse et une volonté d'accentuer le caractère éprouvant de cette migration, justement pour se mieux faire accepter ou reconnaître dans sa classe de destination. (Je simplifie à gros traits, bien entendu.)
Puis il souligne, dans la partie suivante, l'importance du regard et des attentes qui ont été portés sur l'enfant ou l'adolescent, transclasse en devenir, sur les quelques moments ou remarques clés qui l'ont infléchi, au moins dans sa propre tête, selon que l'on a cru ou non en lui, selon qu'on l'a encouragé ou dissuadé.
Après vient un chapitre où l'auteur argumente le fait qu'on se ment tous, volontairement ou involontairement, on se raconte, bref, que notre perception est tout sauf objectivité, qu'elle n'est autre que fiction. On surinterprète, on surestime l'importance de telle ou telle chose, on est bienveillant avec soi-même (si je réussis, c'est dû à mon talent, si j'échoue, c'est la faute à pas de chance), etc.
Dans la section suivante, l'auteur s'en prend un peu (gentiment) à Pierre Bourdieu — un analyste de la reproduction sociale, de la lutte des classes, d'un système qui engendre de l'inertie sociale — pour montrer qu'il n'y a pas, selon lui, de complot généralisé fomenté par les puissants pour empêcher les représentants des classes populaires de s'élever, que s'il subsiste des inégalités sur la ligne de départ — ce qu'il reconnaît volontiers —, la méritocratie reste tout de même un système opérant pour atteindre une classe sociale supérieure à celle de ses parents.
Les deux dernières parties traitent, pour l'une, du rôle respectif de l'inné et de l'acquis dans la réalisation de la personne, pour l'autre du rôle des pairs, c'est-à-dire des personnes rencontrées pendant le parcours, dans l'édification de soi-même. Enfin, l'épilogue nous laisse un peu sur notre faim en concluant que, vu la multitude des influences qui concourent à faire ce que l'on est, il est difficile de privilégier plus les unes que les autres.
Bon, bon, bon… Après avoir remercié vivement l'éditeur Autrement et Babelio pour l'envoi de ce livre dans le cadre de Masse Critique, il me faut peut-être tout de même m'interroger un brin sur ce que dit l'auteur.
Si je comprends bien, ne remettons pas en cause un système qui, s'il est imparfait, permet tout de même à un pourcentage substantiel de personnes d'accéder à ce qu'elles désirent… Mmouais… Pas convaincue, et d'autant moins aujourd'hui qu'à l'époque où l'auteur s'est élevé socialement via l'école (il est né en 1969). le sociologue nous livre sa propre expérience de transclasse, à savoir, celle d'être né dans une famille pauvre et d'avoir grandi parmi des personnes, elles aussi, situées plutôt au bas qu'au haut de l'échelle sociale.
Pas de problème de couleur ou de sexe, pas de problème d'acclimatation à la ville, pas même au plus bas rang parmi l'environnement humain dans lequel il a grandi. Je précise, car ceci peut aussi expliquer cela du relatif « confort » dans lequel il a dû batailler. Il ne cesse de nous dire qu'il se sentait « différent », mais je pointe le fait qu'il n'était pas « étrange » ni « étranger ».
L'auteur prétend qu'il a réalisé assez tard qu'il était pauvre. Personnellement, ce n'est pas mon cas : j'ai grandi dans un trou paumé à la campagne, et même dans mon trou paumé, parmi des gamins qui n'étaient pas beaucoup plus que des culs-terreux, on a pourtant vite fait de me faire comprendre que je n'étais pas riche. Ce fut fortement renforcé au collège, lequel collège n'était pourtant, lui aussi, qu'un collège de culs-terreux. Idem lorsque j'ai migré à la sous-préfecture pour le lycée ou à la préfecture pour la fac, car, j'étais toujours dans ce qui se faisait de plus bas dans la catégorie. de même, lorsque j'ai changé de fac, j'étais issue de ce qui se faisait de moins prestigieux à chaque fois.
Je me souviens, au lycée, dans notre livre de biologie, sur le chapitre dédié à la génétique, il y avait la photo d'un jeune Africain albinos entouré de ses camarades « normaux ». Il n'avait pas l'air franchement heureux d'être si « étrange »…
J'ai souvent pensé depuis à la chanson des Doors : « People are strange, When you ‘re a stranger, Faces look ugly, When you ‘re alone, Women seem wicked, When you ‘re unwanted, Streets are uneven, When you ‘re down, etc., etc… »
Eh bien, au risque de contredire Gérald Bronner, pour ma part, je me suis souvent sentie comme cet enfant d'Afrique, étrange parmi les miens, étrange parmi les autres, jamais à ma place, jamais en paix ni au repos, justement du fait de cette étrangeté.
Je me souviens encore, pendant mes études d'éthologie, je ne sais plus exactement qui, peut-être Konrad Lorenz — je n'affirmerais pas, je ne me souviens plus exactement —, avait une formule de ce type : dans la réalisation d'un être humain, l'inné compte à 100 % et l'acquis compte à 100 %. C'est exactement ce que je pense aussi.
Plus exactement, notre destinée est une suite ininterrompue de hasards et de nécessités, comme l'aurait formulé Jacques Monod. D'après moi, le premier des hasards est justement la génétique : parmi la foule de gènes que possèdent nos parents, l'échantillonnage qui nous échoit fait de nous quelqu'un de tout à fait conforme, globalement conforme, moyennement conforme, faiblement conforme ou pas du tout conforme aux personnes du milieu duquel on vient, à commencer par nos parents (et à supposer qu'ils soient conformes l'un à l'autre, ce qui est loin d'être certain). Et ça, l'on n'y peut absolument rien.
Le deuxième hasard concerne la nature de la non-conformité en question, si non-conformité il y a. En ce qui me concerne, je crois que le hasard m'a pourvue d'un phénoménal appétit de compréhension : dès l'enfance, j'adorais comprendre. Je me rends compte que plein de gens — voire la majorité —, se fichent éperdument de comprendre telle ou telle chose, tel ou tel lien entre des choses apparemment disjointes. Moi, pas, c'est même carrément une passion. Je dirais même plus, cette passion est presque pathologique, de l'ordre du TOC : je ne dors pas si je n'ai pas compris le phénomène, ou la portion de phénomène, sur lequel je me questionne.
On devine aisément que cette passion — que je n'ai pas choisie, qui ressort donc du pur hasard, d'une pure potentialité génétique — a, en retour, des conséquences, qui elles ressortent de la nécessité, sachant que la passion de comprendre est donnée. Mais qu'en aurait-il été si ma « non-conformité » par rapport à mon milieu d'origine avait été d'une nature toute différente ? Par exemple, si j'avais adoré les cactus à la folie ou élever des serpents ou collectionner les jupes ?
Ensuite, dire que le rôle des parents — qui relève de la nécessité — est fondateur est une lapalissade : Mozart aurait-il été Mozart si son père n'avait pas été musicien auprès des Grands d'Autriche ? Julie Depardieu ferait-elle du cinéma si elle ne s'appelait pas Depardieu ? Joakim Noah aurait-il été sportif de haut niveau si… enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire.
Ceci dit, nul ne peut dire DANS QUEL SENS ni EN PARTANT D'OÙ il est fondateur. On a tendance à remarquer ce rôle fondateur lorsque le trait principal du parent se retrouve chez son descendant. Mais si je vous disais que mon penchant pour la lecture me provient de mon père, qui est sûrement parmi les moins lecteurs qu'on puisse imaginer, qu'en penseriez-vous ?
Il y a une phase sensible de l'enfance — autour de 7 ans — pendant laquelle plein de choses s'impriment, sans qu'on en ait nécessairement conscience quand on est parent. Quand j'avais autour de 7 ans, donc, mon père, très temporairement et très brièvement, s'est abonné à une revue de sport automobile, dont le titre avait le mérite d'être explicite : Sport auto. (J'ai déjà abordé ce puissant héritage paternel dans mon commentaire d'un livre de Vic Elford, La Victoire ou rien.) Eh bien, d'avoir vu mon père lire cette revue durant cette courte période, alors que j'avais l'âge sensible — c'était un hasard —, a imprimé durablement le goût de lire en moi. Ce fut donc un minuscule bout de la lorgnette, quelque chose qui n'est pas du tout caractéristique ni représentatif de mon père, qu'il m'a légué inconsciemment et dont l'objet ne s'est jamais dirigé depuis lors vers le sport automobile, d'où la difficulté (voire la quasi-impossibilité) à le déceler pour quelqu'un d'extérieur.
Je me suis souvent demandée ce que j'avais de commun avec ma mère (j'ai déjà évoqué mes relations avec ma mère dans ma critique du Coran) ou avec mon père. Pourtant, à fin et à force de chercher à comprendre, j'ai fini par repérer des minuscules morceaux de ceci et de cela, qui ne les caractérisent ni l'un ni l'autre, qui ne sont, pour eux, que des épiphénomènes, et qui pourtant, chez moi, sont constitutifs, voire essentiels. Tout vient d'eux, mais un peu comme on ne reconnaît pas dans ma peau ou dans mes os les carottes et les petits pois dont ils proviennent, on ne reconnaît pas en moi le comportement ou les centres d'intérêts de mes parents.
Je voudrais encore me démarquer de Gérald Bronner sur la question du dolorisme. Pour lui, de ce que j'en comprends, c'est presque une posture, un « chiquet », quelque chose de surfait. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui sur ce point. L'idée même de « lutte des classes » suppose que les différentes classes sociales luttent les unes contre les autres. Et donc, par conséquent, le fait de changer de classe équivaut à changer de camp dans cette lutte qui se poursuit. de là à la traitrise, du moins à l'accusation de traitrise, il n'y a jamais loin. Allez donc demander aux Malgré-Nous alsaciens si ce n'est pas douloureux de changer de camp « par la force des choses ». La réussite scolaire et plus tard professionnelle induit nécessairement de changer de camp, d'où les fréquentes charges qu'ont à subir les « bons à l'école » de la part de ceux qui ne le sont pas. Peu ou prou, tous savent que, plus tard, ils ne combattront pas du même côté de la ligne de partage des eaux.
J'ai assez puissamment exprimé mon désaccord avec Annie Ernaux dans ma critique de la Place, car, d'après mon vécu, j'ai ressenti exactement le contraire de ce qu'elle prétend vouloir exprimer à qui veut l'entendre. Selon elle, son écriture « vengerait » sa « race », là, où moi qui viens du même milieu qu'elle je ne perçois que mépris pour ce milieu dans son récit. Donc, entre Annie Ernaux, qui a clairement trahi son milieu d'origine, qui fait semblant d'en être encore tout en décrivant la douleur de se sentir traitre, et Gérald Bronner, qui éprouve une fierté tant de son milieu d'origine que d'avoir réussi à s'en extraire, mon coeur balance, car il demeure une autre catégorie à laquelle, je pense, j'appartiens : celle des personnes dont les centres d'intérêts les éloignent de leur milieu d'origine mais vis-à-vis de qui les lumières de la ville et la vie bourgeoise font office de repoussoir, une sorte de NI, NI pas très confortable.
Je me sens très prolo, socialement parlant, et très bobo quant à mes centres d'intérêt. Exactement comme le pauvre enfant africain de mon livre de bio, qui avait le malheur d'avoir une peau trop blanche parmi les populations noires, et des traits trop négroïdes pour nourrir beaucoup d'espoir parmi des populations blanches. Bien sûr, on me rétorquera que ça n'a pas empêché Salif Keïta de devenir qui il est devenu, mais j'ai peine à croire que le concernant, s'il avait eu le choix, au départ, il n'aurait pas opté pour avoir la même pigmentation que ses pairs. J'ai peine à croire qu'il n'a jamais été perçu comme un traitre par les uns ou les autres, et qu'il ne s'est jamais senti comme un apatride, à un moment ou à un autre, et que ça n'ait jamais suscité de douleurs en lui.
Oui, être hors cases, ça peut être douloureux, ça peut être une cicatrice à vie, ça peut être difficile à vivre au quotidien, et je ne me suis attardée que sur ce malheureux exemple, mais j'aurais pu en développer à l'envi et de tout autre type. Ça n'est rien d'autre, finalement, que ce qu'exprime le conte d'Andersen, le vilain petit Canard. N'être pas à sa place, être toujours différent ou dans l'ultra-minorité, ce n'est pas forcément une sinécure. Ne vous déplaise, cher Gérald Bronner, mais ce n'est que mon avis de transclasse, à peine transclasse d'ailleurs ou transclasse à grand peine, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Captivante, indubitablement, elle l'est, car, chaque fois que l'on se prend à renrouler la destinée de tel(le) ou tel(le), parmi les personnages célèbres, on s'aperçoit qu'un nombre étonnant d'entre eux sont « déviants » par rapport à ce que la logique eût pu leur prédire.
Réductrice, elle l'est également, car, si l'on se borne aux personnes célèbres et/ou à celles qui ont « réussi » à déjouer les attentes normales du destin, on oublie nécessairement dans l'échantillonnage tous ceux qui ne dévient pas de la trajectoire « attendue » et qui sont très nombreux.
Mal posée, car si je dis « pourquoi », cela sous-entend qu'il y a une causalité, un faisceau d'événements conduisant logiquement d'un point A à un point B, une sorte de chemin balisé : si j'ai tel et tel et tel ingrédients dans ma compote, j'obtiendrais tel et tel et tel résultats.
Même dans l'expression plus que courante et fourre-tout « chercher le pourquoi du comment », la question du « Pourquoi ? » n'est jamais dissociée de celle du « Comment ? » : prenons un exemple. Si je pose la question : Pourquoi des émigrants cherchent-ils à rejoindre le Royaume-Uni ?, j'obtiendrais certes des réponses multiples mais toutes relativement convergentes. J'ai bien mon point A et mon point B, je suis contente.
Cependant, si par malheur j'essaie de compléter ma question avec un : « Comment rejoignent-ils le Royaume-Uni ? », là je risque fort d'être confrontée à une multiplicité de cas difficilement réductibles. Un continuum immense va se dessiner entre ceux qui auraient voulu et qui ont renoncé dès leur position de départ, ceux qui ont entamé le processus mais se sont fait arrêter d'une façon ou d'une autre (la mort pouvant être une de ces façons), ceux qui ont réussi à émigrer, mais sans pour autant atteindre le Royaume-Uni, et enfin, ceux, qui, après maintes et maintes péripéties, ont finalement bouclé la boucle.
Eh bien, c'est un peu ça que j'ai ressenti à la lecture du livre de Gérald Bronner. Cette volonté de synthèse me semble mal appropriée à la question même. Relevant moi-même du sous-groupe des transclasses auquel l'auteur s'intéresse, je ne me suis pas toujours, voire pas souvent, reconnue dans son analyse. C'est un exercice difficile, j'en conviens, que de vouloir embrasser cette question, et l'ouvrage est loin d'être inintéressant selon moi, d'où mon appréciation globalement positive.
Dans son prologue, tout d'abord, l'auteur examine, en général, la question des origines, et notamment au travers des mythes fondateurs de telle ou telle population humaine, actuels ou passés. Ensuite, Gérald Bronner commence par envisager la question du « dolorisme », c'est-à-dire, le fait que l'expérience de changer de classe sociale puisse être vécu comme une forme de douleur, de déchirure. Il se positionne là-dessus. Selon lui, il y aurait comme une espèce de tendance, voire de mauvaise foi du transclasse et une volonté d'accentuer le caractère éprouvant de cette migration, justement pour se mieux faire accepter ou reconnaître dans sa classe de destination. (Je simplifie à gros traits, bien entendu.)
Puis il souligne, dans la partie suivante, l'importance du regard et des attentes qui ont été portés sur l'enfant ou l'adolescent, transclasse en devenir, sur les quelques moments ou remarques clés qui l'ont infléchi, au moins dans sa propre tête, selon que l'on a cru ou non en lui, selon qu'on l'a encouragé ou dissuadé.
Après vient un chapitre où l'auteur argumente le fait qu'on se ment tous, volontairement ou involontairement, on se raconte, bref, que notre perception est tout sauf objectivité, qu'elle n'est autre que fiction. On surinterprète, on surestime l'importance de telle ou telle chose, on est bienveillant avec soi-même (si je réussis, c'est dû à mon talent, si j'échoue, c'est la faute à pas de chance), etc.
Dans la section suivante, l'auteur s'en prend un peu (gentiment) à Pierre Bourdieu — un analyste de la reproduction sociale, de la lutte des classes, d'un système qui engendre de l'inertie sociale — pour montrer qu'il n'y a pas, selon lui, de complot généralisé fomenté par les puissants pour empêcher les représentants des classes populaires de s'élever, que s'il subsiste des inégalités sur la ligne de départ — ce qu'il reconnaît volontiers —, la méritocratie reste tout de même un système opérant pour atteindre une classe sociale supérieure à celle de ses parents.
Les deux dernières parties traitent, pour l'une, du rôle respectif de l'inné et de l'acquis dans la réalisation de la personne, pour l'autre du rôle des pairs, c'est-à-dire des personnes rencontrées pendant le parcours, dans l'édification de soi-même. Enfin, l'épilogue nous laisse un peu sur notre faim en concluant que, vu la multitude des influences qui concourent à faire ce que l'on est, il est difficile de privilégier plus les unes que les autres.
Bon, bon, bon… Après avoir remercié vivement l'éditeur Autrement et Babelio pour l'envoi de ce livre dans le cadre de Masse Critique, il me faut peut-être tout de même m'interroger un brin sur ce que dit l'auteur.
Si je comprends bien, ne remettons pas en cause un système qui, s'il est imparfait, permet tout de même à un pourcentage substantiel de personnes d'accéder à ce qu'elles désirent… Mmouais… Pas convaincue, et d'autant moins aujourd'hui qu'à l'époque où l'auteur s'est élevé socialement via l'école (il est né en 1969). le sociologue nous livre sa propre expérience de transclasse, à savoir, celle d'être né dans une famille pauvre et d'avoir grandi parmi des personnes, elles aussi, situées plutôt au bas qu'au haut de l'échelle sociale.
Pas de problème de couleur ou de sexe, pas de problème d'acclimatation à la ville, pas même au plus bas rang parmi l'environnement humain dans lequel il a grandi. Je précise, car ceci peut aussi expliquer cela du relatif « confort » dans lequel il a dû batailler. Il ne cesse de nous dire qu'il se sentait « différent », mais je pointe le fait qu'il n'était pas « étrange » ni « étranger ».
L'auteur prétend qu'il a réalisé assez tard qu'il était pauvre. Personnellement, ce n'est pas mon cas : j'ai grandi dans un trou paumé à la campagne, et même dans mon trou paumé, parmi des gamins qui n'étaient pas beaucoup plus que des culs-terreux, on a pourtant vite fait de me faire comprendre que je n'étais pas riche. Ce fut fortement renforcé au collège, lequel collège n'était pourtant, lui aussi, qu'un collège de culs-terreux. Idem lorsque j'ai migré à la sous-préfecture pour le lycée ou à la préfecture pour la fac, car, j'étais toujours dans ce qui se faisait de plus bas dans la catégorie. de même, lorsque j'ai changé de fac, j'étais issue de ce qui se faisait de moins prestigieux à chaque fois.
Je me souviens, au lycée, dans notre livre de biologie, sur le chapitre dédié à la génétique, il y avait la photo d'un jeune Africain albinos entouré de ses camarades « normaux ». Il n'avait pas l'air franchement heureux d'être si « étrange »…
J'ai souvent pensé depuis à la chanson des Doors : « People are strange, When you ‘re a stranger, Faces look ugly, When you ‘re alone, Women seem wicked, When you ‘re unwanted, Streets are uneven, When you ‘re down, etc., etc… »
Eh bien, au risque de contredire Gérald Bronner, pour ma part, je me suis souvent sentie comme cet enfant d'Afrique, étrange parmi les miens, étrange parmi les autres, jamais à ma place, jamais en paix ni au repos, justement du fait de cette étrangeté.
Je me souviens encore, pendant mes études d'éthologie, je ne sais plus exactement qui, peut-être Konrad Lorenz — je n'affirmerais pas, je ne me souviens plus exactement —, avait une formule de ce type : dans la réalisation d'un être humain, l'inné compte à 100 % et l'acquis compte à 100 %. C'est exactement ce que je pense aussi.
Plus exactement, notre destinée est une suite ininterrompue de hasards et de nécessités, comme l'aurait formulé Jacques Monod. D'après moi, le premier des hasards est justement la génétique : parmi la foule de gènes que possèdent nos parents, l'échantillonnage qui nous échoit fait de nous quelqu'un de tout à fait conforme, globalement conforme, moyennement conforme, faiblement conforme ou pas du tout conforme aux personnes du milieu duquel on vient, à commencer par nos parents (et à supposer qu'ils soient conformes l'un à l'autre, ce qui est loin d'être certain). Et ça, l'on n'y peut absolument rien.
Le deuxième hasard concerne la nature de la non-conformité en question, si non-conformité il y a. En ce qui me concerne, je crois que le hasard m'a pourvue d'un phénoménal appétit de compréhension : dès l'enfance, j'adorais comprendre. Je me rends compte que plein de gens — voire la majorité —, se fichent éperdument de comprendre telle ou telle chose, tel ou tel lien entre des choses apparemment disjointes. Moi, pas, c'est même carrément une passion. Je dirais même plus, cette passion est presque pathologique, de l'ordre du TOC : je ne dors pas si je n'ai pas compris le phénomène, ou la portion de phénomène, sur lequel je me questionne.
On devine aisément que cette passion — que je n'ai pas choisie, qui ressort donc du pur hasard, d'une pure potentialité génétique — a, en retour, des conséquences, qui elles ressortent de la nécessité, sachant que la passion de comprendre est donnée. Mais qu'en aurait-il été si ma « non-conformité » par rapport à mon milieu d'origine avait été d'une nature toute différente ? Par exemple, si j'avais adoré les cactus à la folie ou élever des serpents ou collectionner les jupes ?
Ensuite, dire que le rôle des parents — qui relève de la nécessité — est fondateur est une lapalissade : Mozart aurait-il été Mozart si son père n'avait pas été musicien auprès des Grands d'Autriche ? Julie Depardieu ferait-elle du cinéma si elle ne s'appelait pas Depardieu ? Joakim Noah aurait-il été sportif de haut niveau si… enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire.
Ceci dit, nul ne peut dire DANS QUEL SENS ni EN PARTANT D'OÙ il est fondateur. On a tendance à remarquer ce rôle fondateur lorsque le trait principal du parent se retrouve chez son descendant. Mais si je vous disais que mon penchant pour la lecture me provient de mon père, qui est sûrement parmi les moins lecteurs qu'on puisse imaginer, qu'en penseriez-vous ?
Il y a une phase sensible de l'enfance — autour de 7 ans — pendant laquelle plein de choses s'impriment, sans qu'on en ait nécessairement conscience quand on est parent. Quand j'avais autour de 7 ans, donc, mon père, très temporairement et très brièvement, s'est abonné à une revue de sport automobile, dont le titre avait le mérite d'être explicite : Sport auto. (J'ai déjà abordé ce puissant héritage paternel dans mon commentaire d'un livre de Vic Elford, La Victoire ou rien.) Eh bien, d'avoir vu mon père lire cette revue durant cette courte période, alors que j'avais l'âge sensible — c'était un hasard —, a imprimé durablement le goût de lire en moi. Ce fut donc un minuscule bout de la lorgnette, quelque chose qui n'est pas du tout caractéristique ni représentatif de mon père, qu'il m'a légué inconsciemment et dont l'objet ne s'est jamais dirigé depuis lors vers le sport automobile, d'où la difficulté (voire la quasi-impossibilité) à le déceler pour quelqu'un d'extérieur.
Je me suis souvent demandée ce que j'avais de commun avec ma mère (j'ai déjà évoqué mes relations avec ma mère dans ma critique du Coran) ou avec mon père. Pourtant, à fin et à force de chercher à comprendre, j'ai fini par repérer des minuscules morceaux de ceci et de cela, qui ne les caractérisent ni l'un ni l'autre, qui ne sont, pour eux, que des épiphénomènes, et qui pourtant, chez moi, sont constitutifs, voire essentiels. Tout vient d'eux, mais un peu comme on ne reconnaît pas dans ma peau ou dans mes os les carottes et les petits pois dont ils proviennent, on ne reconnaît pas en moi le comportement ou les centres d'intérêts de mes parents.
Je voudrais encore me démarquer de Gérald Bronner sur la question du dolorisme. Pour lui, de ce que j'en comprends, c'est presque une posture, un « chiquet », quelque chose de surfait. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui sur ce point. L'idée même de « lutte des classes » suppose que les différentes classes sociales luttent les unes contre les autres. Et donc, par conséquent, le fait de changer de classe équivaut à changer de camp dans cette lutte qui se poursuit. de là à la traitrise, du moins à l'accusation de traitrise, il n'y a jamais loin. Allez donc demander aux Malgré-Nous alsaciens si ce n'est pas douloureux de changer de camp « par la force des choses ». La réussite scolaire et plus tard professionnelle induit nécessairement de changer de camp, d'où les fréquentes charges qu'ont à subir les « bons à l'école » de la part de ceux qui ne le sont pas. Peu ou prou, tous savent que, plus tard, ils ne combattront pas du même côté de la ligne de partage des eaux.
J'ai assez puissamment exprimé mon désaccord avec Annie Ernaux dans ma critique de la Place, car, d'après mon vécu, j'ai ressenti exactement le contraire de ce qu'elle prétend vouloir exprimer à qui veut l'entendre. Selon elle, son écriture « vengerait » sa « race », là, où moi qui viens du même milieu qu'elle je ne perçois que mépris pour ce milieu dans son récit. Donc, entre Annie Ernaux, qui a clairement trahi son milieu d'origine, qui fait semblant d'en être encore tout en décrivant la douleur de se sentir traitre, et Gérald Bronner, qui éprouve une fierté tant de son milieu d'origine que d'avoir réussi à s'en extraire, mon coeur balance, car il demeure une autre catégorie à laquelle, je pense, j'appartiens : celle des personnes dont les centres d'intérêts les éloignent de leur milieu d'origine mais vis-à-vis de qui les lumières de la ville et la vie bourgeoise font office de repoussoir, une sorte de NI, NI pas très confortable.
Je me sens très prolo, socialement parlant, et très bobo quant à mes centres d'intérêt. Exactement comme le pauvre enfant africain de mon livre de bio, qui avait le malheur d'avoir une peau trop blanche parmi les populations noires, et des traits trop négroïdes pour nourrir beaucoup d'espoir parmi des populations blanches. Bien sûr, on me rétorquera que ça n'a pas empêché Salif Keïta de devenir qui il est devenu, mais j'ai peine à croire que le concernant, s'il avait eu le choix, au départ, il n'aurait pas opté pour avoir la même pigmentation que ses pairs. J'ai peine à croire qu'il n'a jamais été perçu comme un traitre par les uns ou les autres, et qu'il ne s'est jamais senti comme un apatride, à un moment ou à un autre, et que ça n'ait jamais suscité de douleurs en lui.
Oui, être hors cases, ça peut être douloureux, ça peut être une cicatrice à vie, ça peut être difficile à vivre au quotidien, et je ne me suis attardée que sur ce malheureux exemple, mais j'aurais pu en développer à l'envi et de tout autre type. Ça n'est rien d'autre, finalement, que ce qu'exprime le conte d'Andersen, le vilain petit Canard. N'être pas à sa place, être toujours différent ou dans l'ultra-minorité, ce n'est pas forcément une sinécure. Ne vous déplaise, cher Gérald Bronner, mais ce n'est que mon avis de transclasse, à peine transclasse d'ailleurs ou transclasse à grand peine, c'est-à-dire, pas grand-chose.
C'est à la mode les transclasses, ou transfuge de classe, ou nomades de classe, encore plus depuis le dernier Nobel. Tout le monde y va de son petit nom, pour mieux expliquer les choses à sa façon. Gérald Bronner préfère le nomadisme de classe pour parler de ces gens qui naviguent entre leur milieu d'origine et leur milieu d'arrivée tels des caméléons, transfuge est connoté trahison selon lui, Chantal Jacquet utilise transclasse car le changement de classe peut aller dans les deux sens. Moi je les appelle les débrouillards.
Dans cet essai, il y va de ses réflexions sur le mythe du transclasse, en s'intéressant tout d'abord à la mythologie de soi, à la typologie narrative du transclasse. Il fustige la stéréotypie d'une narration à tendance doloriste, et y oppose la fierté, via le mérite. À l'opposé de Chantal Jacquet, qui pointe dans sa théorie les illusions et les écueils du mérite. Dans le livre, j'ai trouvé la présentation de la théorie de Chantal Jacquet très réductrice par rapport à ce que j'avais pu lire, elle lui répond dans un débat sur philomag :
« Dans votre livre, vous écrivez que je fais preuve d'une « imagination débridée » lorsque j'écris que le mérite est une « pure construction politique, un instrument de gouvernement destiné à renforcer l'obéissance à l'ordre social par un système de valorisation ou de réprobation des comportements ». Pour vous, il est difficile de prendre au sérieux cette interprétation « lestée par le biais d'intentionnalité ». Mais vous extrayez une phrase de son contexte et lui imputez une signification qu'elle n'a pas. Il s'agissait en l'occurrence d'expliquer qu'historiquement, le mérite est une construction théologique et politique, qui n'a de valeur que dans l'état civil. Il n'a aucun fondement ontologique. À l'état naturel, il n'y a ni mérite ni faute. »
Reste que le livre m'a beaucoup intéressé, il mêle neuroscience et psychologie à la sociologie et la philosophie, on se doute qu'il sera question de Bourdieu, mais aussi de Raymond Boudon son pendant moins marqué du biais d'intentionnalité selon Bronner, mais aussi d'Ernaux, Eribon,... Mais Bronner explore aussi la biologie, l'inné et l'acquis, l'importance des pairs et des rencontres (les fées selon Norbert Alter) dans la construction de soi. Il évoque aussi la créativité et les capacités langagières assez communes chez les transfuges, sans trop s'y attarder non plus (dommage).
J'ai beaucoup aimé sa conclusion, qui tend à rendre quasi impossible une théorisation uniforme des origines (via le cas particulier des transclasses). Et si après tout, les transclasses avaient tous leur singularité et leur propre histoire, malgré leurs points communs évidents ?
Dans cet essai, il y va de ses réflexions sur le mythe du transclasse, en s'intéressant tout d'abord à la mythologie de soi, à la typologie narrative du transclasse. Il fustige la stéréotypie d'une narration à tendance doloriste, et y oppose la fierté, via le mérite. À l'opposé de Chantal Jacquet, qui pointe dans sa théorie les illusions et les écueils du mérite. Dans le livre, j'ai trouvé la présentation de la théorie de Chantal Jacquet très réductrice par rapport à ce que j'avais pu lire, elle lui répond dans un débat sur philomag :
« Dans votre livre, vous écrivez que je fais preuve d'une « imagination débridée » lorsque j'écris que le mérite est une « pure construction politique, un instrument de gouvernement destiné à renforcer l'obéissance à l'ordre social par un système de valorisation ou de réprobation des comportements ». Pour vous, il est difficile de prendre au sérieux cette interprétation « lestée par le biais d'intentionnalité ». Mais vous extrayez une phrase de son contexte et lui imputez une signification qu'elle n'a pas. Il s'agissait en l'occurrence d'expliquer qu'historiquement, le mérite est une construction théologique et politique, qui n'a de valeur que dans l'état civil. Il n'a aucun fondement ontologique. À l'état naturel, il n'y a ni mérite ni faute. »
Reste que le livre m'a beaucoup intéressé, il mêle neuroscience et psychologie à la sociologie et la philosophie, on se doute qu'il sera question de Bourdieu, mais aussi de Raymond Boudon son pendant moins marqué du biais d'intentionnalité selon Bronner, mais aussi d'Ernaux, Eribon,... Mais Bronner explore aussi la biologie, l'inné et l'acquis, l'importance des pairs et des rencontres (les fées selon Norbert Alter) dans la construction de soi. Il évoque aussi la créativité et les capacités langagières assez communes chez les transfuges, sans trop s'y attarder non plus (dommage).
J'ai beaucoup aimé sa conclusion, qui tend à rendre quasi impossible une théorisation uniforme des origines (via le cas particulier des transclasses). Et si après tout, les transclasses avaient tous leur singularité et leur propre histoire, malgré leurs points communs évidents ?
J'avais entendu Gérald Bronner parler de son livre à la radio et j'avais très envie de le lire car je m'intéresse beaucoup à la question des transfuges de classe, même si, un peu comme lui, je trouve le terme horrible.
Je remercie donc vivement l'équipe de Babelio et les éditions Autrement pour m'avoir offert cette opportunité.
J'ai trouvé cet ouvrage absolument passionnant, surtout la première partie sur le refus du dolorisme.
J'ai aussi trouvé intéressantes les comparaisons avec les oeuvres d'Annie Ernaux et d'Edouard Louis.
Enfin, j'ai été très touchée par les deux scènes que l'auteur décrit au moment des résultats du bac (avec la patronne de sa mère et à la pâtisserie).
Je conseille vraiment cet essai à tous ceux qui se posent la question de l'influence de leur origine sociale sur leur vie, ils y trouveront des analyses argumentées et positives car refusant de tomber dans la honte ou l'apitoiement.
A titre personnel, ce livre m'a intéressée, m'a touchée, et je crois même pouvoir dire qu'il m'a fait du bien (mais ne vous attendez pas à un roman feel good, c'est quand même un ouvrage scientifique avec des passages un peu ardus!)
Enfin, une mention spéciale pour la couverture, qui est très réussie. C'est une excellente idée d'avoir ressorti de vieilles bandes de photos d'identité de l'auteur.
Je remercie donc vivement l'équipe de Babelio et les éditions Autrement pour m'avoir offert cette opportunité.
J'ai trouvé cet ouvrage absolument passionnant, surtout la première partie sur le refus du dolorisme.
J'ai aussi trouvé intéressantes les comparaisons avec les oeuvres d'Annie Ernaux et d'Edouard Louis.
Enfin, j'ai été très touchée par les deux scènes que l'auteur décrit au moment des résultats du bac (avec la patronne de sa mère et à la pâtisserie).
Je conseille vraiment cet essai à tous ceux qui se posent la question de l'influence de leur origine sociale sur leur vie, ils y trouveront des analyses argumentées et positives car refusant de tomber dans la honte ou l'apitoiement.
A titre personnel, ce livre m'a intéressée, m'a touchée, et je crois même pouvoir dire qu'il m'a fait du bien (mais ne vous attendez pas à un roman feel good, c'est quand même un ouvrage scientifique avec des passages un peu ardus!)
Enfin, une mention spéciale pour la couverture, qui est très réussie. C'est une excellente idée d'avoir ressorti de vieilles bandes de photos d'identité de l'auteur.
Cet essai de Gérard Bronner a les défauts de ses qualités. Synthétisant les analyses des chercheurs en sciences sociales sur la destinée sociale des individus, il leur confronte sa propre vision, en puisant dans son histoire personnelle, un peu à la manière dont Ivan Jablonka avait usé de son récit personnel dans Un garçon comme vous et moi. le mélange a le mérite d'une lecture attrayante et l'inconvénient de focaliser l'attention du lecteur sur une expérience personnelle et particulière, avec tous les biais que cela comporte.
Cependant, Gérard Bronner développe un contrepoint intéressant à une thématique très en vogue ces derniers temps, celle de la honte sociale. Il s'oppose à ce qu'il appelle la tentation du dolorisme (sic) véhiculée par certaines études sociologiques (Patricia Janody) ou chez quelques écrivains tels que Annie Ernaux, Didier Eribon, ou encore Édouard Louis.
Au bout du compte, il effectue un passage en revue de questions centrales dans le débat sur les origines des trajectoires sociales : la stigmatisation sociale, la socialisation familiale, la méritocratie, l'influence des pairs… et quelques passes d'armes avec les défenseurs de la théorie bourdieusienne sur les modes de domination à l'oeuvre dans la société.
Un livre qui participe du débat sur les concepts de transfuges de classe/transclasses.
Cependant, Gérard Bronner développe un contrepoint intéressant à une thématique très en vogue ces derniers temps, celle de la honte sociale. Il s'oppose à ce qu'il appelle la tentation du dolorisme (sic) véhiculée par certaines études sociologiques (Patricia Janody) ou chez quelques écrivains tels que Annie Ernaux, Didier Eribon, ou encore Édouard Louis.
Au bout du compte, il effectue un passage en revue de questions centrales dans le débat sur les origines des trajectoires sociales : la stigmatisation sociale, la socialisation familiale, la méritocratie, l'influence des pairs… et quelques passes d'armes avec les défenseurs de la théorie bourdieusienne sur les modes de domination à l'oeuvre dans la société.
Un livre qui participe du débat sur les concepts de transfuges de classe/transclasses.
Éclairant sur plein de points ! J'ai découvert ce livre à la télévision, je ne connaissais ni l'auteur, ni la couverture, mais le sujet m'a évidemment happée ! C'est clair et concis, bien écris et inspirant, et ça touchera quiconque se pose des questions sur ce thème abyssal que sont les origines.
critiques presse (1)
Ni essai théorique ni confession intime, son libre propos interroge les récits que nous construisons tous pour répondre à l’insoluble question de nos origines. Comment, et pourquoi, sommes-nous devenus ce que nous sommes ? Par quel hasard, ou quelle nécessité, finit-on par être celle-ci, ou celui-là ?
Lire la critique sur le site : LeMonde
Citations et extraits (30)
Voir plus
Ajouter une citation
[sur les déterminismes à la Bourdieu]
On dit souvent qu’une première expérience est marquante. Il est bien vrai que l’on se souvient plus facilement de son premier baiser que de son trentième, ou de sa première ivresse – à condition de ne pas l’avoir poussée trop loin – que de celles qui suivront.
Pour mettre en exergue cette tendance de l’esprit humain à donner tant d’importance à une information qu’il rencontre pour la première fois, Solomon Asch présenta à deux groupes d’individus distincts la description, en une phrase, d’une même personnalité, avec les mêmes qualités et les mêmes défauts. Dans un cas, les défauts étaient présentés en premier et, dans l’autre, en dernier.
Description présentée au premier groupe : Steve est intelligent, travailleur, sanguin, critique, têtu et envieux.
Description présentée au deuxième groupe : Steve est envieux, têtu, critique, sanguin, travailleur et intelligent.
Le psychologue constata que, dans le premier cas, les sujets de l’expérience avaient une opinion de Steve supérieure à celle que se faisaient les individus confrontés à la seconde description. L’ordre dans lequel étaient placés les adjectifs avait donc une influence sur la représentation que les sujets de l’expérience se faisaient de Steve. La première impression avait bien quelque chose de fondateur. On pourrait multiplier les exemples de ce phénomène. Ainsi, dans un tout autre registre, on a pu montrer que cet effet est très fort concernant les informations et notamment les fausses informations que l’on nomme des « infox ». Lorsqu’un individu est confronté à une première narration d’un phénomène, il demeure une impression favorable dans son esprit quand bien même il lui a été démontré qu’elle était fausse. On peut donc conjecturer raisonnablement que les premières propositions cognitives que nous rencontrerons lors de notre socialisation auront des chances d’ancrer en nous des formes de représentations du monde auxquelles nous nous mettrons à tenir dès lors que nous les aurons endossées. Partant de ce point, l’idée selon laquelle nos premières expériences, celles qui s’enracinent dans nos origines, ont quelque chose de fondateur est une spéculation raisonnable.
L’un des auteurs qui a poussé assez loin cette idée que nos premières expériences – celles que nous rencontrons dans notre socialisation primaire – forgent durablement nos représentations du monde est le sociologue français Pierre Bourdieu. Rappeler qu’il considérait l’individu comme un sujet hétéronome n’est pas trahir sa pensée. Selon lui, et cette seule phrase résume assez bien les intentions de sa sociologie, il y a un « rapport de complicité ontologique entre les structures mentales et les structures objectives de l’espace social ». Qu’entendait-il par là ? Cette complicité est la conséquence du processus de socialisation qui implémente en nous des dispositions, affirmait-il. En d’autres termes, notre éducation et les premières expériences que nous rencontrons dans le monde social que nous fréquentons ont quelque chose de séminal. Bourdieu l’écrit encore autrement en expliquant : « Ces dispositions communes et la doxa partagée qu’elles fondent sont le produit d’une socialisation identique ou semblable conduisant à l’incorporation généralisée des structures du marché des biens symboliques sous la forme de structures cognitives accordées avec les structures objectives du marché. » De cette institution du social dans le corps, résulte l’existence d’habitus qui « engage […] des schémas pratiques issus de l’incorporation – à travers le processus historique de socialisation, l’ontogenèse – de structures sociales elles-mêmes issues du travail historique des générations successives, la phylogenèse ».
Cette conception de l’habitus, pour métaphorique qu’elle paraisse, est plutôt compatible avec les propositions des chercheurs en neurosciences qui ont souvent insisté sur les processus d’implémentation par expérience relevant en partie de ce que l’on nomme la « socialisation ». L’idée serait que l’apprentissage – que Bourdieu définit, en se référant justement à L’Homme neuronal écrit par un spécialiste de l’étude du cerveau humain, Jean-Pierre Changeux, comme la « transformation sélective et durable des corps qui s’opère par renforcement ou affaiblissement des connexions synaptiques » – implémenterait en nous des structures neuronales enfouies dans une sorte d’inconscient cognitif hors d’atteinte de la volonté des sujets et qui seraient les déterminants réels de leurs actions, décisions, goûts, croyances, postures, etc. En somme, selon le sociologue français, l’esprit humain serait gouverné par des mécanismes causals aveugles qui ressembleraient à des « ressorts ».
On dit souvent qu’une première expérience est marquante. Il est bien vrai que l’on se souvient plus facilement de son premier baiser que de son trentième, ou de sa première ivresse – à condition de ne pas l’avoir poussée trop loin – que de celles qui suivront.
Pour mettre en exergue cette tendance de l’esprit humain à donner tant d’importance à une information qu’il rencontre pour la première fois, Solomon Asch présenta à deux groupes d’individus distincts la description, en une phrase, d’une même personnalité, avec les mêmes qualités et les mêmes défauts. Dans un cas, les défauts étaient présentés en premier et, dans l’autre, en dernier.
Description présentée au premier groupe : Steve est intelligent, travailleur, sanguin, critique, têtu et envieux.
Description présentée au deuxième groupe : Steve est envieux, têtu, critique, sanguin, travailleur et intelligent.
Le psychologue constata que, dans le premier cas, les sujets de l’expérience avaient une opinion de Steve supérieure à celle que se faisaient les individus confrontés à la seconde description. L’ordre dans lequel étaient placés les adjectifs avait donc une influence sur la représentation que les sujets de l’expérience se faisaient de Steve. La première impression avait bien quelque chose de fondateur. On pourrait multiplier les exemples de ce phénomène. Ainsi, dans un tout autre registre, on a pu montrer que cet effet est très fort concernant les informations et notamment les fausses informations que l’on nomme des « infox ». Lorsqu’un individu est confronté à une première narration d’un phénomène, il demeure une impression favorable dans son esprit quand bien même il lui a été démontré qu’elle était fausse. On peut donc conjecturer raisonnablement que les premières propositions cognitives que nous rencontrerons lors de notre socialisation auront des chances d’ancrer en nous des formes de représentations du monde auxquelles nous nous mettrons à tenir dès lors que nous les aurons endossées. Partant de ce point, l’idée selon laquelle nos premières expériences, celles qui s’enracinent dans nos origines, ont quelque chose de fondateur est une spéculation raisonnable.
L’un des auteurs qui a poussé assez loin cette idée que nos premières expériences – celles que nous rencontrons dans notre socialisation primaire – forgent durablement nos représentations du monde est le sociologue français Pierre Bourdieu. Rappeler qu’il considérait l’individu comme un sujet hétéronome n’est pas trahir sa pensée. Selon lui, et cette seule phrase résume assez bien les intentions de sa sociologie, il y a un « rapport de complicité ontologique entre les structures mentales et les structures objectives de l’espace social ». Qu’entendait-il par là ? Cette complicité est la conséquence du processus de socialisation qui implémente en nous des dispositions, affirmait-il. En d’autres termes, notre éducation et les premières expériences que nous rencontrons dans le monde social que nous fréquentons ont quelque chose de séminal. Bourdieu l’écrit encore autrement en expliquant : « Ces dispositions communes et la doxa partagée qu’elles fondent sont le produit d’une socialisation identique ou semblable conduisant à l’incorporation généralisée des structures du marché des biens symboliques sous la forme de structures cognitives accordées avec les structures objectives du marché. » De cette institution du social dans le corps, résulte l’existence d’habitus qui « engage […] des schémas pratiques issus de l’incorporation – à travers le processus historique de socialisation, l’ontogenèse – de structures sociales elles-mêmes issues du travail historique des générations successives, la phylogenèse ».
Cette conception de l’habitus, pour métaphorique qu’elle paraisse, est plutôt compatible avec les propositions des chercheurs en neurosciences qui ont souvent insisté sur les processus d’implémentation par expérience relevant en partie de ce que l’on nomme la « socialisation ». L’idée serait que l’apprentissage – que Bourdieu définit, en se référant justement à L’Homme neuronal écrit par un spécialiste de l’étude du cerveau humain, Jean-Pierre Changeux, comme la « transformation sélective et durable des corps qui s’opère par renforcement ou affaiblissement des connexions synaptiques » – implémenterait en nous des structures neuronales enfouies dans une sorte d’inconscient cognitif hors d’atteinte de la volonté des sujets et qui seraient les déterminants réels de leurs actions, décisions, goûts, croyances, postures, etc. En somme, selon le sociologue français, l’esprit humain serait gouverné par des mécanismes causals aveugles qui ressembleraient à des « ressorts ».
Il manque une enquête qui mettrait au jour, en tenant à distance le récit doloriste, les vraies caractéristiques de ceux dont les origines ne correspondent pas à la ligne d’arrivée sociale. La créativité me paraît un point assez aveugle de cette question. La chose est difficile à mesurer mais il me semble qu’elle présuppose un esprit frondeur, une forme de défiance qui est facilitée par le regard ironique de celui ou celle qui a traversé plusieurs mondes sociaux. Comme l’écrit de belle façon Norbert Alter dans Sans classe ni place à propos du nomade social : « Il aborde le monde avec liberté, et parfois le succès, de celui qui n’en connaît pas les règles. »
Il se trouve que mon père, lorsque j'étais à peine sorti de mon corps grassouillet de bébé, m'a dit un jour: "Toi, tu iras loin." Impossible de me souvenir de ce que j'avais pu dire ou faire pour mériter une telle prophétie. Pourtant, le souvenir de cette phrase, ce n'est pas rien. Est-ce qu'elle venait confirmer quelque chose que je savais? Est-ce qu'au contraire elle a créé de toutes pièces l'ambition qui m'a toujours fait regarder le futur avec gourmandise?
(…) le principe de la méritocratie est encore applaudi par les opinions publiques démocratiques. Quel intérêt y aurait-il à démolir ce mythe républicain fondateur si ce n'est lui substituer un fatalisme tout aussi fictionnel mais plus instrumentalisable politiquement ? Les conséquences de ce fatalisme me paraissent - même au regard des valeurs que prétendent défendre ceux qui le portent - effrayantes. Non seulement il propose une assignation à résidence sociale mais il décourage à peu près toute forme d'efforts, et notamment scolaires, étant entendu que, pour nébuleuses que soient les chances de réussite, elles ne peuvent puiser leur source que là. Il faut veiller à ce que l'inégalité des chances ne se transforme pas - ce qui serait une double peine - en inégalité des espoirs.
[Michael Young et la méritocratie]
Tenter un catalogue des reproches nombreux qui ont été adressés à la notion de méritocratie ces dernières décennies dépasserait mes compétences et userait la patience du lecteur. Je ferai donc appel à l’une des plus fascinantes de ces critiques : celle de Michael Young. Ce sociologue, très lié au Parti travailliste britannique, est particulièrement légitime pour évoquer ce sujet, non seulement parce qu’il est justement l’inventeur du terme de « méritocratie », mais encore parce qu’il fut dans son pays, l’un des promoteurs du renouvellement des élites par la reconnaissance du mérite plutôt que de l’hérédité. Pourtant, Michael Young publia, dès 1958, un récit à la tonalité dystopique où il imaginait une Angleterre en 2033 plus divisée encore que celle du XXe siècle. L’Angleterre du XXIe siècle décrite par le sociologue a, par la méritocratie, réinstauré de nouvelles classes dirigeantes qui sont encore plus arrogantes que celles du passé. Leur suffisance vient du sentiment qu’elles doivent leur position sociale à elles seules, une combinaison de dispositions naturelles – mesurées dès le plus jeune âge dans cette société – et de leurs efforts. Cette constatation les rend moins capables que toutes les autres élites les ayant précédées d’une forme de mansuétude sociale. Dans cette société dystopique, le mérite constitue l’ultime et inconditionnelle justification des inégalités sociales. La colère gronde et la violence politique revient sur le devant de la scène au sein d’une Angleterre qui pensait pourtant avoir adopté le plus légitime des systèmes. Avec l’assassinat du président des syndicats et un attentat à la bombe contre le ministère de l’Éducation, le climat social vire à l’émeute. Par ce récit, le sociologue suggère que si l’hérédité sociale, comme principe de hiérarchie, suscite la révolte, le principe des dispositions combinées à l’effort pourrait la susciter tout autant. La réussite sociale qui en résulte n’est, en effet, pas fondée sur l’ensemble des dispositions en général, mais seulement sur les compétences scolaires et donc une certaine forme d’intelligence en particulier. Ceci, associé à l’arrogance de ceux qui ne doutent pas du bien-fondé de leurs privilèges, provoque mécaniquement le ressentiment. Ce ressentiment est d’autant plus compréhensible, dans cette société du futur, que ce pur système d’égalité des chances reproduit en réalité une partie des inégalités héritées, comme l’a bien pressenti l’auteur de cette dystopie. Les parents qui ont été sélectionnés par le système pour leur intelligence mesurée ont tendance à se reproduire entre eux et enfanter des individus aux aptitudes plus élevées que la moyenne et favorisés par leur éducation initiale.
Tenter un catalogue des reproches nombreux qui ont été adressés à la notion de méritocratie ces dernières décennies dépasserait mes compétences et userait la patience du lecteur. Je ferai donc appel à l’une des plus fascinantes de ces critiques : celle de Michael Young. Ce sociologue, très lié au Parti travailliste britannique, est particulièrement légitime pour évoquer ce sujet, non seulement parce qu’il est justement l’inventeur du terme de « méritocratie », mais encore parce qu’il fut dans son pays, l’un des promoteurs du renouvellement des élites par la reconnaissance du mérite plutôt que de l’hérédité. Pourtant, Michael Young publia, dès 1958, un récit à la tonalité dystopique où il imaginait une Angleterre en 2033 plus divisée encore que celle du XXe siècle. L’Angleterre du XXIe siècle décrite par le sociologue a, par la méritocratie, réinstauré de nouvelles classes dirigeantes qui sont encore plus arrogantes que celles du passé. Leur suffisance vient du sentiment qu’elles doivent leur position sociale à elles seules, une combinaison de dispositions naturelles – mesurées dès le plus jeune âge dans cette société – et de leurs efforts. Cette constatation les rend moins capables que toutes les autres élites les ayant précédées d’une forme de mansuétude sociale. Dans cette société dystopique, le mérite constitue l’ultime et inconditionnelle justification des inégalités sociales. La colère gronde et la violence politique revient sur le devant de la scène au sein d’une Angleterre qui pensait pourtant avoir adopté le plus légitime des systèmes. Avec l’assassinat du président des syndicats et un attentat à la bombe contre le ministère de l’Éducation, le climat social vire à l’émeute. Par ce récit, le sociologue suggère que si l’hérédité sociale, comme principe de hiérarchie, suscite la révolte, le principe des dispositions combinées à l’effort pourrait la susciter tout autant. La réussite sociale qui en résulte n’est, en effet, pas fondée sur l’ensemble des dispositions en général, mais seulement sur les compétences scolaires et donc une certaine forme d’intelligence en particulier. Ceci, associé à l’arrogance de ceux qui ne doutent pas du bien-fondé de leurs privilèges, provoque mécaniquement le ressentiment. Ce ressentiment est d’autant plus compréhensible, dans cette société du futur, que ce pur système d’égalité des chances reproduit en réalité une partie des inégalités héritées, comme l’a bien pressenti l’auteur de cette dystopie. Les parents qui ont été sélectionnés par le système pour leur intelligence mesurée ont tendance à se reproduire entre eux et enfanter des individus aux aptitudes plus élevées que la moyenne et favorisés par leur éducation initiale.
Videos de Gérald Bronner (43)
Voir plusAjouter une vidéo
Conférence de Gérald Bronner
Nos décisions quotidiennes, nos jugements moraux et nos actions sont largement influencés par nos croyances religieuses, politiques ou éthiques. Avec une saisonconsacrée à la croyance, ce cycle de conférences interroge cette notion complexe et en examine les enjeux.
Lors de cette séance, le sociologue Gérald Bronner propose d'analyser l'émergence de nouvelles formes de crédulité dans le monde contemporain. Celles-ci seront présentées comme la conséquence du fonctionnement ancestral de notre cerveau rencontrant la modernité informationnelle.
Conférence enregistrée le 3 avril 2024 à la BnF I François-Mitterrand.
Nos décisions quotidiennes, nos jugements moraux et nos actions sont largement influencés par nos croyances religieuses, politiques ou éthiques. Avec une saisonconsacrée à la croyance, ce cycle de conférences interroge cette notion complexe et en examine les enjeux.
Lors de cette séance, le sociologue Gérald Bronner propose d'analyser l'émergence de nouvelles formes de crédulité dans le monde contemporain. Celles-ci seront présentées comme la conséquence du fonctionnement ancestral de notre cerveau rencontrant la modernité informationnelle.
Conférence enregistrée le 3 avril 2024 à la BnF I François-Mitterrand.
+ Lire la suite
autres livres classés : méritocratieVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Gérald Bronner (25)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (5 - essais )
Roland Barthes : "Fragments d'un discours **** "
amoureux
positiviste
philosophique
20 questions
881 lecteurs ont répondu
Thèmes :
essai
, essai de société
, essai philosophique
, essai documentCréer un quiz sur ce livre881 lecteurs ont répondu