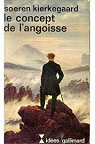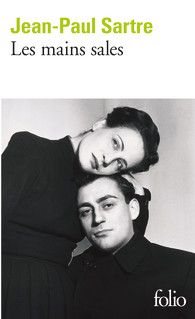Jean-Paul Sartre/5
2399 notes
Résumé :
Donc j'étais tout à l'heure au Jardin public. La racine du marronnier s'enfonçait dans la terre, juste au-dessous de mon banc. Je ne me rappelais plus que c'était une racine. Les mots s'étaient évanouis et, avec eux, la signification des choses, leurs modes d'emploi, les faibles repères que les hommes ont tracés à leur surface. J'étais assis, un peu voûté, la tête basse, seul en face de cette masse noire et noueuse entièrement brute et qui me faisait peur. Et puis j... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après La Nausée Voir plus
Critiques, Analyses et Avis (96)
Voir plus
Ajouter une critique
On pourrait croire que La Nausée est une expérience du dégoût de soi appartenant à la vie. En réalité, elle est son opposé, c'est-à-dire une expérience du dégoût de la vie n'étant pas contenue en soi. On comprend d'autant mieux ce positionnement que le livre qui le décrit est le premier que publia Jean-Paul Sartre, lui libérant ainsi une voie royale pour se faire connaître. Avant la nausée ? Rage de n'être rien. Ecriture de la nausée. Après la nausée ? Digestion satisfaite de l'homme qui a commencé à s'affirmer dans l'existence. Et ce dernier mot nous en rappelle un autre : existentialisme, ô mon amour… en un roman à tendance autobiographique, on devine les raisons de la construction d'un système philosophique. Parce que Jean-Paul Sartre aura réussi à dépasser sa nausée, il imposera ensuite à tous de le faire sous peine d'être des hommes de « mauvaise foi ». Et pourtant, l'entreprise ne semble pas aisée. Il suffit de lire les pérégrinations d'Antoine Roquentin pour s'en rendre compte.
Le bonhomme mène une vie peu intéressante qui le trimballe de Bouville à Paris, essayant de renouer des liens avec une femme qui fut autrefois son amante, tandis qu'il s'attèle à la rédaction d'un livre historique traitant de la vie du marquis de Rollebon. Solitaire, plutôt désoeuvré, il a beaucoup trop de temps libre pour réfléchir. On sait jusqu'à quelles extrémités peuvent conduire l'inactivité… chez Antoine Roquentin, elle se traduit par des idées fixes, des spasmes et une phobie de la nausée. Cette dernière survient comme une crise épileptique : certains signaux permettent d'en soupçonner l'arrivée, sans pouvoir toutefois jamais être certain de la probabilité, de l'heure et du lieu d'attaque. Antoine Roquentin observe les objets et les gens jusqu'à se laisser hypnotiser par eux. Mais l'hypnose est maussade et le choc du retour à la réalité se traduit par le sentiment d'avoir compris intellectuellement l'existence des choses observées sans jamais pouvoir exprimer cette expérience de manière intelligible. Au lieu d'écrire La nausée, Wittgenstein aurait écrit : « Ce dont on ne peut parler, il faut le taire ». Mais Jean-Paul Sartre préfère parler.
Si l'on excepte ces tentatives ratées de descriptions impossibles, on avouera toutefois que certains passages brillent à décrire des sensations moins intellectuelles. Pour bien faire, Sartre n'hésite pas à former des paragraphes synesthésiques convaincants qui mettent en avant l'absurdité de nos croyances en une vie fondée une fois pour toute, et partant à jamais immuable.
« Sur tout ce que j'aime, sur la rouille du chantier, sur les planches pourries de la palissade, il tombe une lumière avare et raisonnable, semblable au regard qu'on jette, après une nuit sans sommeil, sur les décisions qu'on a prises d'enthousiasme la veille, sur les pages qu'on a écrites sans ratures et d'un seul jet. »
Entre quelques touches d'absurde dignes d'Ionesco (« Mon canif est sur la table. Je l'ouvre. Pourquoi pas ? de toute façon, ça changerait un peu »), on découvre une tendance à la vision organique et horrifique. le doute surgit : et si tout pouvait être autrement ? et si tout se mettait à vivre, vraiment ? Ce mélange audacieux aurait pu être convaincant si Jean-Sôl Partre n'était pas convaincu d'être le seul être humain sur terre –s'opposant à une humanité de bourgeois- à connaître le doute existentiel. Connaissant ce que devint l'homme des années après la publication de ce premier roman, n'est-il pas amusant de le lire rager contre ceux qui s'attirent la reconnaissance sociale et intellectuelle ? « Les magnifiques yeux gris ! Jamais le moindre doute ne les avait traversés » -et pourtant lui… et d'ailleurs, n'est-ce pas un privilège « bourgeois » de pouvoir contempler sa main et la décrire des pages durant jusqu'à faire surgir la nausée ?
Il serait toutefois dommage de cracher sur ce livre bourgeois qui s'amuse lui-même à cracher dans la soupe bourgeoise. le plus important est de reconnaître ses illuminations psychologiques, sa finesse des perceptions, et l'acuité d'une vision qui se précisera plus tard jusqu'à former un système philosophique et politique. Comme quoi, il y a toujours du bon dans le désoeuvrement.
Lien : http://colimasson.over-blog...
Le bonhomme mène une vie peu intéressante qui le trimballe de Bouville à Paris, essayant de renouer des liens avec une femme qui fut autrefois son amante, tandis qu'il s'attèle à la rédaction d'un livre historique traitant de la vie du marquis de Rollebon. Solitaire, plutôt désoeuvré, il a beaucoup trop de temps libre pour réfléchir. On sait jusqu'à quelles extrémités peuvent conduire l'inactivité… chez Antoine Roquentin, elle se traduit par des idées fixes, des spasmes et une phobie de la nausée. Cette dernière survient comme une crise épileptique : certains signaux permettent d'en soupçonner l'arrivée, sans pouvoir toutefois jamais être certain de la probabilité, de l'heure et du lieu d'attaque. Antoine Roquentin observe les objets et les gens jusqu'à se laisser hypnotiser par eux. Mais l'hypnose est maussade et le choc du retour à la réalité se traduit par le sentiment d'avoir compris intellectuellement l'existence des choses observées sans jamais pouvoir exprimer cette expérience de manière intelligible. Au lieu d'écrire La nausée, Wittgenstein aurait écrit : « Ce dont on ne peut parler, il faut le taire ». Mais Jean-Paul Sartre préfère parler.
Si l'on excepte ces tentatives ratées de descriptions impossibles, on avouera toutefois que certains passages brillent à décrire des sensations moins intellectuelles. Pour bien faire, Sartre n'hésite pas à former des paragraphes synesthésiques convaincants qui mettent en avant l'absurdité de nos croyances en une vie fondée une fois pour toute, et partant à jamais immuable.
« Sur tout ce que j'aime, sur la rouille du chantier, sur les planches pourries de la palissade, il tombe une lumière avare et raisonnable, semblable au regard qu'on jette, après une nuit sans sommeil, sur les décisions qu'on a prises d'enthousiasme la veille, sur les pages qu'on a écrites sans ratures et d'un seul jet. »
Entre quelques touches d'absurde dignes d'Ionesco (« Mon canif est sur la table. Je l'ouvre. Pourquoi pas ? de toute façon, ça changerait un peu »), on découvre une tendance à la vision organique et horrifique. le doute surgit : et si tout pouvait être autrement ? et si tout se mettait à vivre, vraiment ? Ce mélange audacieux aurait pu être convaincant si Jean-Sôl Partre n'était pas convaincu d'être le seul être humain sur terre –s'opposant à une humanité de bourgeois- à connaître le doute existentiel. Connaissant ce que devint l'homme des années après la publication de ce premier roman, n'est-il pas amusant de le lire rager contre ceux qui s'attirent la reconnaissance sociale et intellectuelle ? « Les magnifiques yeux gris ! Jamais le moindre doute ne les avait traversés » -et pourtant lui… et d'ailleurs, n'est-ce pas un privilège « bourgeois » de pouvoir contempler sa main et la décrire des pages durant jusqu'à faire surgir la nausée ?
Il serait toutefois dommage de cracher sur ce livre bourgeois qui s'amuse lui-même à cracher dans la soupe bourgeoise. le plus important est de reconnaître ses illuminations psychologiques, sa finesse des perceptions, et l'acuité d'une vision qui se précisera plus tard jusqu'à former un système philosophique et politique. Comme quoi, il y a toujours du bon dans le désoeuvrement.
Lien : http://colimasson.over-blog...
Ce roman que je lis pour la deuxième fois, me touche beaucoup. Il faut croire que la problématique existentialiste est particulièrement marquante pour moi. Je m'identifie assez bien au protagoniste. le regard qu'il porte sur lui, le monde et les autres est aussi souvent le mien. Se sentir étranger au monde ! Pourquoi fait-on cela ou pas ? Réflexion sur l'existence, et plus largement sur le sens que l'on donne à sa vie. Je ne suis pas très doué pour les systèmes philosophiques. Je reste dans le superficiel, le pragmatique et l'accessible. Plutôt Pierre Hadot ou Sénèque que Kant ou Foucault.
Il me semble pourtant comprendre assez bien l'existentialisme sartrien et l'angoisse devant le « néant ». Mais, au-delà de l'aspect purement philosophique, ce roman est d'abord une intrigue factuelle, insérée dans la société havraise des années 30. C'est un regard sur l'époque, les lieux…
Un des mes livres favoris qui n'est pas sans me rappeler parfois les essais de Cioran.
Il me semble pourtant comprendre assez bien l'existentialisme sartrien et l'angoisse devant le « néant ». Mais, au-delà de l'aspect purement philosophique, ce roman est d'abord une intrigue factuelle, insérée dans la société havraise des années 30. C'est un regard sur l'époque, les lieux…
Un des mes livres favoris qui n'est pas sans me rappeler parfois les essais de Cioran.
Après ma critique de Huis Clos et les Mouches, qui fut ma première lecture de Sartre, il me semblait intéressant de poursuivre par son premier roman, de 1938, la Nausée.
En partie autobiographique, ce roman se déroule assez clairement dans la riante ville du Havre, dans des années 30 marquées par la crise de 29 et la montée des totalitarismes. Il prend la forme d'un journal, que le narrateur aurait retrouvé, incomplet, et dont il rend compte avec un détachement qui accroit le caractère morbide de la narration.
Ce roman met en en scène, sous la forme d'un journal, un homme ayant vécu, voyagé, et qui, n'y trouvant plus sens, se fait rat de bibliothèque, contraint au voyage immobile par un comportement d'anorexique mental. Roquentin, confronté à son vide intérieur et ayant cessé de compenser par un course extérieure, prend conscience du non-sens de sa vie, de la vie, et en conçoit... La nausée, sentiment morbide qui l'éloigne peu à peu de ses semblables et de lui-même, un peu comme dans le Horla ou la Métamorphose. Au départ donc, ce roman semble s'inspirer de l'univers de Kafka, du dégoût de Céline, et préfigurer l'absurde de Ionesco.
Mais La Nausée est bien avant tout l'une des premières oeuvres de Sartre, et donc l'un des tous premiers manifestes existentialistes, version négative de l'Etre et le Néant. Grâce à sa Nausée, Roquentin prend conscience du vide d'une vie d'apparence -celle vécu par les bourgeois honnis qui l'entourent-, mais aussi de la liberté fondamentale que constitue cette prise de conscience même. Si ni sa relation avec Anny ni ses échanges intellectuels avec l'Autodidacte -nouvelles distractions extérieures sans doute ? - ne parviennent à l'extraire de sa Nausée, c'est finalement l'écoute d'un morceau de jazz à la terrasse d'un café, et la vision d'un humain n'existant qu'à travers l'acte créatif, qui semblent consister en fin d'ouvrage un remède. Ainsi, si les "salauds" hédonistes sont définitivement exclus des espoirs sartriens, une autre forme d'humanisme semble se dessiner en fin de roman. le lecteur en sort provisoirement soulagé, car sentant bien que la réponse est un peu courte, et dans l'obligation morale de poursuivre le chemin philosophique de Sartre das ses oeuvres ultérieures, ou de bifurquer vers d'autres recherches de sens.
En conclusion, la Nausée rend compte d'une première intuition philosophique -mais déjà creusée depuis des années par l'auteur-, par le ressenti. Se situant dans une veine "dépressive" de l'expression littéraire reliant Céline à Houellebecq, l'ouvrage semble introduire la réflexion de Sartre d'abord par l'effacement des cadres convenus, et laisse le lecteur en suspens au bord du vide, avec un simple airbag dans les bras. A la différence d'ouvrages postérieurs plus intellectuellement construits, Sartre cherche à montrer sans ménagement, dans un style sobre et faussement détaché, mais surtout par le partage de perceptions et de sensations vraies, la contingence brute des choses et de l'être. Bien qu'on sente l'intention "professorale" derrière cette démonstration, il parvient, avec des mots simples et des images concrètes, non dépourvus d'une poésie empruntant à la fois au spleen Baudelairien et au surréalisme hallucinogène, à transmettre ce ressenti, et par suite, à faire partager sa quête de sens -et de non sens- au lecteur.
Comme pour de nombreux autres lecteurs, ce n'est pas mon ouvrage préféré de Sartre, parce que son théâtre est plus percutant et ses oeuvres ultérieures plus précises quant à sa pensée philosophique ; mais j'ai néanmoins apprécié cette version en négatif de l'Etre et le Néant, ainsi que son écriture romanesque, proche de Kafka et Huysmans.
En partie autobiographique, ce roman se déroule assez clairement dans la riante ville du Havre, dans des années 30 marquées par la crise de 29 et la montée des totalitarismes. Il prend la forme d'un journal, que le narrateur aurait retrouvé, incomplet, et dont il rend compte avec un détachement qui accroit le caractère morbide de la narration.
Ce roman met en en scène, sous la forme d'un journal, un homme ayant vécu, voyagé, et qui, n'y trouvant plus sens, se fait rat de bibliothèque, contraint au voyage immobile par un comportement d'anorexique mental. Roquentin, confronté à son vide intérieur et ayant cessé de compenser par un course extérieure, prend conscience du non-sens de sa vie, de la vie, et en conçoit... La nausée, sentiment morbide qui l'éloigne peu à peu de ses semblables et de lui-même, un peu comme dans le Horla ou la Métamorphose. Au départ donc, ce roman semble s'inspirer de l'univers de Kafka, du dégoût de Céline, et préfigurer l'absurde de Ionesco.
Mais La Nausée est bien avant tout l'une des premières oeuvres de Sartre, et donc l'un des tous premiers manifestes existentialistes, version négative de l'Etre et le Néant. Grâce à sa Nausée, Roquentin prend conscience du vide d'une vie d'apparence -celle vécu par les bourgeois honnis qui l'entourent-, mais aussi de la liberté fondamentale que constitue cette prise de conscience même. Si ni sa relation avec Anny ni ses échanges intellectuels avec l'Autodidacte -nouvelles distractions extérieures sans doute ? - ne parviennent à l'extraire de sa Nausée, c'est finalement l'écoute d'un morceau de jazz à la terrasse d'un café, et la vision d'un humain n'existant qu'à travers l'acte créatif, qui semblent consister en fin d'ouvrage un remède. Ainsi, si les "salauds" hédonistes sont définitivement exclus des espoirs sartriens, une autre forme d'humanisme semble se dessiner en fin de roman. le lecteur en sort provisoirement soulagé, car sentant bien que la réponse est un peu courte, et dans l'obligation morale de poursuivre le chemin philosophique de Sartre das ses oeuvres ultérieures, ou de bifurquer vers d'autres recherches de sens.
En conclusion, la Nausée rend compte d'une première intuition philosophique -mais déjà creusée depuis des années par l'auteur-, par le ressenti. Se situant dans une veine "dépressive" de l'expression littéraire reliant Céline à Houellebecq, l'ouvrage semble introduire la réflexion de Sartre d'abord par l'effacement des cadres convenus, et laisse le lecteur en suspens au bord du vide, avec un simple airbag dans les bras. A la différence d'ouvrages postérieurs plus intellectuellement construits, Sartre cherche à montrer sans ménagement, dans un style sobre et faussement détaché, mais surtout par le partage de perceptions et de sensations vraies, la contingence brute des choses et de l'être. Bien qu'on sente l'intention "professorale" derrière cette démonstration, il parvient, avec des mots simples et des images concrètes, non dépourvus d'une poésie empruntant à la fois au spleen Baudelairien et au surréalisme hallucinogène, à transmettre ce ressenti, et par suite, à faire partager sa quête de sens -et de non sens- au lecteur.
Comme pour de nombreux autres lecteurs, ce n'est pas mon ouvrage préféré de Sartre, parce que son théâtre est plus percutant et ses oeuvres ultérieures plus précises quant à sa pensée philosophique ; mais j'ai néanmoins apprécié cette version en négatif de l'Etre et le Néant, ainsi que son écriture romanesque, proche de Kafka et Huysmans.
Antoine Roquentin, célibataire, vit seul à Bouville. Il travaille à un ouvrage sur la vie du marquis de Rollebon et il vit de ses rentes.
Dans ce roman Sartre nous dit que Roquetin est un existant, un être qui existe. Il existe tout comme les pierres, les papillons, les tongs. L'existence reflue vers lui. Il existe, tout simplement.
le corps de l'existant ne doit pas être confondu avec son objectivité. L'objectivité de l'existant est sa transcendance ontologique. L'existence est le mode d'être de l'étant comme conscience d'être. Il n'y a pour un être qu'une façon d'exister, c'est qu'il ait conscience de son existantité, tout simplement.
L'homme est fondamentalement désir d'être, le désir est manque d'être mais un existant ne peut justifier son désir d'être sinon il s'objective, se choséifie, tout simplement...
Roquetin avait la nausée , il tournait en rond dans son petit appartement. Il gambergeait trop. Il se dit que l'existence c'est le néant qui se donne l'illusion d'être, le néant ne rend rien, il se néantise lui-même, pensa-t-il en s'angoissant. le rien n'est rien, tout simplement finit-t-il par se dire, soulagé. Il alla dans sa chambre...
L'existence précède l'essence se dit Roquetin en enlevant ses chaussettes...
Dans ce roman Sartre nous dit que Roquetin est un existant, un être qui existe. Il existe tout comme les pierres, les papillons, les tongs. L'existence reflue vers lui. Il existe, tout simplement.
le corps de l'existant ne doit pas être confondu avec son objectivité. L'objectivité de l'existant est sa transcendance ontologique. L'existence est le mode d'être de l'étant comme conscience d'être. Il n'y a pour un être qu'une façon d'exister, c'est qu'il ait conscience de son existantité, tout simplement.
L'homme est fondamentalement désir d'être, le désir est manque d'être mais un existant ne peut justifier son désir d'être sinon il s'objective, se choséifie, tout simplement...
Roquetin avait la nausée , il tournait en rond dans son petit appartement. Il gambergeait trop. Il se dit que l'existence c'est le néant qui se donne l'illusion d'être, le néant ne rend rien, il se néantise lui-même, pensa-t-il en s'angoissant. le rien n'est rien, tout simplement finit-t-il par se dire, soulagé. Il alla dans sa chambre...
L'existence précède l'essence se dit Roquetin en enlevant ses chaussettes...
Un livre que j'ai lu pendant des vacances d'une traite. C'est étrange de reconnaitre la pensée philosophique de Sartre, tout ce à quoi il a pensé durant sa vie, et de lire son bouquin dont le style est très éloigné de celui d'un bouquin de philo où chaque phrase nécessite une journée pour la comprendre. Ce livre est comme un journal intime d'une personne prise d'un mal être. Les réflexions font mouche. Et la lecture se fait comme un polar...
Citations et extraits (280)
Voir plus
Ajouter une citation
Quand on vit seul, on ne sait même plus ce que c’est que raconter : le vraisemblable disparaît en même tant que les amis. Les évènements aussi, on les laisse couler ; on voit surgir brusquement des gens qui parlent et qui s’en vont, on plonge dans des histoires sans queue, ni tête : on ferait un exécrable témoin.
"J'ai voulu que les moments de ma vie se suivent et s'ordonnent comme ceux d'une vie qu'on se rappelle.
Autant tenter d'attraper le temps par la queue".
Autant tenter d'attraper le temps par la queue".
Je sais que je ne rencontrerais plus jamais rien ni personne qui m'inspire de la passion. Tu sais, pour se mettre à aimer quelqu'un, c'est une entreprise. Il faut avoir une énergie, une générosité, un aveuglement... Il y a même un moment, tout au début, où il faut sauter par-dessus un précipice ; si on réfléchit, on ne le fait pas. Je sais que je ne sauterai plus jamais.
La chose, qui attendait, s'est alertée, elle a fondu sur moi, elle se coule en moi, j'en suis plein. - Ce n'est rien: la Chose, c'est moi. L'existence, libérée, dégagée, reflue sur moi. J'existe.
J'existe. C'est doux, si doux, si lent. Et léger: on dirait que ça tient en l'air tout seul. Ça remue. Ce sont des effleurements partout qui fondent et s'évanouissent. Tout doux, tout doux. Il y a de l'eau mousseuse dans ma bouche. Je l'avale, elle glisse dans ma gorge, elle me caresse - et la voila qui renaît dans ma bouche, j'ai dans la bouche à perpétuité une petite mare d'eau blanchâtre - discrète - qui frôle ma langue. Et cette mare, c'est encore moi. Et la langue. Et la gorge, c'est moi.
Je vois ma main, qui s'épanouit sur la table. Elle vit - c'est moi. Elle s'ouvre, les doigts se déploient et pointent. Elle est sur le dos. Elle me montre son ventre gras. Elle a l'air d'une bête à la renverse. Les doigts, ce sont les pattes. Je m'amuse à les faire remuer, très vite, comme les pattes d'un crabe qui est tombé sur le dos. Le crabe est mort: les pattes se recroquevillent, se ramènent sur le ventre de ma main. Je vois les ongles - la seule chose de moi qui ne vit pas. Et encore. Ma main se retourne, s'étale à plat ventre, elle m'offre à présent son dos. Un dos argenté, un peu brillant - on dirait un poisson, s'il n'y avait pas les poils roux à la naissance des phalanges. Je sens ma main. C'est moi, ces deux bêtes qui s'agitent au bout de mes bras. Ma main gratte une de ses pattes, avec l'ongle d'une autre patte; je sens son poids sur la table qui n'est pas moi. C'est long, long, cette impression de poids, ça ne passe pas. Il n'y a pas de raison pour que ça passe. A la longue, c'est intolérable... Je retire ma main, je la mets dans ma poche. Mais je sens tout de suite, à travers l'étoffe, la chaleur de ma cuisse. Aussitôt, je fais sauter ma main de ma poche; je la laisse pendre contre le dossier de la chaise. Maintenant, je sens son poids au bout de mon bras. Elle tire un peu, à peine, mollement, moelleusement, elle existe. Je n'insiste pas: ou que je la mette, elle continuera d'exister et je continuerai de sentir qu'elle existe; je ne peux pas la supprimer, ni supprimer le reste de mon corps, la chaleur humide qui salit ma chemise, ni toute cette graisse chaude qui tourne paresseusement comme si on la remuait à la cuiller, ni toutes les sensations qui se promènent là-dedans, qui vont et viennent, remontent de mon flanc à mon aisselle ou bien qui végètent doucement, du matin jusqu'au soir, dans leur coin habituel.
Je me lève en sursaut: si seulement je pouvais m'arrêter de penser, ça irait déjà mieux. Les pensées, c'est ce qu'il y a de plus fade. Plus fade encore que de la chair. Ça s'étire à n'en plus finir et ça laisse un drôle de goût. Et puis il y a les mots, au-dedans des pensées, les mots inachevés, les ébauches de phrases qui reviennent tout le temps: "Il faut que je fini... J'ex... Mort... M. de Roll est mort... Je ne suis pas... J'ex..." Ça va, ça va... et ça ne finit jamais. C'est pis que le reste parce que je me sens responsable et complice. Par exemple, cette espèce de rumination douloureuse:
j'existe, c'est moi qui l'entretiens. Moi. Le corps, ça vit tout seul, une fois que ça a commencé. Mais la pensée, c'est moi qui la continue, qui la déroule. J'existe. Je pense que j'existe. Oh! le long serpentin, ce sentiment d'exister - et je le déroule, tout doucement... Si je pouvais m'empêcher de penser! J'essaie, je réussis : il me semble que ma tête s'emplit de fumée... et voila que ça recommence:
"Fumée... ne pas penser... Je ne veux pas penser... Je pense que je ne veux pas penser. Il ne faut pas que je pense que je ne veux pas penser. Parce que c'est encore une pensée."
On n'en finira donc jamais?
Ma pensée, c'est moi: voilà pourquoi je ne peux pas m'arrêter. J'existe par ce que je pense... et je ne peux pas m'empêcher de penser. En ce moment même - c'est affreux - si j'existe, c'est parce que j'ai horreur d'exister. C'est moi, c'est moi qui me tire du néant auquel j'aspire: la haine, le dégoût d'exister, ce sont autant de manières de me faire exister, de m'enfoncer dans l'existence. Les pensées naissent par derrière moi comme un vertige, je les sens naître derrière ma tête... si je cède, elles vont venir la devant, entre mes yeux - et je cède toujours, la pensée grossit, grossit, et la voilà, l'immense, qui me remplit tout entier et renouvelle mon existence. (...)
Je suis, j'existe, je pense donc je suis; je suis parce que je pense, pourquoi est-ce que je pense? je ne veux plus penser, je suis parce que je pense que je ne veux pas être, je pense que je... parce que... pouah!
J'existe. C'est doux, si doux, si lent. Et léger: on dirait que ça tient en l'air tout seul. Ça remue. Ce sont des effleurements partout qui fondent et s'évanouissent. Tout doux, tout doux. Il y a de l'eau mousseuse dans ma bouche. Je l'avale, elle glisse dans ma gorge, elle me caresse - et la voila qui renaît dans ma bouche, j'ai dans la bouche à perpétuité une petite mare d'eau blanchâtre - discrète - qui frôle ma langue. Et cette mare, c'est encore moi. Et la langue. Et la gorge, c'est moi.
Je vois ma main, qui s'épanouit sur la table. Elle vit - c'est moi. Elle s'ouvre, les doigts se déploient et pointent. Elle est sur le dos. Elle me montre son ventre gras. Elle a l'air d'une bête à la renverse. Les doigts, ce sont les pattes. Je m'amuse à les faire remuer, très vite, comme les pattes d'un crabe qui est tombé sur le dos. Le crabe est mort: les pattes se recroquevillent, se ramènent sur le ventre de ma main. Je vois les ongles - la seule chose de moi qui ne vit pas. Et encore. Ma main se retourne, s'étale à plat ventre, elle m'offre à présent son dos. Un dos argenté, un peu brillant - on dirait un poisson, s'il n'y avait pas les poils roux à la naissance des phalanges. Je sens ma main. C'est moi, ces deux bêtes qui s'agitent au bout de mes bras. Ma main gratte une de ses pattes, avec l'ongle d'une autre patte; je sens son poids sur la table qui n'est pas moi. C'est long, long, cette impression de poids, ça ne passe pas. Il n'y a pas de raison pour que ça passe. A la longue, c'est intolérable... Je retire ma main, je la mets dans ma poche. Mais je sens tout de suite, à travers l'étoffe, la chaleur de ma cuisse. Aussitôt, je fais sauter ma main de ma poche; je la laisse pendre contre le dossier de la chaise. Maintenant, je sens son poids au bout de mon bras. Elle tire un peu, à peine, mollement, moelleusement, elle existe. Je n'insiste pas: ou que je la mette, elle continuera d'exister et je continuerai de sentir qu'elle existe; je ne peux pas la supprimer, ni supprimer le reste de mon corps, la chaleur humide qui salit ma chemise, ni toute cette graisse chaude qui tourne paresseusement comme si on la remuait à la cuiller, ni toutes les sensations qui se promènent là-dedans, qui vont et viennent, remontent de mon flanc à mon aisselle ou bien qui végètent doucement, du matin jusqu'au soir, dans leur coin habituel.
Je me lève en sursaut: si seulement je pouvais m'arrêter de penser, ça irait déjà mieux. Les pensées, c'est ce qu'il y a de plus fade. Plus fade encore que de la chair. Ça s'étire à n'en plus finir et ça laisse un drôle de goût. Et puis il y a les mots, au-dedans des pensées, les mots inachevés, les ébauches de phrases qui reviennent tout le temps: "Il faut que je fini... J'ex... Mort... M. de Roll est mort... Je ne suis pas... J'ex..." Ça va, ça va... et ça ne finit jamais. C'est pis que le reste parce que je me sens responsable et complice. Par exemple, cette espèce de rumination douloureuse:
j'existe, c'est moi qui l'entretiens. Moi. Le corps, ça vit tout seul, une fois que ça a commencé. Mais la pensée, c'est moi qui la continue, qui la déroule. J'existe. Je pense que j'existe. Oh! le long serpentin, ce sentiment d'exister - et je le déroule, tout doucement... Si je pouvais m'empêcher de penser! J'essaie, je réussis : il me semble que ma tête s'emplit de fumée... et voila que ça recommence:
"Fumée... ne pas penser... Je ne veux pas penser... Je pense que je ne veux pas penser. Il ne faut pas que je pense que je ne veux pas penser. Parce que c'est encore une pensée."
On n'en finira donc jamais?
Ma pensée, c'est moi: voilà pourquoi je ne peux pas m'arrêter. J'existe par ce que je pense... et je ne peux pas m'empêcher de penser. En ce moment même - c'est affreux - si j'existe, c'est parce que j'ai horreur d'exister. C'est moi, c'est moi qui me tire du néant auquel j'aspire: la haine, le dégoût d'exister, ce sont autant de manières de me faire exister, de m'enfoncer dans l'existence. Les pensées naissent par derrière moi comme un vertige, je les sens naître derrière ma tête... si je cède, elles vont venir la devant, entre mes yeux - et je cède toujours, la pensée grossit, grossit, et la voilà, l'immense, qui me remplit tout entier et renouvelle mon existence. (...)
Je suis, j'existe, je pense donc je suis; je suis parce que je pense, pourquoi est-ce que je pense? je ne veux plus penser, je suis parce que je pense que je ne veux pas être, je pense que je... parce que... pouah!
Ces petits bonhommes noirs que je distingue au loin, dans une heure je serais l'un d'eux. Comme je me sens loin d'eux du haut de cette colline. Il me semble que j'appartiens à une autre espèce. ils sortent des bureaux, après leur journée de travail, ils regardent les maisons et les squares d'un air satisfait, ils pensent que c'est leur ville. Ils n'ont pas peur, ils se sentent chez eux. Ils n’ont jamais vu que l'eau apprivoisée qui coule des robinets, que la lumière qui jaillit des ampoules quand on appuie sur l'interrupteur, que les arbres métis, bâtards, qu'on soutient avec des fourches. Ils ont la preuve cent fois par jour, que tout se fait par mécanisme, que le monde obéit à des lois fixes et immuables. Les corps abandonnés dans le vide tombent tous à la même vitesse, le jardin public est fermé tous les jours à seize heures en hiver, à dix-huit heure en été, le plomb fond à 335°, le dernier tramway part de l'Hôtel de Ville à vingt-trois heures cinq. Ils sont paisibles, un peu moroses, ils pensent à Demain, c'est à dire, simplement, à un nouvel aujourd'hui ; les villes ne disposent que d'une seule journée qui revient toute pareille à chaque matin. A peine pomponne-t-on un peu, les dimanches. Les imbéciles. Ça me répugne, de penser que je vais revoir leur faces épaisses et rassurées. Ils légifèrent, ils écrivent des romans populistes, ils se marient, ils ont l'extrême sottise de faire des enfants. Cependant, la grande nature vague s'est glissée dans leur ville, elle s'est infiltrée, partout, dans leurs maisons, dans leurs bureaux, en eux-mêmes. Elle ne bouge pas, elle se tient tranquille et eux, ils sont en plein dedans, ils la respirent et ils ne la voient pas, ils s’imaginent qu'elle est dehors, à vingt lieues de la ville. Je la vois, moi, cette nature, je la vois... Je sais que sa soumission est paresse, je sait qu'elle n'a pas de lois : ce qu'ils prennent pour sa constance... Elle n'a que des habitudes et elle peut en changer demain. S'il arrivait quelque chose ? Si tout d'un coup elle se mettait à palpiter ? Alors ils s'apercevraient qu'elle est là et il leur semblerait que leur cœur va craquer. Alors de quoi leur serviraient leurs digues et leurs remparts et leurs centrales électriques et leurs haut fourneaux et leurs marteau-pilons ? Cela peut arriver n'importe quand, tout de suite peut-être : les présages sont là. Ou alors rien de tout cela n'arrivera, il ne se produira aucun changement appréciable, mais les gens, un matin, en ouvrant leur persiennes, seront surpris par une espèce de sens affreux, lourdement posé sur les choses et qui aura l'air d'attendre. Rien que cela : mais pour peu que cela dure quelque temps, il y aura des suicides par centaines. Eh bien oui ! Que cela change un peu, pour voir, je ne demande pas mieux. On en verra d'autres, alors, plongés brusquement dans la solitude. Des hommes tout seuls, entièrement seuls avec d'horribles monstruosités, courront par les rues, passeront lourdement devant moi, les yeux fixes, fuyant leurs maux et les emportant avec soi, la bouche ouverte, avec leur langue-insecte qui battra des ailes. Alors j'éclaterais de rire, même si mon corps est couvert de sales croutes louches qui s'épanouissent en fleurs de chair, en violettes, en renoncules. Je m'adosserai à un mur et je leur crierais au passage : "Qu'avez-vous fait de votre science ? Qu'avez-vous fait de votre humanisme ? Où est votre dignité de roseau pensant ?" Je n'aurais pas peur - ou du moins pas plus qu'en ce moment. Est-ce que ce ne sera pas toujours de l'existence, des variations sur l'existence ? Tous ces yeux qui mangeront lentement un visage, ils seront de trop, sans doute, mais pas plus que les deux premiers. C'est de l'existence que j'ai peur.
Videos de Jean-Paul Sartre (207)
Voir plusAjouter une vidéo
Le 6 mars 2024, le philosophe et académicien Jean-Luc Marion était l'invité de la "Fabrique des idées", la série de masterclass que vous propose Philosophie magazine. Spécialiste de Husserl, le phénoménologue a tracé une petite généalogie de ce courant de pensée philosophique, n'hésitant pas à tacler Jean-Paul Sartre, qui n'est "pas un grand phénoménologue", selon lui.
Pour assister à toutes nos "Fabriques des idées" revoir ces masterclass librement, abonnez-vous à partir de 2€/mois, sans engagement
https://abo.philomag.com/loggia/site/philomag/abo-new/fr/abo/index.html
Pour assister à toutes nos "Fabriques des idées" revoir ces masterclass librement, abonnez-vous à partir de 2€/mois, sans engagement
https://abo.philomag.com/loggia/site/philomag/abo-new/fr/abo/index.html
autres livres classés : existentialismeVoir plus
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Jean-Paul Sartre (103)
Voir plus
Quiz
Voir plus
L'oeuvre littéraire et théâtrale de Jean-Paul Sartre
Dans Huis Clos, l'enfer c'est...
Les oeufs
Les autres
La guerre
Les voisins
8 questions
348 lecteurs ont répondu
Thème :
Jean-Paul SartreCréer un quiz sur ce livre348 lecteurs ont répondu