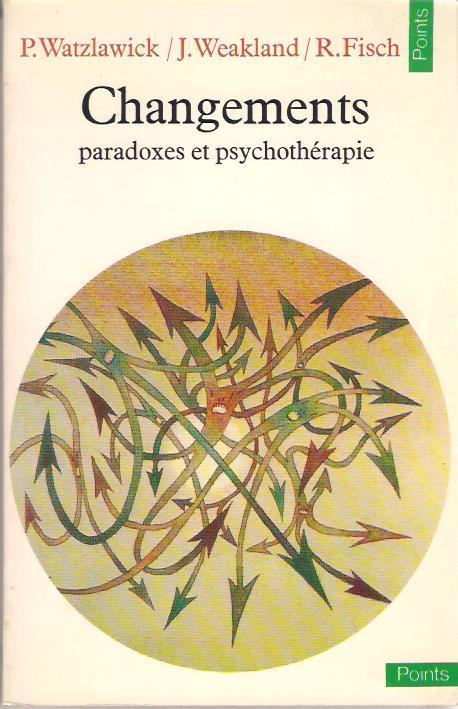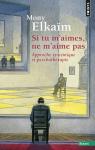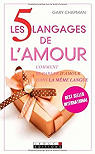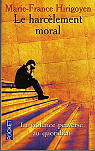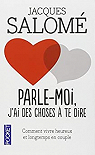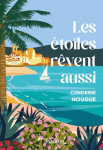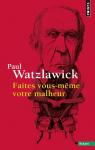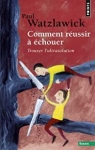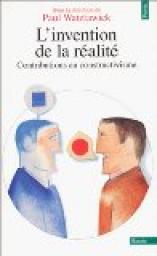Paul WatzlawickJohn H. WeaklandRichard Fisch
Pierre Furlan (Autre)/5 63 notes
Pierre Furlan (Autre)/5 63 notes
Résumé :
Anthropologie
Sciences humaines
Changements, paradoxes et psychothérapie
Comment, dans les relations humaines, les impasses apparaissent-elles ? Qu'est-ce qui fait que, souvent, nos tentatives de provoquer un changement ne font que nous emmurer dans un jeu sans fin ? Il y a des changements qui ne sont que source de la permanence. Dire " plus ça change, plus c'est la même chose " équivaut, si l'on prend les choses par l'autre bout... >Voir plus
Sciences humaines
Changements, paradoxes et psychothérapie
Comment, dans les relations humaines, les impasses apparaissent-elles ? Qu'est-ce qui fait que, souvent, nos tentatives de provoquer un changement ne font que nous emmurer dans un jeu sans fin ? Il y a des changements qui ne sont que source de la permanence. Dire " plus ça change, plus c'est la même chose " équivaut, si l'on prend les choses par l'autre bout... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après ChangementsVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (7)
Voir plus
Ajouter une critique
Sans doute une bonne introduction aux auteurs de l'école de Palo-Alto, Changements ouvre des perspectives nouvelles pour qui s'intéresse à la communication, à la psychologie, ou aux systèmes humains.
Les auteurs présentent tout d'abord la théorie des groupes issue des travaux d'Evariste Galois au début du XIXe siècle, ainsi que la théorie des types logiques. Pour qui n'est pas féru de mathématiques, il faut s'accrocher un peu, mais la présentation de ces deux théories sur lesquelles s'appuie le propos du livre est accessible.
Pour résumer très grossièrement, les changements qui ont lieu à l'intérieur des groupes ne remettent pas en cause le fonctionnement du groupe lui-même (changement 1). Un changement conséquent doit se produire à un niveau logique supérieur, et à l'extérieur du groupe (changement 2).
Un exemple très simple, relier un groupe de neuf points en quatre droites, sans lever le crayon, démontre l'importance des prémisses de nos raisonnements, qui nous conduisent à la recherche de solutions parfois impossibles, ou illusoires. Il faut donc "penser en dehors de la boîte" diraient les anglo-saxons, ce qui est facile à dire, mais pas toujours à faire.
Les auteurs s'attachent également à donner des exemples de thérapies brèves, ou des instructions paradoxales (un peu sur le modèle des koans du Zen japonais) amènent à des modifications de comportement, parfois des prises de conscience, sans s'appesantir sur le "pourquoi". C'est sur le "quoi", "ici et maintenant" autrement dit sur une situation concrète qu'il est possible d'agir pour amener à un réel changement.
Les auteurs présentent tout d'abord la théorie des groupes issue des travaux d'Evariste Galois au début du XIXe siècle, ainsi que la théorie des types logiques. Pour qui n'est pas féru de mathématiques, il faut s'accrocher un peu, mais la présentation de ces deux théories sur lesquelles s'appuie le propos du livre est accessible.
Pour résumer très grossièrement, les changements qui ont lieu à l'intérieur des groupes ne remettent pas en cause le fonctionnement du groupe lui-même (changement 1). Un changement conséquent doit se produire à un niveau logique supérieur, et à l'extérieur du groupe (changement 2).
Un exemple très simple, relier un groupe de neuf points en quatre droites, sans lever le crayon, démontre l'importance des prémisses de nos raisonnements, qui nous conduisent à la recherche de solutions parfois impossibles, ou illusoires. Il faut donc "penser en dehors de la boîte" diraient les anglo-saxons, ce qui est facile à dire, mais pas toujours à faire.
Les auteurs s'attachent également à donner des exemples de thérapies brèves, ou des instructions paradoxales (un peu sur le modèle des koans du Zen japonais) amènent à des modifications de comportement, parfois des prises de conscience, sans s'appesantir sur le "pourquoi". C'est sur le "quoi", "ici et maintenant" autrement dit sur une situation concrète qu'il est possible d'agir pour amener à un réel changement.
Un thérapeute doit à un moment donné ou l'autre passer par cette lecture. Il ouvre à beaucoup d'autres pensées, visions du travail de compréhension de l'humain et du relationnel. Et puis, bon sang, ces paradoxes, faut en faire quelque chose de constructif !
Quelques éléments :
La thérapie est une façon de faciliter l'apparition des courants de changement qui tourbillonnaient dans le patient et à l'intérieur de sa famille. Il s'agit de courants qui ont besoin d'un geste thérapeutique « inattendu », « illogique » et « soudain » pour émerger.
Il s'agit de voir comment le bon sens et la « logique » conduisent souvent à l'échec - ce qui semble paradoxal -, tandis qu'un comportement « illogique » et « déraisonnable », comme celui des assiégés d'Hosterwitz, produit le changement recherché.
Le problème n'est pas d'éviter l'influence et la manipulation, mais de les comprendre mieux et de les utiliser dans l'intérêt du patient.
Quelques éléments :
La thérapie est une façon de faciliter l'apparition des courants de changement qui tourbillonnaient dans le patient et à l'intérieur de sa famille. Il s'agit de courants qui ont besoin d'un geste thérapeutique « inattendu », « illogique » et « soudain » pour émerger.
Il s'agit de voir comment le bon sens et la « logique » conduisent souvent à l'échec - ce qui semble paradoxal -, tandis qu'un comportement « illogique » et « déraisonnable », comme celui des assiégés d'Hosterwitz, produit le changement recherché.
Le problème n'est pas d'éviter l'influence et la manipulation, mais de les comprendre mieux et de les utiliser dans l'intérêt du patient.
Un peu difficile de rentrer dedans
Mais quel génie !
Une grande découverte de mes lectures d'étudiant
Que m'en reste t -il 20 ans après (snif !)
TOUT
Donc à lire, pour mieux vivre les conflits, les paradoxes, les noeuds dans la tête ...
NB : très belle analogie mathématique sur la théorie des Groupes
Mais quel génie !
Une grande découverte de mes lectures d'étudiant
Que m'en reste t -il 20 ans après (snif !)
TOUT
Donc à lire, pour mieux vivre les conflits, les paradoxes, les noeuds dans la tête ...
NB : très belle analogie mathématique sur la théorie des Groupes
Le livre n'est pas "classé" en philosophie et pourtant sa portée philosophique est manifeste, puisque l'ouvrage cite beaucoup Wittgenstein et sa conception du langage et la théorie des types logiques. Sa portée psychothérapique est évidente aussi. C'est cette relation entre logique et psychothérapie qui est passionnante. le dernier chapitre présente plusieurs cas.
Je l'ai trouvé dans la bibliothèque du salon de mon hôpital et je ne regrette pas.
Je l'ai trouvé dans la bibliothèque du salon de mon hôpital et je ne regrette pas.
A lire absolument , avant de se décider à faire une psychanalyse...
Citations et extraits (27)
Voir plus
Ajouter une citation
Le syndrome d’Utopie
Le recours à l’extrémisme pour régler les problèmes humains survient le plus souvent, semble-t-il, à la suite de la conviction d’avoir trouvé (ou même de pouvoir trouver) la solution définitive, totale. Celui qui s’attache à cette croyance est, dès lors, logiquement forcé de vouloir mettre en pratique sa solution – de fait, il se renierait lui-même s’il n’essayait pas. Le comportement qui en découle – nous l’appellerons syndrome d’utopie – prend l’une des trois formes suivantes.
La première forme pourrait être qualifiée d’« introjective ». Ses manifestations appellent une définition plus psychiatrique que sociale, car elles proviennent d’un profond et douloureux sentiment d’impuissance personnelle à atteindre le but qu’on s’est posé. L’acte-même de se poser un but utopique crée une situation dans laquelle, vraisemblablement, l’inaccessibilité du but ne sera pas imputée à sa nature utopique, mais plutôt à l’impuissance du sujet qui, par exemple, se dira : alors que ma vie devrait être remplie d’expériences et de joies, je suis plongé dans la banalité et l’ennui ; je devrais éprouver des sentiments intenses, mais je suis incapable de les faire naître en moi. L’abandon, la dépression, le retrait, peut-être le suicide, voilà quelques résultats prévisibles de cette impasse. [...]
Cette première forme du syndrome d’utopie admet d’autres conséquences, parmi lesquelles on trouve l’aliénation, le divorce, le nihilisme. L’alcoolisme et la toxicomanie s’y rattachent souvent ; les euphories passagères qu’ils procurent sont évidemment suivies d’un retour à une réalité encore plus froide et grise, retour qui rend encore plus attrayant l’abandon existentiel.
La deuxième forme du syndrome d’utopie est beaucoup moins dramatique et peut même posséder un certain charme. Elle fait sien le célèbre aphorisme de Robert Louis Stevenson (probablement tiré d’un proverbe japonais) : « Il vaut mieux voyager avec espoir qu’arriver à destination. » L’utopiste, ici, au lieu de condamner son impuissance à réaliser un changement utopique, choisit une manière innocente et presque enjouée de temporiser. Comme le but est lointain, le voyage sera long, et un long voyage exige de longs préparatifs. La question délicate de savoir si le but est accessible, ou s’il vaut la peine de faire un tel chemin, n’a donc pas besoin d’être posée pour l’instant. Dans son poème, « Ithaque », le poète grec Constantinos Cavafys dépeint cette attitude. Priez pour que votre route soit longue, conseille-t-il au voyageur qui s’embarque, pour que votre voyage soit rempli d’aventures et d’événements. Gardez Ithaque présente à l’esprit, car c’est là que vous êtes prédestinés à arriver – mais ne vous hâtez pas, prenez plutôt de nombreuses années. Soyez très vieux quand vous jetterez l’ancre à Ithaque. Cavafys propose une solution qui n’est pas utopique : vous entrez dans des ports que vous n’avez jamais connus, et, riches de tout ce que vous avez acquis en chemin, n’attendez pas d’Ithaque qu’elle vous donne la richesse. Ithaque vous a donné votre merveilleux voyage, sans elle vous ne seriez pas parti. […] George Bernard Shaw a, exprimé la même pensée en termes plus sarcastiques : "Dans la vie, il y a deux tragédies. L’une est de ne pas réaliser ses désirs. L’autre est de les réaliser." […]
La troisième forme du syndrome d’utopie est essentiellement « projective ». Elle est constituée principalement par une attitude de rigueur morale reposant sur la conviction d’avoir trouvé la vérité. Cette attitude s’alimente du missionarisme qui en découle, c’est-à-dire de la responsabilité de transformer le monde. On s’y essaie d’abord par la persuasion, avec l’espoir que la vérité, une fois rendue sensible, apparaîtra forcément à tous les hommes de bonne volonté. Par conséquent, ceux qui ne veulent pas se convertir, ou même refusent d’écouter, sont obligatoirement de mauvaise foi : leur destruction, pour le bien de l’humanité, peut même, en dernier ressort, être justifiée.
[…]
Tous les aspects du syndrome d’utopie ont ceci en commun : les prémisses sur lesquelles le syndrome se fonde sont considérées comme plus réelles que la réalité. Nous voulons dire par là que lorsqu’un individu (ou un groupe, ou toute une société) s’efforce d’ordonner son univers en accord avec sa prémisse et que son effort échoue, il ne va pas, normalement, réexaminer sa prémisse pour savoir si elle ne recèle pas d’élément absurde ou irréel, mais, nous l’avons vu, il va accuser l’extérieur (par exemple, la société) ou sa propre incapacité. Il ne peut pas supporter l’idée que ses prémisses soient en défaut, car, pour lui, elles constituent la vérité, la réalité. Par exemple, disent les maoïstes, si, après plus d’un demi-siècle, la version soviétique du marxisme n’a pas réussi à créer la société idéale sans classes, c’est parce que la pure doctrine est tombée dans des mains impures, et non parce que, peut-être, le marxisme contient quelque chose de fondamentalement faux. On rencontre fréquemment la même position chez les chercheurs dont les travaux restent improductifs : leur solution consiste souvent à demander plus d’argent, à proposer un plus grand projet, en un mot, à faire « plus de la même chose ».
Le recours à l’extrémisme pour régler les problèmes humains survient le plus souvent, semble-t-il, à la suite de la conviction d’avoir trouvé (ou même de pouvoir trouver) la solution définitive, totale. Celui qui s’attache à cette croyance est, dès lors, logiquement forcé de vouloir mettre en pratique sa solution – de fait, il se renierait lui-même s’il n’essayait pas. Le comportement qui en découle – nous l’appellerons syndrome d’utopie – prend l’une des trois formes suivantes.
La première forme pourrait être qualifiée d’« introjective ». Ses manifestations appellent une définition plus psychiatrique que sociale, car elles proviennent d’un profond et douloureux sentiment d’impuissance personnelle à atteindre le but qu’on s’est posé. L’acte-même de se poser un but utopique crée une situation dans laquelle, vraisemblablement, l’inaccessibilité du but ne sera pas imputée à sa nature utopique, mais plutôt à l’impuissance du sujet qui, par exemple, se dira : alors que ma vie devrait être remplie d’expériences et de joies, je suis plongé dans la banalité et l’ennui ; je devrais éprouver des sentiments intenses, mais je suis incapable de les faire naître en moi. L’abandon, la dépression, le retrait, peut-être le suicide, voilà quelques résultats prévisibles de cette impasse. [...]
Cette première forme du syndrome d’utopie admet d’autres conséquences, parmi lesquelles on trouve l’aliénation, le divorce, le nihilisme. L’alcoolisme et la toxicomanie s’y rattachent souvent ; les euphories passagères qu’ils procurent sont évidemment suivies d’un retour à une réalité encore plus froide et grise, retour qui rend encore plus attrayant l’abandon existentiel.
La deuxième forme du syndrome d’utopie est beaucoup moins dramatique et peut même posséder un certain charme. Elle fait sien le célèbre aphorisme de Robert Louis Stevenson (probablement tiré d’un proverbe japonais) : « Il vaut mieux voyager avec espoir qu’arriver à destination. » L’utopiste, ici, au lieu de condamner son impuissance à réaliser un changement utopique, choisit une manière innocente et presque enjouée de temporiser. Comme le but est lointain, le voyage sera long, et un long voyage exige de longs préparatifs. La question délicate de savoir si le but est accessible, ou s’il vaut la peine de faire un tel chemin, n’a donc pas besoin d’être posée pour l’instant. Dans son poème, « Ithaque », le poète grec Constantinos Cavafys dépeint cette attitude. Priez pour que votre route soit longue, conseille-t-il au voyageur qui s’embarque, pour que votre voyage soit rempli d’aventures et d’événements. Gardez Ithaque présente à l’esprit, car c’est là que vous êtes prédestinés à arriver – mais ne vous hâtez pas, prenez plutôt de nombreuses années. Soyez très vieux quand vous jetterez l’ancre à Ithaque. Cavafys propose une solution qui n’est pas utopique : vous entrez dans des ports que vous n’avez jamais connus, et, riches de tout ce que vous avez acquis en chemin, n’attendez pas d’Ithaque qu’elle vous donne la richesse. Ithaque vous a donné votre merveilleux voyage, sans elle vous ne seriez pas parti. […] George Bernard Shaw a, exprimé la même pensée en termes plus sarcastiques : "Dans la vie, il y a deux tragédies. L’une est de ne pas réaliser ses désirs. L’autre est de les réaliser." […]
La troisième forme du syndrome d’utopie est essentiellement « projective ». Elle est constituée principalement par une attitude de rigueur morale reposant sur la conviction d’avoir trouvé la vérité. Cette attitude s’alimente du missionarisme qui en découle, c’est-à-dire de la responsabilité de transformer le monde. On s’y essaie d’abord par la persuasion, avec l’espoir que la vérité, une fois rendue sensible, apparaîtra forcément à tous les hommes de bonne volonté. Par conséquent, ceux qui ne veulent pas se convertir, ou même refusent d’écouter, sont obligatoirement de mauvaise foi : leur destruction, pour le bien de l’humanité, peut même, en dernier ressort, être justifiée.
[…]
Tous les aspects du syndrome d’utopie ont ceci en commun : les prémisses sur lesquelles le syndrome se fonde sont considérées comme plus réelles que la réalité. Nous voulons dire par là que lorsqu’un individu (ou un groupe, ou toute une société) s’efforce d’ordonner son univers en accord avec sa prémisse et que son effort échoue, il ne va pas, normalement, réexaminer sa prémisse pour savoir si elle ne recèle pas d’élément absurde ou irréel, mais, nous l’avons vu, il va accuser l’extérieur (par exemple, la société) ou sa propre incapacité. Il ne peut pas supporter l’idée que ses prémisses soient en défaut, car, pour lui, elles constituent la vérité, la réalité. Par exemple, disent les maoïstes, si, après plus d’un demi-siècle, la version soviétique du marxisme n’a pas réussi à créer la société idéale sans classes, c’est parce que la pure doctrine est tombée dans des mains impures, et non parce que, peut-être, le marxisme contient quelque chose de fondamentalement faux. On rencontre fréquemment la même position chez les chercheurs dont les travaux restent improductifs : leur solution consiste souvent à demander plus d’argent, à proposer un plus grand projet, en un mot, à faire « plus de la même chose ».
Les utopies positives impliquent un monde « sans problèmes », les négatives un monde « sans solutions ». Les deux ont ceci de semblable qu’elles définissent les difficultés et plaisirs normaux de la vie comme des anomalies.
Une des erreurs les plus courantes concernant le changement est de conclure que, si quelque chose est mauvais, son contraire est nécessairement bon. Une femme qui divorce d'avec un mari "faible" pour en épouser un "fort" découvre souvent, pour son malheur, que son deuxième mariage, qui devrait être exactement le contraire du premier, est en fait plutôt semblable. L'invocation du contraste puissant a toujours constitué un instrument de prédilection pour la propagande des politiciens et des dictateurs. "Le national-socialisme ou le chaos bolchévique ?" demandait avec arrogance une affiche nazie, faisant croire par là que seule existait cette alternative et que, pour tous les hommes de bonne volonté, le choix était évident. "Erdäpfel oder Kartoffel ?" (Patates ou pommes de terre ?) répondait une petite bande de papier qu'un groupe clandestin colla sur des centaines de ces grandes affiches, déclenchant ainsi une enquête massive de la Gestapo.
L'étrange interdépendance des contraire était déjà bien connue par Héraclite, le grand philosophe du changement, qui l'appelait enantiodromia.
L'étrange interdépendance des contraire était déjà bien connue par Héraclite, le grand philosophe du changement, qui l'appelait enantiodromia.
Dans une large mesure, le processus de socialisation consiste à enseigner aux jeunes ce qu'ils ne doivent pas voir, ni entendre, ni sentir ou dire.
Théorie des types logiques :
… commence elle aussi avec le concept de collection « d’objets » qui sont rassemblés selon une certaine propriété qu’ils ont en commun. Les constituants de cette totalité sont ici appelés membres, et la totalité porte le nom de classe.
Axiome : « ce qui comprends tous les membres d’une collection ne peut être un membre de la collection. »
Distinction capitale entre « membre » et « classe »… une classe ne peut être membre d’elle-même.
… les dangers de confusion de niveaux sont omniprésents, avec leurs conséquences embarrassantes.
… le changement implique toujours le niveau immédiatement supérieur : pour passer, p. ex., de l’immobilité au mouvement, il faut faire un pas en dehors du cadre théorique de l’immobilité. A l’intérieur de ce cadre, le concept de mouvement ne peut pas apparaître ; il n’est donc pas question de l’y étudier, et toute tentative qui vise à passer outre cet axiome fondamental de la théorie des types logiques aboutit à la confusion paradoxale.
Wittgenstein : « les problèmes philosophiques apparaissent quand le langage part en vacances » … Malheureusement, il est souvent malaisé, dans le langage naturel, de différencier nettement entre membre et classe.
Deux conclusions importantes : a) les niveaux logiques doivent être rigoureusement séparés si l’on ne veut pas tomber dans le paradoxe et la confusion, et b) le passage d’un niveau au niveau supérieur (c-à-d. de membre à classe) comporte une mutation, un saut, une discontinuité ou une transformation – en un mot, un changement – du plus grand intérêt théorique de la plus haute importance pratique, car il permet de sortir du système.
… existence de deux sortes de changements : l’un prend place à l’intérieur d’un système donné qui, lui, reste inchangé, l’autre modifie le système lui-même.
Ex. le rêveur : en proie à un cauchemar, il a la possibilité de faire plusieurs choses en rêve : courir, se cacher, se battre, hurler… mais aucun changement issu d’une de ces actions ne pourrait mettre fin au cauchemar. La seule possibilité pour sortir d’un rêve comporte un changement allant du rêve à l’état de veille. Il est évident que l’état de veille ne fait plus partie du rêve, mais représente un changement complet. Ce changement-ci est donc un changement de changement dont Aristote niait si catégoriquement l’existence.
… les groupes ne restent invariants qu’au niveau du changement 1, mais peuvent changer au niveau du changement 2 (c’est-à-dire au niveau où s’effectuent les changements dans les règles gouvernant leur structure ou leur ordre interne.) … la théorie des groupes et la théorie des types logiques ne sont pas seulement compatibles, mais complémentaires.
… commence elle aussi avec le concept de collection « d’objets » qui sont rassemblés selon une certaine propriété qu’ils ont en commun. Les constituants de cette totalité sont ici appelés membres, et la totalité porte le nom de classe.
Axiome : « ce qui comprends tous les membres d’une collection ne peut être un membre de la collection. »
Distinction capitale entre « membre » et « classe »… une classe ne peut être membre d’elle-même.
… les dangers de confusion de niveaux sont omniprésents, avec leurs conséquences embarrassantes.
… le changement implique toujours le niveau immédiatement supérieur : pour passer, p. ex., de l’immobilité au mouvement, il faut faire un pas en dehors du cadre théorique de l’immobilité. A l’intérieur de ce cadre, le concept de mouvement ne peut pas apparaître ; il n’est donc pas question de l’y étudier, et toute tentative qui vise à passer outre cet axiome fondamental de la théorie des types logiques aboutit à la confusion paradoxale.
Wittgenstein : « les problèmes philosophiques apparaissent quand le langage part en vacances » … Malheureusement, il est souvent malaisé, dans le langage naturel, de différencier nettement entre membre et classe.
Deux conclusions importantes : a) les niveaux logiques doivent être rigoureusement séparés si l’on ne veut pas tomber dans le paradoxe et la confusion, et b) le passage d’un niveau au niveau supérieur (c-à-d. de membre à classe) comporte une mutation, un saut, une discontinuité ou une transformation – en un mot, un changement – du plus grand intérêt théorique de la plus haute importance pratique, car il permet de sortir du système.
… existence de deux sortes de changements : l’un prend place à l’intérieur d’un système donné qui, lui, reste inchangé, l’autre modifie le système lui-même.
Ex. le rêveur : en proie à un cauchemar, il a la possibilité de faire plusieurs choses en rêve : courir, se cacher, se battre, hurler… mais aucun changement issu d’une de ces actions ne pourrait mettre fin au cauchemar. La seule possibilité pour sortir d’un rêve comporte un changement allant du rêve à l’état de veille. Il est évident que l’état de veille ne fait plus partie du rêve, mais représente un changement complet. Ce changement-ci est donc un changement de changement dont Aristote niait si catégoriquement l’existence.
… les groupes ne restent invariants qu’au niveau du changement 1, mais peuvent changer au niveau du changement 2 (c’est-à-dire au niveau où s’effectuent les changements dans les règles gouvernant leur structure ou leur ordre interne.) … la théorie des groupes et la théorie des types logiques ne sont pas seulement compatibles, mais complémentaires.
Videos de Paul Watzlawick (2)
Voir plusAjouter une vidéo
Thérapie par le Toucher et le Piano. PRIX WATZLAWICK. Grand Auditorium. Biarritz, Juin 2011.
Cette vidéo a reçu le PRIX WATZLAWICK qui récompensait le praticien de santé auteur de la meilleure vidéo d'interactivité thérapeutique dans le domaine de la psychothérapie ou dans le traitement de la douleur. 7 ème Forum de la Confédération Francophone d'Hypnose et Thérapies Brèves, Biarritz, 2-3-4 juin 2011.
Dans la catégorie :
Relations avec autruiVoir plus
>Psychologie>Psychologie appliquée>Relations avec autrui (99)
autres livres classés : changementVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Paul Watzlawick (10)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Philo pour tous
Jostein Gaarder fut au hit-parade des écrits philosophiques rendus accessibles au plus grand nombre avec un livre paru en 1995. Lequel?
Les Mystères de la patience
Le Monde de Sophie
Maya
Vita brevis
10 questions
438 lecteurs ont répondu
Thèmes :
spiritualité
, philosophieCréer un quiz sur ce livre438 lecteurs ont répondu