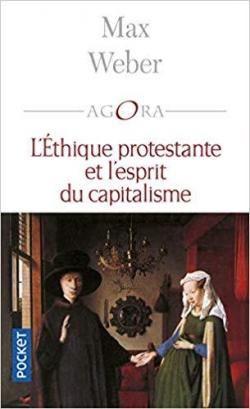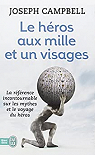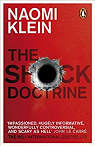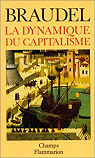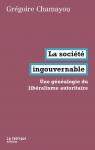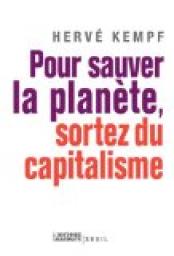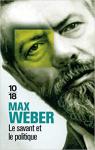Max Weber/5
155 notes
Résumé :
Max Weber décrit le grand bouleversement des Temps modernes, la transformation dans les mentalités du rapport à l'argent et à la fortune.
Aux consciences médiévales marquées par la parole évangélique selon laquelle " il est plus aisé pour un chameau de passer par le chas d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu " (Marc, X, 25), le protestantisme affirme que l'homme est sur terre pour se livrer à des œuvres terrestres, et que l... >Voir plus
Aux consciences médiévales marquées par la parole évangélique selon laquelle " il est plus aisé pour un chameau de passer par le chas d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu " (Marc, X, 25), le protestantisme affirme que l'homme est sur terre pour se livrer à des œuvres terrestres, et que l... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après L'Ethique protestante et l'esprit du capitalismeVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (10)
Voir plus
Ajouter une critique
Véritable leçon de sociologie, Max Weber nous montre que le monocausalisme est réducteur. En effet, il ne permet de saisir la complexité inhérente au réel. Il remet aussi en cause le matérialisme historique :
les idées parfois, au contraire, peuvent guider un processus historique. le capitalisme tire son origine du protestantisme, qui par la théorie de la prédestination (notamment calviniste), devait justifier son éléction par ses oeuvres : la réussite dans le travail a été vu comme un succès auprès de Dieu. de là, naît le travail comme vocation, principe qui guide notre société contemporaine. le capitalisme est pur rationnalisation. Ce n'est pas l'amour de l'argent, par conséquent, qui a déterminé ce système économique. Si il était déterminant, comme on peut le croire, dès lors, le capitalisme se serait déjà enraciné depuis longtemps.
Ouvrage à conseiller, si vous êtes intéressés ou passionnés par la sociologie, ou si vous voulez voir sous un autre angle certains phénomènes religieux. On voit à tel point la religion a façonné nos mentalités, quitte
à être toujours présente dans notre monde contemporain, à priori désenchanté. On parle de christianisme invisible : nos mentalités, nos pratiques culturelles sont encore concernés et même notre Déclaration des droits de l'homme. D'où l'intérêt de connaître les religions, qui sont une grande partie de notre patrimoine.
les idées parfois, au contraire, peuvent guider un processus historique. le capitalisme tire son origine du protestantisme, qui par la théorie de la prédestination (notamment calviniste), devait justifier son éléction par ses oeuvres : la réussite dans le travail a été vu comme un succès auprès de Dieu. de là, naît le travail comme vocation, principe qui guide notre société contemporaine. le capitalisme est pur rationnalisation. Ce n'est pas l'amour de l'argent, par conséquent, qui a déterminé ce système économique. Si il était déterminant, comme on peut le croire, dès lors, le capitalisme se serait déjà enraciné depuis longtemps.
Ouvrage à conseiller, si vous êtes intéressés ou passionnés par la sociologie, ou si vous voulez voir sous un autre angle certains phénomènes religieux. On voit à tel point la religion a façonné nos mentalités, quitte
à être toujours présente dans notre monde contemporain, à priori désenchanté. On parle de christianisme invisible : nos mentalités, nos pratiques culturelles sont encore concernés et même notre Déclaration des droits de l'homme. D'où l'intérêt de connaître les religions, qui sont une grande partie de notre patrimoine.
Max Weber, grand nom de la sociologie qu'on ne doit plus présenter, décortique ici l'influence religieuse du protestantisme (ou, plutôt, du calvinisme et en particulier piétisme) sur la genèse de "l'esprit capitaliste" : il montre comment les idées de "double pré-destination" et "Beruf" (métier ou, mieux encore, "vocation") ont "rationalisé" le fait économique dans la vie de ceux qui professaient le protestantisme calviniste ou piétiste ; ce paradigme de "ascèse active" a transformé le travail en un mode de connaissance du divin, il est donc "valorisé" au point où la stricte morale ne visait plus que le travail comme "fin en soi".
Il appuie sa thèse sur des démonstrations empiriques et autres sources documentaires, et termine son travail par ce propos:
"L'un des éléments fondamentaux de l'esprit du capitalisme moderne, et non seulement de celui-ci, mais de la civilisation moderne elle-même, à savoir : la conduite rationnelle fondée sur l'idée de Beruf, est né de l'esprit de l'ascétisme chrétien - c'est ce que notre exposé s'est proposé de démontrer."
Il appuie sa thèse sur des démonstrations empiriques et autres sources documentaires, et termine son travail par ce propos:
"L'un des éléments fondamentaux de l'esprit du capitalisme moderne, et non seulement de celui-ci, mais de la civilisation moderne elle-même, à savoir : la conduite rationnelle fondée sur l'idée de Beruf, est né de l'esprit de l'ascétisme chrétien - c'est ce que notre exposé s'est proposé de démontrer."
Ce livre apporte principalement la notion de" désenchantement du monde" qui a été souvent réutilisé depuis et dont une traduction plus juste aurais pu être "démagification du monde". le protestantisme, ou plus exactement les sectes américaines issues du calvinisme, met en oeuvre un ensemble de croyance engendrant chez l'individu une éthique, un mode de vie méthodique, lequel étant adéquate à l'esprit du capitalisme. En bref, des croyances irrationnelle engendre chez l'individu un comportement de calcul rationnel.
On peut voir émerger dans cette étude des notions analogue à celle de Adorno et Foucault et distinguer ainsi quel sont les apports spécifique des uns et des autres.
On peut voir émerger dans cette étude des notions analogue à celle de Adorno et Foucault et distinguer ainsi quel sont les apports spécifique des uns et des autres.
Je ne vais pas me livrer à un énième commentaire où le plan fait office de critique mais plutôt me livrer à mon ressenti concernant ma lecture.
Cet ouvrage, de mon point de vue pose de nombreux problèmes même si Weber, que je considère énormément au demeurant, est un grand sociologue ; à mes yeux, d'ailleurs, plus économiste...
En effet, cet ouvrage n'est pas construit de manière très cohérente dans le sens où certains allers-retours sont complexes voire très complexes à comprendre. de même, les réponses aux critiques de ses détracteurs en plein milieu d'un développement... Assez curieux comme procédé.
Enfin, ne vous lancez pas dans cet ouvrage après (comme je l'ai fait) avoir lu un ouvrage comme Les formes élémentaires de la vie religieuse de Durkheim où tout est classé et clair et surtout, sans base sociologique... Je dis bien sociologique car comme le dit Weber, son ouvrage n'a pas une vocation théologique.
Cet ouvrage, de mon point de vue pose de nombreux problèmes même si Weber, que je considère énormément au demeurant, est un grand sociologue ; à mes yeux, d'ailleurs, plus économiste...
En effet, cet ouvrage n'est pas construit de manière très cohérente dans le sens où certains allers-retours sont complexes voire très complexes à comprendre. de même, les réponses aux critiques de ses détracteurs en plein milieu d'un développement... Assez curieux comme procédé.
Enfin, ne vous lancez pas dans cet ouvrage après (comme je l'ai fait) avoir lu un ouvrage comme Les formes élémentaires de la vie religieuse de Durkheim où tout est classé et clair et surtout, sans base sociologique... Je dis bien sociologique car comme le dit Weber, son ouvrage n'a pas une vocation théologique.
La démonstration de Max Weber au sujet du lien entre « l'éthique protestante » et la naissance d'un « esprit capitaliste » est très éloquente. Il consacre une large part de son exposé à la distinction des différents courants protestants puis détaille chacun des principaux dogmes nous permettant ensuite de comprendre que cette influence des idées d'abord réservée à la vie monastique a ensuite gagnée la vie professionnelle et morale d'une société aujourd'hui tributaire de l'ordre économique moderne.
Citations et extraits (19)
Voir plus
Ajouter une citation
Ce n'est ni l'oisiveté ni la jouissance, mais l'activité seule qui sert à accroître la gloire de Dieu, selon les manifestations sans équivoque de sa volonté. Gaspiller son temps est donc le premier, en principe le plus grave, de tous les péchés. […] La richesse elle-même ne libère pas de ces prescriptions. Le possédant, lui non plus, ne doit pas manger sans travailler, car même s'il ne lui est pas nécessaire de travailler pour couvrir ses besoins, le commandement divin n'en subsiste pas moins, et il doit lui obéir au même titre que le pauvre. Car la divine Providence a prévu pour chacun sans exception un métier qu'il doit reconnaître et auquel il doit se consacrer. Et ce métier ne constitue pas un destin auquel on doit se soumettre et se résigner, mais un commandement que Dieu fait à l'individu de travailler à la gloire divine. Partant, le bon chrétien doit répondre à cet appel : "Si Dieu vous désigne tel chemin dans lequel vous puissiez légalement gagner plus que dans tel autre (cela sans dommage pour votre âme ni pour celle d'autrui) et que vous refusiez le plus profitable pour choisir le chemin qui l'est moins, vous contrecarrez l'une des fins de votre vocation, vous refusez de vous faire l'intendant de Dieu et d'accepter ses dons, et de les employer à son service s'il vient à l'exiger. "Travaillez donc à être riches pour Dieu, non pour la chair et le péché. "
...ainsi, dans l'histoire des religions, trouvait son point final ce vaste processus de « désenchantement » [Entzauberung] du monde qui avait débuté avec les prophéties du judaïsme ancien et qui, de concert avec la pensée scientifique grecque, rejetait tous les moyens magiques d'atteindre au salut comme autant de superstitions et de sacrilèges. Le puritain authentique allait jusqu'à rejeter tout soupçon de cérémonie religieuse au bord de la tombe; il enterrait ses proches sans chant ni musique, afin que ne risquât de transparaître aucune « superstition », aucun crédit en l'efficacité salutaire de pratiques magico-sacramentelles.
Nul moyen magique - voire nul moyen, quel qu'il soit - de procurer la grâce à qui Dieu avait décidé de la refuser. Combiné avec la dure doctrine de la transcendance absolue de Dieu [Gottferne] et de la futilité de tout ce qui est de l'ordre de la chair, cet isolement intime de l'homme constitue, d'une part, le fondement de l'attitude radicalement négative du puritanisme à l'égard de toute espèce d'élément sensuel ou émotionnel dans la culture et la religion Subjective (éléments considérés comme inutiles au salut et suscitant illusions sentimentales et Superstitions idolâtres); et par là il élimina toute possibilité d'une culture des sens [Sinnenhultur].
Mais, d'autre part, il constitue l'une des racines de cet individualisme pessimiste, sans illusion, qui se manifeste de nos jours encore dans le caractère national et les institutions des peuples qui ont un passé puritain; le contraste est frappant avec la façon dont la philosophie des Lumières, plus tard, a vu l'humanité.
A l'époque, nous retrouvons les traces de l'influence de la doctrine de la prédestination sur la conduite individuelle et la conception de la vie là même où, en tant que dogme, elle était sur le déclin : en fait, il ne s'agissait alors que de la forme la plus extrême de cette exclusive confiance en Dieu, ce qui nous intéresse ici. A titre d'exemple elle se manifeste, notamment dans la littérature puritaine anglaise, par une fréquence remarquable des mises en garde contre la foi en l'entraide, en l'amitié humaines. Le doux Baxter lui-même conseille de se méfier de l'ami le plus proche, et Bailey recommande en propres termes de ne se fier à personne, de ne rien confier qui soit compromettant. Un seul confident possible : Dieu. En opposition évidente avec le luthéranisme, cette attitude envers la vie était liée dans toutes les contrées où s'épanouissait le calvinisme à l'élimination discrète de la confession privée; cependant, les scrupules de Calvin lui-même à ce sujet n'avaient trait qu'aux possibilités de mésinterprétation du sacrement. (chapitre II, 1°, A. Le calvinisme)
Nul moyen magique - voire nul moyen, quel qu'il soit - de procurer la grâce à qui Dieu avait décidé de la refuser. Combiné avec la dure doctrine de la transcendance absolue de Dieu [Gottferne] et de la futilité de tout ce qui est de l'ordre de la chair, cet isolement intime de l'homme constitue, d'une part, le fondement de l'attitude radicalement négative du puritanisme à l'égard de toute espèce d'élément sensuel ou émotionnel dans la culture et la religion Subjective (éléments considérés comme inutiles au salut et suscitant illusions sentimentales et Superstitions idolâtres); et par là il élimina toute possibilité d'une culture des sens [Sinnenhultur].
Mais, d'autre part, il constitue l'une des racines de cet individualisme pessimiste, sans illusion, qui se manifeste de nos jours encore dans le caractère national et les institutions des peuples qui ont un passé puritain; le contraste est frappant avec la façon dont la philosophie des Lumières, plus tard, a vu l'humanité.
A l'époque, nous retrouvons les traces de l'influence de la doctrine de la prédestination sur la conduite individuelle et la conception de la vie là même où, en tant que dogme, elle était sur le déclin : en fait, il ne s'agissait alors que de la forme la plus extrême de cette exclusive confiance en Dieu, ce qui nous intéresse ici. A titre d'exemple elle se manifeste, notamment dans la littérature puritaine anglaise, par une fréquence remarquable des mises en garde contre la foi en l'entraide, en l'amitié humaines. Le doux Baxter lui-même conseille de se méfier de l'ami le plus proche, et Bailey recommande en propres termes de ne se fier à personne, de ne rien confier qui soit compromettant. Un seul confident possible : Dieu. En opposition évidente avec le luthéranisme, cette attitude envers la vie était liée dans toutes les contrées où s'épanouissait le calvinisme à l'élimination discrète de la confession privée; cependant, les scrupules de Calvin lui-même à ce sujet n'avaient trait qu'aux possibilités de mésinterprétation du sacrement. (chapitre II, 1°, A. Le calvinisme)
Le puritain voulait être un homme besogneux ‑ et nous sommes forcés de l’être. Car lorsque l’ascétisme se trouva transféré de la cellule des moines dans la vie professionnelle et qu’il commença à dominer la moralité séculière, ce fut pour participer à l’édification du cosmos prodigieux de l’ordre économique moderne. Ordre lié aux conditions techniques et économiques de la production mécanique et machiniste qui détermine, avec une force irrésistible, le style de vie de l’ensemble des individus nés dans ce mécanisme ‑ et pas seulement de ceux que concerne directement l’acquisition économique. Peut‑être le déterminera‑t‑il jusqu’à ce que la dernière tonne de carburant fossile ait achevé de se consumer. Selon les vues de Baxter, le souci des biens extérieurs ne devait peser sur les épaules de ses saints qu’à la façon d’ « un léger manteau qu’à chaque instant l’on peut rejeter ». Mais la fatalité a transformé ce manteau en une cage d’acier. »
...ainsi, dans l'histoire des religions, trouvait son point final ce vaste processus de « désenchantement » [Entzauberung] du monde qui avait débuté avec les prophéties du judaïsme ancien et qui, de concert avec la pensée scientifique grecque, rejetait tous les moyens magiques d'atteindre au salut comme autant de superstitions et de sacrilèges. Le puritain authentique allait jusqu'à rejeter tout soupçon de cérémonie religieuse au bord de la tombe; il enterrait ses proches sans chant ni musique, afin que ne risquât de transparaître aucune « superstition », aucun crédit en l'efficacité salutaire de pratiques magico-sacramentelles.
Nul moyen magique - voire nul moyen, quel qu'il soit - de procurer la grâce à qui Dieu avait décidé de la refuser. Combiné avec la dure doctrine de la transcendance absolue de Dieu [Gottferne] et de la futilité de tout ce qui est de l'ordre de la chair, cet isolement intime de l'homme constitue, d'une part, le fondement de l'attitude radicalement négative du puritanisme à l'égard de toute espèce d'élément sensuel ou émotionnel dans la culture et la religion Subjective (éléments considérés comme inutiles au salut et suscitant illusions sentimentales et Superstitions idolâtres); et par là il élimina toute possibilité d'une culture des sens [Sinnenhultur].
Mais, d'autre part, il constitue l'une des racines de cet individualisme pessimiste, sans illusion, qui se manifeste de nos jours encore dans le caractère national et les institutions des peuples qui ont un passé puritain; le contraste est frappant avec la façon dont la philosophie des Lumières, plus tard, a vu l'humanité.
A l'époque, nous retrouvons les traces de l'influence de la doctrine de la prédestination sur la conduite individuelle et la conception de la vie là même où, en tant que dogme, elle était sur le déclin : en fait, il ne s'agissait alors que de la forme la plus extrême de cette exclusive confiance en Dieu, ce qui nous intéresse ici. A titre d'exemple elle se manifeste, notamment dans la littérature puritaine anglaise, par une fréquence remarquable des mises en garde contre la foi en l'entraide, en l'amitié humaines. Le doux Baxter lui-même conseille de se méfier de l'ami le plus proche, et Bailey recommande en propres termes de ne se fier à personne, de ne rien confier qui soit compromettant. Un seul confident possible : Dieu. En opposition évidente avec le luthéranisme, cette attitude envers la vie était liée dans toutes les contrées où s'épanouissait le calvinisme à l'élimination discrète de la confession privée; cependant, les scrupules de Calvin lui-même à ce sujet n'avaient trait qu'aux possibilités de mésinterprétation du sacrement. (chapitre II, 1°, A. Le calvinisme)
Nul moyen magique - voire nul moyen, quel qu'il soit - de procurer la grâce à qui Dieu avait décidé de la refuser. Combiné avec la dure doctrine de la transcendance absolue de Dieu [Gottferne] et de la futilité de tout ce qui est de l'ordre de la chair, cet isolement intime de l'homme constitue, d'une part, le fondement de l'attitude radicalement négative du puritanisme à l'égard de toute espèce d'élément sensuel ou émotionnel dans la culture et la religion Subjective (éléments considérés comme inutiles au salut et suscitant illusions sentimentales et Superstitions idolâtres); et par là il élimina toute possibilité d'une culture des sens [Sinnenhultur].
Mais, d'autre part, il constitue l'une des racines de cet individualisme pessimiste, sans illusion, qui se manifeste de nos jours encore dans le caractère national et les institutions des peuples qui ont un passé puritain; le contraste est frappant avec la façon dont la philosophie des Lumières, plus tard, a vu l'humanité.
A l'époque, nous retrouvons les traces de l'influence de la doctrine de la prédestination sur la conduite individuelle et la conception de la vie là même où, en tant que dogme, elle était sur le déclin : en fait, il ne s'agissait alors que de la forme la plus extrême de cette exclusive confiance en Dieu, ce qui nous intéresse ici. A titre d'exemple elle se manifeste, notamment dans la littérature puritaine anglaise, par une fréquence remarquable des mises en garde contre la foi en l'entraide, en l'amitié humaines. Le doux Baxter lui-même conseille de se méfier de l'ami le plus proche, et Bailey recommande en propres termes de ne se fier à personne, de ne rien confier qui soit compromettant. Un seul confident possible : Dieu. En opposition évidente avec le luthéranisme, cette attitude envers la vie était liée dans toutes les contrées où s'épanouissait le calvinisme à l'élimination discrète de la confession privée; cependant, les scrupules de Calvin lui-même à ce sujet n'avaient trait qu'aux possibilités de mésinterprétation du sacrement. (chapitre II, 1°, A. Le calvinisme)
Ce n'est ni l'oisiveté ni la jouissance, mais l'activité seule qui sert à accroître la gloire de Dieu, selon les manifestations sans équivoque de sa volonté. Gaspiller son temps est donc le premier, en principe le plus grave, de tous les péchés. […] La richesse elle-même ne libère pas de ces prescriptions. Le possédant, lui non plus, ne doit pas manger sans travailler, car même s'il ne lui est pas nécessaire de travailler pour couvrir ses besoins, le commandement divin n'en subsiste pas moins, et il doit lui obéir au même titre que le pauvre. Car la divine Providence a prévu pour chacun sans exception un métier qu'il doit reconnaître et auquel il doit se consacrer. Et ce métier ne constitue pas un destin auquel on doit se soumettre et se résigner, mais un commandement que Dieu fait à l'individu de travailler à la gloire divine. Partant, le bon chrétien doit répondre à cet appel : "Si Dieu vous désigne tel chemin dans lequel vous puissiez légalement gagner plus que dans tel autre (cela sans dommage pour votre âme ni pour celle d'autrui) et que vous refusiez le plus profitable pour choisir le chemin qui l'est moins, vous contrecarrez l'une des fins de votre vocation, vous refusez de vous faire l'intendant de Dieu et d'accepter ses dons, et de les employer à son service s'il vient à l'exiger. "Travaillez donc à être riches pour Dieu, non pour la chair et le péché.
Video de Max Weber (2)
Voir plusAjouter une vidéo
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=49209&motExact=0&motcle=&mode=AND
DÉSENCHANTEMENT DU SEXE
Dialectique du désir et de l'amour
Claude Esturgie
PSYCHANALYSE, PSYCHIATRIE, PSYCHOLOGIE QUESTIONS DE GENRE SOCIOLOGIE SEXUALITÉ
C'est grâce à la littérature, la poésie, la philosophie, la psychanalyse, le cinéma, mais aussi à son expérience clinique personnelle, que l'auteur s'est intéressé à l'évolution de la perception du sexe pour aboutir à l'époque contemporaine où le développement exponentiel de la technique entraîne ce désenchantement dont avait parlé Max Weber et Marcel Gauchet. Aucun déclinisme cependant dans son propos mais un questionnement sur la possibilité d'une nouvelle alchimie entre le désir, l'érotisme et l'amour.
Broché
ISBN : 978-2-343-08055-0 ? janvier 2016 ? 156 pages
Prix éditeur : 17 ? 16,15 ?
DÉSENCHANTEMENT DU SEXE
Dialectique du désir et de l'amour
Claude Esturgie
PSYCHANALYSE, PSYCHIATRIE, PSYCHOLOGIE QUESTIONS DE GENRE SOCIOLOGIE SEXUALITÉ
C'est grâce à la littérature, la poésie, la philosophie, la psychanalyse, le cinéma, mais aussi à son expérience clinique personnelle, que l'auteur s'est intéressé à l'évolution de la perception du sexe pour aboutir à l'époque contemporaine où le développement exponentiel de la technique entraîne ce désenchantement dont avait parlé Max Weber et Marcel Gauchet. Aucun déclinisme cependant dans son propos mais un questionnement sur la possibilité d'une nouvelle alchimie entre le désir, l'érotisme et l'amour.
Broché
ISBN : 978-2-343-08055-0 ? janvier 2016 ? 156 pages
Prix éditeur : 17 ? 16,15 ?
+ Lire la suite
Dans la catégorie :
Pratiques religieusesVoir plus
>Sciences sociales : généralités>Culture et normes de comportement>Pratiques religieuses (29)
autres livres classés : capitalismeVoir plus
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Max Weber (32)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (5 - essais )
Roland Barthes : "Fragments d'un discours **** "
amoureux
positiviste
philosophique
20 questions
853 lecteurs ont répondu
Thèmes :
essai
, essai de société
, essai philosophique
, essai documentCréer un quiz sur ce livre853 lecteurs ont répondu