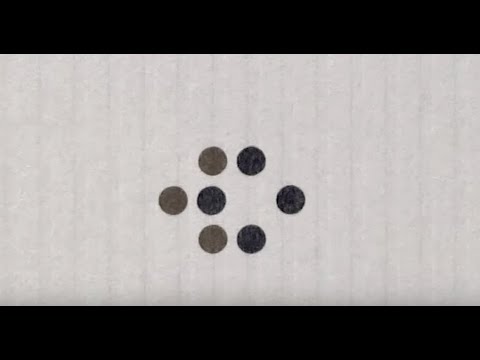Julie Douard, qui signe avec "Après l’enfance" son premier roman, a écrit plusieurs pièces de théâtre et enseigne la philosophie en lycée depuis une dizaine d'années.
"Bienvenue aux éditions P.O.L", un film de Valérie Mréjen. Pour les 40 ans des éditions P.O.L, quelques un(e)s des auteurs et des autrices publié(e)s aux éditions P.O.L écrivent une carte postale et laissent un message aux éditions P.O.L. Avec par ordre d'apparition de la carte postale: Violaine Schwartz, Jean-Paul Hirsch, Lucie Rico, Emmanuel Lascoux, Jacques jouet, Philippe Michard, François Matton, Frédéric Boyer, Catherine Henri, Suzanne Doppelt, Lamia Zadié, Marianne Alphant, Suzanne Duval, Laure Gouraige, Emmanuel Carrère, Jean Rolin, Elisabeth Filhol, Célia Houdart, Nicolas Fargues, Nicolas Bouyssi, Louise Chennevière, Frédérique Berthet, Marie Darrieussecq, Jocelyne Desverchère, Jean Frémon, Kiko Herrero, Julie Wolkenstein, Emmanuelle Bayamack-Tam, Liliane Giraudon, Frédéric Forte, Pierric Bailly, Valère Novarina, Hélène Zimmer, Nicolas Combet, Christian Prigent, Patrice Robin,, Emmanuelle Salasc, Alice Roland, Shane Haddad, Mathieu Bermann, Arthur Dreyfus, legor Gran, Charles Pennequin, Atiq Rahimi, Anne Portugal, Patrick Lapeyre, Caroline Dubois, Ryad Girod, Valérie Mréjen / Dominique Fourcade, Marielle Hubert, Robert Bober, Pierre Patrolin, Olivier Bouillère, Martin Winckler, Jean-Luc Bayard, Anne Parian, Nathalie Azoulai, Julie Douard, Théo Casciani, Paul Fournel, Raymond Bellour, Christine Montalbetti, Francis Tabouret, Ryoko Sekiguchi,
En réalité, elle n'avait pas qu'une éponge, elle avait aussi un homme lourd et besogneux qui semblait chercher à creuser un trou dans son corps à elle, et dont le visage apparaissait puis disparaissait, pour réapparaitre puis redisparaitre, et ainsi de suite. Ce va-et-vient lui faisait quitter la terre ferme sans la monter au ciel ; elle tanguait plutôt sur les eaux putrides d'une mer à peine agitée mais juste assez pour vous faire remonter le foie dans la gorge.
Etait-on supposé s'amuser ici ? Sophie ne se rappelait pas qu'on lui ait demandé son avis, mais pensait que les choses étaient malheureusement trop engagées pour qu'elle pût protester avec véhémence et succès, d'autant qu'elle se sentait sans force, écrasée par l'alcool et par ce robot accomplissant une tâche mécanique et répétitive, qui s'achèverait sans nul doute dans un gros soupir d'aise.
Et celui-ci se fit tant attendre que Sophie eut le loisir de dessaouler. Et moins elle était saoule, plus elle se sentait mal. C'était elle finalement l'éponge, elle tout entière qui absorbait les secousses du gars le moins sensuel de la Terre, et qui devrait en plus absorber son foutre, son foutu foutre !
La panique succéda au dégoût. besognait-il avec ou sans préservatif ? Etait-il sain ? Malade ? Vérolé ? Fertile ? Depuis quand n'avait-elle pas eu ses règles ? Pourquoi avait-elle arrêté la pilule deux ans plus tôt ?
Sophie commença à compter mais elle s'embrouillait dans les jours et les dates, alors elle se dit qu'il fallait qu'elle s'extirpe au plus vite de ce mauvais pas. Cependant un râle poussif et rauque lui apprit que c'était trop tard, de toute façon.
C'est bien ce que je me demande quand j'en voudrais connaître des centaines. Mais je croise tant de truies et d'obèses complexées et de souris gueulardes que c'est à se demander s'il reste des vraies femmes, des qui savent quelle chance c'est d'être une femme et qui sont généreuses pour les moins chanceux qu'elles qui sont devenus des hommes ou qui apprennent à l'être.
Tout est si simple dès lors qu'on est une femme, tout nous profite et tout nous est offert. On n'a qu'à refuser si le malheur nous a faites conne, et à rejeter celui qui est assez serviable pour n'aspirer qu'à nous faire sentir quelle joie cela peut être d'avoir un corps de femme, un corps tout doux et tout douillet, un corps sans poils et sans dureté. Pourtant les mieux loties sont les plus égoïstes. Quand elles devraient partager sans question, elles minaudent et réclament encore des choses, des preuves et des cadeaux alors que le seul cadeau qui vaille c'est que la nature les a faites femmes. Mais de tout cela, elles ne se rendent pas compte.
Mais moi je sais, je connais l'injustice et sa réparation.
Alors bien obligé de corriger moi-même cette absurdité naturelle qui fait qu'elles ont tout quand nous n'avons que des grumeaux sur la peau et des poils sur les joues qu'on se doit d'arracher pour connaitre l'étreinte sans mettre le feu aux poudres de leur teint délicat. Et encore faut-il dans ce marasme rester l'homme, le vit qui dure et qui durcit.
Taré, le mot est peut-être fort si l'on s'en tient à une conception purement génétique du personnage car, après tout, il n'y avait pas, dans la famille Machin, de défauts héréditaires tels qu'on pût expliquer par ce biais la monstruosité du petit Gustave. Evidemment, le problème pouvait venir d'un lointain aïeul dont on avait enterré jusqu'au souvenir. Mais il se pouvait aussi que le pensionnat dans lequel les parents Machin avaient placé leur fils lui avait appris la roublardise plus finement que le latin.
Jouons avec Clark Gable
D'après le roman Night Bus de Samuel Hopkins Adams, Gable triomphe dans l'un des premières comédies loufoques (screwball comedy) du cinéma. Ce film américain réalisé par Frank Capra en 1934 avec Claudette Colbert s'intitule:
10 lecteurs ont répondu