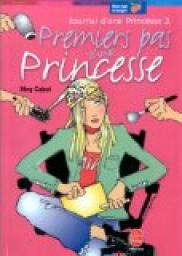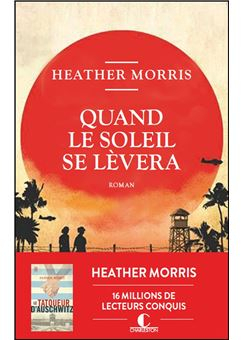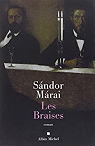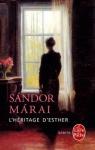Retrouvez les derniers épisodes de la cinquième saison de la P'tite Librairie sur la plateforme france.tv :
https://www.france.tv/france-5/la-p-tite-librairie/
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos de la P'tite Librairie.
Avez-vous déjà vécu cette expérience terrible : quand l'amour entre en conflit avec l'amitié ? Mais savez-vous qu'il existe un roman formidable qui nous dit lequel de ces deux sentiments finit toujours par l'emporter ?
« Les braises », de Sandor Marai, c'est à lire au Livre de poche.

Sándor MáraiSándor Márai : Journal tome 1 sur 3
/5 22 notes
/5 22 notes
Résumé :
Inédit en France, le Journal du grand écrivain hongrois Sándor Márai éclaire l'homme et l'oeuvre d'une lumière nouvelle.
Romancier, chroniqueur, Sándor Márai fut également le témoin et l'acteur d'une époque dont il a consigné les événements dès 1943 dans un Journal qui l'a accompagné jusqu'à la fin de ses jours, devenant un de ses chefs-d'oeuvre.
Ce premier volume couvre la période historique la plus riche - la guerre, l'arrivée des Soviétiques, le dép... >Voir plus
Romancier, chroniqueur, Sándor Márai fut également le témoin et l'acteur d'une époque dont il a consigné les événements dès 1943 dans un Journal qui l'a accompagné jusqu'à la fin de ses jours, devenant un de ses chefs-d'oeuvre.
Ce premier volume couvre la période historique la plus riche - la guerre, l'arrivée des Soviétiques, le dép... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Journal, tome 1 : Les années hongroises 1943-1948Voir plus
Critiques, Analyses et Avis (6)
Voir plus
Ajouter une critique
Lectrice de Sandor Marai depuis peu, intriguée et passionnée par l'oeuvre, ses fondements politiques, sociaux, et moraux, ainsi qu'historiques, l'existence de ce Journal m'a évidemment attirée. Et je l'ai lu avec une avidité qui a été similaire à la lecture d'un thriller, nonobstant l'absence de suspense.
Un Journal d'un grand écrivain est sans doute quelque chose de particulier entre le public et l'intime, entre le correct et le croustillant. J'imagine.
Ici, le Journal est d'abord un carnet de vie, tenu par un être vivant, respirant, souffrant, transpirant, aimant, vomissant, mangeant, puant, se lavant, et surtout pensant, pensant à son oeuvre, sa vie, l'une n'étant pas sans l'autre, l'autre n'ayant pas de sens seule.
Le Journal suit chacune des années de 1943 à 1948, soit six chapitres. Chacune est marquée : la guerre encore lointaine, l'invasion par les Allemands et l'abandon aux nazis, les déportations, puis, les bombardements et l'invasion - la libération - par les Soviétiques, la confusion, et enfin la soviétisation, la bolchévisation, les exécutions, la perte des libertés, et la préparation inexorable de l'exil.
Il est sûr que lire le Journal c'est lire, relire, découvrir ou se rappeler ces années d'entrée dans la guerre froide, dans la perte de ces petits pays. La Hongrie paye le prix fort. Sandor Marai exprime à maintes reprises la honte qu'il ressent devant la lâcheté de son pays, sa patrie.
Lire ce Journal c'est forcément s'intéresser passionnément à cette histoire ou du moins vouloir la découvrir et la comprendre. Marai ne se fait pas militant. Il se place toujours comme citoyen hongrois, aimant profondément son pays, son histoire, sa langue, et il est toujours européen. Et lorsque l'on remet dans son contexte et ce Journal mais aussi d'autres oeuvres de l'auteur, on est stupéfait par cette ouverture d'esprit, grandeur d'âme, et profondeur de l'intelligence, qui fait que Sandor Marai revendique sa "magyarité" mais toujours liée à son "européanité".
Ce Journal est aussi l'occasion de partager avec son auteur ses lectures. Puisque selon lui, un écrivain est d'abord un lecteur. Il dévore et nous fait partager ses "notes" de lecture. Magnifiques. Proust, Krudy, Mann, et tous ces auteurs hongrois que nous ne connaissons pas, Goethe, Huxley, il est ouvert à tout, il lit, il lit, pas une journée sans quelques heures de lectures.
Le Journal est le journal d'un grand lecteur, passionné, découvreur, malgré les difficultés à se procurer et malgré la douleur d'avoir perdu des livres dans les bombardements (ce que l'on retrouvera plusieurs fois dans ses romans).
Enfin, Sandor se prépare à l'exil. Car il a vu les lâchetés, les changements, les procès sommaires, les retournements, les trahisons, les profiteurs, les salauds, il a vu, et il a compris ce qu'était devenu son cher pays, sa belle Hongrie et sa belle langue. Il a mal, quitter, s'exiler c'est avant tout perdre sa langue quand on est écrivain. Dans quelle langue alors pourrais-je écrire ? et dans quelle langue serais-je un écrivain ? A ce moment-là, il m'a rappelé le superbement triste livre d'Agota Kritof, sa compatriote, exilée, et ne sachant plus dans quelle langue elle pourra écrire. Ces pages sont extrêmement belles et touchantes car elles ont une portée universelle qui touche à la condition de tout exilé.
Dans la plume de Sandor Marai, la question n'en est que plus douloureuse.
Et puis, il y a l'Enfant. Dans le Journal, Sandor raconte sa rencontre avec l'Enfant, Janos. Ici on touche à l'intime. Une émotion, la douleur de la perte du petit (en 1939), et l'apparition de Janos, et une forme de réapprentissage de l'amour paternel. Là, dans ce Journal, les pages sont à la fois douloureuses et lumineuses, tragédie et pages noires d'avoir perdu et enterré un enfant, face à l'éclosion, la clarté, l'innocence du jeune Janos. Encore des pages magnifiques d''émotion et pleines d'amour.
Lire le Journal d'un écrivain n'est peut être pas une démarche simple si on ne connait pas vraiment son auteur. Je n'aime pas donner des leçons. Sauf que je vais en donner au moins une. Si on veut découvrir l'auteur et son oeuvre, pourquoi pas par ce Journal ? Mais ce n'est pas une biographie, ce n'est pas un roman, et c'est au jour le jour, donc cela peut donner un aspect un peu décousu. Donc ce serait dommage.
J'en reviens donc à... si on veut découvrir Sandor Marai, Les Révoltés, Les Braises ou L'Héritage d'Esther, de mon point de vue, permettent une approche fort sympathique.
Le Journal est un éclairage.
Ou, comme pour moi, le Journal est indispensable, car cet écrivain est passionnant et pas du tout vieilli, les idées qu'il exprime sont justes et il est souvent d'une telle lucidité.
Un Journal d'un grand écrivain est sans doute quelque chose de particulier entre le public et l'intime, entre le correct et le croustillant. J'imagine.
Ici, le Journal est d'abord un carnet de vie, tenu par un être vivant, respirant, souffrant, transpirant, aimant, vomissant, mangeant, puant, se lavant, et surtout pensant, pensant à son oeuvre, sa vie, l'une n'étant pas sans l'autre, l'autre n'ayant pas de sens seule.
Le Journal suit chacune des années de 1943 à 1948, soit six chapitres. Chacune est marquée : la guerre encore lointaine, l'invasion par les Allemands et l'abandon aux nazis, les déportations, puis, les bombardements et l'invasion - la libération - par les Soviétiques, la confusion, et enfin la soviétisation, la bolchévisation, les exécutions, la perte des libertés, et la préparation inexorable de l'exil.
Il est sûr que lire le Journal c'est lire, relire, découvrir ou se rappeler ces années d'entrée dans la guerre froide, dans la perte de ces petits pays. La Hongrie paye le prix fort. Sandor Marai exprime à maintes reprises la honte qu'il ressent devant la lâcheté de son pays, sa patrie.
Lire ce Journal c'est forcément s'intéresser passionnément à cette histoire ou du moins vouloir la découvrir et la comprendre. Marai ne se fait pas militant. Il se place toujours comme citoyen hongrois, aimant profondément son pays, son histoire, sa langue, et il est toujours européen. Et lorsque l'on remet dans son contexte et ce Journal mais aussi d'autres oeuvres de l'auteur, on est stupéfait par cette ouverture d'esprit, grandeur d'âme, et profondeur de l'intelligence, qui fait que Sandor Marai revendique sa "magyarité" mais toujours liée à son "européanité".
Ce Journal est aussi l'occasion de partager avec son auteur ses lectures. Puisque selon lui, un écrivain est d'abord un lecteur. Il dévore et nous fait partager ses "notes" de lecture. Magnifiques. Proust, Krudy, Mann, et tous ces auteurs hongrois que nous ne connaissons pas, Goethe, Huxley, il est ouvert à tout, il lit, il lit, pas une journée sans quelques heures de lectures.
Le Journal est le journal d'un grand lecteur, passionné, découvreur, malgré les difficultés à se procurer et malgré la douleur d'avoir perdu des livres dans les bombardements (ce que l'on retrouvera plusieurs fois dans ses romans).
Enfin, Sandor se prépare à l'exil. Car il a vu les lâchetés, les changements, les procès sommaires, les retournements, les trahisons, les profiteurs, les salauds, il a vu, et il a compris ce qu'était devenu son cher pays, sa belle Hongrie et sa belle langue. Il a mal, quitter, s'exiler c'est avant tout perdre sa langue quand on est écrivain. Dans quelle langue alors pourrais-je écrire ? et dans quelle langue serais-je un écrivain ? A ce moment-là, il m'a rappelé le superbement triste livre d'Agota Kritof, sa compatriote, exilée, et ne sachant plus dans quelle langue elle pourra écrire. Ces pages sont extrêmement belles et touchantes car elles ont une portée universelle qui touche à la condition de tout exilé.
Dans la plume de Sandor Marai, la question n'en est que plus douloureuse.
Et puis, il y a l'Enfant. Dans le Journal, Sandor raconte sa rencontre avec l'Enfant, Janos. Ici on touche à l'intime. Une émotion, la douleur de la perte du petit (en 1939), et l'apparition de Janos, et une forme de réapprentissage de l'amour paternel. Là, dans ce Journal, les pages sont à la fois douloureuses et lumineuses, tragédie et pages noires d'avoir perdu et enterré un enfant, face à l'éclosion, la clarté, l'innocence du jeune Janos. Encore des pages magnifiques d''émotion et pleines d'amour.
Lire le Journal d'un écrivain n'est peut être pas une démarche simple si on ne connait pas vraiment son auteur. Je n'aime pas donner des leçons. Sauf que je vais en donner au moins une. Si on veut découvrir l'auteur et son oeuvre, pourquoi pas par ce Journal ? Mais ce n'est pas une biographie, ce n'est pas un roman, et c'est au jour le jour, donc cela peut donner un aspect un peu décousu. Donc ce serait dommage.
J'en reviens donc à... si on veut découvrir Sandor Marai, Les Révoltés, Les Braises ou L'Héritage d'Esther, de mon point de vue, permettent une approche fort sympathique.
Le Journal est un éclairage.
Ou, comme pour moi, le Journal est indispensable, car cet écrivain est passionnant et pas du tout vieilli, les idées qu'il exprime sont justes et il est souvent d'une telle lucidité.
Andras Kanyadi et Catherine Fay sont les auteurs de cette édition de morceaux choisis du Journal de Sandor Marai, pour les années 1943 à 1948. Ces années correspondent, pour l'écrivain hongrois, au gouvernement des Croix Fléchées, à l'occupation allemande, puis à la conquête russe et à l'instauration d'une dictature communiste. A la fin de 1948, l'auteur et sa famille ont émigré en Italie. La richesse de l'arrière-plan historique a peut-être inspiré à un malheureux, sur Babelio, l'étiquette "collaboration", ce qui est aussi étonnant que faux.
On sera tenté de lire ce Journal à cause des années tragiques qu'il couvre, et c'est intéressant de voir comment un individu cultivé traverse une guerre et trois dictatures. Dans le Journal, par nature, la vie et la littérature se croisent et s'empoignent. A hauteur d'homme, ce livre offre une expérience intéressante.
Cet homme est un intellectuel de gauche. Pas de la tribu servile qui naît en Occident à pareille époque avec Aragon et Sartre, mais plutôt un individu héritier de la tradition humaniste européenne : générosité, idées larges, lucidité épisodique (au contact direct des Utopies meurtrières, loin de St Germain des Prés), indignations morales. Le modèle de tous ces gens, qui acceptent l'étiquette marxiste "humanistes bourgeois" est Thomas Mann. On ne s'attendra donc pas à trouver des pensées bien profondes, mais de grandes idées molles, très appréciées aujourd'hui. Une gauche de confort, dans l'esprit des Prix Nobel de littérature.
Enfin, l'auteur est un artiste et un grand lecteur. J'ignore tout du hongrois et je suis incapable d'imaginer à quoi ressemble son style, mais ses notes de lecture et ses jugements critiques sont toujours pleins d'intérêt et de verve. Marai, auteur hongrois, communie intensément avec son peuple et avec sa langue : quitter l'un et l'autre, c'est quitter le milieu vital de son esprit. C'est sans doute le plus grand intérêt, et l'aspect le plus tragique, de ce journal d'écrivain ; poser la question du créateur et de sa nation, du créateur et de sa langue.
Cependant un certain ennui distingué (à la Goethe) se dégage du livre, malgré de très intéressants passages et des pages magnifiques. L'auteur a réfléchi à la forme et on a quand même l'impression de lire une oeuvre littéraire, non un reportage pris sur le vif. Je ne regrette pas mes efforts, mais je n'ai guère envie de regarder les romans de l'auteur après avoir visité son atelier.
On sera tenté de lire ce Journal à cause des années tragiques qu'il couvre, et c'est intéressant de voir comment un individu cultivé traverse une guerre et trois dictatures. Dans le Journal, par nature, la vie et la littérature se croisent et s'empoignent. A hauteur d'homme, ce livre offre une expérience intéressante.
Cet homme est un intellectuel de gauche. Pas de la tribu servile qui naît en Occident à pareille époque avec Aragon et Sartre, mais plutôt un individu héritier de la tradition humaniste européenne : générosité, idées larges, lucidité épisodique (au contact direct des Utopies meurtrières, loin de St Germain des Prés), indignations morales. Le modèle de tous ces gens, qui acceptent l'étiquette marxiste "humanistes bourgeois" est Thomas Mann. On ne s'attendra donc pas à trouver des pensées bien profondes, mais de grandes idées molles, très appréciées aujourd'hui. Une gauche de confort, dans l'esprit des Prix Nobel de littérature.
Enfin, l'auteur est un artiste et un grand lecteur. J'ignore tout du hongrois et je suis incapable d'imaginer à quoi ressemble son style, mais ses notes de lecture et ses jugements critiques sont toujours pleins d'intérêt et de verve. Marai, auteur hongrois, communie intensément avec son peuple et avec sa langue : quitter l'un et l'autre, c'est quitter le milieu vital de son esprit. C'est sans doute le plus grand intérêt, et l'aspect le plus tragique, de ce journal d'écrivain ; poser la question du créateur et de sa nation, du créateur et de sa langue.
Cependant un certain ennui distingué (à la Goethe) se dégage du livre, malgré de très intéressants passages et des pages magnifiques. L'auteur a réfléchi à la forme et on a quand même l'impression de lire une oeuvre littéraire, non un reportage pris sur le vif. Je ne regrette pas mes efforts, mais je n'ai guère envie de regarder les romans de l'auteur après avoir visité son atelier.
Dès l'invasion de la Hongrie par l'Allemagne en 1944, Sándor Márai, journaliste et écrivain hongrois, décide de ne plus écrire que pour ses tiroirs et pour son Journal, un « exil intérieur dans un pays au bord du précipice ». de 1943 à 1948, il rédige de courtes chroniques relatant ses impressions et ses sentiments sur la débâcle politique de son pays. En même temps, l'écrivain questionne l'attitude des dirigeants hongrois face aux Nazis et s'indigne du sort fait à la population juive habitant le territoire. Sur le plan personnel, Márai s'inquiète de sa santé et de celle de sa compagne, Lola, laquelle doit impérativement vivre cachée afin d'éviter le déportement vers les camps de travail, ce que son père n'a pu éviter. Une période sombre que la fin de la guerre en 1945 ne réglera pas sur tous les fronts. Dépossédé de tous ses biens à cause des bombardements à Budapest et mal vu des autorités hongroises pour sa neutralité politique, Márai se résigne alors à s'exiler en 1948, d'abord à Genève et ensuite à Naples. C'est sur ce dernier chapitre de sa vie que se termine le journal.
J'aime beaucoup cet outil littéraire qu'est le journal, et même si je ne connaissais pas Sándor Márai, j'en ai apprécié le style et le contenu, très émouvant. Son oeuvre mérite donc d'être approfondie et j'irai voir du côté de ses romans pour la suite.
J'aime beaucoup cet outil littéraire qu'est le journal, et même si je ne connaissais pas Sándor Márai, j'en ai apprécié le style et le contenu, très émouvant. Son oeuvre mérite donc d'être approfondie et j'irai voir du côté de ses romans pour la suite.
Couvrant en autant de parties les années 1943 à 1948, ce Journal est un témoignage personnel sur la guerre, la fin de la guerre et l'immédiat après-guerre. Ce qui est étonnant pour un journal, l'ouvrage ne comporte pas de date intermédiaire. Il offre en effet une lecture morcelée, non suivie et donc un peu "décousue", mais qui n'en reste pas moins agréable. Au fil des années, les préoccupations de l'auteur évoluent imperceptiblement. D'abord, la guerre et ses horreurs, les bombardements, la déportation des juifs, etc. Puis, la paix qui revient, la naissance de la guerre froide entre les blocs russe et américain, la peur de la destruction du monde par la bombe atomique, des considérations politiques sur l'avenir de son pays, et ce qui en découle, la tentation de l'exil.
Le Journal est aussi le réceptacle de ses pensées personnelles sur des sujets variés. Sándor Márai y apparaît comme un homme cultivé, sensible, inquiet. Il nous décrit sa vie quotidienne, le temps qu'il fait, ses ennuis de santé ("la réponse qu'apportent les organes du ventre à des questions que l'intelligence n'arrive pas à résoudre") et ceux de L., sa femme, ses lectures et l'avancement de sa propre oeuvre littéraire...
Car Sándor Márai est un écrivain et la littérature, c'est toute sa vie : "Qu'est-ce qu'un écrivain ? Un homme chez qui la libido, ce courant vital, est plus forte que chez beaucoup d'autres. Ce courant, il faut le canaliser" (1943 - page 72). Il réfléchit à la mission de l'écrivain : "Par orgueil, par ambition, par avidité, nous avons (...) négligé notre obligation essentielle, à savoir l'éducation de la société et la clarification intransigeante des idées" (1944 - page 141). Auteur, Sándor Márai nous livre ses difficultés sur la création artistique et l'inspiration qu'elle requiert. L'écriture de son ouvrage Les offusqués lui demande un réel effort : "Je dois consacrer ce qui me reste de forces à terminer Les Offusqués. Sinon, tout aura été inutile et vain, mon travail et ma vie" (1944 - page 127). Il nous apprend qu'une oeuvre est en gestation tant qu'elle n'est pas aboutie : "La Soeur est arrivée à la croisée des chemins, il faut prendre une décision : roman ou livre de souvenirs ? Ce choix nécessite un effort considérable pour un écrivain. Je me sens fatigué" (1944 - page 143).
Le Journal nous donne également un aperçu de sa grande culture littéraire : de nombreux noms d'auteur et d'oeuvre y côtoient de nombreuses citations. La Bible mérite une place à part : "Maintenant que je lis la Bible tous les jours comme un livre d'histoire, je ne peux me libérer de l'influence exercée par ce texte magnifique. Quand Matthieu parle des bienheureux, les larmes me montèrent aux yeux... Cette poésie est la plus profonde dont l'homme se soit jamais doté" (1947 - page 425). La littérature française y est beaucoup citée : Stendhal, Gide, Proust. "Il faut du temps pour lire Proust (...) ; on a besoin de quarante, cinquante pages avant de commencer à percevoir sa voix. Mais ensuite elle ne vous lâche plus" (1946 - page 383). Les auteurs russe (Dostoïevski), allemand (Goethe), anglais (Shakespeare), italien (Dante), ne sont pas en reste. Lors de son départ pour l'exil, il cite les cinq livres qui lui sont le plus chers (1948 - page 572).
Mais en réalité, ce qui lui est le plus cher, n'est-ce pas son fils ? On apprend au début du Journal que L. et lui ont perdu leur fils en 1939, quelques semaines après sa naissance. Citant le journal d'un curé de campagne de Georges Bernanos, il déclare, amer : "L'enfer, c'est de ne plus aimer" (1943 - page 35). Puis, peu à peu, Le Journal va s'illuminer par le projet d'adoption d'un enfant, "le petit garçon". Poursuivant sa réflexion, Márai cite alors Tolstoï, dans La mort d'Ivan Ilitch. Qu'apprend-il à l'heure de sa mort ? Ceci : "Je n'ai pas aimé ceux que j'aurais dû aimer" (1945 - page 308). Et la même année, Márai peut enfin déclarer : "János, l'enfant, a gagné : impossible de ne pas l'aimer" (1945 - page 326).
Le Journal est aussi le réceptacle de ses pensées personnelles sur des sujets variés. Sándor Márai y apparaît comme un homme cultivé, sensible, inquiet. Il nous décrit sa vie quotidienne, le temps qu'il fait, ses ennuis de santé ("la réponse qu'apportent les organes du ventre à des questions que l'intelligence n'arrive pas à résoudre") et ceux de L., sa femme, ses lectures et l'avancement de sa propre oeuvre littéraire...
Car Sándor Márai est un écrivain et la littérature, c'est toute sa vie : "Qu'est-ce qu'un écrivain ? Un homme chez qui la libido, ce courant vital, est plus forte que chez beaucoup d'autres. Ce courant, il faut le canaliser" (1943 - page 72). Il réfléchit à la mission de l'écrivain : "Par orgueil, par ambition, par avidité, nous avons (...) négligé notre obligation essentielle, à savoir l'éducation de la société et la clarification intransigeante des idées" (1944 - page 141). Auteur, Sándor Márai nous livre ses difficultés sur la création artistique et l'inspiration qu'elle requiert. L'écriture de son ouvrage Les offusqués lui demande un réel effort : "Je dois consacrer ce qui me reste de forces à terminer Les Offusqués. Sinon, tout aura été inutile et vain, mon travail et ma vie" (1944 - page 127). Il nous apprend qu'une oeuvre est en gestation tant qu'elle n'est pas aboutie : "La Soeur est arrivée à la croisée des chemins, il faut prendre une décision : roman ou livre de souvenirs ? Ce choix nécessite un effort considérable pour un écrivain. Je me sens fatigué" (1944 - page 143).
Le Journal nous donne également un aperçu de sa grande culture littéraire : de nombreux noms d'auteur et d'oeuvre y côtoient de nombreuses citations. La Bible mérite une place à part : "Maintenant que je lis la Bible tous les jours comme un livre d'histoire, je ne peux me libérer de l'influence exercée par ce texte magnifique. Quand Matthieu parle des bienheureux, les larmes me montèrent aux yeux... Cette poésie est la plus profonde dont l'homme se soit jamais doté" (1947 - page 425). La littérature française y est beaucoup citée : Stendhal, Gide, Proust. "Il faut du temps pour lire Proust (...) ; on a besoin de quarante, cinquante pages avant de commencer à percevoir sa voix. Mais ensuite elle ne vous lâche plus" (1946 - page 383). Les auteurs russe (Dostoïevski), allemand (Goethe), anglais (Shakespeare), italien (Dante), ne sont pas en reste. Lors de son départ pour l'exil, il cite les cinq livres qui lui sont le plus chers (1948 - page 572).
Mais en réalité, ce qui lui est le plus cher, n'est-ce pas son fils ? On apprend au début du Journal que L. et lui ont perdu leur fils en 1939, quelques semaines après sa naissance. Citant le journal d'un curé de campagne de Georges Bernanos, il déclare, amer : "L'enfer, c'est de ne plus aimer" (1943 - page 35). Puis, peu à peu, Le Journal va s'illuminer par le projet d'adoption d'un enfant, "le petit garçon". Poursuivant sa réflexion, Márai cite alors Tolstoï, dans La mort d'Ivan Ilitch. Qu'apprend-il à l'heure de sa mort ? Ceci : "Je n'ai pas aimé ceux que j'aurais dû aimer" (1945 - page 308). Et la même année, Márai peut enfin déclarer : "János, l'enfant, a gagné : impossible de ne pas l'aimer" (1945 - page 326).
De 1943 à sa mort en 1989, le grand écrivain Sandor Marai tient son Journal, dont de larges extraits sont aujourd'hui publiés en français. Ce premier tome, intitulé Les années hongroises 1943-1948, couvre la période de la guerre, de l'occupation allemande à l'occupation soviétique. Passionnant.
Durant ces cinq « années hongroises », que l'on pourrait aussi nommer années tragiques ou décisives, Sandor Marai est au coeur des grands drames du XX° siècle. Dans la capitale et à la campagne, il vit l'occupation nazie, la déportation des Juifs (dont son beau-père), les bombardements alliés, le siège de Budapest, la libération par l'armée rouge et la prise de pouvoir des communistes. Son beau-père est déporté, son appartement détruit par les bombes, sa maison de campagne réquisitionnée pour loger seize soldats de l'armée soviétique (plutôt sympathiques ces jeunes Russes admiratifs de l'écrivain). Ecoeuré par le nouveau régime, par la nationalisation des esprits et la confiscation des libertés, attaqué par la presse communiste, l'écrivain bourgeois (comme il aime à se qualifier) fuit ce pays dans lequel il n'a plus sa place. Il s'exile, la mort dans l'âme, et part vers la Suisse et l'Italie n'emportant que cinq livres dont L'Odyssée (lui qui possédait avant les bombardements une bibliothèque de plus de cinq mille livres.) Quitter la Hongrie est pour lui la seule manière de continuer à faire vivre la langue et la littérature hongroise.
Ce qui surprend dès les premières pages, c'est la forme originale de ce journal sans indications de dates. Constitué de paragraphes séparés par un trait, l'ouvrage est fait de notations plus ou moins brèves, de réflexions (entre Choses vues de Victor Hugo et Maximes de la Rochefoucauld), parfois de micro-récits, presque des nouvelles avec chute. Ce qui étonne aussi c'est l'humour dont fait preuve l'auteur (humour que ses romans ne laissaient pas soupçonner) tant envers la guerre qu'envers lui-même écrivain. Tout cela rend la lecture immédiatement et constamment prenante.
On découvre la complexité de la situation hongroise entre fascisme et communisme. Ennemi de de tous les totalitarismes, Sandor Marai est sans pitié à l'égard de ses compatriotes : dans ses analyses acerbes, il dénonce l'esprit de caste de ceux qu'il nomme « les gentilshommes hongrois chrétiens », l'opportunisme des anciens Croix fléchées pro-nazis qui s'empressent de mettre sur pied le parti communiste local, l'antisémitisme et l'esprit de revanche qui anime la société hongroise. Il décrit la fin d'un monde, incarné par le vieux café où il se rend après le bain de vapeur : « Thé, viandes froides, journaux. le refuge tiède de la civilisation. Et la conscience que ce bonheur est plus fragile encore que la tasse de thé en verre que tu portes à tes lèvres. » Il constate et déplore l'absence d'une bourgeoisie consciente et cultivée et l'impossibilité pour la Hongrie d'accéder dans l'immédiat à la démocratie.
On découvre aussi la force, l'intelligence et la sensibilité d'un homme en temps de guerre, un lecteur, un écrivain. Il lit, relit sans cesse : Platon et Goethe sous les bombardements alliés, La Chartreuse de Parme pendant la chute de Buda (on se souvient que Giono a fait toute la guerre de 1914 avec ce roman dans sa veste), les classiques comme les plus contemporains, La Peste dès sa parution en 1947. Il se nourrit de ses lectures, établit des échos entre passé et présent : Les Oiseaux d'Aristophane « terriblement actuel », le Juif de Malte de Marlowe, figure éternelle de l'antisémitisme, Les Châtiments « effroyablement contemporain »… Et surtout il travaille, il écrit sans relâche, même dans des conditions de vie difficile. Il est même prolifique : durant ces années de guerre, il rédige, outre son journal, pas moins de cinq romans. Il écrit « pour le tiroir » puisque, depuis 1944 et l'instauration de la censure, il a décidé de ne plus publier ni d'écrire pour les journaux. L'écriture est pour lui à la fois une discipline, une drogue, un témoignage, une obligation morale : « Si je ne travaille pas, je meurs. »
Il confie aussi les plaisirs simples et quotidiens - le bonheur de manger de nouveau des petits pains beurrés, les promenades au zoo avec Janos, le petit garçon qu'il a adopté - les sentiments, les émotions intimes. Bien sûr, la mort est là, omniprésente en ces temps de guerre, mais il la rend sensible quand il parle de son vieux chien ou de sa tante Julie qui, à quatre-vingt-neuf ans, s'accroche à la vie. Et il s'interroge : « Quel est le plus beau souvenir de ces cinq années? Qu'est-ce qui a été le plus beau? C'est la vie qui était belle, la vie tout entière, dans sa totalité, même au milieu de la souffrance. »
Témoignage d'un immense intérêt historique, le Journal de Sandor Marai est aussi un texte à valeur universelle parce que c'est celui d'un grand écrivain. Comme il le note à propos du Journal de guerre de Gide : « les seuls passages dignes d'être retenus sont ceux qui ne rendent pas compte de l'actualité. »
Journal, Les Années hongroises 1943-1948, traduit du hongrois par Catherine Fay, Albin Michel, 2019, 523 pages.
Lien : http://www.lesheuresperdues...
Durant ces cinq « années hongroises », que l'on pourrait aussi nommer années tragiques ou décisives, Sandor Marai est au coeur des grands drames du XX° siècle. Dans la capitale et à la campagne, il vit l'occupation nazie, la déportation des Juifs (dont son beau-père), les bombardements alliés, le siège de Budapest, la libération par l'armée rouge et la prise de pouvoir des communistes. Son beau-père est déporté, son appartement détruit par les bombes, sa maison de campagne réquisitionnée pour loger seize soldats de l'armée soviétique (plutôt sympathiques ces jeunes Russes admiratifs de l'écrivain). Ecoeuré par le nouveau régime, par la nationalisation des esprits et la confiscation des libertés, attaqué par la presse communiste, l'écrivain bourgeois (comme il aime à se qualifier) fuit ce pays dans lequel il n'a plus sa place. Il s'exile, la mort dans l'âme, et part vers la Suisse et l'Italie n'emportant que cinq livres dont L'Odyssée (lui qui possédait avant les bombardements une bibliothèque de plus de cinq mille livres.) Quitter la Hongrie est pour lui la seule manière de continuer à faire vivre la langue et la littérature hongroise.
Ce qui surprend dès les premières pages, c'est la forme originale de ce journal sans indications de dates. Constitué de paragraphes séparés par un trait, l'ouvrage est fait de notations plus ou moins brèves, de réflexions (entre Choses vues de Victor Hugo et Maximes de la Rochefoucauld), parfois de micro-récits, presque des nouvelles avec chute. Ce qui étonne aussi c'est l'humour dont fait preuve l'auteur (humour que ses romans ne laissaient pas soupçonner) tant envers la guerre qu'envers lui-même écrivain. Tout cela rend la lecture immédiatement et constamment prenante.
On découvre la complexité de la situation hongroise entre fascisme et communisme. Ennemi de de tous les totalitarismes, Sandor Marai est sans pitié à l'égard de ses compatriotes : dans ses analyses acerbes, il dénonce l'esprit de caste de ceux qu'il nomme « les gentilshommes hongrois chrétiens », l'opportunisme des anciens Croix fléchées pro-nazis qui s'empressent de mettre sur pied le parti communiste local, l'antisémitisme et l'esprit de revanche qui anime la société hongroise. Il décrit la fin d'un monde, incarné par le vieux café où il se rend après le bain de vapeur : « Thé, viandes froides, journaux. le refuge tiède de la civilisation. Et la conscience que ce bonheur est plus fragile encore que la tasse de thé en verre que tu portes à tes lèvres. » Il constate et déplore l'absence d'une bourgeoisie consciente et cultivée et l'impossibilité pour la Hongrie d'accéder dans l'immédiat à la démocratie.
On découvre aussi la force, l'intelligence et la sensibilité d'un homme en temps de guerre, un lecteur, un écrivain. Il lit, relit sans cesse : Platon et Goethe sous les bombardements alliés, La Chartreuse de Parme pendant la chute de Buda (on se souvient que Giono a fait toute la guerre de 1914 avec ce roman dans sa veste), les classiques comme les plus contemporains, La Peste dès sa parution en 1947. Il se nourrit de ses lectures, établit des échos entre passé et présent : Les Oiseaux d'Aristophane « terriblement actuel », le Juif de Malte de Marlowe, figure éternelle de l'antisémitisme, Les Châtiments « effroyablement contemporain »… Et surtout il travaille, il écrit sans relâche, même dans des conditions de vie difficile. Il est même prolifique : durant ces années de guerre, il rédige, outre son journal, pas moins de cinq romans. Il écrit « pour le tiroir » puisque, depuis 1944 et l'instauration de la censure, il a décidé de ne plus publier ni d'écrire pour les journaux. L'écriture est pour lui à la fois une discipline, une drogue, un témoignage, une obligation morale : « Si je ne travaille pas, je meurs. »
Il confie aussi les plaisirs simples et quotidiens - le bonheur de manger de nouveau des petits pains beurrés, les promenades au zoo avec Janos, le petit garçon qu'il a adopté - les sentiments, les émotions intimes. Bien sûr, la mort est là, omniprésente en ces temps de guerre, mais il la rend sensible quand il parle de son vieux chien ou de sa tante Julie qui, à quatre-vingt-neuf ans, s'accroche à la vie. Et il s'interroge : « Quel est le plus beau souvenir de ces cinq années? Qu'est-ce qui a été le plus beau? C'est la vie qui était belle, la vie tout entière, dans sa totalité, même au milieu de la souffrance. »
Témoignage d'un immense intérêt historique, le Journal de Sandor Marai est aussi un texte à valeur universelle parce que c'est celui d'un grand écrivain. Comme il le note à propos du Journal de guerre de Gide : « les seuls passages dignes d'être retenus sont ceux qui ne rendent pas compte de l'actualité. »
Journal, Les Années hongroises 1943-1948, traduit du hongrois par Catherine Fay, Albin Michel, 2019, 523 pages.
Lien : http://www.lesheuresperdues...
Citations et extraits (49)
Voir plus
Ajouter une citation
(Janvier 1945, prise de Kassa, ville natale de l'auteur).
Kassa est tombée.
Il est prévisible, voire probable, que Kassa ne sera plus, plus jamais, une ville hongroise ; les Slaves vont absorber cette belle ville, la cité de Rakoczi.
C'est quelque chose de douloureux pour tous les Hongrois et particulièrement pour moi ; depuis deux jours, je pense à Kassa comme à une morte bien-aimée. Mais en réalité, ce n'est pas le jour où les troupes russes sont entrées dans la ville que les Hongrois ont perdu Kassa ; c'est en novembre 1938, le jour où les troupes de Horthy ont fait irruption devant la cathédrale, que nous l'avons perdue, et pour toujours. Oui, nous l'avons perdue, parce que nous lui apportions alors la pire forme de la réaction : l'arbitraire des fonctionnaires veules et cupides, des corps administratifs et militaires incultes et arrogants ; nous apportions à une ville qui avait goûté à la démocratie avec les Tchèques l'esprit de servilité hongrois envers les Messieurs, les Excellences et les Grandeurs ; nous apportions tout ce qui était mauvais dans la Hongrie de Trianon [note : Hongrie née des sanctions du traité de Trianon, 1920]. La Hongrie des passe-droits, des privilèges, des parvenus, des dilettantes et de la sous-culture néo-baroque avait défilé ce jour-là dans Kassa, où l'on connaissait un autre type de Hongrois et un mode de vie européen. C'est alors que nous avons vraiment perdu Kassa, sans doute à jamais. Nous méritons le châtiment car nous lui avons fait défaut. Ces dernières années, on n'aurait pu trouver un seul natif de la ville qui n'eût pas attendu le retour des Tchèques.
pp. 189-190
Kassa est tombée.
Il est prévisible, voire probable, que Kassa ne sera plus, plus jamais, une ville hongroise ; les Slaves vont absorber cette belle ville, la cité de Rakoczi.
C'est quelque chose de douloureux pour tous les Hongrois et particulièrement pour moi ; depuis deux jours, je pense à Kassa comme à une morte bien-aimée. Mais en réalité, ce n'est pas le jour où les troupes russes sont entrées dans la ville que les Hongrois ont perdu Kassa ; c'est en novembre 1938, le jour où les troupes de Horthy ont fait irruption devant la cathédrale, que nous l'avons perdue, et pour toujours. Oui, nous l'avons perdue, parce que nous lui apportions alors la pire forme de la réaction : l'arbitraire des fonctionnaires veules et cupides, des corps administratifs et militaires incultes et arrogants ; nous apportions à une ville qui avait goûté à la démocratie avec les Tchèques l'esprit de servilité hongrois envers les Messieurs, les Excellences et les Grandeurs ; nous apportions tout ce qui était mauvais dans la Hongrie de Trianon [note : Hongrie née des sanctions du traité de Trianon, 1920]. La Hongrie des passe-droits, des privilèges, des parvenus, des dilettantes et de la sous-culture néo-baroque avait défilé ce jour-là dans Kassa, où l'on connaissait un autre type de Hongrois et un mode de vie européen. C'est alors que nous avons vraiment perdu Kassa, sans doute à jamais. Nous méritons le châtiment car nous lui avons fait défaut. Ces dernières années, on n'aurait pu trouver un seul natif de la ville qui n'eût pas attendu le retour des Tchèques.
pp. 189-190
Budapest (1943). Adieux à mon appartement. Je ne possède rien d'autre que les livres dans ma chambre. Parmi eux, il y en a un millier que j'aime, un millier avec lesquels j'ai un lien personnel. Si ces livres disparaissent ... eh bien, cela n'entraînera sans doute rien d'essentiel pour moi.
Tout de même, c'est en eux que je puise des forces. Sans eux, je me sens particulièrement sourd. Cette pièce avec des livres, c'est ma patrie... Dans les bibliothèques étrangères, je ne retrouve pas ce qui me lie à l'esprit qui émane de ces livres-là, dans cet endroit-là, et qui s'adresse à moi. Si demain une bombe détruit cette pièce, je me retrouverai sans patrie. Il faut en être conscient. Mais sans se plaindre. La bombe est là, elle tournoie quelque part dans l'air au-dessus de nos têtes, elle peut tomber à tout moment. Vraiment, il faudrait un miracle pour qu'elle ne tombe pas. Et pourtant, il faut y croire, à ce miracle. Mais ne compter sur personne, ne rien espérer. Il faut se taire, travailler, autant que possible. Et, autant que possible, considérer avec un bonheur reconnaissant ces livres, mes derniers amis.
pp. 56-57
Tout de même, c'est en eux que je puise des forces. Sans eux, je me sens particulièrement sourd. Cette pièce avec des livres, c'est ma patrie... Dans les bibliothèques étrangères, je ne retrouve pas ce qui me lie à l'esprit qui émane de ces livres-là, dans cet endroit-là, et qui s'adresse à moi. Si demain une bombe détruit cette pièce, je me retrouverai sans patrie. Il faut en être conscient. Mais sans se plaindre. La bombe est là, elle tournoie quelque part dans l'air au-dessus de nos têtes, elle peut tomber à tout moment. Vraiment, il faudrait un miracle pour qu'elle ne tombe pas. Et pourtant, il faut y croire, à ce miracle. Mais ne compter sur personne, ne rien espérer. Il faut se taire, travailler, autant que possible. Et, autant que possible, considérer avec un bonheur reconnaissant ces livres, mes derniers amis.
pp. 56-57
Je me demande à quel point Erasme était "lâche". En fin de compte, il n'y aurait rien eu de plus facile pour lui que de se déclarer pour un parti quelconque. On ne lui demandait rien de particulier : le pape et l'empereur lui faisaient miroiter des biens terrestres, une barrette de cardinal, quant à Luther et Ulrich von Hutten, ils faisaient tout pour l'attirer dans leur camp. Chaque parti lui aurait décerné une attestation d'appartenance et on l'aurait mis dans une vitrine. Mais le "lâche" Erasme n'a jamais appartenu à aucun parti, justement parce qu'il était humaniste et qu'il savait qu'un parti, c'était toujours une trahison à l'encontre d'un tout, qu'une faction reste toujours une faction et que cela bafoue la liberté d'esprit.
Budapest, 1947, p. 370. [On pense à Brecht et à tant d'autres, momifiés par le Parti Communiste, et à la tentation du confort qui devait être celle de Marai en ce temps-là. ]
Budapest, 1947, p. 370. [On pense à Brecht et à tant d'autres, momifiés par le Parti Communiste, et à la tentation du confort qui devait être celle de Marai en ce temps-là. ]
À dix heures du soir, je sors mon volume de Racine de ma bibliothèque, une belle édition du milieu du XIXe siècle, et je commence à lire Phèdre. J'en suis au début du deuxième acte quand la radio qui diffusait de la musique dans la troisième pièce de l'appartement se tait et reprend, en claironnant : " Attention ! Alerte aérienne ! " Et elle donne des chiffres. Les Anglais sont entrés quelque part dans l'espace aérien hongrois. Je lève les yeux de Phèdre et j'écoute. C'est tout les jours la même chose, on crie au loup, et nous nous y habituons peu à peu. Il est possible qu'il ne se passe rien mais il se peut aussi que je disparaisse dans quelques minutes avec le quartier où j'habite. " S'habitue-t-on " vraiment à cela ?... En m'observant, à ma grande surprise, je suis obligé de répondre que, oui, on s'habitue. Aucune crainte, aucune révolte dans mon cœur. Le destin indifférent me tient entre ses mains. Moi aussi, je suis indifférent. Je continue ma lecture, j'écoute les râles d'Hyppolite. Les Français, et Jules Renard avec eux, placent Racine au-dessus de Shakespeare. C'est exagéré, d'après moi. Puis je ferme le livre et je m'endors. ( Journal, année 1943 )
J'en ai assez de Montaigne. Pourtant cela fait plusieurs jours que je pioche au sein de ce fatras les deux, trois
phrases qui donnent leur valeur à ses livres et à lui-même. Mais même un esprit supérieur n'a pas le droit de délayer ainsi ce "quelque chose" qui épice la saveur de son plat. Et parce que Montaigne est en effet un sage, le plus jovial des stoïques, un latiniste attachant, un Français rusé et un humaniste érudit, il mériterait que l'on extraie de ce méli-mélo le véritable Montaigne. Ce qui tiendrait en un mince volume mais serait un chef-d'oeuvre. Il ne suffit pas d'être sage. Il faut également être parfait.
Ce grand Français ne possède pas le sens de la mesure. cet être à la pensée dense fractionne cette densité avec ses bavardages. Il tire une grande fierté de sa connaissance du latin et de ses nombreuses lectures. Son lecteur aimerait l'interrompre : " Oui, bien sûr que nous croyons que tu as lu Lucrèce, Suétone et Juvénal. Mais, toi, Montaigne, quand prendras-tu enfin la parole ? ... Il la prend, certes, parfois, en passant, mais en attendant, le lecteur se lasse de Lucrèce et de Suétone.
( Journal, année 1943 )
Je me doute parfois de ce qu'a pu ressentir Montaigne, écrivain et aristocrate, et maire pendant trente ans, à l'époque des guerres de religion. Quant tout le monde était suspect d'appartenir à tel ou tel camp. Quand chaque jour, les hordes enragées de passage contraignaient tous les membres d'une maisonnée à avouer sous la torture à quel camp ils appartenaient. Aujourd'hui, nous, écrivains et gentlemen, vivons de la même manière, particulièrement ceux parmi les écrivains qui sont aussi des gentlemen dans l'âme, ce qui, bien entendu, n'est pas une question d'origine. Socialistes, blancs, rouges, communistes, nazis, ainsi que les francs-tireurs intellectuels libéraux démocrates pris de rage, les offensés et les laissés-pour-compte, tous revendiquent quelque chose, tous cherchent à se venger, tous veulent à la fois me rallier à eux et me rejeter, tous veulent que je prête serment et, en même temps, que je monte de moi-même sur quelque bûcher de circonstance. Tout ceci est tragique, c'est certain. Mais également ennuyeux, tout aussi certain. Oui. Je commence à comprendre ce qu'a dû ressentir Montaigne.
(Journal, année 1944).
phrases qui donnent leur valeur à ses livres et à lui-même. Mais même un esprit supérieur n'a pas le droit de délayer ainsi ce "quelque chose" qui épice la saveur de son plat. Et parce que Montaigne est en effet un sage, le plus jovial des stoïques, un latiniste attachant, un Français rusé et un humaniste érudit, il mériterait que l'on extraie de ce méli-mélo le véritable Montaigne. Ce qui tiendrait en un mince volume mais serait un chef-d'oeuvre. Il ne suffit pas d'être sage. Il faut également être parfait.
Ce grand Français ne possède pas le sens de la mesure. cet être à la pensée dense fractionne cette densité avec ses bavardages. Il tire une grande fierté de sa connaissance du latin et de ses nombreuses lectures. Son lecteur aimerait l'interrompre : " Oui, bien sûr que nous croyons que tu as lu Lucrèce, Suétone et Juvénal. Mais, toi, Montaigne, quand prendras-tu enfin la parole ? ... Il la prend, certes, parfois, en passant, mais en attendant, le lecteur se lasse de Lucrèce et de Suétone.
( Journal, année 1943 )
Je me doute parfois de ce qu'a pu ressentir Montaigne, écrivain et aristocrate, et maire pendant trente ans, à l'époque des guerres de religion. Quant tout le monde était suspect d'appartenir à tel ou tel camp. Quand chaque jour, les hordes enragées de passage contraignaient tous les membres d'une maisonnée à avouer sous la torture à quel camp ils appartenaient. Aujourd'hui, nous, écrivains et gentlemen, vivons de la même manière, particulièrement ceux parmi les écrivains qui sont aussi des gentlemen dans l'âme, ce qui, bien entendu, n'est pas une question d'origine. Socialistes, blancs, rouges, communistes, nazis, ainsi que les francs-tireurs intellectuels libéraux démocrates pris de rage, les offensés et les laissés-pour-compte, tous revendiquent quelque chose, tous cherchent à se venger, tous veulent à la fois me rallier à eux et me rejeter, tous veulent que je prête serment et, en même temps, que je monte de moi-même sur quelque bûcher de circonstance. Tout ceci est tragique, c'est certain. Mais également ennuyeux, tout aussi certain. Oui. Je commence à comprendre ce qu'a dû ressentir Montaigne.
(Journal, année 1944).
Videos de Sándor Márai (13)
Voir plusAjouter une vidéo
autres livres classés : journal intimeVoir plus

Le journal d'Aurélie Laflamme, tome 1 : Extraterrestre... ou presque !
India Desjardins
178
critiques
33
citations
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Sándor Márai (25)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3189 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3189 lecteurs ont répondu