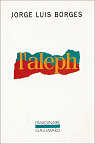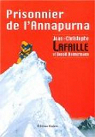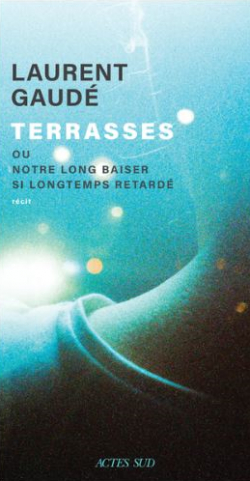Hector Berlioz
Pierre Citron (Éditeur scientifique)/5 21 notes
Les Mémoires de Berlioz tracent le portrait exemplaire d'une sensibilité à l'époque romantique. Né en 1803, Berlioz est le contemporain de Hugo, de Delacroix et l'aîné de quelques années de Mendelssohn, Chopin, Liszt, Schumann et Wagner ; il demeure cependant une figure isolée dans le paysage musical français et la singularité flamboyante de son ouvre suscite en France ironie et scepticisme. Trop souv... >Voir plus
Pierre Citron (Éditeur scientifique)/5 21 notes
Résumé :
Les Mémoires de Berlioz tracent le portrait exemplaire d'une sensibilité à l'époque romantique. Né en 1803, Berlioz est le contemporain de Hugo, de Delacroix et l'aîné de quelques années de Mendelssohn, Chopin, Liszt, Schumann et Wagner ; il demeure cependant une figure isolée dans le paysage musical français et la singularité flamboyante de son ouvre suscite en France ironie et scepticisme. Trop souv... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après MémoiresVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (4)
Ajouter une critique
- Berlioz, vous connaissez, les enfants ?
- Facile, Berlioz, avec Marie et Toulouse, sont les trois chatons de Duchesse dans les « Aristochats » !
- Mmouais, c'est pas faux, comme dirait Perceval, mais à part ça, ce nom ne dit rien à personne ?
- Si, c'est un musicien, je crois ?
- Tu peux en être sûr ! Un des plus grands. L'histoire de la musique française ne serait pas la même s'il n'y avait pas eu Berlioz ! Voyez-vous, Hector Berlioz, en musique, a fait ce que faisaient à la même époque Victor Hugo en littérature et Eugène Delacroix en peinture : la révolution romantique. Révolution, parce que c'était un sacré coup de balai sur une tradition en train de se scléroser ; et romantique, parce que le Romantisme est un mouvement des idées qui a secoué la fin du XVIIIème siècle (en Allemagne et en Angleterre) et la première moitié (au moins) du XIXème siècle (dans le reste de l'Europe et donc en France).
- Berlioz était donc un romantique ?
- Un peu, mon neveu. On peut même dire que c'était un romantique à l'état pur. Mais savez-vous qu'en plus d'être un génie de la musique, il avait aussi un excellent don d'écriture : pendant des années il a tenu une rubrique dans Le Journal des débats, où il étalait ses états d'âmes, fustigeant la médiocrité des créations contemporaines (en particulier une haine tenace contre Cherubini) et portant aux nues les compositeurs qu'il idolâtrait, Beethoven, Glück ou Weber. Et puis il nous a laissé ses « Mémoires » qui ne sont parus qu'en 1870, à titre posthume (il était mort en 1869, à l'âge de 66 ans).
Ecrire ses mémoires, en soi, n'est pas un acte nouveau : Rousseau et Chateaubriand l'avaient fait avec lui. Mais l'époque n'était pas la même, et la sensibilité non plus, quoique l'un et l'autre ont eu une influence prépondérante sur le romantisme français. Quand Berlioz commence à rédiger ses souvenirs, il pense à une autobiographie, mais aussi à une histoire de son oeuvre, et à travers elle, au tableau musical de toute une époque. Et de fait, ces « Mémoires » sont autant une évocation extrêmement vivante de sa vie et des amours, que la lente description de son évolution musicale, son parcours personnel, ses influences, ses haines, parfois, et la place qu'il prend sur la scène musicale.
Pour autant, ces « Mémoires » sont-ils un document ? Sans aucun doute oui. On y respire toute une époque, où le sentiment prévaut, où le génie (littéraire, artistique ou musical) se manifeste obligatoirement par le coeur autant que par la raison. Berlioz, comme Hugo, ou Delacroix (qui lui aussi a laissé un Journal très intéressant), laisse paraître sa sensibilité dans tout ce qu'il fait, ses écrits comme ses partitions. Bien sûr, on pourra relever çà et là des inexactitudes, ou des approximations, et même des oublis, volontaires ou pas. Il reste cependant que ces « mémoires » constituent un témoignage important de cet autre « enfant du siècle ».
L'impression, en lisant ces « Mémoires », est que Berlioz ne nous livre pas seulement son « vécu », mais également son « vivant » : dans ces mémoires qui ont été rédigés tout au long de sa vie, on sent l'accent de l'authentique. Berlioz ne cache rien de ses sentiments, de ses haines comme de ses amours. Des quatre femmes de sa vie, il en est une qui bizarrement tient une grande place : ce n'est pas Camille Moke, qui l'a enflammé en 1830, ce n'est pas Harriett Simpson, qui lui a inspiré nombre de succès musicaux (mais bien des déboires sentimentaux), ce n'est pas Marie Recio qui elle n'avait rien pour elle, semble-t-il, que son physique, non, la femme qui a le plus marqué Berlioz, c'est Estelle Duboeuf, future Estelle Fornier), son tout premier amour (il avait douze ans), qu'il a aimée toute sa vie, et dont le retrouvailles à la fin de sa vie constituent un des moments les plus émouvants des « Mémoires »
Un livre remarquable, incontournable si l'on s'intéresse à la musique, incontournable si l'on s'intéresse à l'histoire littéraire. Et même, si ces deux intérêts vous sont étrangers, vous aurez quand même grand plaisir à lire ces pages vivantes, parfois enjouées, parfois techniques, et toujours enrichissantes. Fantastiques, comme… disons, une symphonie !
- Facile, Berlioz, avec Marie et Toulouse, sont les trois chatons de Duchesse dans les « Aristochats » !
- Mmouais, c'est pas faux, comme dirait Perceval, mais à part ça, ce nom ne dit rien à personne ?
- Si, c'est un musicien, je crois ?
- Tu peux en être sûr ! Un des plus grands. L'histoire de la musique française ne serait pas la même s'il n'y avait pas eu Berlioz ! Voyez-vous, Hector Berlioz, en musique, a fait ce que faisaient à la même époque Victor Hugo en littérature et Eugène Delacroix en peinture : la révolution romantique. Révolution, parce que c'était un sacré coup de balai sur une tradition en train de se scléroser ; et romantique, parce que le Romantisme est un mouvement des idées qui a secoué la fin du XVIIIème siècle (en Allemagne et en Angleterre) et la première moitié (au moins) du XIXème siècle (dans le reste de l'Europe et donc en France).
- Berlioz était donc un romantique ?
- Un peu, mon neveu. On peut même dire que c'était un romantique à l'état pur. Mais savez-vous qu'en plus d'être un génie de la musique, il avait aussi un excellent don d'écriture : pendant des années il a tenu une rubrique dans Le Journal des débats, où il étalait ses états d'âmes, fustigeant la médiocrité des créations contemporaines (en particulier une haine tenace contre Cherubini) et portant aux nues les compositeurs qu'il idolâtrait, Beethoven, Glück ou Weber. Et puis il nous a laissé ses « Mémoires » qui ne sont parus qu'en 1870, à titre posthume (il était mort en 1869, à l'âge de 66 ans).
Ecrire ses mémoires, en soi, n'est pas un acte nouveau : Rousseau et Chateaubriand l'avaient fait avec lui. Mais l'époque n'était pas la même, et la sensibilité non plus, quoique l'un et l'autre ont eu une influence prépondérante sur le romantisme français. Quand Berlioz commence à rédiger ses souvenirs, il pense à une autobiographie, mais aussi à une histoire de son oeuvre, et à travers elle, au tableau musical de toute une époque. Et de fait, ces « Mémoires » sont autant une évocation extrêmement vivante de sa vie et des amours, que la lente description de son évolution musicale, son parcours personnel, ses influences, ses haines, parfois, et la place qu'il prend sur la scène musicale.
Pour autant, ces « Mémoires » sont-ils un document ? Sans aucun doute oui. On y respire toute une époque, où le sentiment prévaut, où le génie (littéraire, artistique ou musical) se manifeste obligatoirement par le coeur autant que par la raison. Berlioz, comme Hugo, ou Delacroix (qui lui aussi a laissé un Journal très intéressant), laisse paraître sa sensibilité dans tout ce qu'il fait, ses écrits comme ses partitions. Bien sûr, on pourra relever çà et là des inexactitudes, ou des approximations, et même des oublis, volontaires ou pas. Il reste cependant que ces « mémoires » constituent un témoignage important de cet autre « enfant du siècle ».
L'impression, en lisant ces « Mémoires », est que Berlioz ne nous livre pas seulement son « vécu », mais également son « vivant » : dans ces mémoires qui ont été rédigés tout au long de sa vie, on sent l'accent de l'authentique. Berlioz ne cache rien de ses sentiments, de ses haines comme de ses amours. Des quatre femmes de sa vie, il en est une qui bizarrement tient une grande place : ce n'est pas Camille Moke, qui l'a enflammé en 1830, ce n'est pas Harriett Simpson, qui lui a inspiré nombre de succès musicaux (mais bien des déboires sentimentaux), ce n'est pas Marie Recio qui elle n'avait rien pour elle, semble-t-il, que son physique, non, la femme qui a le plus marqué Berlioz, c'est Estelle Duboeuf, future Estelle Fornier), son tout premier amour (il avait douze ans), qu'il a aimée toute sa vie, et dont le retrouvailles à la fin de sa vie constituent un des moments les plus émouvants des « Mémoires »
Un livre remarquable, incontournable si l'on s'intéresse à la musique, incontournable si l'on s'intéresse à l'histoire littéraire. Et même, si ces deux intérêts vous sont étrangers, vous aurez quand même grand plaisir à lire ces pages vivantes, parfois enjouées, parfois techniques, et toujours enrichissantes. Fantastiques, comme… disons, une symphonie !
J'avais 20 ans et quelques, je découvrais l'art lyrique, un ami me fit écouter le morceau du concours de Rome où Berlioz échoua cette fois encore: La Mort de Cléopâtre.Interprète: Janet Baker.
Saisissement, étonnement, rire même à la dixième écoute.Il y a des facéties musicales réjouissantes qui secouent un peu les paroles pompeuses et lourdes (ah! le" vil reptile"! )
Orchestre démentiel, expressionisme, romantisme, voix détimbrée de Miss Baker pour traduire les affres et le remord de la "Veuve d'Antoine et veuve de César, au pouvoir d'Octave livrée"Cela ne ressemblait à rien de ce que je connaissais.
Plus tard Les Troyens m'ont livré quelques merveilles et enfin L'Enfance du Christ m'a charmée de sa délicatesse (L'Adieu des bergers à la Sainte Famille ferait pleurer un taxidermiste)
Mais qui est Berlioz? Un provincial qui s'émancipe de la lourde tutelle du papa médecin,et qui dissèque quelques semaines les cadavres avant de suivre sa vocation musicale et de jouer du flageolet.
Etudiant pauvre, il court le cachet et se fâche avec tout ce qui compte dans le monde musical. il va à l'opéra, au poulailler, déroule sa partition sur ses genoux et se lève courroucé pour dénoncer les timbales qui ne partent pas, les trompettes qui ne trompettent pas, et, sacrilège des sacrilèges, une interprétation tronquée: "qui donc se permet de corriger Glück??" éructe-t-il durant un silence de l'orchestre, à la grande confusion du chef, et à la grande joie des étudiants fauchés qui s'engouffrent dans un chahut monstre.Les têtes chapeautées ou aigrettées des dames se tournent vers lui.
C'est un braillard au nez en bec d'aigle, aux cheveux incandescents et ébouriffés, l'oeil méchant et l'écume aux lèvres. Un vrai punk, en somme. Il a écrit ces épisodes caractériels, son bras de fer avec les vieux profs du Conservatoire de Paris où il fait peur à tout le monde, avec une vanité ingénue qui passe très bien.Il raconte aussi son propre parcours vers la musique, ce qu'il croit, et à quoi il croit. Il a toujours une cause à défendre, mais sait aussi se dénommer ver de terre amoureux d'une étoile: Miss Harriett Smithson
L'anglaise actrice de théâtre, à qui il fera une cour effrénée, et qui se révélera bipolaire, ou neurasthénique, et qu'il n'abandonnera pas, pourtant.
Et il rédige ses mémoires, pour consigner tout ce bruit et cette fureur.
Méchant, souvent spirituel, ce brûlot au style journalistique fait toujours mouche. Il ne fait pas bon se trouver sous ses flêches.
Il a du souffle, pour parler de ses passions, Berlioz.
Mais le plus beau est à la fin du livre, quand il nous fait vivre de façon très "cinématographique" ses retrouvailles avec une femme plus âgée, dont il tomba amoureux au sortir de l'enfance,qu'il aima longtemps, qu'il aima toujours, et qui se refusa à ses avances, même quand elle eût pu, libre, les accepter car elle comprit à la fin de quel amour vrai et sincère elle était et resta l'objet. Cette scène là, à la fois retrouvailles pour l'éternité et séparation définitive, est une des plus émouvante que j'aie lue, ou fantasmée à la lecture.
Rire, critique féroce, style percutant et images à l'emporte pièce, c'est bien, bien meilleur que Pacadis et Beigbeder réunis.
Sa capacité à s'enflammer pour une femme, puis à se consumer ensuite, sa tendresse jointe à son caractère atrabilaire, cela fait de ses Mémoires un sacré bon livre!
Saisissement, étonnement, rire même à la dixième écoute.Il y a des facéties musicales réjouissantes qui secouent un peu les paroles pompeuses et lourdes (ah! le" vil reptile"! )
Orchestre démentiel, expressionisme, romantisme, voix détimbrée de Miss Baker pour traduire les affres et le remord de la "Veuve d'Antoine et veuve de César, au pouvoir d'Octave livrée"Cela ne ressemblait à rien de ce que je connaissais.
Plus tard Les Troyens m'ont livré quelques merveilles et enfin L'Enfance du Christ m'a charmée de sa délicatesse (L'Adieu des bergers à la Sainte Famille ferait pleurer un taxidermiste)
Mais qui est Berlioz? Un provincial qui s'émancipe de la lourde tutelle du papa médecin,et qui dissèque quelques semaines les cadavres avant de suivre sa vocation musicale et de jouer du flageolet.
Etudiant pauvre, il court le cachet et se fâche avec tout ce qui compte dans le monde musical. il va à l'opéra, au poulailler, déroule sa partition sur ses genoux et se lève courroucé pour dénoncer les timbales qui ne partent pas, les trompettes qui ne trompettent pas, et, sacrilège des sacrilèges, une interprétation tronquée: "qui donc se permet de corriger Glück??" éructe-t-il durant un silence de l'orchestre, à la grande confusion du chef, et à la grande joie des étudiants fauchés qui s'engouffrent dans un chahut monstre.Les têtes chapeautées ou aigrettées des dames se tournent vers lui.
C'est un braillard au nez en bec d'aigle, aux cheveux incandescents et ébouriffés, l'oeil méchant et l'écume aux lèvres. Un vrai punk, en somme. Il a écrit ces épisodes caractériels, son bras de fer avec les vieux profs du Conservatoire de Paris où il fait peur à tout le monde, avec une vanité ingénue qui passe très bien.Il raconte aussi son propre parcours vers la musique, ce qu'il croit, et à quoi il croit. Il a toujours une cause à défendre, mais sait aussi se dénommer ver de terre amoureux d'une étoile: Miss Harriett Smithson
L'anglaise actrice de théâtre, à qui il fera une cour effrénée, et qui se révélera bipolaire, ou neurasthénique, et qu'il n'abandonnera pas, pourtant.
Et il rédige ses mémoires, pour consigner tout ce bruit et cette fureur.
Méchant, souvent spirituel, ce brûlot au style journalistique fait toujours mouche. Il ne fait pas bon se trouver sous ses flêches.
Il a du souffle, pour parler de ses passions, Berlioz.
Mais le plus beau est à la fin du livre, quand il nous fait vivre de façon très "cinématographique" ses retrouvailles avec une femme plus âgée, dont il tomba amoureux au sortir de l'enfance,qu'il aima longtemps, qu'il aima toujours, et qui se refusa à ses avances, même quand elle eût pu, libre, les accepter car elle comprit à la fin de quel amour vrai et sincère elle était et resta l'objet. Cette scène là, à la fois retrouvailles pour l'éternité et séparation définitive, est une des plus émouvante que j'aie lue, ou fantasmée à la lecture.
Rire, critique féroce, style percutant et images à l'emporte pièce, c'est bien, bien meilleur que Pacadis et Beigbeder réunis.
Sa capacité à s'enflammer pour une femme, puis à se consumer ensuite, sa tendresse jointe à son caractère atrabilaire, cela fait de ses Mémoires un sacré bon livre!
Plonger dans la vie exaltée d'un grand musicien donne à sa musique un supplément de coeur. Berlioz incarne à merveille l'artiste romantique, en est presque la carricature. Il s'enflame pour l'art et l'amour, les fusionne en une épouse shakespearienne, et pourfend, donquichotesquement, les moeurs musicales dissolues de ses contemporains, qui (horreur ultime, impensable aujourd'hui et dans l'esprit en avance de Berlioz) réarrangent les symphonies de Beeethoven et sont incapables de monter correctement la moindre petite oeuvre à mille exécutants du brave Hector, qui erre à travers l'Europe dans l'espoir de trouver un ophycléide jouant juste. Tantôt fleur bleue, quand, vieux, il réécrit au rêve amoureux de ses douze ans, tantôt féroce, quand il décrit comment le jury (des architectes et des scultpeurs...) déscernait le prix de Rome, quand il zozotte la méchanteté de Cherubini et de tous les directeurs d'opéras et de conservatoires, ou quand il énonce les compétences des musiciens qui ne l'aiment pas, Berlioz parvient à captiver un lecteur prêt à le suivre dans ses pérégrinations à travers l'Allemagne et la Russie et dans sa romanesque fuite de Rome pour tuer l'amant de son amie, fuite avortée, car Berlioz, toujours, revient à la musique, son émotion la plus vraie et son énervement le plus outrancier.
Un livre qui allie connaissances biographiques et musicologiques sur Berlioz. Il se lit assez bien, les détails sur ses voyages et sur ses compositions sont précises et claires...! Un très beau livre sur un compositeur romantique, écrit par lui même.
Citations et extraits (318)
Voir plus
Ajouter une citation
A propos de Habeneck, ayant travaillé toute sa vie à diffuser les œuvres de Beethoven en France :
Il eut à lutter aussi, et ce n'est pas la moindre de ses peines, contre l'opposition sourde, le blâme plus ou moins déguisé, l'ironie et les réticences des compositeurs français et italiens, fort peu ravis de voir ériger un temple à un Allemand dont ils considéraient les compositeurs comme des monstruosités, redoutables néanmoins pour eux et leur école.
Que d'abominables sottises j'ai entendu dire aux uns et aux autres sur ces merveilles de savoir et d'inspiration !
Mon Maître, Lesueur, homme honnête pourtant, exempt de fiel et de jalousie, aimant son art, mais dévoué à ces dogmes musicaux que j'ose appeler des préjugés et des folies, laissa échapper à ce sujet un mot caractéristique.
Bien qu'il vécût assez retiré et absorbé dans ses travaux, la rumeur produite dans le monde musical de Paris par les premiers concerts du Conservatoire et les symphonies de Beethoven était rapidement parvenue jusqu'à lui.
Il s'en étonna d'autant plus, qu'avec la plupart de ses confrères de l'Institut, il regardait la musique instrumentale comme un genre inférieur, une partie de l'art estimable mais d'une valeur médiocre, et qu'à son avis Haydn et Mozart en avaient posé les bornes qui ne pouvaient être dépassés.
Lesueur, malgré la fièvre d'administration dont il voyait possédés les artistes en général, et moi en particulier, Lesueur se taisait, faisait le sourd et s'abstenait soigneusement d'assister aux concerts du Conservatoire. Il eût fallu, en y allant, s'y former une opinion sur Beethoven, l'exprimer, être témoin du furieux enthousiasme qu'il excitait ; et c'est ce que Lesueur, sans se l'avouer, ne voulait pas.
Je fis tant, néanmoins, je lui parlais de telle sorte de l'obligation où il était de connaitre et d'apprécier personnellement un fait aussi considérable que l'avènement dans notre art de ce nouveau style, de ces formes colossales, qu'il consentit à se laisser entraîner au Conservatoire un jour où l'on exécutait la symphonie en ut mineur de Beethoven.
(...)
Je le rencontrai dans un couloir, il était très rouge et marchait à grand pas : "Eh bien ? cher Maître" lui dis-je... "Ouf, je sors, j'ai besoin d'air. C'est inouï ! C'est merveilleux ! Cela m'a tellement ému, troublé, bouleversé, qu'en sortant de ma loge et voulant remettre mon chapeau, j'ai cru je ne pourrais plus retrouver ma tête ! Laissez moi seul. A demain..."
Je triomphais. Le lendemain je m'empressais de l'aller voir. La conservation s'établit de prime abord sur le chef-d'œuvre qui nous avait si violemment agités.
Lesueur me laissa parler pendant quelques temps, approuvant d'un air contraint mes exclamations admiratives. Mais il était aisé de voir que je n'avais plus pour interlocuteur l'homme de la veille et que ce sujet d'entretien lui était pénible. je continuais pourtant, jusqu'à ce que Lesueur, à qui je venais d'arracher un nouvel aveu de sa profonde émotion en écoutant la symphonie de Beethoven, dit en secouant la tête et avec un singulier sourire :
"C'et égal, il ne faut pas faire de la musique comme celle-là"
Ce à quoi je répondis : "Soyez tranquille, cher Maître, on n'en fera pas beaucoup."
Pauvre nature humaine !... Pauvre Maître !... Il y a dans ce mot paraphrasé par tant d'autres hommes en mainte circonstance semblable, de l'entêtement, du regret, la terreur de l'inconnu, de l'envie, et un aveu implicite d'impuissance.
Car dire : il ne faut pas faire de la musique comme celle-là, quand on a été forcé d'en subir le pouvoir et d'en reconnaître la beauté, c'est bien déclarer qu'on se gardera soi-même d'en écrire de pareille, mais parce qu'on sent qu'on ne le pourrait pas si on voulait.
Haydn en avait déjà dit autant de ce même Beethoven, qu'il s'obstinait à appeler seulement un grand pianiste.
Gretry a écrit d'ineptes aphorismes de la même nature sur Mozart (...)
Handel prétendait que son cuisinier était plus musicien que Gluck.
Rossini dit, en parlant de la musique de Weber, qu'elle lui donne la colique.
(...)
Cette obstination de Lesueur à lutter contre l'évidence et ses propres impressions acheva de me faire reconnaître le néant des doctrines qu'il s'était efforcé de m'inculquer ; et je quittais brusquement la vieille grande route pour prendre ma course par monts et par vaux à travers les bois et les champs. Je dissimulais pourtant de mon mieux, et Lesueur ne s'aperçut de mon infidélité que beaucoup plus tard, en entendant mes nouvelles compositions que je m'étais gardé de lui montrer.
Il eut à lutter aussi, et ce n'est pas la moindre de ses peines, contre l'opposition sourde, le blâme plus ou moins déguisé, l'ironie et les réticences des compositeurs français et italiens, fort peu ravis de voir ériger un temple à un Allemand dont ils considéraient les compositeurs comme des monstruosités, redoutables néanmoins pour eux et leur école.
Que d'abominables sottises j'ai entendu dire aux uns et aux autres sur ces merveilles de savoir et d'inspiration !
Mon Maître, Lesueur, homme honnête pourtant, exempt de fiel et de jalousie, aimant son art, mais dévoué à ces dogmes musicaux que j'ose appeler des préjugés et des folies, laissa échapper à ce sujet un mot caractéristique.
Bien qu'il vécût assez retiré et absorbé dans ses travaux, la rumeur produite dans le monde musical de Paris par les premiers concerts du Conservatoire et les symphonies de Beethoven était rapidement parvenue jusqu'à lui.
Il s'en étonna d'autant plus, qu'avec la plupart de ses confrères de l'Institut, il regardait la musique instrumentale comme un genre inférieur, une partie de l'art estimable mais d'une valeur médiocre, et qu'à son avis Haydn et Mozart en avaient posé les bornes qui ne pouvaient être dépassés.
Lesueur, malgré la fièvre d'administration dont il voyait possédés les artistes en général, et moi en particulier, Lesueur se taisait, faisait le sourd et s'abstenait soigneusement d'assister aux concerts du Conservatoire. Il eût fallu, en y allant, s'y former une opinion sur Beethoven, l'exprimer, être témoin du furieux enthousiasme qu'il excitait ; et c'est ce que Lesueur, sans se l'avouer, ne voulait pas.
Je fis tant, néanmoins, je lui parlais de telle sorte de l'obligation où il était de connaitre et d'apprécier personnellement un fait aussi considérable que l'avènement dans notre art de ce nouveau style, de ces formes colossales, qu'il consentit à se laisser entraîner au Conservatoire un jour où l'on exécutait la symphonie en ut mineur de Beethoven.
(...)
Je le rencontrai dans un couloir, il était très rouge et marchait à grand pas : "Eh bien ? cher Maître" lui dis-je... "Ouf, je sors, j'ai besoin d'air. C'est inouï ! C'est merveilleux ! Cela m'a tellement ému, troublé, bouleversé, qu'en sortant de ma loge et voulant remettre mon chapeau, j'ai cru je ne pourrais plus retrouver ma tête ! Laissez moi seul. A demain..."
Je triomphais. Le lendemain je m'empressais de l'aller voir. La conservation s'établit de prime abord sur le chef-d'œuvre qui nous avait si violemment agités.
Lesueur me laissa parler pendant quelques temps, approuvant d'un air contraint mes exclamations admiratives. Mais il était aisé de voir que je n'avais plus pour interlocuteur l'homme de la veille et que ce sujet d'entretien lui était pénible. je continuais pourtant, jusqu'à ce que Lesueur, à qui je venais d'arracher un nouvel aveu de sa profonde émotion en écoutant la symphonie de Beethoven, dit en secouant la tête et avec un singulier sourire :
"C'et égal, il ne faut pas faire de la musique comme celle-là"
Ce à quoi je répondis : "Soyez tranquille, cher Maître, on n'en fera pas beaucoup."
Pauvre nature humaine !... Pauvre Maître !... Il y a dans ce mot paraphrasé par tant d'autres hommes en mainte circonstance semblable, de l'entêtement, du regret, la terreur de l'inconnu, de l'envie, et un aveu implicite d'impuissance.
Car dire : il ne faut pas faire de la musique comme celle-là, quand on a été forcé d'en subir le pouvoir et d'en reconnaître la beauté, c'est bien déclarer qu'on se gardera soi-même d'en écrire de pareille, mais parce qu'on sent qu'on ne le pourrait pas si on voulait.
Haydn en avait déjà dit autant de ce même Beethoven, qu'il s'obstinait à appeler seulement un grand pianiste.
Gretry a écrit d'ineptes aphorismes de la même nature sur Mozart (...)
Handel prétendait que son cuisinier était plus musicien que Gluck.
Rossini dit, en parlant de la musique de Weber, qu'elle lui donne la colique.
(...)
Cette obstination de Lesueur à lutter contre l'évidence et ses propres impressions acheva de me faire reconnaître le néant des doctrines qu'il s'était efforcé de m'inculquer ; et je quittais brusquement la vieille grande route pour prendre ma course par monts et par vaux à travers les bois et les champs. Je dissimulais pourtant de mon mieux, et Lesueur ne s'aperçut de mon infidélité que beaucoup plus tard, en entendant mes nouvelles compositions que je m'étais gardé de lui montrer.
XLV
Représentation à bénéfice et concert au Théâtre-Italien. — Le quatrième acte d’Hamlet. — Antony. — Défection de l’orchestre. — Je prends ma revanche. — Visite de Paganini. — Son alto. — Composition d’Harold en Italie. — Fautes du chef d’orchestre Girard. — Je prends le parti de toujours conduire l’exécution de mes ouvrages. — Une lettre anonyme.
Il me restait d’ailleurs une faible ressource dans ma pension de lauréat de l’Institut, qui devait durer encore un an et demi. Le ministre de l’intérieur m’avait dispensé du voyage en Allemagne imposé par le règlement de l’Académie des beaux-arts ; je commençais à avoir des partisans à Paris, et j’avais foi dans l’avenir. Pour achever de payer les dettes de ma femme, je recommençai le pénible métier de bénéficiaire, et je vins à bout, après des fatigues inouïes, d’organiser au Théâtre-Italien une représentation suivie d’un concert. Mes amis me vinrent encore en aide à cette occasion, entre autres Alexandre Dumas, qui toute sa vie a été pour moi d’une cordialité parfaite.
Le programme de la soirée se composait de la pièce d’Antony de Dumas, jouée par Firmin et madame Dorval, du 4e acte de l’Hamlet de Shakespeare, joué par Henriette et quelques amateurs anglais que nous avions fini par trouver, et d’un concert dirigé par moi, où devaient figurer la Symphonie fantastique, l’ouverture des Francs-Juges, ma cantate de Sardanapale, le Concert-Stuck de Weber, exécuté par cet excellent et admirable Liszt, et un chœur de Weber. On voit qu’il y avait beaucoup trop de drame et de musique, et que le concert, s’il eût fini, n’eût pu être terminé qu’à une heure du matin.
Mais je dois pour l’enseignement des jeunes artistes, et quoi qu’il m’en coûte, faire le récit exact de cette malheureuse représentation.
Peu au courant des mœurs des musiciens de théâtre, j’avais fait avec le directeur de l’Opéra-Italien un marché, par lequel il s’engageait à me donner sa salle et son orchestre, auquel j’adjoignis un petit nombre d’artistes de l’Opéra. C’était la plus dangereuse des combinaisons. Les musiciens, obligés par leur engagement de prendre part à l’exécution des concerts, lorsqu’on en donne dans leur théâtre, considèrent ces soirées exceptionnelles comme des corvées et n’y apportent qu’ennui et mauvais vouloir. Si, en outre, on leur adjoint d’autres musiciens, alors payés quand eux ne le sont pas, leur mauvaise humeur s’en augmente, et l’artiste qui donne le concert ne tarde guère à s’en ressentir.
Étrangers aux petits tripotages des coulisses françaises, comme nous l’étions, ma femme et moi, nous avions négligé toutes les précautions qui se prennent en pareil cas pour assurer le succès de l’héroïne de la fête ; nous n’avions pas donné un seul billet aux claqueurs. Madame Dorval, au contraire, persuadée qu’il y aurait ce soir-là pour ma femme une cabale formidable, que tout serait arrangé selon l’usage pour lui assurer un triomphe éclatant, ne manqua pas, cela se conçoit, de s’armer pour sa propre défense, en garnissant convenablement le parterre, soit avec les billets que nous lui donnâmes, soit avec ceux que nous avions donnés à Dumas, soit avec ceux qu’elle fit acheter. Madame Dorval, admirable du reste dans le rôle d’Adèle, fut en conséquence couverte d’applaudissements et redemandée à la fin de la pièce. Quand vint ensuite le 4e acte d’Hamlet, fragment incompréhensible, pour des Français surtout, s’il n’est ni amené ni préparé par les actes précédents, le rôle sublime d’Ophélia, qui, peu d’années auparavant, avait produit un effet si profondément douloureux et poétique, perdit les trois quarts de son prestige ; le chef-d’œuvre parut froid.
On remarqua même avec quelle peine, l’actrice, toujours maîtresse néanmoins de son merveilleux talent, s’était relevée, en s’appuyant avec la main sur le plancher du théâtre, à la fin de la scène dans laquelle Ophélia s’agenouille auprès de son voile noir qu’elle prend pour le linceul de son père. Ce fut pour elle aussi une cruelle découverte. Guérie, elle ne boitait pas, mais l’assurance et la liberté de quelques-uns de ses mouvements étaient perdues. Puis, quand, après la chute de la toile, elle vit que le public, ce public dont elle était l’idole autrefois et qui, de plus, venait de décerner une ovation à madame Dorval, ne la rappelait pas... Quel affreux crève-cœur ! ! Toutes les femmes et tous les artistes le comprendront. Pauvre Ophélia ! ton soleil déclinait.. j’étais désolé.
Le concert commença. L’ouverture des Francs-Juges, très-médiocrement exécutée, fut néanmoins accueillie par deux salves d’applaudissements, qui m’étonnèrent. Le Concert-Stuck de Weber, joué par Liszt avec la fougue entraînante qu’il y a toujours mise, obtint un magnifique succès. Je m’oubliai même dans mon enthousiasme pour Liszt, jusqu’à l’embrasser en plein théâtre devant le public. Stupide inconvenance qui pouvait nous couvrir tous les deux de ridicule, et dont les spectateurs néanmoins eurent la bonté de ne se point moquer.
Dans l’introduction instrumentale de Sardanapale, mon inexpérience dans l’art de conduire l’orchestre fut cause que les seconds violons ayant manqué une entrée, tout l’orchestre se perdit et que je dus indiquer aux exécutants, comme point de ralliement, le dernier accord, en sautant tout le reste. Alexis Dupont chanta assez bien la cantate, mais le fameux incendie final, mal répété et mal rendu, produisit peu d’effet. Rien ne marchait plus ; je n’entendais que le bruit sourd des pulsations de mes artères, il me semblait m’enfoncer en terre peu à peu. De plus il se faisait tard et nous avions encore à exécuter le chœur de Weber et la Symphonie fantastique tout entière. Les règlements du Théâtre-Italien, dit-on, n’obligent pas les musiciens à jouer après minuit. En conséquence, mal disposés pour moi, par les raisons que l’on connaît, ils attendaient avec impatience le moment de s’échapper, quelles que dussent être les conséquences d’une aussi plate défection. Ils n’y manquèrent pas ; pendant que le chœur de Weber se chantait, ces lâches drôles, indignes de porter le nom d’artistes, disparurent tous clandestinement. Il était minuit. Les musiciens étrangers que je payais, restèrent seuls à leur poste et quand je me retournai pour commencer la symphonie je me vis entouré de cinq violons, de deux altos, de quatre basses et d’un trombone. Je ne savais quel parti prendre dans ma consternation. Le public ne faisant pas mine de vouloir s’en aller. Il en vint bientôt à s’impatienter et à réclamer l’exécution de la symphonie. Je n’avais garde de commencer. Enfin, au milieu du tumulte, une voix s’étant écriée du balcon : «La Marche au supplice !» Je répondis : «Je ne puis faire exécuter la Marche au supplice par cinq violons !... Ce n’est pas ma faute, l’orchestre a disparu, j’espère que le public...» J’étais rouge de honte et d’indignation. L’assemblée alors se leva désappointée. Le concert en resta là, et mes ennemis ne manquèrent pas de le tourner en ridicule en ajoutant que ma musique faisait fuir les musiciens.
Je ne crois pas qu’il y ait jamais eu auparavant d’exemple d’une telle action amenée par d’aussi ignobles motifs. Maudits racleurs ! Méprisables polissons ! je regrette de ne pas avoir recueilli vos noms que leur obscurité protège.
Cette triste soirée me rapporta à peu près sept mille francs ; et cette somme disparut en quelques jours dans le gouffre de la dette de ma femme, sans le combler encore ; hélas ! je n’y parvins que plusieurs années après et en nous imposant de cruelles privations.
J’aurais voulu donner à Henriette l’occasion d’une éclatante revanche ; mais Paris ne pouvait lui offrir le concours d’aucun acteur anglais, il n’y en avait plus un seul ; elle eût dû s’adresser de nouveau à des amateurs tout à fait insuffisants et ne reparaître que dans des fragments mutilés de Shakespeare. C’eût été absurde, elle venait d’en acquérir la preuve. Il fallut donc y renoncer. Je tentai, moi au moins, et sur-le-champ, de répondre aux rumeurs hostiles qui de toutes parts s’élevaient, par un succès incontestable. J’engageai, en le payant chèrement, un orchestre de premier ordre, composé de l’élite des musiciens de Paris, parmi lesquels je pouvais compter un bon nombre d’amis, ou tout au moins de juges impartiaux de mes ouvrages, et j’annonçai un concert dans la salle du Conservatoire. Je m’exposais beaucoup en faisant une pareille dépense que la recette du concert pouvait fort bien ne pas couvrir. Mais ma femme elle-même m’y encouragea et se montra dès ce moment ce qu’elle a toujours été, ennemie des demi-mesures et des petits moyens, et dès que la gloire de l’artiste ou l’intérêt de l’art sont en question, brave devant la gêne et la misère jusqu’à la témérité.
J’eus peur de compromettre l’exécution en conduisant l’orchestre moi-même. Habeneck refusa obstinément de le diriger ; mais Girard, qui était alors fort de mes amis, consentit à accepter cette tâche et s’en acquitta bien. La Symphonie fantastique figurait encore dans le programme ; elle enleva d’assaut d’un bout à l’autre les applaudissements. Le succès fut complet, j’étais réhabilité. Mes musiciens (il n’y en avait pas un seul du Théâtre-Italien, cela se devine) rayonnaient de joie en quittant l’orchestre. Enfin, pour comble de bonheur, un homme quand le public fut sorti, un homme à la longue chevelure, à l’œil perçant, à la figure étrange et ravagée, un possédé du génie, un colosse parmi les géants, que je n’avais jamais vu, et dont le premier aspect me troubla profondément, m’attendit seul dans la salle, m’arrêta au passage pour me serrer la main, m’accabla d’éloges brûlants qui m’incendièrent le cœur et la tête ; c’était Paganini ! ! (22 décembre 1833.)
De ce jour-là datent mes relations avec le grand artiste qui a exercé une si heureuse influence sur ma destinée et dont la noble générosité à mon égard a donné lieu, on saura bientôt comment, à tant de méchants et absurdes commentaires.
Représentation à bénéfice et concert au Théâtre-Italien. — Le quatrième acte d’Hamlet. — Antony. — Défection de l’orchestre. — Je prends ma revanche. — Visite de Paganini. — Son alto. — Composition d’Harold en Italie. — Fautes du chef d’orchestre Girard. — Je prends le parti de toujours conduire l’exécution de mes ouvrages. — Une lettre anonyme.
Il me restait d’ailleurs une faible ressource dans ma pension de lauréat de l’Institut, qui devait durer encore un an et demi. Le ministre de l’intérieur m’avait dispensé du voyage en Allemagne imposé par le règlement de l’Académie des beaux-arts ; je commençais à avoir des partisans à Paris, et j’avais foi dans l’avenir. Pour achever de payer les dettes de ma femme, je recommençai le pénible métier de bénéficiaire, et je vins à bout, après des fatigues inouïes, d’organiser au Théâtre-Italien une représentation suivie d’un concert. Mes amis me vinrent encore en aide à cette occasion, entre autres Alexandre Dumas, qui toute sa vie a été pour moi d’une cordialité parfaite.
Le programme de la soirée se composait de la pièce d’Antony de Dumas, jouée par Firmin et madame Dorval, du 4e acte de l’Hamlet de Shakespeare, joué par Henriette et quelques amateurs anglais que nous avions fini par trouver, et d’un concert dirigé par moi, où devaient figurer la Symphonie fantastique, l’ouverture des Francs-Juges, ma cantate de Sardanapale, le Concert-Stuck de Weber, exécuté par cet excellent et admirable Liszt, et un chœur de Weber. On voit qu’il y avait beaucoup trop de drame et de musique, et que le concert, s’il eût fini, n’eût pu être terminé qu’à une heure du matin.
Mais je dois pour l’enseignement des jeunes artistes, et quoi qu’il m’en coûte, faire le récit exact de cette malheureuse représentation.
Peu au courant des mœurs des musiciens de théâtre, j’avais fait avec le directeur de l’Opéra-Italien un marché, par lequel il s’engageait à me donner sa salle et son orchestre, auquel j’adjoignis un petit nombre d’artistes de l’Opéra. C’était la plus dangereuse des combinaisons. Les musiciens, obligés par leur engagement de prendre part à l’exécution des concerts, lorsqu’on en donne dans leur théâtre, considèrent ces soirées exceptionnelles comme des corvées et n’y apportent qu’ennui et mauvais vouloir. Si, en outre, on leur adjoint d’autres musiciens, alors payés quand eux ne le sont pas, leur mauvaise humeur s’en augmente, et l’artiste qui donne le concert ne tarde guère à s’en ressentir.
Étrangers aux petits tripotages des coulisses françaises, comme nous l’étions, ma femme et moi, nous avions négligé toutes les précautions qui se prennent en pareil cas pour assurer le succès de l’héroïne de la fête ; nous n’avions pas donné un seul billet aux claqueurs. Madame Dorval, au contraire, persuadée qu’il y aurait ce soir-là pour ma femme une cabale formidable, que tout serait arrangé selon l’usage pour lui assurer un triomphe éclatant, ne manqua pas, cela se conçoit, de s’armer pour sa propre défense, en garnissant convenablement le parterre, soit avec les billets que nous lui donnâmes, soit avec ceux que nous avions donnés à Dumas, soit avec ceux qu’elle fit acheter. Madame Dorval, admirable du reste dans le rôle d’Adèle, fut en conséquence couverte d’applaudissements et redemandée à la fin de la pièce. Quand vint ensuite le 4e acte d’Hamlet, fragment incompréhensible, pour des Français surtout, s’il n’est ni amené ni préparé par les actes précédents, le rôle sublime d’Ophélia, qui, peu d’années auparavant, avait produit un effet si profondément douloureux et poétique, perdit les trois quarts de son prestige ; le chef-d’œuvre parut froid.
On remarqua même avec quelle peine, l’actrice, toujours maîtresse néanmoins de son merveilleux talent, s’était relevée, en s’appuyant avec la main sur le plancher du théâtre, à la fin de la scène dans laquelle Ophélia s’agenouille auprès de son voile noir qu’elle prend pour le linceul de son père. Ce fut pour elle aussi une cruelle découverte. Guérie, elle ne boitait pas, mais l’assurance et la liberté de quelques-uns de ses mouvements étaient perdues. Puis, quand, après la chute de la toile, elle vit que le public, ce public dont elle était l’idole autrefois et qui, de plus, venait de décerner une ovation à madame Dorval, ne la rappelait pas... Quel affreux crève-cœur ! ! Toutes les femmes et tous les artistes le comprendront. Pauvre Ophélia ! ton soleil déclinait.. j’étais désolé.
Le concert commença. L’ouverture des Francs-Juges, très-médiocrement exécutée, fut néanmoins accueillie par deux salves d’applaudissements, qui m’étonnèrent. Le Concert-Stuck de Weber, joué par Liszt avec la fougue entraînante qu’il y a toujours mise, obtint un magnifique succès. Je m’oubliai même dans mon enthousiasme pour Liszt, jusqu’à l’embrasser en plein théâtre devant le public. Stupide inconvenance qui pouvait nous couvrir tous les deux de ridicule, et dont les spectateurs néanmoins eurent la bonté de ne se point moquer.
Dans l’introduction instrumentale de Sardanapale, mon inexpérience dans l’art de conduire l’orchestre fut cause que les seconds violons ayant manqué une entrée, tout l’orchestre se perdit et que je dus indiquer aux exécutants, comme point de ralliement, le dernier accord, en sautant tout le reste. Alexis Dupont chanta assez bien la cantate, mais le fameux incendie final, mal répété et mal rendu, produisit peu d’effet. Rien ne marchait plus ; je n’entendais que le bruit sourd des pulsations de mes artères, il me semblait m’enfoncer en terre peu à peu. De plus il se faisait tard et nous avions encore à exécuter le chœur de Weber et la Symphonie fantastique tout entière. Les règlements du Théâtre-Italien, dit-on, n’obligent pas les musiciens à jouer après minuit. En conséquence, mal disposés pour moi, par les raisons que l’on connaît, ils attendaient avec impatience le moment de s’échapper, quelles que dussent être les conséquences d’une aussi plate défection. Ils n’y manquèrent pas ; pendant que le chœur de Weber se chantait, ces lâches drôles, indignes de porter le nom d’artistes, disparurent tous clandestinement. Il était minuit. Les musiciens étrangers que je payais, restèrent seuls à leur poste et quand je me retournai pour commencer la symphonie je me vis entouré de cinq violons, de deux altos, de quatre basses et d’un trombone. Je ne savais quel parti prendre dans ma consternation. Le public ne faisant pas mine de vouloir s’en aller. Il en vint bientôt à s’impatienter et à réclamer l’exécution de la symphonie. Je n’avais garde de commencer. Enfin, au milieu du tumulte, une voix s’étant écriée du balcon : «La Marche au supplice !» Je répondis : «Je ne puis faire exécuter la Marche au supplice par cinq violons !... Ce n’est pas ma faute, l’orchestre a disparu, j’espère que le public...» J’étais rouge de honte et d’indignation. L’assemblée alors se leva désappointée. Le concert en resta là, et mes ennemis ne manquèrent pas de le tourner en ridicule en ajoutant que ma musique faisait fuir les musiciens.
Je ne crois pas qu’il y ait jamais eu auparavant d’exemple d’une telle action amenée par d’aussi ignobles motifs. Maudits racleurs ! Méprisables polissons ! je regrette de ne pas avoir recueilli vos noms que leur obscurité protège.
Cette triste soirée me rapporta à peu près sept mille francs ; et cette somme disparut en quelques jours dans le gouffre de la dette de ma femme, sans le combler encore ; hélas ! je n’y parvins que plusieurs années après et en nous imposant de cruelles privations.
J’aurais voulu donner à Henriette l’occasion d’une éclatante revanche ; mais Paris ne pouvait lui offrir le concours d’aucun acteur anglais, il n’y en avait plus un seul ; elle eût dû s’adresser de nouveau à des amateurs tout à fait insuffisants et ne reparaître que dans des fragments mutilés de Shakespeare. C’eût été absurde, elle venait d’en acquérir la preuve. Il fallut donc y renoncer. Je tentai, moi au moins, et sur-le-champ, de répondre aux rumeurs hostiles qui de toutes parts s’élevaient, par un succès incontestable. J’engageai, en le payant chèrement, un orchestre de premier ordre, composé de l’élite des musiciens de Paris, parmi lesquels je pouvais compter un bon nombre d’amis, ou tout au moins de juges impartiaux de mes ouvrages, et j’annonçai un concert dans la salle du Conservatoire. Je m’exposais beaucoup en faisant une pareille dépense que la recette du concert pouvait fort bien ne pas couvrir. Mais ma femme elle-même m’y encouragea et se montra dès ce moment ce qu’elle a toujours été, ennemie des demi-mesures et des petits moyens, et dès que la gloire de l’artiste ou l’intérêt de l’art sont en question, brave devant la gêne et la misère jusqu’à la témérité.
J’eus peur de compromettre l’exécution en conduisant l’orchestre moi-même. Habeneck refusa obstinément de le diriger ; mais Girard, qui était alors fort de mes amis, consentit à accepter cette tâche et s’en acquitta bien. La Symphonie fantastique figurait encore dans le programme ; elle enleva d’assaut d’un bout à l’autre les applaudissements. Le succès fut complet, j’étais réhabilité. Mes musiciens (il n’y en avait pas un seul du Théâtre-Italien, cela se devine) rayonnaient de joie en quittant l’orchestre. Enfin, pour comble de bonheur, un homme quand le public fut sorti, un homme à la longue chevelure, à l’œil perçant, à la figure étrange et ravagée, un possédé du génie, un colosse parmi les géants, que je n’avais jamais vu, et dont le premier aspect me troubla profondément, m’attendit seul dans la salle, m’arrêta au passage pour me serrer la main, m’accabla d’éloges brûlants qui m’incendièrent le cœur et la tête ; c’était Paganini ! ! (22 décembre 1833.)
De ce jour-là datent mes relations avec le grand artiste qui a exercé une si heureuse influence sur ma destinée et dont la noble générosité à mon égard a donné lieu, on saura bientôt comment, à tant de méchants et absurdes commentaires.
C’est que je connaissais déjà cette cruelle passion, si bien décrite par l’auteur de l’Énéide, passion rare, quoi qu’on en dise, si mal définie et si puissante sur certaines âmes. Elle m’avait été révélée avant la musique, à l’âge de douze ans. Voici comment :
Mon grand-père maternel, dont le nom est celui du fabuleux guerrier de Walter Scott, (Marmion) vivait à Meylan, campagne située à deux lieues de Grenoble, du côté de la frontière de Savoie. Ce village, et les hameaux qui l’entourent, la vallée de l’Isère qui se déroule à leurs pieds et les montagnes du Dauphiné qui viennent là se joindre aux Basses-Alpes, forment un des plus romantiques séjours que j’aie jamais admirés. Ma mère, mes sœurs et moi, nous allions ordinairement chaque année y passer trois semaines vers la fin de l’été. Mon oncle (Félix Marmion), qui suivait alors la trace lumineuse du grand Empereur, venait quelquefois nous y joindre, tout chaud encore de l’haleine du canon, orné tantôt d’un simple coup de lance, tantôt d’un coup de mitraille dans le pied ou d’un magnifique coup de sabre au travers de la figure. Il n’était encore qu’adjudant-major de lanciers ; jeune, épris de la gloire, prêt à donner sa vie pour un de ses regards, croyant le trône de Napoléon inébranlable comme le mont Blanc ; et joyeux et galant, grand amateur de violon et chantant fort bien l’opéra-comique.
Dans la partie haute de Meylan, tout contre l’escarpement de la montagne, est une maisonnette blanche, entourée de vignes et de jardins, d’où la vue plonge sur la vallée de l’Isère ; derrière sont quelques collines rocailleuses, une vieille tour en ruines, des bois, et l’imposante masse d’un rocher immense, le Saint-Eynard ; une retraite enfin évidemment prédestinée à être le théâtre d’un roman. C’était la villa de madame Gautier, qui l’habitait pendant la belle saison avec ses deux nièces, dont la plus jeune s’appelait Estelle. Ce nom seul eût suffi pour attirer mon attention ; il m’était cher déjà à cause de la pastorale de Florian (Estelle et Némorin) dérobée par moi dans la bibliothèque de mon père, et lue en cachette, cent et cent fois. Mais celle qui le portait avait dix-huit ans, une taille élégante et élevée, de grands yeux armés en guerre, bien que toujours souriants, une chevelure digne d’orner le casque d’Achille, des pieds, je ne dirai pas d’Andalouse, mais de Parisienne pur sang, et des... brodequins roses !... Je n’en avais jamais vu... Vous riez ! !... Eh bien, j’ai oublié la couleur de ses cheveux (que je crois noirs pourtant) et je ne puis penser à elle sans voir scintiller, en même temps que les grands yeux, les petits brodequins roses.
En l’apercevant, je sentis une secousse électrique ; je l’aimai, c’est tout dire. Le vertige me prit et ne me quitta plus. Je n’espérais rien... je ne savais rien... mais j’éprouvais au cœur une douleur profonde. Je passais des nuits entières à me désoler. Je me cachais le jour dans les champs de maïs, dans les réduits secrets du verger de mon grand-père, comme un oiseau blessé, muet et souffrant. La jalousie, cette pâle compagne des plus pures amours, me torturait au moindre mot adressé par un homme à mon idole. J’entends encore en frémissant le bruit des éperons de mon oncle quand il dansait avec elle ! Tout le monde, à la maison et dans le voisinage, s’amusait de ce pauvre enfant de douze ans brisé par un amour au-dessus de ses forces. Elle-même qui, la première, avait tout deviné, s’en est fort divertie, j’en suis sûr. Un soir il y avait une réunion nombreuse chez sa tante ; il fut question de jouer aux barres ; il fallait, pour former les deux camps ennemis, se diviser en deux groupes égaux ; les cavaliers choisissaient leurs dames ; on fit exprès de me laisser avant tous désigner la mienne. Mais je n’osai, le cœur me battait trop fort ; je baissai les yeux en silence. Chacun de me railler ; quand mademoiselle Estelle, saisissant ma main : «Eh bien, non, c’est moi qui choisirai ! Je prends M. Hector !» Ô douleur ! elle riait aussi, la cruelle, en me regardant du haut de sa beauté...
Non, le temps n’y peut rien... d’autres amours n’effacent point la trace du premier... J’avais treize ans, quand je cessai de la voir... J’en avais trente quand, revenant d’Italie par les Alpes, mes yeux se voilèrent en apercevant de loin le Saint-Eynard, et la petite maison blanche, et la vieille tour... Je l’aimais encore... J’appris en arrivant qu’elle était devenue... mariée et... tout ce qui s’ensuit. Cela ne me guérit point. Ma mère, qui me taquinait quelquefois au sujet de ma première passion, eut peut-être tort de me jouer le tour qu’on va lire. «Tiens, me dit-elle, peu de jours après mon retour de Rome, voilà une lettre qu’on m’a chargée de faire tenir à une dame qui doit passer ici tout à l’heure dans la diligence de Vienne. Va au bureau du courrier, pendant qu’on changera de chevaux, tu demanderas madame F*** et tu lui remettras la lettre. Regarde bien cette dame, je parie que tu la reconnaîtras, bien que tu ne l’aies pas vue depuis dix-sept ans.» Je vais, sans me douter de ce que cela voulait dire, à la station de la diligence. À son arrivée, je m’approche la lettre à la main, demandant madame F***. «C’est moi, monsieur !» me dit une voix. C’est elle ! me dit un coup sourd qui retentit dans ma poitrine. Estelle !... encore belle !... Estelle !... la nymphe, l’hamadryade du Saint-Eynard, des vertes collines de Meylan ! C’est son port de tête, sa splendide chevelure, et son sourire éblouissant !... mais les petits brodequins roses, hélas ! où étaient-ils ?... On prit la lettre. Me reconnut-on ? je ne sais. La voiture repartit ; je rentrai tout vibrant de la commotion. «Allons, me dit ma mère en m’examinant, je vois que Némorin n’a point oublié son Estelle.» Son Estelle ! méchante mère !... IV
Mon grand-père maternel, dont le nom est celui du fabuleux guerrier de Walter Scott, (Marmion) vivait à Meylan, campagne située à deux lieues de Grenoble, du côté de la frontière de Savoie. Ce village, et les hameaux qui l’entourent, la vallée de l’Isère qui se déroule à leurs pieds et les montagnes du Dauphiné qui viennent là se joindre aux Basses-Alpes, forment un des plus romantiques séjours que j’aie jamais admirés. Ma mère, mes sœurs et moi, nous allions ordinairement chaque année y passer trois semaines vers la fin de l’été. Mon oncle (Félix Marmion), qui suivait alors la trace lumineuse du grand Empereur, venait quelquefois nous y joindre, tout chaud encore de l’haleine du canon, orné tantôt d’un simple coup de lance, tantôt d’un coup de mitraille dans le pied ou d’un magnifique coup de sabre au travers de la figure. Il n’était encore qu’adjudant-major de lanciers ; jeune, épris de la gloire, prêt à donner sa vie pour un de ses regards, croyant le trône de Napoléon inébranlable comme le mont Blanc ; et joyeux et galant, grand amateur de violon et chantant fort bien l’opéra-comique.
Dans la partie haute de Meylan, tout contre l’escarpement de la montagne, est une maisonnette blanche, entourée de vignes et de jardins, d’où la vue plonge sur la vallée de l’Isère ; derrière sont quelques collines rocailleuses, une vieille tour en ruines, des bois, et l’imposante masse d’un rocher immense, le Saint-Eynard ; une retraite enfin évidemment prédestinée à être le théâtre d’un roman. C’était la villa de madame Gautier, qui l’habitait pendant la belle saison avec ses deux nièces, dont la plus jeune s’appelait Estelle. Ce nom seul eût suffi pour attirer mon attention ; il m’était cher déjà à cause de la pastorale de Florian (Estelle et Némorin) dérobée par moi dans la bibliothèque de mon père, et lue en cachette, cent et cent fois. Mais celle qui le portait avait dix-huit ans, une taille élégante et élevée, de grands yeux armés en guerre, bien que toujours souriants, une chevelure digne d’orner le casque d’Achille, des pieds, je ne dirai pas d’Andalouse, mais de Parisienne pur sang, et des... brodequins roses !... Je n’en avais jamais vu... Vous riez ! !... Eh bien, j’ai oublié la couleur de ses cheveux (que je crois noirs pourtant) et je ne puis penser à elle sans voir scintiller, en même temps que les grands yeux, les petits brodequins roses.
En l’apercevant, je sentis une secousse électrique ; je l’aimai, c’est tout dire. Le vertige me prit et ne me quitta plus. Je n’espérais rien... je ne savais rien... mais j’éprouvais au cœur une douleur profonde. Je passais des nuits entières à me désoler. Je me cachais le jour dans les champs de maïs, dans les réduits secrets du verger de mon grand-père, comme un oiseau blessé, muet et souffrant. La jalousie, cette pâle compagne des plus pures amours, me torturait au moindre mot adressé par un homme à mon idole. J’entends encore en frémissant le bruit des éperons de mon oncle quand il dansait avec elle ! Tout le monde, à la maison et dans le voisinage, s’amusait de ce pauvre enfant de douze ans brisé par un amour au-dessus de ses forces. Elle-même qui, la première, avait tout deviné, s’en est fort divertie, j’en suis sûr. Un soir il y avait une réunion nombreuse chez sa tante ; il fut question de jouer aux barres ; il fallait, pour former les deux camps ennemis, se diviser en deux groupes égaux ; les cavaliers choisissaient leurs dames ; on fit exprès de me laisser avant tous désigner la mienne. Mais je n’osai, le cœur me battait trop fort ; je baissai les yeux en silence. Chacun de me railler ; quand mademoiselle Estelle, saisissant ma main : «Eh bien, non, c’est moi qui choisirai ! Je prends M. Hector !» Ô douleur ! elle riait aussi, la cruelle, en me regardant du haut de sa beauté...
Non, le temps n’y peut rien... d’autres amours n’effacent point la trace du premier... J’avais treize ans, quand je cessai de la voir... J’en avais trente quand, revenant d’Italie par les Alpes, mes yeux se voilèrent en apercevant de loin le Saint-Eynard, et la petite maison blanche, et la vieille tour... Je l’aimais encore... J’appris en arrivant qu’elle était devenue... mariée et... tout ce qui s’ensuit. Cela ne me guérit point. Ma mère, qui me taquinait quelquefois au sujet de ma première passion, eut peut-être tort de me jouer le tour qu’on va lire. «Tiens, me dit-elle, peu de jours après mon retour de Rome, voilà une lettre qu’on m’a chargée de faire tenir à une dame qui doit passer ici tout à l’heure dans la diligence de Vienne. Va au bureau du courrier, pendant qu’on changera de chevaux, tu demanderas madame F*** et tu lui remettras la lettre. Regarde bien cette dame, je parie que tu la reconnaîtras, bien que tu ne l’aies pas vue depuis dix-sept ans.» Je vais, sans me douter de ce que cela voulait dire, à la station de la diligence. À son arrivée, je m’approche la lettre à la main, demandant madame F***. «C’est moi, monsieur !» me dit une voix. C’est elle ! me dit un coup sourd qui retentit dans ma poitrine. Estelle !... encore belle !... Estelle !... la nymphe, l’hamadryade du Saint-Eynard, des vertes collines de Meylan ! C’est son port de tête, sa splendide chevelure, et son sourire éblouissant !... mais les petits brodequins roses, hélas ! où étaient-ils ?... On prit la lettre. Me reconnut-on ? je ne sais. La voiture repartit ; je rentrai tout vibrant de la commotion. «Allons, me dit ma mère en m’examinant, je vois que Némorin n’a point oublié son Estelle.» Son Estelle ! méchante mère !... IV
Je donne mon second concert. — La symphonie fantastique. — Liszt vient me voir. — Commencement de notre liaison. — Les critiques parisiens. — Mot de Cherubini. — Je pars pour l’Italie.
Malgré les pressantes sollicitations que j’adressai au ministre de l’intérieur pour qu’il me dispensât du voyage d’Italie, auquel ma qualité de lauréat de l’Institut m’obligeait, je dus me préparer à partir pour Rome.
Je ne voulus pourtant pas quitter Paris sans reproduire en public ma cantate de Sardanapale, dont le finale avait été abîmé à la distribution des prix de l’Institut. J’organisai, en conséquence, un concert au Conservatoire, où cette œuvre académique figura à côté de la symphonie fantastique qu’on n’avait pas encore entendue. Habeneck se chargea de diriger ce concert dont tous les exécutants, avec une bonne grâce dont je ne saurais trop les remercier, me prêtèrent une troisième fois leur concours gratuitement.
Ce fut la veille de ce jour que Liszt vint me voir. Nous ne nous connaissions pas encore. Je lui parlai du Faust de Gœthe, qu’il m’avoua n’avoir pas lu, et pour lequel il se passionna autant que moi bientôt après. Nous éprouvions une vive sympathie l’un pour l’autre, et depuis lors notre liaison n’a fait que se resserrer et se consolider.
Il assista à ce concert où il se fit remarquer de tout l’auditoire par ses applaudissements et ses enthousiastes démonstrations.
L’exécution ne fut pas irréprochable sans doute, ce n’était pas avec deux répétitions seulement qu’on pouvait en obtenir une parfaite pour des œuvres aussi compliquées. L’ensemble toutefois fut suffisant pour en laisser apercevoir les traits principaux. Trois morceaux de la symphonie, le Bal, la Marche au supplice et le Sabbat, firent une grande sensation. La Marche au supplice surtout bouleversa la salle. La Scène aux champs ne produisit aucun effet. Elle ressemblait peu, il est vrai, à ce qu’elle est aujourd’hui. Je pris aussitôt la résolution de la récrire, et F. Hiller, qui était alors à Paris, me donna à cet égard d’excellents conseils dont j’ai tâché de profiter.
La cantate fut bien rendue ; l’incendie s’alluma, l’écroulement eut lieu ; le succès fut très-grand. Quelques jours après, les aristarques de la presse se prononcèrent, les uns pour, les autres contre moi, avec passion. Mais les reproches que me faisait la critique hostile, au lieu de porter sur les défauts évidents des deux ouvrages entendus dans ce concert, défauts très-graves et que j’ai corrigés dans la symphonie, avec tout le soin dont je suis capable en retravaillant ma partition pendant plusieurs années, ces reproches, dis-je, tombaient presque tous à faux. Ils s’adressaient tantôt à des idées absurdes qu’on me supposait et que je n’eus jamais, tantôt à la rudesse de certaines modulations qui n’existaient pas, à l’inobservance systématique de certaines règles fondamentales de l’art que j’avais religieusement observées et à l’absence de certaines formes musicales qui étaient seules employées dans les passages où on en niait la présence. Au reste, je dois l’avouer, mes partisans m’ont aussi bien souvent attribué des intentions que je n’ai jamais eues, et parfaitement ridicules. Ce que la critique française a dépensé, depuis cette époque, à exalter ou à déchirer mes œuvres, de non sens, de folies, de systèmes extravagants, de sottise et d’aveuglement, passe toute croyance. Deux ou trois hommes seulement ont tout d’abord parlé de moi avec une sage et intelligente réserve. Mais les critiques clairvoyants, doués de savoir, de sensibilité, d’imagination et d’impartialité, capables de me juger sainement, de bien apprécier la portée de mes tentatives et la direction de mon esprit, ne sont pas aujourd’hui faciles à trouver. En tous cas ils n’existaient pas dans les premières années de ma carrière ; les exécutions rares et fort imparfaites de mes essais leur eussent d’ailleurs laissé beaucoup à deviner.
Tout ce qu’il y avait alors à Paris de jeunes gens doués d’un peu de culture musicale et de ce sixième sens qu’on nomme le sens artiste, musiciens ou non, me comprenait mieux et plus vite que ces froids prosateurs pleins de vanité et d’une ignorance prétentieuse. Les professeurs de musique dont les œuvres-bornes étaient rudement heurtées et écornées par quelques-unes des formes de mon style, commencèrent à me prendre en horreur. Mon impiété à l’égard de certaines croyances scolastiques surtout les exaspérait. Et Dieu sait s’il y a quelque chose de plus violent et de plus acharné qu’un pareil fanatisme. On juge de la colère que devaient causer à Cherubini ces questions hétérodoxes, soulevées à mon sujet, et tout ce bruit dont j’étais la cause. Ses affidés lui avaient rendu compte de la dernière répétition de l’abominable symphonie ; le lendemain, il passait devant la porte de la salle des concerts au moment où le public y entrait, quand quelqu’un l’arrêtant, lui dit : «Eh bien, monsieur Cherubini, vous ne venez pas entendre la nouvelle composition de Berlioz ? — Zé n’ai pas besoin d’aller savoir comment il né faut pas faire !» répondit-il, avec l’air d’un chat auquel on veut faire avaler de la moutarde. Ce fut bien pis, après le succès du concert : il semblait qu’il eût avalé la moutarde ; il ne parlait plus, il éternuait. Au bout de quelques jours, il me fit appeler : «Vous allez partir pour l’Italie, me dit-il ? — Oui, monsieur. — On va vous effacer des rézistres du Conservatoire, vos études sont terminées. Mais il mé semble qué, qué, qué, vous deviez venir mé faire une visite. On-on-on-on né sort pas d’ici comme d’une écurie !...» — Je fus sur le point de répondre : «Pourquoi non ? puisqu’on nous y traite comme des chevaux !» mais j’eus le bon sens de me contenir et d’assurer même à notre aimable directeur que je n’avais point eu la pensée de quitter Paris sans venir prendre congé de lui et le remercier de ses bontés.
Il fallut donc, bon gré mal gré, me diriger vers l’académie de Rome, où je devais avoir le loisir d’oublier les gracieusetés du bon Cherubini, les coups de lance à fer émoulu du chevalier français Boïeldieu, les grotesques dissertations des feuilletonistes, les chaleureuses démonstrations de mes amis, les invectives de mes ennemis, et le monde musical et même la musique.
Cette institution eut sans doute, dans le principe, un but d’utilité pour l’art et les artistes. Il ne m’appartient pas de juger jusqu’à quel point les intentions du fondateur ont été remplies à l’égard des peintres, sculpteurs, graveurs et architectes ; quant aux musiciens, le voyage d’Italie, favorable au développement de leur imagination par le trésor de poésie que la nature, l’art et les souvenirs étalent à l’envi sous leurs pas, est au moins inutile sous le rapport des études spéciales qu’ils y peuvent faire. Mais le fait ressortira plus évident du tableau fidèle de la vie que mènent à Rome les artistes français. Avant de s’y rendre, les cinq ou six nouveaux lauréats se réunissent pour combiner ensemble les arrangements du grand voyage qui se fait d’ordinaire en commun. Un voiturin se charge, moyennant une somme assez modique, de faire parvenir en Italie sa cargaison de grands hommes, en les entassant dans une lourde carriole, ni plus, ni moins que des bourgeois du marais. Comme il ne change jamais de chevaux, il lui faut beaucoup de temps pour traverser la France, passer les Alpes, et parvenir dans les États-Romains ; mais ce voyage à petites journées doit être fécond en incidents pour une demi-douzaine de jeunes voyageurs, dont l’esprit, à cette époque, est loin d’être tourné à la mélancolie. Si j’en parle sous la forme dubitative, c’est que je ne l’ai pas fait ainsi moi-même ; diverses circonstances me retinrent à Paris, après la cérémonie auguste de mon couronnement, jusqu’au milieu de janvier ; et après être allé passer quelques semaines à la Côte-Saint-André, où mes parents, tout fiers de la palme académique que je venais d’obtenir, me firent le meilleur accueil, je m’acheminai vers l’Italie, seul et assez triste.
Malgré les pressantes sollicitations que j’adressai au ministre de l’intérieur pour qu’il me dispensât du voyage d’Italie, auquel ma qualité de lauréat de l’Institut m’obligeait, je dus me préparer à partir pour Rome.
Je ne voulus pourtant pas quitter Paris sans reproduire en public ma cantate de Sardanapale, dont le finale avait été abîmé à la distribution des prix de l’Institut. J’organisai, en conséquence, un concert au Conservatoire, où cette œuvre académique figura à côté de la symphonie fantastique qu’on n’avait pas encore entendue. Habeneck se chargea de diriger ce concert dont tous les exécutants, avec une bonne grâce dont je ne saurais trop les remercier, me prêtèrent une troisième fois leur concours gratuitement.
Ce fut la veille de ce jour que Liszt vint me voir. Nous ne nous connaissions pas encore. Je lui parlai du Faust de Gœthe, qu’il m’avoua n’avoir pas lu, et pour lequel il se passionna autant que moi bientôt après. Nous éprouvions une vive sympathie l’un pour l’autre, et depuis lors notre liaison n’a fait que se resserrer et se consolider.
Il assista à ce concert où il se fit remarquer de tout l’auditoire par ses applaudissements et ses enthousiastes démonstrations.
L’exécution ne fut pas irréprochable sans doute, ce n’était pas avec deux répétitions seulement qu’on pouvait en obtenir une parfaite pour des œuvres aussi compliquées. L’ensemble toutefois fut suffisant pour en laisser apercevoir les traits principaux. Trois morceaux de la symphonie, le Bal, la Marche au supplice et le Sabbat, firent une grande sensation. La Marche au supplice surtout bouleversa la salle. La Scène aux champs ne produisit aucun effet. Elle ressemblait peu, il est vrai, à ce qu’elle est aujourd’hui. Je pris aussitôt la résolution de la récrire, et F. Hiller, qui était alors à Paris, me donna à cet égard d’excellents conseils dont j’ai tâché de profiter.
La cantate fut bien rendue ; l’incendie s’alluma, l’écroulement eut lieu ; le succès fut très-grand. Quelques jours après, les aristarques de la presse se prononcèrent, les uns pour, les autres contre moi, avec passion. Mais les reproches que me faisait la critique hostile, au lieu de porter sur les défauts évidents des deux ouvrages entendus dans ce concert, défauts très-graves et que j’ai corrigés dans la symphonie, avec tout le soin dont je suis capable en retravaillant ma partition pendant plusieurs années, ces reproches, dis-je, tombaient presque tous à faux. Ils s’adressaient tantôt à des idées absurdes qu’on me supposait et que je n’eus jamais, tantôt à la rudesse de certaines modulations qui n’existaient pas, à l’inobservance systématique de certaines règles fondamentales de l’art que j’avais religieusement observées et à l’absence de certaines formes musicales qui étaient seules employées dans les passages où on en niait la présence. Au reste, je dois l’avouer, mes partisans m’ont aussi bien souvent attribué des intentions que je n’ai jamais eues, et parfaitement ridicules. Ce que la critique française a dépensé, depuis cette époque, à exalter ou à déchirer mes œuvres, de non sens, de folies, de systèmes extravagants, de sottise et d’aveuglement, passe toute croyance. Deux ou trois hommes seulement ont tout d’abord parlé de moi avec une sage et intelligente réserve. Mais les critiques clairvoyants, doués de savoir, de sensibilité, d’imagination et d’impartialité, capables de me juger sainement, de bien apprécier la portée de mes tentatives et la direction de mon esprit, ne sont pas aujourd’hui faciles à trouver. En tous cas ils n’existaient pas dans les premières années de ma carrière ; les exécutions rares et fort imparfaites de mes essais leur eussent d’ailleurs laissé beaucoup à deviner.
Tout ce qu’il y avait alors à Paris de jeunes gens doués d’un peu de culture musicale et de ce sixième sens qu’on nomme le sens artiste, musiciens ou non, me comprenait mieux et plus vite que ces froids prosateurs pleins de vanité et d’une ignorance prétentieuse. Les professeurs de musique dont les œuvres-bornes étaient rudement heurtées et écornées par quelques-unes des formes de mon style, commencèrent à me prendre en horreur. Mon impiété à l’égard de certaines croyances scolastiques surtout les exaspérait. Et Dieu sait s’il y a quelque chose de plus violent et de plus acharné qu’un pareil fanatisme. On juge de la colère que devaient causer à Cherubini ces questions hétérodoxes, soulevées à mon sujet, et tout ce bruit dont j’étais la cause. Ses affidés lui avaient rendu compte de la dernière répétition de l’abominable symphonie ; le lendemain, il passait devant la porte de la salle des concerts au moment où le public y entrait, quand quelqu’un l’arrêtant, lui dit : «Eh bien, monsieur Cherubini, vous ne venez pas entendre la nouvelle composition de Berlioz ? — Zé n’ai pas besoin d’aller savoir comment il né faut pas faire !» répondit-il, avec l’air d’un chat auquel on veut faire avaler de la moutarde. Ce fut bien pis, après le succès du concert : il semblait qu’il eût avalé la moutarde ; il ne parlait plus, il éternuait. Au bout de quelques jours, il me fit appeler : «Vous allez partir pour l’Italie, me dit-il ? — Oui, monsieur. — On va vous effacer des rézistres du Conservatoire, vos études sont terminées. Mais il mé semble qué, qué, qué, vous deviez venir mé faire une visite. On-on-on-on né sort pas d’ici comme d’une écurie !...» — Je fus sur le point de répondre : «Pourquoi non ? puisqu’on nous y traite comme des chevaux !» mais j’eus le bon sens de me contenir et d’assurer même à notre aimable directeur que je n’avais point eu la pensée de quitter Paris sans venir prendre congé de lui et le remercier de ses bontés.
Il fallut donc, bon gré mal gré, me diriger vers l’académie de Rome, où je devais avoir le loisir d’oublier les gracieusetés du bon Cherubini, les coups de lance à fer émoulu du chevalier français Boïeldieu, les grotesques dissertations des feuilletonistes, les chaleureuses démonstrations de mes amis, les invectives de mes ennemis, et le monde musical et même la musique.
Cette institution eut sans doute, dans le principe, un but d’utilité pour l’art et les artistes. Il ne m’appartient pas de juger jusqu’à quel point les intentions du fondateur ont été remplies à l’égard des peintres, sculpteurs, graveurs et architectes ; quant aux musiciens, le voyage d’Italie, favorable au développement de leur imagination par le trésor de poésie que la nature, l’art et les souvenirs étalent à l’envi sous leurs pas, est au moins inutile sous le rapport des études spéciales qu’ils y peuvent faire. Mais le fait ressortira plus évident du tableau fidèle de la vie que mènent à Rome les artistes français. Avant de s’y rendre, les cinq ou six nouveaux lauréats se réunissent pour combiner ensemble les arrangements du grand voyage qui se fait d’ordinaire en commun. Un voiturin se charge, moyennant une somme assez modique, de faire parvenir en Italie sa cargaison de grands hommes, en les entassant dans une lourde carriole, ni plus, ni moins que des bourgeois du marais. Comme il ne change jamais de chevaux, il lui faut beaucoup de temps pour traverser la France, passer les Alpes, et parvenir dans les États-Romains ; mais ce voyage à petites journées doit être fécond en incidents pour une demi-douzaine de jeunes voyageurs, dont l’esprit, à cette époque, est loin d’être tourné à la mélancolie. Si j’en parle sous la forme dubitative, c’est que je ne l’ai pas fait ainsi moi-même ; diverses circonstances me retinrent à Paris, après la cérémonie auguste de mon couronnement, jusqu’au milieu de janvier ; et après être allé passer quelques semaines à la Côte-Saint-André, où mes parents, tout fiers de la palme académique que je venais d’obtenir, me firent le meilleur accueil, je m’acheminai vers l’Italie, seul et assez triste.
Mes soirées à l’Opéra. — Mon prosélytisme. — Scandales. — Scène d’enthousiasme. Sensibilité d’un mathématicien.
La plupart des représentations de l’Opéra étaient des solennités auxquelles je me préparais par la lecture et la méditation des ouvrages qu’on y devait exécuter. Le fanatisme d’admiration que nous professions, quelques habitués du parterre et moi, pour nos auteurs favoris, n’était comparable qu’à notre haine profonde pour les autres. Le Jupiter de notre Olympe était Gluck, et le culte que nous lui rendions ne se peut comparer à rien de ce que le dilettantisme le plus effréné pourrait imaginer aujourd’hui. Mais si quelques-uns de mes amis étaient de fidèles sectateurs de cette religion musicale, je puis dire sans vanité que j’en étais le pontife. Quand je voyais faiblir leur ferveur, je la ranimais par des prédications dignes des Saint-Simoniens ; je les amenais à l’Opéra bon gré, mal gré, souvent en leur donnant des billets achetés de mon argent, au bureau, et que je prétendais avoir reçus d’un employé de l’administration. Dès que, grâce à cette ruse, j’avais entraîné mes hommes à la représentation du chef-d’œuvre de Gluck, je les plaçais sur une banquette du parterre, en leur recommandant bien de n’en pas changer, vu que toutes les places n’étaient pas également bonnes pour l’audition, et qu’il n’y en avait pas une dont je n’eusse étudié les défauts ou les avantages. Ici on était trop près des cors, là on ne les entendait pas ; à droite le son des trombones dominait trop ; à gauche, répercuté par les loges du rez-de-chaussée, il produisait un effet désagréable ; en bas, on était trop près de l’orchestre, il écrasait les voix ; en haut, l’éloignement de la scène empêchait de distinguer les paroles, ou l’expression de la physionomie des acteurs ; l’instrumentation de cet ouvrage devait être entendue de tel endroit, les chœurs de celui-ci de tel autre ; à tel acte, la décoration représentant un bois sacré, la scène était très-vaste et le son se perdait dans le théâtre de toutes parts, il fallait donc se rapprocher ; un autre, au contraire, se passait dans l’intérieur d’un palais, le décor était ce que les machinistes appellent un salon fermé, la puissance des voix étant doublée par cette circonstance si indifférente en apparence, on devait remonter un peu dans le parterre, afin que les sons de l’orchestre et ceux des voix, entendus de moins près, paraissent plus intimement unis et fondus dans un ensemble plus harmonieux.
Une fois ces instructions données, je demandais à mes néophytes s’ils connaissaient bien la pièce qu’ils allaient entendre. S’ils n’en avaient pas lu les paroles, je tirais un livret de ma poche, et, profitant du temps qui nous restait avant le lever de la toile, je le leur faisais lire, en ajoutant aux principaux passages toutes les observations que je croyais propres à leur faciliter l’intelligence de la pensée du compositeur ; car nous venions toujours de fort bonne heure pour avoir le choix des places, ne pas nous exposer à manquer les premières notes de l’ouverture, et goûter ce charme singulier de l’attente avant une grande jouissance qu’on est assuré d’obtenir. En outre, nous trouvions beaucoup de plaisir à voir l’orchestre, vide d’abord et ne représentant qu’un piano sans cordes, se garnir peu à peu de musique et de musiciens. Le garçon d’orchestre y entra le premier pour placer les parties sur les pupitres. Ce moment-là n’était pas pour nous sans mélange de craintes ; depuis notre arrivée, quelque accident pouvait être survenu ; on avait peut-être changé le spectacle et substitué à l’œuvre monumentale de Gluck quelque Rossignol, quelques Prétendus, une Caravane du Caire, un Panurge, un Devin du village, une Lasthénie, toutes productions plus ou moins pâles et maigres, plus ou moins plates et fausses, pour lesquelles nous professions un égal et souverain mépris. Le nom de la pièce inscrit en grosses lettres sur les parties de contre-basse qui, par leur position, se trouvent les plus rapprochées du parterre, nous tirait d’inquiétude ou justifiait nos appréhensions. Dans ce dernier cas, nous nous précipitions hors de la salle, en jurant comme des soldats en maraude qui ne trouveraient que de l’eau dans ce qu’ils ont pris pour des barriques d’eau-de-vie, et en confondant dans nos malédictions l’auteur de la pièce substituée, le directeur qui l’infligeait au public, et le gouvernement qui la laissait représenter. Pauvre Rousseau, qui attachait autant d’importance à sa partition du Devin du village, qu’aux chefs-d’œuvre d’éloquence qui ont immortalisé son nom, lui qui croyait fermement avoir écrasé Rameau tout entier, voire le trio des Parques[13], avec les petites chansons, les petits flons-flons, les petits rondeaux, les petits solos, les petites bergeries, les petites drôleries de toute espèce dont se compose son petit intermède ; lui qu’on a tant tourmenté, lui que la secte des Holbachiens a tant envié pour son œuvre musicale, lui qu’on a accusé de n’en être pas l’auteur ; lui qui a été chanté par toute la France, depuis Jéliotte et mademoiselle Fel[14] jusqu’au roi Louis XV, qui ne pouvait se lasser de répéter : «J’ai perdu mon serviteur,» avec la voix la plus fausse de son royaume, lui enfin dont l’œuvre favorite obtint à son apparition tous les genres de succès ; pauvre Rousseau ! qu’eût-il dit de nos blasphèmes, s’il eût pu les entendre ? Et pouvait-il prévoir que son cher opéra, qui excita tant d’applaudissements, tomberait un jour pour ne plus se relever, sous le coup d’une énorme perruque poudrée à blanc, jetée aux pieds de Colette par un insolent railleur ? J’assistais, par extraordinaire, à cette dernière[15] représentation du Devin ; beaucoup de gens, en conséquence, m’ont attribué la mise en scène de la perruque ; mais je proteste de mon innocence. Je crois même avoir été autant indigné que diverti par cette grotesque irrévérence, de sorte que je ne puis savoir au juste si j’en eusse été capable. Mais s’imaginerait-on que Gluck, oui, Gluck lui-même, à propos de ce triste Devin, il y a quelque cinquante ans, a poussé l’ironie plus loin encore, et qu’il a osé écrire et imprimer dans une épître la plus sérieuse du monde, adressée à la reine Marie-Antoinette, que la France, peu favorisée sous le rapport musical, comptait pourtant quelques ouvrages remarquables, parmi lesquels il fallait citer le Devin du village de M. Rousseau ? Qui jamais se fût avisé de penser que Gluck pût être aussi plaisant ? Ce trait seul d’un Allemand suffit pour enlever aux Italiens la palme de la perfidie facétieuse.
La plupart des représentations de l’Opéra étaient des solennités auxquelles je me préparais par la lecture et la méditation des ouvrages qu’on y devait exécuter. Le fanatisme d’admiration que nous professions, quelques habitués du parterre et moi, pour nos auteurs favoris, n’était comparable qu’à notre haine profonde pour les autres. Le Jupiter de notre Olympe était Gluck, et le culte que nous lui rendions ne se peut comparer à rien de ce que le dilettantisme le plus effréné pourrait imaginer aujourd’hui. Mais si quelques-uns de mes amis étaient de fidèles sectateurs de cette religion musicale, je puis dire sans vanité que j’en étais le pontife. Quand je voyais faiblir leur ferveur, je la ranimais par des prédications dignes des Saint-Simoniens ; je les amenais à l’Opéra bon gré, mal gré, souvent en leur donnant des billets achetés de mon argent, au bureau, et que je prétendais avoir reçus d’un employé de l’administration. Dès que, grâce à cette ruse, j’avais entraîné mes hommes à la représentation du chef-d’œuvre de Gluck, je les plaçais sur une banquette du parterre, en leur recommandant bien de n’en pas changer, vu que toutes les places n’étaient pas également bonnes pour l’audition, et qu’il n’y en avait pas une dont je n’eusse étudié les défauts ou les avantages. Ici on était trop près des cors, là on ne les entendait pas ; à droite le son des trombones dominait trop ; à gauche, répercuté par les loges du rez-de-chaussée, il produisait un effet désagréable ; en bas, on était trop près de l’orchestre, il écrasait les voix ; en haut, l’éloignement de la scène empêchait de distinguer les paroles, ou l’expression de la physionomie des acteurs ; l’instrumentation de cet ouvrage devait être entendue de tel endroit, les chœurs de celui-ci de tel autre ; à tel acte, la décoration représentant un bois sacré, la scène était très-vaste et le son se perdait dans le théâtre de toutes parts, il fallait donc se rapprocher ; un autre, au contraire, se passait dans l’intérieur d’un palais, le décor était ce que les machinistes appellent un salon fermé, la puissance des voix étant doublée par cette circonstance si indifférente en apparence, on devait remonter un peu dans le parterre, afin que les sons de l’orchestre et ceux des voix, entendus de moins près, paraissent plus intimement unis et fondus dans un ensemble plus harmonieux.
Une fois ces instructions données, je demandais à mes néophytes s’ils connaissaient bien la pièce qu’ils allaient entendre. S’ils n’en avaient pas lu les paroles, je tirais un livret de ma poche, et, profitant du temps qui nous restait avant le lever de la toile, je le leur faisais lire, en ajoutant aux principaux passages toutes les observations que je croyais propres à leur faciliter l’intelligence de la pensée du compositeur ; car nous venions toujours de fort bonne heure pour avoir le choix des places, ne pas nous exposer à manquer les premières notes de l’ouverture, et goûter ce charme singulier de l’attente avant une grande jouissance qu’on est assuré d’obtenir. En outre, nous trouvions beaucoup de plaisir à voir l’orchestre, vide d’abord et ne représentant qu’un piano sans cordes, se garnir peu à peu de musique et de musiciens. Le garçon d’orchestre y entra le premier pour placer les parties sur les pupitres. Ce moment-là n’était pas pour nous sans mélange de craintes ; depuis notre arrivée, quelque accident pouvait être survenu ; on avait peut-être changé le spectacle et substitué à l’œuvre monumentale de Gluck quelque Rossignol, quelques Prétendus, une Caravane du Caire, un Panurge, un Devin du village, une Lasthénie, toutes productions plus ou moins pâles et maigres, plus ou moins plates et fausses, pour lesquelles nous professions un égal et souverain mépris. Le nom de la pièce inscrit en grosses lettres sur les parties de contre-basse qui, par leur position, se trouvent les plus rapprochées du parterre, nous tirait d’inquiétude ou justifiait nos appréhensions. Dans ce dernier cas, nous nous précipitions hors de la salle, en jurant comme des soldats en maraude qui ne trouveraient que de l’eau dans ce qu’ils ont pris pour des barriques d’eau-de-vie, et en confondant dans nos malédictions l’auteur de la pièce substituée, le directeur qui l’infligeait au public, et le gouvernement qui la laissait représenter. Pauvre Rousseau, qui attachait autant d’importance à sa partition du Devin du village, qu’aux chefs-d’œuvre d’éloquence qui ont immortalisé son nom, lui qui croyait fermement avoir écrasé Rameau tout entier, voire le trio des Parques[13], avec les petites chansons, les petits flons-flons, les petits rondeaux, les petits solos, les petites bergeries, les petites drôleries de toute espèce dont se compose son petit intermède ; lui qu’on a tant tourmenté, lui que la secte des Holbachiens a tant envié pour son œuvre musicale, lui qu’on a accusé de n’en être pas l’auteur ; lui qui a été chanté par toute la France, depuis Jéliotte et mademoiselle Fel[14] jusqu’au roi Louis XV, qui ne pouvait se lasser de répéter : «J’ai perdu mon serviteur,» avec la voix la plus fausse de son royaume, lui enfin dont l’œuvre favorite obtint à son apparition tous les genres de succès ; pauvre Rousseau ! qu’eût-il dit de nos blasphèmes, s’il eût pu les entendre ? Et pouvait-il prévoir que son cher opéra, qui excita tant d’applaudissements, tomberait un jour pour ne plus se relever, sous le coup d’une énorme perruque poudrée à blanc, jetée aux pieds de Colette par un insolent railleur ? J’assistais, par extraordinaire, à cette dernière[15] représentation du Devin ; beaucoup de gens, en conséquence, m’ont attribué la mise en scène de la perruque ; mais je proteste de mon innocence. Je crois même avoir été autant indigné que diverti par cette grotesque irrévérence, de sorte que je ne puis savoir au juste si j’en eusse été capable. Mais s’imaginerait-on que Gluck, oui, Gluck lui-même, à propos de ce triste Devin, il y a quelque cinquante ans, a poussé l’ironie plus loin encore, et qu’il a osé écrire et imprimer dans une épître la plus sérieuse du monde, adressée à la reine Marie-Antoinette, que la France, peu favorisée sous le rapport musical, comptait pourtant quelques ouvrages remarquables, parmi lesquels il fallait citer le Devin du village de M. Rousseau ? Qui jamais se fût avisé de penser que Gluck pût être aussi plaisant ? Ce trait seul d’un Allemand suffit pour enlever aux Italiens la palme de la perfidie facétieuse.
Video de Hector Berlioz (1)
Voir plusAjouter une vidéo
Dans la catégorie :
Biographie: artistes et sportifsVoir plus
>Histoire, géographie, sciences auxiliaires de l'histoire>Biographie générale et généalogie>Biographie: artistes et sportifs (789)
autres livres classés : autobiographieVoir plus
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Hector Berlioz (32)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les lettres d'Hector Berlioz
Mon prénom, c'est aussi le nom d'un personnage que je mets en scène dans un de mes opéras : les Troyens. Opéra dont je compose le livret, en alexandrins, à partir du texte original que je lis en latin. Mais qui a écrit le poème original ?
Hector
Homère
Virgile
Plaute
10 questions
12 lecteurs ont répondu
Thème :
Hector BerliozCréer un quiz sur ce livre12 lecteurs ont répondu