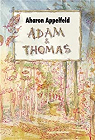Aharon Appelfeld
Valérie Zenatti (Traducteur)/5 307 notes
Valérie Zenatti (Traducteur)/5 307 notes
Résumé :
Quatrième de couverture:
Comment un enfant ayant tout perdu peut-il survivre plusieurs années seul dans les sombres forêts ukrainiennes ?
Aharon Appelfeld a dix ans lorsqu'il s'échappe du camp. Sa longue errance le conduira, quatre ans plus tard, en Palestine.
Plongé dans le silence depuis le début de la guerre, il apprend une nouvelle langue. Il l'utilisera désormais pour tenter de relier les différentes strates de sa vie à leurs racines perdu... >Voir plus
Comment un enfant ayant tout perdu peut-il survivre plusieurs années seul dans les sombres forêts ukrainiennes ?
Aharon Appelfeld a dix ans lorsqu'il s'échappe du camp. Sa longue errance le conduira, quatre ans plus tard, en Palestine.
Plongé dans le silence depuis le début de la guerre, il apprend une nouvelle langue. Il l'utilisera désormais pour tenter de relier les différentes strates de sa vie à leurs racines perdu... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Histoire d'une vieVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (56)
Voir plus
Ajouter une critique
« Je suis né dans un monde cruel, j'ai vécu l'enfer. Pour ne pas perdre la tête, il a fallu se forcer à oublier, à réprimer. Mais un jour j'ai compris que refouler des émotions pareilles c'était dangereux. Alors j'ai laissé remonter les souvenirs – ceux de mes parents, ceux de mes grands-parents, l'odeur des rues de mon enfance… ».
« Histoire d'une vie », un titre qui passerait presque inaperçu, un titre qui ne claque pas, qui n'interpelle pas, n'accroche pas le regard. Sauf qu'il s'agit d'Aharon Appelfeld et de sa vie, et là ça change tout. La biographie, voire l'autobiographie de ce grand écrivain ? Pas du tout, le terme d'histoire devrait plutôt être mis au pluriel, histoires d'une vie serait plus approprié, voire bribes ou fragments de mémoire, voilà un titre qui résumerait bien le contenu de ce récit, un récit tout en retenue, en délicatesse. Même l'horreur des camps est racontée avec dignité et avec peu de mots. Ou plutôt des bribes d'horreur, des flashs qui remontent à la surface. Peu de détails, peu d'éléments chronologiques, peu de liens de cause à effet qui lui échappaient totalement alors qu'il était enfant, juste la mémoire authentique qui afflue, vient et repart, en vagues de douleurs. Ressac de sentiments qui effleurent à peine l'amer mais va chercher loin sur ce qui a de plus profond en l'humain, nos abysses intimes. Les évènements relatés avec ses yeux d'enfant, son regard d'enfant, regard qui ne comprend pas tous les éléments factuels mais qui voie, qui ressent le moment présent. Je me suis surprise à avoir les larmes aux yeux plus d'une fois tant cette façon digne de raconter m'a émue. Je n'ai d'ailleurs pas réussi à le lire d'une traite, il m'a fallu faire des pauses de lecture.
« Tout ce qui s'est passé s'est inscrit dans les cellules du corps et non dans la mémoire. Les cellules, semble-t-il, se souviennent mieux que la mémoire, pourtant prédestinée à cela. de longues années après la guerre, je ne marchais ni au milieu du trottoir ni au milieu de la route, je rasais les murs, toujours dans l'ombre et toujours d'un pas rapide, comme si je fuyais. Je ne suis pas enclin à pleurer en général, mais des séparations insignifiantes me font sangloter violemment ».
Un témoignage sous forme de bribes, de flashs éphémères, de traces, d'instants de contemplation non linéaires. C'est une façon de se raconter d'une sincérité extrême. Pourtant je dois avouer avoir été déstabilisée lorsque j'ai ouvert le livre. Ces bribes de mémoire me semblaient d'un style simple, voire un peu distant, froid, j'étais en retrait. Puis j'ai ressenti et compris à quel point pour cet auteur parler des affects est délicat, à quel point cela peut entrainer dans un labyrinthe sentimental dont il ne veut pas prendre le chemin. Pas de pathos, pas de plainte, pas d'aplatissement mais une élévation silencieuse. Oui, peu à peu la magie a opéré, cette voix est bien celle du petit garçon qu'il était. Aharon Appelfeld n'essaie pas de revisiter ses souvenirs en adulte, de les transformer avec sa vision d'homme, mais veut respecter la mémoire comme une donnée brute, sans analyse, la mémoire et les ressentis du petit garçon qu'il était. La mémoire remonte en bulles éphémères et éclatent, nous éclaboussant au passage. de violentes taches de mémoire comme refuges sans la déformer, la travestir, et sans tomber dans les affres de l'imagination.
« La mémoire était réelle, solide, d'une certaine façon. L'imagination avait des ailes. La mémoire tendait vers le connu, l'imagination embarquait vers l'inconnu. La mémoire répandait sur moi douceur et sérénité. L'imagination me ballotait de droite à gauche et finalement m'angoissait ».
Aharon Appelfeld est originaire de Roumanie, enfant unique d'une famille juive. Ses grands-parents sont pratiquants et parlent le yiddish, une langue qu'il ne comprend pas, qu'il apprendra dans les camps, et qui le fascine. @Yaena avec qui nous avons fait cette lecture en parallèle, me disait qu'Aharon Appelfeld avait peur d'oublier l'hébreu car, petit garçon, on lui imposait l'allemand. Il vérifiait en se parlant à lui-même dans sa tête. Cet élément a ensuite été présent durant ma lecture, magie du partage et de la lecture en duo. le monde de ce petit garçon de 9 ou 10 ans bascule avec l'arrivée de la répression anti-juive du gouvernement roumain. Sa mère est assassinée en 1940 et il connaitra avec son père le ghetto puis la déportation. Il s'échappera, seul, trouvera refuge dans les forêts et rencontrera des adultes plus ou moins bienveillants avec lui. L'occasion pour lui de découvrir l'âme humaine et de lui préférer les objets et les animaux. Il retrouvera par miracle son père plus tard en Israël.
« Plus de cinquante ans ont passé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. le coeur a beaucoup oublié, principalement des lieux, des dates, des noms de gens, et pourtant je ressens ces jours-là dans tout mon corps. Chaque fois qu'il pleut, qu'il fait froid, ou que souffle un vent violent, je suis de nouveau dans le ghetto, dans le camp, ou dans les forêts qui m'ont abrité longtemps. La mémoire, s'avère-t-il, a des racines profondément ancrées dans le corps. Il suffit parfois de l'odeur de la paille pourrie ou du cri d'un oiseau pour me transporter loin et à l'intérieur. Je dis à l'intérieur bien que je n'aie pas encore trouvé de mots pour ces violentes taches de mémoire ».
Une ode au langage, aux langues. Une ode aux mots, aux mots parlés, aux mots écrits. Aux mots murmurés. L'océan de mots après le silence étourdissant de la guerre. Les mots qui encerclent et délimitent les catastrophes pour mieux s'en protéger. Et l'auteur de trouver sa place, l'auteur d'abord bègue et ne pouvant qu'écrire des mots, pas de phrase, va réapprendre à s'exprimer pour dire l'indicible.
Je termine la lecture de ce livre émue, en éprouvant du respect, de la tendresse, de l'empathie et de l'admiration pour cet homme. Avec ce témoignage poignant sur sa vie et ces réflexions précieuses et magnifiques sur la mémoire, sur l'âme humaine, sur les identités palimpsestes, Aharon Appelfeld nous offre un récit empli d'humanité dans lequel, je le sais, je reviendrai de temps à autre, comme on vient parler à un ami. Un ami en exil. Un ami juif, européen, israélien, une triple peau si lourde à porter.
« Histoire d'une vie », un titre qui passerait presque inaperçu, un titre qui ne claque pas, qui n'interpelle pas, n'accroche pas le regard. Sauf qu'il s'agit d'Aharon Appelfeld et de sa vie, et là ça change tout. La biographie, voire l'autobiographie de ce grand écrivain ? Pas du tout, le terme d'histoire devrait plutôt être mis au pluriel, histoires d'une vie serait plus approprié, voire bribes ou fragments de mémoire, voilà un titre qui résumerait bien le contenu de ce récit, un récit tout en retenue, en délicatesse. Même l'horreur des camps est racontée avec dignité et avec peu de mots. Ou plutôt des bribes d'horreur, des flashs qui remontent à la surface. Peu de détails, peu d'éléments chronologiques, peu de liens de cause à effet qui lui échappaient totalement alors qu'il était enfant, juste la mémoire authentique qui afflue, vient et repart, en vagues de douleurs. Ressac de sentiments qui effleurent à peine l'amer mais va chercher loin sur ce qui a de plus profond en l'humain, nos abysses intimes. Les évènements relatés avec ses yeux d'enfant, son regard d'enfant, regard qui ne comprend pas tous les éléments factuels mais qui voie, qui ressent le moment présent. Je me suis surprise à avoir les larmes aux yeux plus d'une fois tant cette façon digne de raconter m'a émue. Je n'ai d'ailleurs pas réussi à le lire d'une traite, il m'a fallu faire des pauses de lecture.
« Tout ce qui s'est passé s'est inscrit dans les cellules du corps et non dans la mémoire. Les cellules, semble-t-il, se souviennent mieux que la mémoire, pourtant prédestinée à cela. de longues années après la guerre, je ne marchais ni au milieu du trottoir ni au milieu de la route, je rasais les murs, toujours dans l'ombre et toujours d'un pas rapide, comme si je fuyais. Je ne suis pas enclin à pleurer en général, mais des séparations insignifiantes me font sangloter violemment ».
Un témoignage sous forme de bribes, de flashs éphémères, de traces, d'instants de contemplation non linéaires. C'est une façon de se raconter d'une sincérité extrême. Pourtant je dois avouer avoir été déstabilisée lorsque j'ai ouvert le livre. Ces bribes de mémoire me semblaient d'un style simple, voire un peu distant, froid, j'étais en retrait. Puis j'ai ressenti et compris à quel point pour cet auteur parler des affects est délicat, à quel point cela peut entrainer dans un labyrinthe sentimental dont il ne veut pas prendre le chemin. Pas de pathos, pas de plainte, pas d'aplatissement mais une élévation silencieuse. Oui, peu à peu la magie a opéré, cette voix est bien celle du petit garçon qu'il était. Aharon Appelfeld n'essaie pas de revisiter ses souvenirs en adulte, de les transformer avec sa vision d'homme, mais veut respecter la mémoire comme une donnée brute, sans analyse, la mémoire et les ressentis du petit garçon qu'il était. La mémoire remonte en bulles éphémères et éclatent, nous éclaboussant au passage. de violentes taches de mémoire comme refuges sans la déformer, la travestir, et sans tomber dans les affres de l'imagination.
« La mémoire était réelle, solide, d'une certaine façon. L'imagination avait des ailes. La mémoire tendait vers le connu, l'imagination embarquait vers l'inconnu. La mémoire répandait sur moi douceur et sérénité. L'imagination me ballotait de droite à gauche et finalement m'angoissait ».
Aharon Appelfeld est originaire de Roumanie, enfant unique d'une famille juive. Ses grands-parents sont pratiquants et parlent le yiddish, une langue qu'il ne comprend pas, qu'il apprendra dans les camps, et qui le fascine. @Yaena avec qui nous avons fait cette lecture en parallèle, me disait qu'Aharon Appelfeld avait peur d'oublier l'hébreu car, petit garçon, on lui imposait l'allemand. Il vérifiait en se parlant à lui-même dans sa tête. Cet élément a ensuite été présent durant ma lecture, magie du partage et de la lecture en duo. le monde de ce petit garçon de 9 ou 10 ans bascule avec l'arrivée de la répression anti-juive du gouvernement roumain. Sa mère est assassinée en 1940 et il connaitra avec son père le ghetto puis la déportation. Il s'échappera, seul, trouvera refuge dans les forêts et rencontrera des adultes plus ou moins bienveillants avec lui. L'occasion pour lui de découvrir l'âme humaine et de lui préférer les objets et les animaux. Il retrouvera par miracle son père plus tard en Israël.
« Plus de cinquante ans ont passé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. le coeur a beaucoup oublié, principalement des lieux, des dates, des noms de gens, et pourtant je ressens ces jours-là dans tout mon corps. Chaque fois qu'il pleut, qu'il fait froid, ou que souffle un vent violent, je suis de nouveau dans le ghetto, dans le camp, ou dans les forêts qui m'ont abrité longtemps. La mémoire, s'avère-t-il, a des racines profondément ancrées dans le corps. Il suffit parfois de l'odeur de la paille pourrie ou du cri d'un oiseau pour me transporter loin et à l'intérieur. Je dis à l'intérieur bien que je n'aie pas encore trouvé de mots pour ces violentes taches de mémoire ».
Une ode au langage, aux langues. Une ode aux mots, aux mots parlés, aux mots écrits. Aux mots murmurés. L'océan de mots après le silence étourdissant de la guerre. Les mots qui encerclent et délimitent les catastrophes pour mieux s'en protéger. Et l'auteur de trouver sa place, l'auteur d'abord bègue et ne pouvant qu'écrire des mots, pas de phrase, va réapprendre à s'exprimer pour dire l'indicible.
Je termine la lecture de ce livre émue, en éprouvant du respect, de la tendresse, de l'empathie et de l'admiration pour cet homme. Avec ce témoignage poignant sur sa vie et ces réflexions précieuses et magnifiques sur la mémoire, sur l'âme humaine, sur les identités palimpsestes, Aharon Appelfeld nous offre un récit empli d'humanité dans lequel, je le sais, je reviendrai de temps à autre, comme on vient parler à un ami. Un ami en exil. Un ami juif, européen, israélien, une triple peau si lourde à porter.
« La mémoire était réelle, solide, d'une certaine façon. L'imagination avait des ailes. La mémoire tendait vers le connu, l'imagination embarquait vers l'inconnu. La mémoire répandait sur moi douceur et sérénité. L'imagination me ballotait de droite à gauche et finalement m'angoissait ».
Comment puis-je approcher, sans trahir le projet de l'auteur, l'âme de ce livre afin de rédiger un commentaire sur la biographie d'Aharon Appelfeld. Il écrit en préface « ce livre n'est pas un résumé mais plutôt une tentative, un effort désespéré pour relier les différentes strates de ma vie à leur racine ».
(Je me suis sentie tellement proche de l'auteur que je me suis autorisée à l'appeler par son prénom tout au long de ma chronique.)
Aharon, pour écrire son récit, fait appel à des traces mémorielles et des instants extrêmes de contemplation. Ces impressions, elles sont restées enfouies au plus profond de son inconscient afin de pouvoir survivre. Cette lecture se lit paisiblement tant Aharon met la souffrance à distance. Il n'écrit pas sur les chambres à gaz, sur les camps de concentration, il écrit et relate les évènements avec ses yeux d'enfant, cet enfant niché au plus profond de son coeur qu'il a tenté de préserver.
Originaire de Roumanie, Aharon est issu d'une famille juive assimilée, germanophone. Ses grands-parents, pratiquants, s'expriment en yiddish au grand dam de ses parents. Il nous confie quelques souvenirs qui lui restent de ses grands-parents et notamment, cette rencontre, à la synagogue, avec la langue de Dieu qu'il ne comprend pas. Je pense que c'est sa première rencontre avec l'Hébreu. Cette langue qui va tenir une place importante dans sa vie. Il a une petite enfance heureuse entre une maman tendre, un papa plus distant et ses grands-parents.
Et puis, le monde d'Aharon bascule sous le joug meurtrier du gouvernement roumain et sa répression anti-juive. Sa mère est assassinée en 1940. Il gardera le souvenir de son cri. Avec son père, il connait le ghetto puis la déportation d'où, seul, il s'échappera. Il aura la chance de retrouver son père, plus tard, en Israël.
Imaginez un enfant de dix ans dont les parents ont été assassinés parce que juifs, survivant dans les forêts ukrainiennes, trouvant un jour abri moyennant quelques petits travaux, chez une prostituée qui le maltraite, puis chez un paysan, tout aussi malveillant que la prostituée, mais sans jamais oublier l'abjecte dénonciation qui plane au-dessus de sa tête. En proie à une terreur constante, cette peur qui ne peut quitter l'enfant tant la chaîne de confiance qui le reliait à l'humanité, s'est brisée. Cet enfant s'est enfui de l'horreur du camp, ce cauchemar qui a fait de lui un animal traqué. Comment résister psychologiquement à de telles atrocités. La méfiance devient une seconde nature et les mots disparaissent, eux aussi deviennent inutiles, superflus et suspects. le silence règne dans les forêts ukrainiennes où il se cache pendant deux ans. Seule la contemplation de la nature parvient à lui faire oublier la faim et la peur. le traumatisme est d'une telle ampleur que la mémoire « cache » de l'enfant s'est vidée, au langage a succédé un bégaiement, c'est un retour à son animalité.
Aharon a souffert dans son corps, dans sa chair, dans son âme, et cette mémoire blessée, commotionnée, va se révéler sous l'effet d'un « déjà vu, déjà senti » mais cette mémoire cognitive ne pourra relier ses sensations à des évènements précis.
Me vient en mémoire cette phrase de Marcel Proust :
« Cette terrible puissance d'enregistrement qu'a le corps et qui fait de la douleur quelque chose de contemporain à toutes les époques de notre vie où nous avons souffert ».
Et malgré toutes ces horreurs, naîtra chez lui un espoir irraisonné, retrouver ses parents, et c'est de cette aspiration qu'il puisera chez lui un irrépressible instinct de survie qui le portera jusqu'en Israël où il deviendra l'un des plus grands écrivains de langue hébraïque.
Ce livre est magnifique, il est parcouru d'ombre et de Lumière, c'est un hymne à la Vie. Ce récit est extrêmement émouvant et particulièrement puissant, quelle force ! Il ne tombe jamais dans la plainte, la nostalgie, il reste pudique. L'écriture est douce et sereine malgré le contexte. Aharon me rappelle mon grand-père, on ne ressent aucune animosité malgré les épreuves de la vie, bien au contraire. Il sait nous raconter qu'il a rencontré des êtres ignobles mais qu'il a rencontré des êtres d'une générosité exceptionnelle. Les mots sont simples et laissent passer l'émotion, on ressent ce besoin de trouver le mot juste sans tomber dans l'inutile car il connait la valeur du « mot ». C'est terrible de se dire que ce sont de telles épreuves qui ont engendré ce grand auteur !
Ce qui m'a le plus interpelée, c'est la relation à la langue maternelle. Je ne m'étais jamais posé de questions sur les relations que nous entretenons avec notre langue maternelle. Pour Aharon, la langue allemande était devenue celle des assassins. Mais c'est aussi cette langue qui le reliait à ses parents. Il avait aussi perdu cette filiation. L'identité s'était effacée et c'est toute son histoire, tout son parcours qu'il tente de reconstituer sous sa plume entre le subjectif, les émotions et la réalité.
Il explique très bien ses difficultés avec l'apprentissage de l'Hébreu. L'allemand, le yiddish, le roumain, s'étaient les langues de l'amour de ses parents, les langues qui le rattachaient à ses racines. Y renoncer, n'était-ce pas mourir encore un peu ou faire mourir sa mère une seconde fois ! Comment retrouver dans l'Hébreu, ce lien affectif, intime d'où pourrait naître le sens de sa nouvelle vie, de l'écriture, de la communication. Ce sont des passages de sa reconstruction particulièrement édifiants. Lorsque l'Hébreu est devenu sa langue maternelle, son attachement à cette nouvelle terre, il raconte sa hantise de perdre, à nouveau cette langue, hantise qui se concrétisait dans ses cauchemars. L'Hébreu lui ouvrira aussi les portes de la spiritualité ce qui lui permettra de se retrouver.
Ces passages m'ont incitée à lire « L'angoisse d'Abraham » de Rosie Pinhas-Delpuech, qui dirige la collection « Lettres hébraïques » d'Actes Sud. Dans ce livre, elle tente d'interroger en profondeur notre relation à la langue maternelle et à l'exil.
« Nous sommes venus en Israël pour construire et être construits ». Ce n'est pas si simple !
Comment puis-je approcher, sans trahir le projet de l'auteur, l'âme de ce livre afin de rédiger un commentaire sur la biographie d'Aharon Appelfeld. Il écrit en préface « ce livre n'est pas un résumé mais plutôt une tentative, un effort désespéré pour relier les différentes strates de ma vie à leur racine ».
(Je me suis sentie tellement proche de l'auteur que je me suis autorisée à l'appeler par son prénom tout au long de ma chronique.)
Aharon, pour écrire son récit, fait appel à des traces mémorielles et des instants extrêmes de contemplation. Ces impressions, elles sont restées enfouies au plus profond de son inconscient afin de pouvoir survivre. Cette lecture se lit paisiblement tant Aharon met la souffrance à distance. Il n'écrit pas sur les chambres à gaz, sur les camps de concentration, il écrit et relate les évènements avec ses yeux d'enfant, cet enfant niché au plus profond de son coeur qu'il a tenté de préserver.
Originaire de Roumanie, Aharon est issu d'une famille juive assimilée, germanophone. Ses grands-parents, pratiquants, s'expriment en yiddish au grand dam de ses parents. Il nous confie quelques souvenirs qui lui restent de ses grands-parents et notamment, cette rencontre, à la synagogue, avec la langue de Dieu qu'il ne comprend pas. Je pense que c'est sa première rencontre avec l'Hébreu. Cette langue qui va tenir une place importante dans sa vie. Il a une petite enfance heureuse entre une maman tendre, un papa plus distant et ses grands-parents.
Et puis, le monde d'Aharon bascule sous le joug meurtrier du gouvernement roumain et sa répression anti-juive. Sa mère est assassinée en 1940. Il gardera le souvenir de son cri. Avec son père, il connait le ghetto puis la déportation d'où, seul, il s'échappera. Il aura la chance de retrouver son père, plus tard, en Israël.
Imaginez un enfant de dix ans dont les parents ont été assassinés parce que juifs, survivant dans les forêts ukrainiennes, trouvant un jour abri moyennant quelques petits travaux, chez une prostituée qui le maltraite, puis chez un paysan, tout aussi malveillant que la prostituée, mais sans jamais oublier l'abjecte dénonciation qui plane au-dessus de sa tête. En proie à une terreur constante, cette peur qui ne peut quitter l'enfant tant la chaîne de confiance qui le reliait à l'humanité, s'est brisée. Cet enfant s'est enfui de l'horreur du camp, ce cauchemar qui a fait de lui un animal traqué. Comment résister psychologiquement à de telles atrocités. La méfiance devient une seconde nature et les mots disparaissent, eux aussi deviennent inutiles, superflus et suspects. le silence règne dans les forêts ukrainiennes où il se cache pendant deux ans. Seule la contemplation de la nature parvient à lui faire oublier la faim et la peur. le traumatisme est d'une telle ampleur que la mémoire « cache » de l'enfant s'est vidée, au langage a succédé un bégaiement, c'est un retour à son animalité.
Aharon a souffert dans son corps, dans sa chair, dans son âme, et cette mémoire blessée, commotionnée, va se révéler sous l'effet d'un « déjà vu, déjà senti » mais cette mémoire cognitive ne pourra relier ses sensations à des évènements précis.
Me vient en mémoire cette phrase de Marcel Proust :
« Cette terrible puissance d'enregistrement qu'a le corps et qui fait de la douleur quelque chose de contemporain à toutes les époques de notre vie où nous avons souffert ».
Et malgré toutes ces horreurs, naîtra chez lui un espoir irraisonné, retrouver ses parents, et c'est de cette aspiration qu'il puisera chez lui un irrépressible instinct de survie qui le portera jusqu'en Israël où il deviendra l'un des plus grands écrivains de langue hébraïque.
Ce livre est magnifique, il est parcouru d'ombre et de Lumière, c'est un hymne à la Vie. Ce récit est extrêmement émouvant et particulièrement puissant, quelle force ! Il ne tombe jamais dans la plainte, la nostalgie, il reste pudique. L'écriture est douce et sereine malgré le contexte. Aharon me rappelle mon grand-père, on ne ressent aucune animosité malgré les épreuves de la vie, bien au contraire. Il sait nous raconter qu'il a rencontré des êtres ignobles mais qu'il a rencontré des êtres d'une générosité exceptionnelle. Les mots sont simples et laissent passer l'émotion, on ressent ce besoin de trouver le mot juste sans tomber dans l'inutile car il connait la valeur du « mot ». C'est terrible de se dire que ce sont de telles épreuves qui ont engendré ce grand auteur !
Ce qui m'a le plus interpelée, c'est la relation à la langue maternelle. Je ne m'étais jamais posé de questions sur les relations que nous entretenons avec notre langue maternelle. Pour Aharon, la langue allemande était devenue celle des assassins. Mais c'est aussi cette langue qui le reliait à ses parents. Il avait aussi perdu cette filiation. L'identité s'était effacée et c'est toute son histoire, tout son parcours qu'il tente de reconstituer sous sa plume entre le subjectif, les émotions et la réalité.
Il explique très bien ses difficultés avec l'apprentissage de l'Hébreu. L'allemand, le yiddish, le roumain, s'étaient les langues de l'amour de ses parents, les langues qui le rattachaient à ses racines. Y renoncer, n'était-ce pas mourir encore un peu ou faire mourir sa mère une seconde fois ! Comment retrouver dans l'Hébreu, ce lien affectif, intime d'où pourrait naître le sens de sa nouvelle vie, de l'écriture, de la communication. Ce sont des passages de sa reconstruction particulièrement édifiants. Lorsque l'Hébreu est devenu sa langue maternelle, son attachement à cette nouvelle terre, il raconte sa hantise de perdre, à nouveau cette langue, hantise qui se concrétisait dans ses cauchemars. L'Hébreu lui ouvrira aussi les portes de la spiritualité ce qui lui permettra de se retrouver.
Ces passages m'ont incitée à lire « L'angoisse d'Abraham » de Rosie Pinhas-Delpuech, qui dirige la collection « Lettres hébraïques » d'Actes Sud. Dans ce livre, elle tente d'interroger en profondeur notre relation à la langue maternelle et à l'exil.
« Nous sommes venus en Israël pour construire et être construits ». Ce n'est pas si simple !
C'est l'essai de Valérie Zenatti, « Dans le faisceau des vivants » qui m'a permis de découvrir Aharon Appelfeld, écrivain et poète israélien dont l'oeuvre est hantée par la Shoah. Valérie Zenatti n'était pas seulement la traductrice d'Aharon Appelfeld, elle était aussi son amie et sa confidente. Lorsqu'il disparaît en janvier 2018, elle tente de renouer le fil défait, de retrouver l'écho de cette voix qui parlait avec douceur de l'indicible, et nous restitue cette quête de l'impossible dans un ouvrage poignant.
« Histoire d'une vie », publié en 1999, revient sur l'enfance et les années de formation de l'auteur. Né en 1932 à Czernowitz, en Bucovine, (alors rattachée à la Roumanie et située à présent en Ukraine), de parents juifs assimilés et germanophones, il ne connaît la religion juive qu'à travers la pratique assidue de son grand-père, un homme pieux, qui emmène parfois son petit-fils à la synagogue.
Sa mère est assassinée par le régime roumain en 1940 tandis qu'Aharon Appelfeld, alors âgé de huit ans, est envoyé au ghetto avec son père, dont il est rapidement séparé. En 1941, il est déporté dans un camp de concentration.
« Au fil des années j'ai tenté plus d'une fois de toucher les châlits du camp et de goûter à la soupe claire qu'on y distribuait. Tout ce qui ressortait de cet effort était un magma de mots, ou plus précisément des mots inexacts, un rythme faussé, des images faibles ou exagérées. Une épreuve profonde, ai-je appris, peut être faussée facilement. Cette fois non plus, je ne toucherai pas ce feu. Je ne parlerai pas du camp, mais de la fuite, qui eut lieu à l'automne 1942 alors que j'avais dix ans. »
« Ni le soleil, ni la mort, ni la Shoah ne peuvent se regarder en face », ce détournement de la maxime de François de la Rochefoucauld, résume le rapport de l'auteur à l'Holocauste. Appelfeld se refuse à raconter l'inracontable, à dire l'indicible, à nommer l'innommable, à toucher « ce feu » qui le brûle encore plus de cinquante ans après la guerre. Si son oeuvre tout entière est habitée par la Shoah, l'auteur ne nous dépeint (presque) jamais l'horreur absolue, et préfère s'appesantir, dans ce récit autobiographique, sur les années qui ont précédé et qui ont suivi l'innommable.
On lui a d'ailleurs reproché cette façon « détournée » d'appréhender la Shoah, de ne pas livrer un témoignage brut, de se taire comme l'a fait toute une génération livrée aux forces du Mal. L'auteur s'en explique en rappelant qu'il avait à peine dix ans lors de son évasion en 1942, et que son regard d'enfant n'a pas l'acuité de celui d'un adulte. La véritable explication se trouve pourtant dans les mots cités plus hauts, qui tentent d'expliciter l'impossibilité ontologique de décrire l'indescriptible, le risque de travestir le réel, de l'exagérer ou de le minorer. Au fond, ce que nous dit Aharon Appelfeld, c'est qu'il ne trouve pas les mots justes pour décrire le Mal absolu. Il est d'ailleurs possible que ces mots n'existent pas et que certaines réalités ne puissent être décrites.
Le décalogue interdit de nommer YHWH (Yahvé dans sa traduction chrétienne), le théonyme du Dieu d'Israël. Par un jeu de miroir troublant, l'auteur s'interdit de nommer le Diable, en s'abstenant de décrire le Mal absolu. Il me semble surtout que l'auteur a saisi une vérité profonde relative au langage. Si ce dernier est une manière de formuler, de nommer, de dire le réel, il est tout à fait concevable que certaines réalités ne soient ni formulables, ni nommables, ni dicibles. « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde » disait Albert Camus. Je comprends qu'Aharon Appelfeld a fait sienne la phrase de Camus, et n'a pas souhaité risquer d'ajouter du malheur au monde en ne nommant pas de manière adéquate, une expérience qui convoque le Mal et touche à une forme de « sacré » : son vécu au sein d'un camp de concentration.
À dix ans, l'auteur se retrouve livré à lui-même dans les forêts ukrainiennes. L'enfant, qui a compris qu'il est préférable de taire ses origines juives, se cache chez des paysans qui lui offrent le gîte et le couvert en contrepartie d'un dur labeur. Il traverse l'Europe jusqu'aux plages italiennes en compagnie d'autres adolescents orphelins et embarque pour la Palestine en 1946 où il sera pris en charge par l'Alyat Hanoar, une organisation chargée d'organiser l'immigration vers la Palestine et de les former à la vie pionnière dans des structures parallèles aux kibboutzim. À l'issue de ces années de formation dans un camp de jeunesse puis dans une école agricole, Appelfeld effectuera son service militaire en 1949.
L'odyssée de l'auteur ne s'achève pas en mai 1945 à la fin de la seconde guerre, mais à l'issue d'une longue errance intérieure, qui se termine au début des années cinquante. L'embarquement pour la Palestine d'un jeune Juif ashkénaze dont la langue maternelle est l'allemand, élevé par des parents non-pratiquants, m'a évoqué un mot : le « déracinement », en hommage à l'ouvrage de Simone Weil : « L'enracinement ».
En 1946, Aharon Appelfeld a quatorze ans, il vient de traverser des années d'une violence inouïe, n'a pas fait d'études, ne parle pas un mot d'Hébreu et doit renoncer à sa langue maternelle, l'allemand. le jeune adolescent est étranger au monde qui vient de l'accueillir et forme sans sourciller les futurs membres de l'État juif. « Histoire d'une vie » raconte la violence de la perte de la langue maternelle ainsi que la douleur d'une forme de solitude existentielle qui rythmèrent ses années de « formation ».
C'est la découverte de la Littérature qui le sauvera et lui permettra de trouver sa voie : « Je percevais quelque chose que je ne compris entièrement que plus tard : la littérature, si elle est littérature de vérité, est la musique religieuse que nous avons perdue. La littérature contient toutes les composantes de la foi : le sérieux, l'intériorité, la musique, et le contact avec les contenus enfouis dans l'âme. »
« Histoire d'une vie » nous conte l'enfance avant-guerre, puis la stupéfiante odyssée d'un rescapé des camps de la mort, qui luttera pour trouver sa place en terre d'Israël. Malgré la noirceur infinie de la Shoah qui ne cesse de hanter le récit, l'écriture d'Aharon Appelfeld est lumineuse. Une écriture qui procède par touches impressionnistes, qui ne cède jamais à la haine, ni au ressentiment. Une écriture qui se conforme à la définition que l'auteur propose lui-même de la Littérature : « Je n'ai pas l'impression d'écrire sur le passé. le passé en lui-même est un très mauvais matériau pour la littérature. La littérature est un présent brûlant, non au sens journalistique, mais comme une aspiration à transcender le temps en une présence éternelle ».
« Histoire d'une vie » n'est pas simplement le récit d'un homme au destin brisé par la Shoah, c'est le récit, paradoxalement lumineux, de ces années d'une noirceur inimaginable, des années que nos aïeux nous ont tues, parce que « l'histoire de leur vie leur a été arrachée sans cicatriser », parce qu'« ils n'ont pas su ouvrir la porte qui menait à la part obscure de leur vie », sans doute aussi parce qu'ils souhaitaient nous protéger.
***
Je dédie cette chronique à Danuta Kosminska qui fut, elle aussi, ballotée par les vents mauvais de l'Histoire, bien avant de devenir ma grand-mère.
« Histoire d'une vie », publié en 1999, revient sur l'enfance et les années de formation de l'auteur. Né en 1932 à Czernowitz, en Bucovine, (alors rattachée à la Roumanie et située à présent en Ukraine), de parents juifs assimilés et germanophones, il ne connaît la religion juive qu'à travers la pratique assidue de son grand-père, un homme pieux, qui emmène parfois son petit-fils à la synagogue.
Sa mère est assassinée par le régime roumain en 1940 tandis qu'Aharon Appelfeld, alors âgé de huit ans, est envoyé au ghetto avec son père, dont il est rapidement séparé. En 1941, il est déporté dans un camp de concentration.
« Au fil des années j'ai tenté plus d'une fois de toucher les châlits du camp et de goûter à la soupe claire qu'on y distribuait. Tout ce qui ressortait de cet effort était un magma de mots, ou plus précisément des mots inexacts, un rythme faussé, des images faibles ou exagérées. Une épreuve profonde, ai-je appris, peut être faussée facilement. Cette fois non plus, je ne toucherai pas ce feu. Je ne parlerai pas du camp, mais de la fuite, qui eut lieu à l'automne 1942 alors que j'avais dix ans. »
« Ni le soleil, ni la mort, ni la Shoah ne peuvent se regarder en face », ce détournement de la maxime de François de la Rochefoucauld, résume le rapport de l'auteur à l'Holocauste. Appelfeld se refuse à raconter l'inracontable, à dire l'indicible, à nommer l'innommable, à toucher « ce feu » qui le brûle encore plus de cinquante ans après la guerre. Si son oeuvre tout entière est habitée par la Shoah, l'auteur ne nous dépeint (presque) jamais l'horreur absolue, et préfère s'appesantir, dans ce récit autobiographique, sur les années qui ont précédé et qui ont suivi l'innommable.
On lui a d'ailleurs reproché cette façon « détournée » d'appréhender la Shoah, de ne pas livrer un témoignage brut, de se taire comme l'a fait toute une génération livrée aux forces du Mal. L'auteur s'en explique en rappelant qu'il avait à peine dix ans lors de son évasion en 1942, et que son regard d'enfant n'a pas l'acuité de celui d'un adulte. La véritable explication se trouve pourtant dans les mots cités plus hauts, qui tentent d'expliciter l'impossibilité ontologique de décrire l'indescriptible, le risque de travestir le réel, de l'exagérer ou de le minorer. Au fond, ce que nous dit Aharon Appelfeld, c'est qu'il ne trouve pas les mots justes pour décrire le Mal absolu. Il est d'ailleurs possible que ces mots n'existent pas et que certaines réalités ne puissent être décrites.
Le décalogue interdit de nommer YHWH (Yahvé dans sa traduction chrétienne), le théonyme du Dieu d'Israël. Par un jeu de miroir troublant, l'auteur s'interdit de nommer le Diable, en s'abstenant de décrire le Mal absolu. Il me semble surtout que l'auteur a saisi une vérité profonde relative au langage. Si ce dernier est une manière de formuler, de nommer, de dire le réel, il est tout à fait concevable que certaines réalités ne soient ni formulables, ni nommables, ni dicibles. « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde » disait Albert Camus. Je comprends qu'Aharon Appelfeld a fait sienne la phrase de Camus, et n'a pas souhaité risquer d'ajouter du malheur au monde en ne nommant pas de manière adéquate, une expérience qui convoque le Mal et touche à une forme de « sacré » : son vécu au sein d'un camp de concentration.
À dix ans, l'auteur se retrouve livré à lui-même dans les forêts ukrainiennes. L'enfant, qui a compris qu'il est préférable de taire ses origines juives, se cache chez des paysans qui lui offrent le gîte et le couvert en contrepartie d'un dur labeur. Il traverse l'Europe jusqu'aux plages italiennes en compagnie d'autres adolescents orphelins et embarque pour la Palestine en 1946 où il sera pris en charge par l'Alyat Hanoar, une organisation chargée d'organiser l'immigration vers la Palestine et de les former à la vie pionnière dans des structures parallèles aux kibboutzim. À l'issue de ces années de formation dans un camp de jeunesse puis dans une école agricole, Appelfeld effectuera son service militaire en 1949.
L'odyssée de l'auteur ne s'achève pas en mai 1945 à la fin de la seconde guerre, mais à l'issue d'une longue errance intérieure, qui se termine au début des années cinquante. L'embarquement pour la Palestine d'un jeune Juif ashkénaze dont la langue maternelle est l'allemand, élevé par des parents non-pratiquants, m'a évoqué un mot : le « déracinement », en hommage à l'ouvrage de Simone Weil : « L'enracinement ».
En 1946, Aharon Appelfeld a quatorze ans, il vient de traverser des années d'une violence inouïe, n'a pas fait d'études, ne parle pas un mot d'Hébreu et doit renoncer à sa langue maternelle, l'allemand. le jeune adolescent est étranger au monde qui vient de l'accueillir et forme sans sourciller les futurs membres de l'État juif. « Histoire d'une vie » raconte la violence de la perte de la langue maternelle ainsi que la douleur d'une forme de solitude existentielle qui rythmèrent ses années de « formation ».
C'est la découverte de la Littérature qui le sauvera et lui permettra de trouver sa voie : « Je percevais quelque chose que je ne compris entièrement que plus tard : la littérature, si elle est littérature de vérité, est la musique religieuse que nous avons perdue. La littérature contient toutes les composantes de la foi : le sérieux, l'intériorité, la musique, et le contact avec les contenus enfouis dans l'âme. »
« Histoire d'une vie » nous conte l'enfance avant-guerre, puis la stupéfiante odyssée d'un rescapé des camps de la mort, qui luttera pour trouver sa place en terre d'Israël. Malgré la noirceur infinie de la Shoah qui ne cesse de hanter le récit, l'écriture d'Aharon Appelfeld est lumineuse. Une écriture qui procède par touches impressionnistes, qui ne cède jamais à la haine, ni au ressentiment. Une écriture qui se conforme à la définition que l'auteur propose lui-même de la Littérature : « Je n'ai pas l'impression d'écrire sur le passé. le passé en lui-même est un très mauvais matériau pour la littérature. La littérature est un présent brûlant, non au sens journalistique, mais comme une aspiration à transcender le temps en une présence éternelle ».
« Histoire d'une vie » n'est pas simplement le récit d'un homme au destin brisé par la Shoah, c'est le récit, paradoxalement lumineux, de ces années d'une noirceur inimaginable, des années que nos aïeux nous ont tues, parce que « l'histoire de leur vie leur a été arrachée sans cicatriser », parce qu'« ils n'ont pas su ouvrir la porte qui menait à la part obscure de leur vie », sans doute aussi parce qu'ils souhaitaient nous protéger.
***
Je dédie cette chronique à Danuta Kosminska qui fut, elle aussi, ballotée par les vents mauvais de l'Histoire, bien avant de devenir ma grand-mère.
Cela faisait longtemps que je voulais partir à la rencontre de cet auteur israélien, mais le temps file beaucoup trop vite et comme un papillon attiré par la lumière, je suis sans cesse attirée vers les nouvelles parutions.
Pour une première rencontre, j'ai choisi de lire « Histoire d'une vie », prix Médicis Etranger 2004, l'histoire d'une vie pleine de turbulences et de vertige, une vie qui s'est morcelée en morceaux.
Une vie avec un avant, un après et entre, peu de paroles, peu de mots, la stupéfaction, la peur, l'oubli face à l'horreur. Entre les lignes, entre les mots, dans cet amas de silence, enfermés dans la mémoire et les non-dits, des évènements qu'un enfant de sept ans ne devrait jamais avoir à vivre.
« Les pages qui suivent sont des fragments de mémoire et de contemplation. La mémoire est fuyante et sélective, elle produit ce qu'elle choisit. »
Ce livre est comme un recueil de souvenirs sans véritable chronologie.
Le lecteur relie les différents souvenirs entre eux et reconstitue les moments importants de la vie de l'auteur à partir de sa mémoire morcelée, pleine de cicatrices, de coutures, de vides et d'abîmes.
*
Le livre débute alors qu'Aharon Appelfeld est âgé d'environ quatre ans. Né en Roumanie en 1932 de parents juifs non pratiquants et parlant allemand, il peint avec ses souvenirs d'enfant, la douceur de ses premières années, le sentiment de sécurité, l'amour de ses parents, ses vacances d'été dans les Carpates chez ses grands-parents.
Jusqu'à l'année 1937 et l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement pro-nazi instaurant une politique antisémite inspirée du régime allemand. Puis la Seconde Guerre mondiale éclate, faisant voler en éclats sa vie alors qu'il est âgé à peine de sept ans. Les Juifs sont parqués dans des ghettos surpeuplés avant d'être exécutés ou déportés, après une marche forcée vers un camp de travail, à travers les plaines d'Ukraine.
« La Seconde Guerre mondiale dura six années. Parfois il me semble que ce ne fut qu'une longue nuit dont je me suis réveillé différent. Parfois il me semble que ce n'est pas moi qui ai connu la guerre mais un autre, quelqu'un de très proche, destiné à me raconter précisément ce qui s'était passé, car je ne me souviens pas de ce qui est arrivé, ni comment. »
De la guerre, de la déportation et de ces longs mois dans un camp à la frontière ukrainienne, une page quasiment blanche. L'enfant ne se souvient de presque rien.
Son esprit est vide, seul son corps a conservé une mémoire, celle de la faim et de la soif, de la solitude et de la peur. Une odeur, un bruit réveillent parfois un souvenir profondément caché, perdu, enfoui ou refoulé au fond de son passé. Quelques images de la marche de la mort, les mourants et les morts étendus sur les bas-côtés de la route. Des images terribles du camp de Kaltchund où les enfants étaient jetés en pâture aux chiens affamés. Et puis une image surgit, réconfortante, celle d'un pommier chargé de magnifiques pommes rouges.
*
Le récit reprend en 1942, au moment de son évasion du camp. L'enfant apprend à survivre seul dans la forêt. Elle est son refuge car l'enfant a appris à se méfier des hommes.
« … pendant la guerre, j'ai préféré la compagnie des objets et des animaux. Les humains sont imprévisibles. Un homme qui au premier regard a l'air posé et calme peut se révéler être un sauvage, voire un meurtrier. »
Puis, à la libération, l'enfant se joint au flot de réfugiés qui traversent l'Europe vers l'Italie. Il a alors douze ans. Sa route le conduit en Israël où il va tenter de se reconstruire et de démarrer une nouvelle vie sur les fondations fragiles de son ancienne vie.
*
C'est un livre qui dit l'horreur, l'inhumanité qui appelle à la défiance et au silence. Mais cette histoire est aussi celle de rencontres marquantes, inoubliables. Des personnes qui traversent sa route, d'autres avec qui il fait un bout de chemin.
« J'ai rencontré des gens merveilleux durant les longues années de guerre. Dommage que le tumulte fut si grand et que je fusse un enfant. Pendant la guerre on ne tenait pas compte des enfants. Ils étaient le brin de paille que tout le monde piétinait, et pourtant il se trouva quelques personnes remarquables qui, dans la tourmente, adoptèrent pour un temps un enfant abandonné, lui donnèrent une tranche de pain et l'enveloppèrent dans un manteau. »
*
Les mots pour parler du passé s'écoulent, chargés de tristesse, d'une profonde nostalgie et d'un sentiment d'abandon. Il pourrait paraître froid, distant, je l'ai trouvé au contraire pudique.
« Je n'aime pas m'étendre sur les sentiments. Une trop grande propension à parler des affects nous entraînera toujours vers le labyrinthe sentimental, vers le piétinement sur place et l'aplatissement. »
Tout au long du livre, l'auteur explore de nombreux thèmes avec profondeur : la mémoire et la perte, la survie et le deuil, l'identité, la faiblesse de notre humanité, la quête de sens et le difficile chemin vers la reconstruction.
De sa langue maternelle, il parlera de "la langue des assassins de sa mère".
Dans cet incroyable travail de mémoire, l'auteur témoigne de l'horreur de l'Holocauste d'une écriture sobre, sincère, simple et subtile, profondément humaine.
*
Je finirai avec les mots de l'auteur :
« la littérature, si elle est littérature de vérité, est la musique religieuse que nous avons perdue. La littérature contient toutes les composantes de la foi : le sérieux, l'intériorité, la musique, et le contact avec les contenus enfouis de l'âme. »
***
Un petit clin d'oeil à Nicola avec qui j'ai partagé cette lecture.
***
Pour une première rencontre, j'ai choisi de lire « Histoire d'une vie », prix Médicis Etranger 2004, l'histoire d'une vie pleine de turbulences et de vertige, une vie qui s'est morcelée en morceaux.
Une vie avec un avant, un après et entre, peu de paroles, peu de mots, la stupéfaction, la peur, l'oubli face à l'horreur. Entre les lignes, entre les mots, dans cet amas de silence, enfermés dans la mémoire et les non-dits, des évènements qu'un enfant de sept ans ne devrait jamais avoir à vivre.
« Les pages qui suivent sont des fragments de mémoire et de contemplation. La mémoire est fuyante et sélective, elle produit ce qu'elle choisit. »
Ce livre est comme un recueil de souvenirs sans véritable chronologie.
Le lecteur relie les différents souvenirs entre eux et reconstitue les moments importants de la vie de l'auteur à partir de sa mémoire morcelée, pleine de cicatrices, de coutures, de vides et d'abîmes.
*
Le livre débute alors qu'Aharon Appelfeld est âgé d'environ quatre ans. Né en Roumanie en 1932 de parents juifs non pratiquants et parlant allemand, il peint avec ses souvenirs d'enfant, la douceur de ses premières années, le sentiment de sécurité, l'amour de ses parents, ses vacances d'été dans les Carpates chez ses grands-parents.
Jusqu'à l'année 1937 et l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement pro-nazi instaurant une politique antisémite inspirée du régime allemand. Puis la Seconde Guerre mondiale éclate, faisant voler en éclats sa vie alors qu'il est âgé à peine de sept ans. Les Juifs sont parqués dans des ghettos surpeuplés avant d'être exécutés ou déportés, après une marche forcée vers un camp de travail, à travers les plaines d'Ukraine.
« La Seconde Guerre mondiale dura six années. Parfois il me semble que ce ne fut qu'une longue nuit dont je me suis réveillé différent. Parfois il me semble que ce n'est pas moi qui ai connu la guerre mais un autre, quelqu'un de très proche, destiné à me raconter précisément ce qui s'était passé, car je ne me souviens pas de ce qui est arrivé, ni comment. »
De la guerre, de la déportation et de ces longs mois dans un camp à la frontière ukrainienne, une page quasiment blanche. L'enfant ne se souvient de presque rien.
Son esprit est vide, seul son corps a conservé une mémoire, celle de la faim et de la soif, de la solitude et de la peur. Une odeur, un bruit réveillent parfois un souvenir profondément caché, perdu, enfoui ou refoulé au fond de son passé. Quelques images de la marche de la mort, les mourants et les morts étendus sur les bas-côtés de la route. Des images terribles du camp de Kaltchund où les enfants étaient jetés en pâture aux chiens affamés. Et puis une image surgit, réconfortante, celle d'un pommier chargé de magnifiques pommes rouges.
*
Le récit reprend en 1942, au moment de son évasion du camp. L'enfant apprend à survivre seul dans la forêt. Elle est son refuge car l'enfant a appris à se méfier des hommes.
« … pendant la guerre, j'ai préféré la compagnie des objets et des animaux. Les humains sont imprévisibles. Un homme qui au premier regard a l'air posé et calme peut se révéler être un sauvage, voire un meurtrier. »
Puis, à la libération, l'enfant se joint au flot de réfugiés qui traversent l'Europe vers l'Italie. Il a alors douze ans. Sa route le conduit en Israël où il va tenter de se reconstruire et de démarrer une nouvelle vie sur les fondations fragiles de son ancienne vie.
*
C'est un livre qui dit l'horreur, l'inhumanité qui appelle à la défiance et au silence. Mais cette histoire est aussi celle de rencontres marquantes, inoubliables. Des personnes qui traversent sa route, d'autres avec qui il fait un bout de chemin.
« J'ai rencontré des gens merveilleux durant les longues années de guerre. Dommage que le tumulte fut si grand et que je fusse un enfant. Pendant la guerre on ne tenait pas compte des enfants. Ils étaient le brin de paille que tout le monde piétinait, et pourtant il se trouva quelques personnes remarquables qui, dans la tourmente, adoptèrent pour un temps un enfant abandonné, lui donnèrent une tranche de pain et l'enveloppèrent dans un manteau. »
*
Les mots pour parler du passé s'écoulent, chargés de tristesse, d'une profonde nostalgie et d'un sentiment d'abandon. Il pourrait paraître froid, distant, je l'ai trouvé au contraire pudique.
« Je n'aime pas m'étendre sur les sentiments. Une trop grande propension à parler des affects nous entraînera toujours vers le labyrinthe sentimental, vers le piétinement sur place et l'aplatissement. »
Tout au long du livre, l'auteur explore de nombreux thèmes avec profondeur : la mémoire et la perte, la survie et le deuil, l'identité, la faiblesse de notre humanité, la quête de sens et le difficile chemin vers la reconstruction.
De sa langue maternelle, il parlera de "la langue des assassins de sa mère".
Dans cet incroyable travail de mémoire, l'auteur témoigne de l'horreur de l'Holocauste d'une écriture sobre, sincère, simple et subtile, profondément humaine.
*
Je finirai avec les mots de l'auteur :
« la littérature, si elle est littérature de vérité, est la musique religieuse que nous avons perdue. La littérature contient toutes les composantes de la foi : le sérieux, l'intériorité, la musique, et le contact avec les contenus enfouis de l'âme. »
***
Un petit clin d'oeil à Nicola avec qui j'ai partagé cette lecture.
***
C'est encore un livre que je n'aurais probablement jamais ouvert, sans Babelio et quelques critiques enthousiastes, surtout qu'à ma médiathèque il était en réserve. Je n'aurais pas pu tomber dessus par hasard.
Histoire d'une vie est une autobiographie, mais sous forme parcellaire. L'auteur n'a que sept ans quand la seconde guerre mondiale éclate et celle-ci fait voler sa vie en éclats. Pour survivre, longtemps il a préféré oublier et puis il a laissé les souvenirs remonter pour éviter qu'un jour ils n'explosent.
Ces souvenirs sont racontés par bribes : comme le dit l'auteur dans la préface :
« La mémoire est fuyante et sélective, elle produit ce qu'elle choisit. Je ne prétends pas qu'elle produit uniquement le bon et l'agréable. La mémoire, tout comme le rêve, saisit dans le flux épais des évènements certains détails, parfois insignifiants, les emmagasine et les fait remonter à la surface à un moment précis. »
Il ne donnera pas beaucoup de faits, beaucoup de détails sur les années de guerre et sa survie. Il évoque plutôt des lieux : entre autres la forêt où il trouve refuge au milieu de la nature ; des personnes : des justes et des cruels, des victimes et des profiteurs ; des sentiments. Il décrira comment cette nécessité de survivre va modifier profondément tous ces enfants qui se sont retrouvés livrés à eux-mêmes durant ces années terribles, oubliant les mots, se réfugiant dans le silence, apprenant la méfiance qui deviendra une seconde nature :
« Il y a des visions qui se sont gravées dans ma mémoire et beaucoup a été oublié, mais la méfiance est restée inscrite dans mon corps, et aujourd'hui encore je m'arrête tous les quelques pas pour écouter. »
Ce récit des années de guerre est profondément émouvant, mais j'ai surtout été marquée par son récit des années qui ont suivi, son arrivée en Israël et la nécessité de s'intégrer dans un monde qui n'est pas le sien, sans doute parce que j'ai moins lu sur ce sujet. Cet adolescent doit tout apprendre, une nouvelle géographie, une nouvelle langue lui qui ne sait quasiment plus parler : « qui avait perdu toutes les langues qu'ils savait parler. »
Dans son enfance, il parlait quatre langues différentes, ces langues étaient attachées à sa vie, son histoire, son environnement. La nouvelle qu'il doit apprendre, l'hébreu, lui est étrangère : les mots n'évoquent aucune image et sont donc difficiles à retenir. J'ai beaucoup aimé ces pages où l'auteur insiste sur la langue et son importance pour les relations entre les hommes et comment l'ignorance de celle-ci est handicapante.
Il est d'autant plus remarquable que Aharon Appelfeld deviendra un écrivain renommé, dans cette langue qui n'est pas sa langue maternelle.
J'ai aimé cette lecture et ce texte à la fois émouvant et très pudique. Je ressens beaucoup d'admiration pour l'auteur et tous les autres qui ont su se reconstruire après avoir quasiment tout perdu.
Merci à Chrystèle, Doriane et les autres de m'avoir conduite vers ce livre.
Histoire d'une vie est une autobiographie, mais sous forme parcellaire. L'auteur n'a que sept ans quand la seconde guerre mondiale éclate et celle-ci fait voler sa vie en éclats. Pour survivre, longtemps il a préféré oublier et puis il a laissé les souvenirs remonter pour éviter qu'un jour ils n'explosent.
Ces souvenirs sont racontés par bribes : comme le dit l'auteur dans la préface :
« La mémoire est fuyante et sélective, elle produit ce qu'elle choisit. Je ne prétends pas qu'elle produit uniquement le bon et l'agréable. La mémoire, tout comme le rêve, saisit dans le flux épais des évènements certains détails, parfois insignifiants, les emmagasine et les fait remonter à la surface à un moment précis. »
Il ne donnera pas beaucoup de faits, beaucoup de détails sur les années de guerre et sa survie. Il évoque plutôt des lieux : entre autres la forêt où il trouve refuge au milieu de la nature ; des personnes : des justes et des cruels, des victimes et des profiteurs ; des sentiments. Il décrira comment cette nécessité de survivre va modifier profondément tous ces enfants qui se sont retrouvés livrés à eux-mêmes durant ces années terribles, oubliant les mots, se réfugiant dans le silence, apprenant la méfiance qui deviendra une seconde nature :
« Il y a des visions qui se sont gravées dans ma mémoire et beaucoup a été oublié, mais la méfiance est restée inscrite dans mon corps, et aujourd'hui encore je m'arrête tous les quelques pas pour écouter. »
Ce récit des années de guerre est profondément émouvant, mais j'ai surtout été marquée par son récit des années qui ont suivi, son arrivée en Israël et la nécessité de s'intégrer dans un monde qui n'est pas le sien, sans doute parce que j'ai moins lu sur ce sujet. Cet adolescent doit tout apprendre, une nouvelle géographie, une nouvelle langue lui qui ne sait quasiment plus parler : « qui avait perdu toutes les langues qu'ils savait parler. »
Dans son enfance, il parlait quatre langues différentes, ces langues étaient attachées à sa vie, son histoire, son environnement. La nouvelle qu'il doit apprendre, l'hébreu, lui est étrangère : les mots n'évoquent aucune image et sont donc difficiles à retenir. J'ai beaucoup aimé ces pages où l'auteur insiste sur la langue et son importance pour les relations entre les hommes et comment l'ignorance de celle-ci est handicapante.
Il est d'autant plus remarquable que Aharon Appelfeld deviendra un écrivain renommé, dans cette langue qui n'est pas sa langue maternelle.
J'ai aimé cette lecture et ce texte à la fois émouvant et très pudique. Je ressens beaucoup d'admiration pour l'auteur et tous les autres qui ont su se reconstruire après avoir quasiment tout perdu.
Merci à Chrystèle, Doriane et les autres de m'avoir conduite vers ce livre.
Citations et extraits (155)
Voir plus
Ajouter une citation
La Seconde Guerre mondiale dura six années. Parfois il me semble que ce ne fut qu'une longue nuit dont je me suis réveillé différent. Parfois il me semble que ce n'est pas moi qui ai connu la guerre mais un autre, quelqu'un de très proche, destiné à me raconter précisément ce qui s'est passé, car je ne me souviens pas de ce qui est arrivé, ni comment.
Je dis : "je ne me souviens pas", et c'est la stricte vérité. Ce qui s'est gravé en moi ces années-là, ce sont principalement des sensations physiques très fortes. Le besoin de manger du pain. Aujourd'hui encore je me réveille la nuit, affamé. Des rêves de faim et de soif se répètent chaque semaine. Je mange comme seuls mangent ceux qui ont eu faim un jour, avec un appétit étrange.
Durant la guerre, je suis allé dans des centaines de lieux, de gares, de villages perdus, près de cours d'eau. Chaque lieu avait un nom. Je n'en ai aucun souvenir, ne serait-ce qu'un. Les années de guerre m'apparaissent tantôt comme un large pâturage qui se fond avec le ciel, tantôt comme une forêt sombre qui s'enfonce indéfiniment dans son obscurité, parfois comme une colonne de gens chargés de ballots, dont quelques-uns tombent régulièrement et sont piétinés.
Tout ce qui s'est passé est inscrit dans les cellules du corps et non dans la mémoire, pourtant prédestinée à cela. De longues années après la guerre, je ne marchais ni au milieu du trottoir ni au milieu de la route mais je rasais les murs, toujours dans l'ombre et toujours d'un pas rapide, comme si je fuyais. Je ne suis pas enclin à pleurer en général, mais des séparations insignifiantes me font sangloter violemment.
J'ai dit : "Je ne me souviens pas", et pourtant je me souviens de milliers de détails. Il suffit parfois de l'odeur d'un plat, de l'humidité des chaussures ou d'un bruit soudain pour me ramener au plus profond de la guerre, et il me semble alors qu'elle n'a pas pris fin, qu'elle s'est poursuivie à mon insu, et à présent que l'on m'a réveillé, je sais que depuis qu'elle a commencé elle n'a pas connu d'interruption
p.100
Je dis : "je ne me souviens pas", et c'est la stricte vérité. Ce qui s'est gravé en moi ces années-là, ce sont principalement des sensations physiques très fortes. Le besoin de manger du pain. Aujourd'hui encore je me réveille la nuit, affamé. Des rêves de faim et de soif se répètent chaque semaine. Je mange comme seuls mangent ceux qui ont eu faim un jour, avec un appétit étrange.
Durant la guerre, je suis allé dans des centaines de lieux, de gares, de villages perdus, près de cours d'eau. Chaque lieu avait un nom. Je n'en ai aucun souvenir, ne serait-ce qu'un. Les années de guerre m'apparaissent tantôt comme un large pâturage qui se fond avec le ciel, tantôt comme une forêt sombre qui s'enfonce indéfiniment dans son obscurité, parfois comme une colonne de gens chargés de ballots, dont quelques-uns tombent régulièrement et sont piétinés.
Tout ce qui s'est passé est inscrit dans les cellules du corps et non dans la mémoire, pourtant prédestinée à cela. De longues années après la guerre, je ne marchais ni au milieu du trottoir ni au milieu de la route mais je rasais les murs, toujours dans l'ombre et toujours d'un pas rapide, comme si je fuyais. Je ne suis pas enclin à pleurer en général, mais des séparations insignifiantes me font sangloter violemment.
J'ai dit : "Je ne me souviens pas", et pourtant je me souviens de milliers de détails. Il suffit parfois de l'odeur d'un plat, de l'humidité des chaussures ou d'un bruit soudain pour me ramener au plus profond de la guerre, et il me semble alors qu'elle n'a pas pris fin, qu'elle s'est poursuivie à mon insu, et à présent que l'on m'a réveillé, je sais que depuis qu'elle a commencé elle n'a pas connu d'interruption
p.100
C'est le poète Y.S. qui nous instruit, un petit homme maigre et chauve qui ne payait pas de mine et ressemblait à un commerçant mais dès qu'il prononçait quelques mots, sa voix faisait votre conquête. IL nous apprenait la poésie et le chant, le tout en yiddish. Il faisait partie des instructeurs dépêchés par Erets-Israël. Ces derniers étaient des tenants de l'hébreu et lui, du yiddish. Les instructeurs d'Erets-Israël étaient plus grands que lui, beaux et surtout, ils parlaient au nom de l'avenir, au nom de la transformation positive, au nom de la vie qui nous attendait en Palestine. Lui, bien entendu, parlait de ce qui avait été, de la continuité qui serait rompue si on ne parlait pas la langue des suppliciés. Celui qui parle la langue des suppliciés leur assure non seulement le souvenir en ce monde mais élève un rempart contre le mal et transmet le flambeau de leur foi de génération en génération.
page 97
page 97
J'avais 7 ans lorsque éclata la Seconde Guerre mondiale. L'ordre temporel s'en trouva bouleversé, il n'y eut plus d'été, ni d'hiver, plus de longs séjours chez les grands-parents à la campagne. Notre vie fut comprimée dans une chambre étroite. Nous restâmes un temps dans le ghetto et à la fin de l'automne nous fûmes déportés. (...) Après la guerre, j'ai passé plusieurs mois sur les côtes italienne et yougoslave. Ces mois furent ceux d'un merveilleux oubli.(...) Sur les plages erraient des êtres que la guerre avait façonnés : musiciens, prestidigitateurs, chanteurs d'opéra, acteurs, sombres prédicateurs, trafiquants et voleurs (...) Lorsque nous arrivâmes en Israël, l'oubli était solidement ancré en nos âmes. (...) Pendant de longues années je fus plongé dans un sommeil amnésique. Ma vie s'écoulait en surface. Je m'étais habitué aux caves enfouies et humides. Cependant, je redoutais toujours l'éruption. Il me semblait, non sans raison, que les forces ténébreuses qui grouillaient en moi s'accroissaient et qu'un jour, lorsque la place leur manquerait, elles jailliraient. (...) Ce livre n'est pas un résumé, mais plutôt une tentative, un effort désespéré pour relier les différentes strates de ma vie à leur racine.Que le lecteur ne cherche pas dans ces pages une autobiographie structurée et précise. Ce sont différents lieux de vie qui se sont enchaînés les uns aux autres dans la mémoire, et convulsent encore.
J’ai rencontré bien des gens dévoués sur la longue route des plaines d’Ukraine aux rives de Haïfa. Sur le bateau, ou plus exactement sur le pont où était entassé des gens et des ballots, j’ai vu un homme plus tout jeune serrer contre lui une petite fille de cinq ans environ, joyeuse, ravissante, qui enchantait le regard. Elle était vêtue d’une jolie robe de laine et ne ressemblait pas à une rescapée. Elle parlait l’allemand à la manière des Juifs et chantait d’une voix agréable. Tandis que tous souffraient du mal de mer, elle s’adressait aux uns et aux autres avec des gestes gracieux. L’homme qui la serrait contre lui n’était pas son père, mais la façon dont il s’occupait d’elle était plus dévoué que celle d’un père. Il la couvait d’un regard émerveillé et buvait chacune de paroles qui sortaient de sa bouche.
Le bateau faisait route vers une mer agitée. […]. Aussitôt après la tempête, le soleil s’éleva dans le ciel, la mer se calma, les passagers émergèrent des tas de ballots et s’accoudèrent au garde-fou. On découvrit que le jambe droite d’Helga était coupée au-dessus de genou. […].
― Et pourquoi lui a-t-on coupé la jambe ?
― La gangrène. Les médecins militaires ont dit qu’elle menaçait non seulement sa jambe, mais aussi sa vie
― Et que faut-il faire à présent ?
― Rien de particuliers. […].
Helga était assise contre l’homme qui l’avait adoptée. La lumière était venue sur son visage. Elle bougeait les lèvre et produisait un son qui ressemblait à un sourd murmure. L’homme pris sa petite main, l’approcha de sa bouche, l’embrassa, et dit : « Bientôt nous arriverons en Palestine où nous aurons une maison et un jardin.
Le bateau faisait route vers une mer agitée. […]. Aussitôt après la tempête, le soleil s’éleva dans le ciel, la mer se calma, les passagers émergèrent des tas de ballots et s’accoudèrent au garde-fou. On découvrit que le jambe droite d’Helga était coupée au-dessus de genou. […].
― Et pourquoi lui a-t-on coupé la jambe ?
― La gangrène. Les médecins militaires ont dit qu’elle menaçait non seulement sa jambe, mais aussi sa vie
― Et que faut-il faire à présent ?
― Rien de particuliers. […].
Helga était assise contre l’homme qui l’avait adoptée. La lumière était venue sur son visage. Elle bougeait les lèvre et produisait un son qui ressemblait à un sourd murmure. L’homme pris sa petite main, l’approcha de sa bouche, l’embrassa, et dit : « Bientôt nous arriverons en Palestine où nous aurons une maison et un jardin.
Ma poétique personnelle s'est formée au début de ma vie, et lorsque je dis "au début de ma vie", je pense à tout ce que j'ai vu et perçu dans la maison de mes parents et pendant la longue guerre. C'est alors que s'est déterminé en moi mon rapport aux hommes, aux croyances, aux sentiments et aux mots. Ce rapport n'a pas changé avec le temps. Ma vie s'est pourtant enrichie, j'ai amassé des mots, des termes et des connaissances, mais le rapport fondamental est demeuré tel quel. Durant la guerre, j'ai vu la vie dans sa nudité, sans fard. Le bien et le mal, le beau et le laid se sont révélés à moi mêlés. Cela ne m'a pas transformé, grâce au ciel, en moraliste. Au contraire, j'ai appris à respecter la faiblesse et à l'aimer, la faiblesse est notre essence et notre humanité. Un homme qui connaît sa faiblesse sait parfois la surmonter. Le moraliste ignore ses faiblesses et, au lieu de s'en prendre à lui-même, il s'en prend à son prochain.
Videos de Aharon Appelfeld (13)
Voir plusAjouter une vidéo
Dans Qui-vive, la narratrice, Mathilde, semble perdre pied dans un monde toujours plus violent et indéchiffrable. Perdant le sommeil, puis le sens du toucher, elle s'arrime à des bribes de lumière des feuillets retrouvés à la mort de son grand-père, une vidéo de Leonard Cohen à Jérusalem, les réflexions douces-amères de sa fille adolescente et décide subitement de partir en Israël pour tenter de rencontrer ce qui la hante. de Tel-Aviv à Capharnaüm puis à Jérusalem, ses rencontres avec des inconnus ne font qu'approfondir le mystère. Trajectoire d'une femme qui cherche à retrouver la foi, ce roman initiatique interroge avec délicatesse le sens d'une vie au sein d'un monde plongé dans le chaos.
À l'occasion de ce grand entretien, l'autrice reviendra sur son oeuvre d'écrivaine où l'enfance et la guerre tiennent une place particulière, ainsi que sur son travail de traductrice.
Valérie Zenatti est l'autrice d'une oeuvre adulte et jeunesse prolifique. Elle reçoit en 2015 le prix du Livre Inter pour son quatrième roman, Jacob, Jacob (L'Olivier, 2014), et le prix France Télévisions pour son essai Dans le faisceau des vivants (L'Olivier, 2019). Son premier roman adulte, En retard pour la guerre (L'Olivier, 2006) est adapté au cinéma par Alain Tasma et réédité en 2021. Elle est également la traductrice en France d'Aharon Appelfeld, décédé en 2018, dont elle a traduit plus d'une dizaine de livres.
Retrouvez notre dossier "Effractions le podcast" sur notre webmagazine Balises : https://balises.bpi.fr/dossier/effractions-le-podcast/ Retrouvez toute la programmation du festival sur le site d'Effractions : https://effractions.bpi.fr/
Suivre la bibliothèque : SITE http://www.bpi.fr/bpi BALISES http://balises.bpi.fr FACEBOOK https://www.facebook.com/bpi.pompidou TWITTER https://twitter.com/bpi_pompidou
À l'occasion de ce grand entretien, l'autrice reviendra sur son oeuvre d'écrivaine où l'enfance et la guerre tiennent une place particulière, ainsi que sur son travail de traductrice.
Valérie Zenatti est l'autrice d'une oeuvre adulte et jeunesse prolifique. Elle reçoit en 2015 le prix du Livre Inter pour son quatrième roman, Jacob, Jacob (L'Olivier, 2014), et le prix France Télévisions pour son essai Dans le faisceau des vivants (L'Olivier, 2019). Son premier roman adulte, En retard pour la guerre (L'Olivier, 2006) est adapté au cinéma par Alain Tasma et réédité en 2021. Elle est également la traductrice en France d'Aharon Appelfeld, décédé en 2018, dont elle a traduit plus d'une dizaine de livres.
Retrouvez notre dossier "Effractions le podcast" sur notre webmagazine Balises : https://balises.bpi.fr/dossier/effractions-le-podcast/ Retrouvez toute la programmation du festival sur le site d'Effractions : https://effractions.bpi.fr/
Suivre la bibliothèque : SITE http://www.bpi.fr/bpi BALISES http://balises.bpi.fr FACEBOOK https://www.facebook.com/bpi.pompidou TWITTER https://twitter.com/bpi_pompidou
+ Lire la suite
Dans la catégorie :
Littérature hébraïqueVoir plus
>Littérature des autres langues>Littératures afro-asiatiques>Littérature hébraïque (66)
autres livres classés : littérature israélienneVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Aharon Appelfeld (20)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les écrivains et le suicide
En 1941, cette immense écrivaine, pensant devenir folle, va se jeter dans une rivière les poches pleine de pierres. Avant de mourir, elle écrit à son mari une lettre où elle dit prendre la meilleure décision qui soit.
Virginia Woolf
Marguerite Duras
Sylvia Plath
Victoria Ocampo
8 questions
1710 lecteurs ont répondu
Thèmes :
suicide
, biographie
, littératureCréer un quiz sur ce livre1710 lecteurs ont répondu