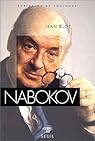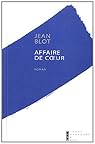Né(e) à : Moscou , le 31/03/1923
Mort(e) à : Sainte-Geneviève-des-Bois , le 23/12/2019
Alexandre Arnoldovitch Blokh (russe : Александр Арнольдович Блок), dit Jean Blot, est un écrivain et traducteur français, d'origine russe.
Son père qui écrivait des poèmes et admirait le célèbre poète homonyme russe Alexandre Blok (1880-1921), s’était fait un devoir de prénommer son fils Alexandre. Doté d’un homonyme si célèbre, il gardera son nom de résistant - Jean Blot - quand il deviendra écrivain.
Dans l'URSS des années vingt, ses parents travaillent au Commissariat à la défense pour son père, comme avocate des enfants des rues pour sa mère. En 1924, sa famille part en Allemagne au moment de la Nouvelle politique économique (NEP), puis s'installe à Paris où il fait ses études primaires.
Envoyé en Angleterre pour apprendre l'anglais pour ses études secondaires, il passe la guerre en France. Réfugié russe et juif, il fuit vers Lyon et s'engage dans la Résistance. À la fin de la guerre, il est lieutenant FFI dans le 1er régiment du colonel Fabien en Rhône-Alpes, et titulaire d’une licence de lettres.
Docteur en droit international, il commence une carrière aux Nations unies, à New York, dans l’interprétariat (1946-1956). On lui confie des missions d’observateur en Grèce et en Corée dans des contextes de guerres civiles. Il poursuit sa carrière au sein de l’organisation internationale à Genève (1958-1961) puis à l'UNESCO de Paris (à partir de 1962).
Secrétaire international du PEN club de 1981 à 1997 puis vice-président international du PEN club depuis 1998 et président du PEN Club français de 1999 à 2005, il crée en 1990 le PEN Club russe.
Auteur d’une œuvre importante, romans, récits, essais, cet écrivain cosmopolite et polyglotte fut aussi interprète et traducteur.
Il est l'auteur d'essais sur Ossip Mandelstam, Ivan Gontcharov ou encore Vladimir Nabokov.
Romancier, il a notamment écrit "Les Cosmopolites" (Gallimard, 1976), Prix Valery-Larbaud 1977 et "Le Juif Margolin" (Omnibus, 1998). En 2005, il publie "Le soleil se couche à l'Est" (Le Rocher), un essai magistral sur la Russie.
Il a obtenu le Grand prix de la Critique littéraire (1985) pour" Ivan Gontcharov ou le réalisme impossible" et le Prix de l'Académie (1986) pour l'ensemble de son œuvre.
Maison de la poésie (10 nov 2017) - Texte et Lecture de Jean-Philippe Domecq, extrait du Dictionnaire des mots en trop (dirigé par Belinda Cannone et Christian Doumet, éd. Thierry Marchaisse, parution novembre 2017). Le Dictionnaire des mots en trop : Comment ? s?entend-on déjà reprocher, des mots en trop ? Mais les mots, on en manquerait plutôt. Et pourtant. Ame, artiste, coach, communauté? ils sont légion ceux qui éveillent notre résistance intime à tout ce qu?ils charrient d?affects, d?idéologie, de pseudo-concepts ? notre résistance mais pas celle du voisin ! ? Quarante-quatre écrivains explorent ici les raisons pour lesquelles ils renâclent devant certains mots, et leurs réflexions critiques témoignent autant d?un état de la langue que des poétiques et des enjeux de notre temps. Une expérience littéraire qui vient compléter, en l?inversant, celle du Dictionnaire des mots manquants. Auteurs : Malek Abbou, Jacques Abeille, Mohamed Aïssaoui, Jacques Ancet, Marie-Louise Audiberti, Michèle Audin, Olivier Barbarant, Marcel Bénabou, Jean Blot, Jean-Claude Bologne, François Bordes, Lucile Bordes, Mathieu Brosseau, Belinda Cannone, Béatrice Commengé, Thibault Ulysse Comte, Seyhmus Dagtekin, Louis-Philippe Dalembert, Remi David, Erwan Desplanques, Jean-Philippe Domecq, Christian Doumet, Renaud Ego, Eric Faye, Caryl Férey, Michaël Ferrier, Philippe Garnier, Simonetta Greggio, Cécile Guilbert, Hubert Haddad, Isabelle Jarry, Cécile Ladjali, , Marie-Hélène Lafon, Sylvie Lainé, Frank Lanot, Fabrice Lardreau, Mathieu Larnaudie, Linda Lê, Guy le Gaufey, Jérôme Meizoz, Christine Montalbetti, Christophe Pradeau, Marlène Soreda, Abdourahman A. Waberi. http://www.editions-marchaisse.fr/catalogue-dictionnaire-des-mots-en-trop
Oh, que tu soies bénie, toi que je n'ai jamais revue et qui, la première, m'as souhaité la bienvenue : tu m'annonçais tous ceux qui, au long des années, allaient me saluer de ces mêmes mots dont la gravité m'allait au coeur, et que j'ai rencontrés sur les sentiers, dans les tavernes, en mer, sur les plages, jaillis des pinèdes, mots criés du haut des rochers, murmurés sur le seuil des maisons endormies, lancés d'un caïque qui passe, du haut d'un toit que l'on couvre d'argile, proférés par le berger que l'avalanche de ses moutons précède et annonce (....)
En chacun, j'ai voulu reconnaître ta voix, mon île qui les englobait tous et te taisait
Au-delà
Aux origines
Frère
Au-delà
Il cavaliere filarmonico
Au-delà
Au revoir la haut
Lors de quelle bataille ce roman débute t'il ?
590 lecteurs ont répondu