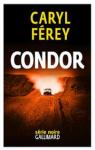Roberto Bolaño/5
429 notes
Résumé :
Roberto Bolaño meurt en 2003, laissant en partie inachevé un roman « monstrueux », instantanément considéré comme le geste littéraire le plus marquant du début du siècle. On y retrouve, amplifiées, toutes les obsessions de son auteur : quatre universitaires partent à la recherche de Benno von Archimboldi, un mystérieux écrivain allemand dont l’oeuvre les fascine. Leur quête les mènera à Santa Teresa, ville mexicaine inspirée de Ciudad Juarez, où les féminicides déci... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après 2666 Voir plus
Critiques, Analyses et Avis (55)
Voir plus
Ajouter une critique
Un des commentaires sur Amazon ( 1 étoile ) :
« Près de 1000 pages de tripotage intellectuel vaseux et stérile, un vide abyssal, un ennui profond. 30 euros et je ne sais pas encore si je conserverais "l'ouvrage" même pour caler un pied d'armoire, tant il m'a semblé calamiteux!!! A MOI Césaire, sauve moi de "ça". »
Réponse d'un lecteur à ce commentaire :
« Pas étonnant qu'un admirateur de Césaire (l'improbable), ne comprenne rien à Bolaño, la quête d'utilitarisme conduit, elle à l'abysse. »
Si ces commentaires m'ont interpellée c'est que je crois bien, moi aussi, n'avoir rien « compris » à Bolaño. On m'avait « vendu » 2666 comme un chef d'oeuvre et les qualificatifs élogieux ne manquent pas lorsqu'on lit la plupart des avis : roman-monde, roman total, roman fou etc etc…
Vous l'avez compris, je ne partage pas l'enthousiasme et l'extase générale suscités par ce roman. J'en attendais probablement trop, autre chose en tout cas c'est certain. Non, en fait le problème c'est que j'en attendais tout simplement quelque chose, rien de précis mais au moins quelque chose et que, finalement, il ne s'est rien passé, je n'ai rien retiré de ma lecture.
C'est pourquoi j'ai voulu vous faire part des deux commentaires amazon ci-dessus.
« La quête d'utilitarisme conduit, elle à l'abysse. »
Ayant lu ces mots, je me suis dit que j'étais une lectrice « utilitariste », j'attends obligatoirement quelque chose de mes lectures, j'ai besoin qu'elles me soient « utiles », que j'en retire un enseignement, une réflexion, des informations, la beauté des mots voire même simplement un beau moment de rêve et de détente. Mais je ne conçois vraiment pas la lecture comme une activité stérile, lire pour lire, sans rien attendre en retour.
2666 ne m'a rien apporté, vraiment rien. le style n'a rien d'exceptionnel, la construction est on ne peut plus frustrante ( peut-être dû au fait que le roman est inachevé …), je n'ai rien appris, je n'ai pas été invitée à la réflexion ( ou alors je n'ai pas vu l'invitation car d'autres apparemment l'ont vue). L'auteur multiplie les genres au sein d'un même roman, c'est bien mais ça n'a rien d'inédit, bref je ne comprends pas l'engouement général …
2666 se compose de 5 parties destinées d'abord à être publiées séparément, cette décision initiale de l'auteur, qui se savait malade, visait à assurer l'avenir économique de sa famille. Après sa mort, par souci de respecter l'oeuvre dans sa globalité, les éditeurs ont choisi de passer outre la volonté de l'auteur et de publier ainsi les cinq parties ensemble.
La première partie m'a franchement déroutée, je me suis même demandée si mon exemplaire n'avait pas été victime d'une erreur d'impression. L'action se déroule en Europe, on suit les péripéties amoureuses d'un quatuor d'universitaires tous fascinés par l'oeuvre d'un mystérieux écrivain allemand. Leur quête les conduit jusqu'au Mexique, à Santa Teresa, où les meurtres en série de jeunes femmes terrorisent la population.
Les deux parties suivantes s'attachent chacune à un personnage précis. D'abord, un mexicain dont l'auteur nous retrace la vie, père célibataire vivant dans la crainte que sa fille ne soit victime du tueur en série. Ensuite, un jeune journaliste américain est chargé de couvrir un match de boxe au Mexique. Il entend parler des meurtres, un sujet en or pour un journaliste comme lui.
La quatrième partie retrace dans le détail toutes les circonstances de chaque meurtre perpétré à Santa Teresa. Ce sont des dizaines et des dizaines de meurtres qui s'enchaînent sans interruption. Cette partie m'a beaucoup impressionnée car on aurait pu craindre la lassitude à force de répétition mais pas du tout. On est littéralement plongé en plein roman noir. La partie précédente avait commencé à éveiller ma curiosité et mon intérêt, je dois avouer que cette partie-ci n'a fait que les accroître considérablement.
Je pensais donc apprendre enfin le fin mot de l'histoire ( au bout de 1000 pages !) dans la dernière partie, celle consacrée à ce mystérieux écrivain. Après donc le roman noir, on se retrouve en plein récit de guerre. J'ai bien aimé cette partie où le tableau commence à s'éclaircir.
Finalement, je me suis quand même plutôt ennuyée durant les ¾ du livre. J'en suis ressortie frustrée car bien qu'il y ait un fin fil conducteur entre les parties, on ne retrouve plus du tout les personnages d'une partie à l'autre, je m'attendais à ce qu'il y ait un lien, des explications mais je suis restée avec mes questions. A la fin, on a bien une idée de l'identité du coupable mais rien n'est affirmé et le fait que le roman soit inachevé se fait bien sentir.
Concernant la série d'assassinats, elle est inspirée de faits réels. Pour connaître l'histoire, je vous conseille le film « Les oubliées de Juarez » avec Antonio Banderas et Jenifer Lopez. Ayant déjà vu le film avant cette lecture, vous comprenez que le sujet du roman de Bolaño n'avait rien d'original pour moi.
Je crois que c'est Joachim qui avait souligné l'influence de Gabriel Garcia Marquez chez Bolaño et c'est vrai, je l'ai remarquée de temps à autre. La dernière partie m'a aussi beaucoup rappelé Kaputt de Malaparte dont il faudra que je vous parle prochainement alors que la toute première partie nous plonge plutôt dans une ambiance digne des auteurs européens tels Zweig, Musil, Marai … Je reconnais donc le talent de Bolaño d'avoir su aussi habilement manier les genres.
C'est terrible, c'est limite si je ne m'excuse pas de ne pas avoir aimé. Alors certains diront que je n'y connais rien en littérature ( et dans ce cas qu'on m'explique ce que signifie « s'y connaître en littérature » ), que je suis une inculte et que je suis dénuée de toute intelligence etc … ( j'y ai eu droit lors de l'affaire « plug anal de MacCarthy »). Mais voilà, c'est comme ça, je me suis ennuyée, je n'ai rien appris, je suis très déçue et je ne dois pas avoir la même définition du « chef d'oeuvre » que la plupart des gens. J'ai mentionné Kaputt tout à l'heure, eh bien Kaputt pour moi EST un chef d'oeuvre.
Addendum :
Je me suis rendue compte que je reprochais aux avis élogieux de ne pas être précis concernant les raisons de leur "orgasme littéraire" mais que mon avis tombait dans le même travers.
Je vais donc essayer d'être plus explicite.
Je dis dans le corps de mon article que les différentes parties du roman sont finalement très peu liées entre elles. A vrai dire, j'ai même carrément eu l'impression qu'on sautait parfois du coq à l'âne. Je n'ai vraiment pas compris pourquoi Bolaño avait procédé ainsi et ce qu'il cherchait à montrer. J'ai cru comprendre, en lisant d'autres articles, que 2666 est dans son ensemble un roman sur le Mal, je veux bien mais je ne vois en quoi c'est le cas concernant notamment les trois premières parties. A moins de considérer le Mal sous son acceptation religieuse et d'y inclure donc les plans à trois, les sports de combat etc ...
Ce que je reproche également à ce roman c'est de vouloir apparemment toucher à plein de choses sans les approfondir. Je fais partie des lecteurs qui aiment lorsqu'un auteur décortique et analyse à fond son sujet. Ce n'est pas du tout le cas ici et j'ai d'ailleurs du mal à déterminer quel est le sujet, l'objectif, la raison d'être de ce roman. J'ai une sensation de superficialité, de survol alors que j'aime plutôt la profondeur.
Enfin dernier point, j'ai une grande prédilection pour les romans coups de poing et les romans surprises. C'est d'ailleurs le critère principal de ma propre définition du chef d'oeuvre. Et ici, j'ai attendu et attendu en vain la "surprise", ce moment où tu te dis " Waouh !". Ce roman a pour moi manqué de force, de panache, je l'ai trouvé terne et sans relief. Je suis restée en dehors. Je n'ai pas ressenti d'atmosphère particulière.
Voilà donc essentiellement pourquoi 2666 n'est, selon moi, pas un chef d'oeuvre.
Lien : http://cherrylivres.blogspot..
« Près de 1000 pages de tripotage intellectuel vaseux et stérile, un vide abyssal, un ennui profond. 30 euros et je ne sais pas encore si je conserverais "l'ouvrage" même pour caler un pied d'armoire, tant il m'a semblé calamiteux!!! A MOI Césaire, sauve moi de "ça". »
Réponse d'un lecteur à ce commentaire :
« Pas étonnant qu'un admirateur de Césaire (l'improbable), ne comprenne rien à Bolaño, la quête d'utilitarisme conduit, elle à l'abysse. »
Si ces commentaires m'ont interpellée c'est que je crois bien, moi aussi, n'avoir rien « compris » à Bolaño. On m'avait « vendu » 2666 comme un chef d'oeuvre et les qualificatifs élogieux ne manquent pas lorsqu'on lit la plupart des avis : roman-monde, roman total, roman fou etc etc…
Vous l'avez compris, je ne partage pas l'enthousiasme et l'extase générale suscités par ce roman. J'en attendais probablement trop, autre chose en tout cas c'est certain. Non, en fait le problème c'est que j'en attendais tout simplement quelque chose, rien de précis mais au moins quelque chose et que, finalement, il ne s'est rien passé, je n'ai rien retiré de ma lecture.
C'est pourquoi j'ai voulu vous faire part des deux commentaires amazon ci-dessus.
« La quête d'utilitarisme conduit, elle à l'abysse. »
Ayant lu ces mots, je me suis dit que j'étais une lectrice « utilitariste », j'attends obligatoirement quelque chose de mes lectures, j'ai besoin qu'elles me soient « utiles », que j'en retire un enseignement, une réflexion, des informations, la beauté des mots voire même simplement un beau moment de rêve et de détente. Mais je ne conçois vraiment pas la lecture comme une activité stérile, lire pour lire, sans rien attendre en retour.
2666 ne m'a rien apporté, vraiment rien. le style n'a rien d'exceptionnel, la construction est on ne peut plus frustrante ( peut-être dû au fait que le roman est inachevé …), je n'ai rien appris, je n'ai pas été invitée à la réflexion ( ou alors je n'ai pas vu l'invitation car d'autres apparemment l'ont vue). L'auteur multiplie les genres au sein d'un même roman, c'est bien mais ça n'a rien d'inédit, bref je ne comprends pas l'engouement général …
2666 se compose de 5 parties destinées d'abord à être publiées séparément, cette décision initiale de l'auteur, qui se savait malade, visait à assurer l'avenir économique de sa famille. Après sa mort, par souci de respecter l'oeuvre dans sa globalité, les éditeurs ont choisi de passer outre la volonté de l'auteur et de publier ainsi les cinq parties ensemble.
La première partie m'a franchement déroutée, je me suis même demandée si mon exemplaire n'avait pas été victime d'une erreur d'impression. L'action se déroule en Europe, on suit les péripéties amoureuses d'un quatuor d'universitaires tous fascinés par l'oeuvre d'un mystérieux écrivain allemand. Leur quête les conduit jusqu'au Mexique, à Santa Teresa, où les meurtres en série de jeunes femmes terrorisent la population.
Les deux parties suivantes s'attachent chacune à un personnage précis. D'abord, un mexicain dont l'auteur nous retrace la vie, père célibataire vivant dans la crainte que sa fille ne soit victime du tueur en série. Ensuite, un jeune journaliste américain est chargé de couvrir un match de boxe au Mexique. Il entend parler des meurtres, un sujet en or pour un journaliste comme lui.
La quatrième partie retrace dans le détail toutes les circonstances de chaque meurtre perpétré à Santa Teresa. Ce sont des dizaines et des dizaines de meurtres qui s'enchaînent sans interruption. Cette partie m'a beaucoup impressionnée car on aurait pu craindre la lassitude à force de répétition mais pas du tout. On est littéralement plongé en plein roman noir. La partie précédente avait commencé à éveiller ma curiosité et mon intérêt, je dois avouer que cette partie-ci n'a fait que les accroître considérablement.
Je pensais donc apprendre enfin le fin mot de l'histoire ( au bout de 1000 pages !) dans la dernière partie, celle consacrée à ce mystérieux écrivain. Après donc le roman noir, on se retrouve en plein récit de guerre. J'ai bien aimé cette partie où le tableau commence à s'éclaircir.
Finalement, je me suis quand même plutôt ennuyée durant les ¾ du livre. J'en suis ressortie frustrée car bien qu'il y ait un fin fil conducteur entre les parties, on ne retrouve plus du tout les personnages d'une partie à l'autre, je m'attendais à ce qu'il y ait un lien, des explications mais je suis restée avec mes questions. A la fin, on a bien une idée de l'identité du coupable mais rien n'est affirmé et le fait que le roman soit inachevé se fait bien sentir.
Concernant la série d'assassinats, elle est inspirée de faits réels. Pour connaître l'histoire, je vous conseille le film « Les oubliées de Juarez » avec Antonio Banderas et Jenifer Lopez. Ayant déjà vu le film avant cette lecture, vous comprenez que le sujet du roman de Bolaño n'avait rien d'original pour moi.
Je crois que c'est Joachim qui avait souligné l'influence de Gabriel Garcia Marquez chez Bolaño et c'est vrai, je l'ai remarquée de temps à autre. La dernière partie m'a aussi beaucoup rappelé Kaputt de Malaparte dont il faudra que je vous parle prochainement alors que la toute première partie nous plonge plutôt dans une ambiance digne des auteurs européens tels Zweig, Musil, Marai … Je reconnais donc le talent de Bolaño d'avoir su aussi habilement manier les genres.
C'est terrible, c'est limite si je ne m'excuse pas de ne pas avoir aimé. Alors certains diront que je n'y connais rien en littérature ( et dans ce cas qu'on m'explique ce que signifie « s'y connaître en littérature » ), que je suis une inculte et que je suis dénuée de toute intelligence etc … ( j'y ai eu droit lors de l'affaire « plug anal de MacCarthy »). Mais voilà, c'est comme ça, je me suis ennuyée, je n'ai rien appris, je suis très déçue et je ne dois pas avoir la même définition du « chef d'oeuvre » que la plupart des gens. J'ai mentionné Kaputt tout à l'heure, eh bien Kaputt pour moi EST un chef d'oeuvre.
Addendum :
Je me suis rendue compte que je reprochais aux avis élogieux de ne pas être précis concernant les raisons de leur "orgasme littéraire" mais que mon avis tombait dans le même travers.
Je vais donc essayer d'être plus explicite.
Je dis dans le corps de mon article que les différentes parties du roman sont finalement très peu liées entre elles. A vrai dire, j'ai même carrément eu l'impression qu'on sautait parfois du coq à l'âne. Je n'ai vraiment pas compris pourquoi Bolaño avait procédé ainsi et ce qu'il cherchait à montrer. J'ai cru comprendre, en lisant d'autres articles, que 2666 est dans son ensemble un roman sur le Mal, je veux bien mais je ne vois en quoi c'est le cas concernant notamment les trois premières parties. A moins de considérer le Mal sous son acceptation religieuse et d'y inclure donc les plans à trois, les sports de combat etc ...
Ce que je reproche également à ce roman c'est de vouloir apparemment toucher à plein de choses sans les approfondir. Je fais partie des lecteurs qui aiment lorsqu'un auteur décortique et analyse à fond son sujet. Ce n'est pas du tout le cas ici et j'ai d'ailleurs du mal à déterminer quel est le sujet, l'objectif, la raison d'être de ce roman. J'ai une sensation de superficialité, de survol alors que j'aime plutôt la profondeur.
Enfin dernier point, j'ai une grande prédilection pour les romans coups de poing et les romans surprises. C'est d'ailleurs le critère principal de ma propre définition du chef d'oeuvre. Et ici, j'ai attendu et attendu en vain la "surprise", ce moment où tu te dis " Waouh !". Ce roman a pour moi manqué de force, de panache, je l'ai trouvé terne et sans relief. Je suis restée en dehors. Je n'ai pas ressenti d'atmosphère particulière.
Voilà donc essentiellement pourquoi 2666 n'est, selon moi, pas un chef d'oeuvre.
Lien : http://cherrylivres.blogspot..
2666 est un livre très étrange. J'ai mis quatre mois à le lire, et on ne sort pas indemne de la fréquentation aussi longue d'une littérature aussi rude. La meilleure façon de décrire le style et le parti pris littéraire est de citer ce que l'auteur dit de l'écriture d'Archimboldi, l'écrivain qui parcourt toute cette oeuvre.
Edition livre de poche page 1271
et elle pensa aussi combien leurs deux vies étaient différentes, celle de Moravia et celle d'Archimboldi, le premier bourgeois, raisonnable, qui allait l'amble avec son temps et ne se privait pas, cependant, d'encourager (non pour lui mais pour ses spectateurs) certaines plaisanteries délicates et intemporelles, le second, surtout si on le comparait au premier, essentiellement un lumpen, un barbare germanique, un artiste en incandescence constante, comme disait Bubis, quelqu'un qui ne verrait jamais les ruines enveloppées d'étoles de lumière qu'on admirait depuis la terrasse de Moravia, n'écouterait jamais les disques de Moravia, ne sortirait jamais la nuit pour se promener dans Rome avec ses amis, poètes, cinéastes, traducteurs et étudiants, aristocrates et marxistes, comme le faisait Moravia avec ses amis, toujours un mot aimable, une remarque intelligente, un commentaire opportun, tandis qu'Archimboldi entretenait de longs soliloques avec lui-même, pensa la baronne, alors qu'elle suivait Lista de Spagna jusqu'au Campo San Geremia, puis traversait le pont delle Guglie et descendait quelques marches jusqu'à la Fondamenta Pescaria, d'inintelligibles soliloques d'enfant employé de maison ou de soldat nu-pieds en terres russes, un enfer peuplé de succubes, pensa la baronne, et elle se souvint alors, sans qu'il n'y ait de rapport, que dans le Berlin de son adolescence certaines personnes, surtout les bonnes qui venaient de la campagne, appelaient les pédérastes des succubes, les bonnes, les soubrettes qui ouvraient très grands les yeux avec une fausse expression de peur, les petites soubrettes qui quittaient leur famille pour aller dans les énormes maisons de quartier des riches et entretenaient de longs soliloques qui leur permettait d'assurer un jour de plus leur survie.
Je crois en effet que cette oeuvre est rude. Ce n'est pas à proprement parler une saga, car, si certains personnages se retrouvent dans tous les chapitres, si le Mexique et la ville de Santa Theresa où sont assassinées toutes ces femmes est le centre de gravité, ou le point de fuite des cinq livres, l'objet n'est pas d'écrire une histoire délimitée dans le temps et dans l'espace. Il s'agit plutôt d'une divagation, que l'on pourrait comparer à Ulysse, de James Joyce, mais en moins littéraire, avec la volonté de se mettre souvent dans la tête et la peau de personnage très simples, aux réflexions et soucis très limités, mais prégnants. D'un autre côté, le propos peut devenir très grave et Roberto Bolano nous fait rentrer dans l'histoire et ce que le 20ème siècle a de plus tragique : la bataille de l'est pendant la deuxième guerre mondiale, l'enlisement et la défaite des allemands, leur débandade dantesque. Dans cette partie, qui est l'essentielle du dernier livre, consacré à l'écrivain Archimboldi, Bolano nous fait plonger au coeur de la logique nazie et du suivisme des allemands d'une façon remarquable, avec autant de force et de perspicacité que les plus grands écrivains allemands ayant décrit ce phénomène, je pense à Host Krüger par exemple. Ceci est évidemment très étonnant pour un auteur sud américain. Mais ne veut-il pas nous indiquer par là que la réalité d'aujourd'hui, résumée en quelque sorte par les meurtres de femmes dont finalement tout le monde se désintéresse, que cette réalité est la même que celle des nazis, le mal dans sa banalité comme disait Anna Arendt ?
Le livre consacré aux crimes est le plus difficile à lire, mais son propos et la thèse qui s'y devine sont terribles. Des centaines de femmes sont assassinées, peut-être par un malade, peut-être par plusieurs, peut-être pour des raisons diverses, peut-être sans aucune raison. Peu importe, ce qui fait que cela continue, est qu'il y a ici, à la frontière de l'Arizona, des milliers de personnes, hommes et femmes, qui essayent de passer aux USA, ou qui sont venus pour chercher un travail car il y a des manufactures bénéficiant d'un législation favorable aux industriels locaux, que ces personnes sont le plus souvent seules, sans famille, sans papier, sans passé, sans avenir et que leur disparition est sans conséquence. de plus la mafia est omniprésente, dans les usines, dans la police, parmi le personnel politique, toute enquête est suspecte et doit s'arrêter très rapidement. Alors peu importe que l'on fasse croupir en prison un suspect et que les crimes continuent des mois après son arrestation et que l'on retrouve toujours de nouveaux corps dans des décharges. Même les décharges en question n'existent pas car elles sont illégales… Pendant des centaines de pages, les mêmes paragraphes se succèdent, décrivant un crime, avec deux ou trois modes opératoires qui reviennent, strangulation, viol, mutilations, l'enquête rapide permet parfois d'identifier la victime, mas ses proches sont inexistants, ont disparu, ou ne répondent pas et l'affaire est classée. Ce procédé très lassant laisse des traces chez le lecteur qui a le courage de lire toutes ces pages, toujours les mêmes, dont il est absolument impossible de retenir ne serait-ce que le nom ou même le nombre des victimes. A-t-on lu 100, 200 ou 300 tels chapitres ? Mais c'est une façon d'éprouver cette réalité, de lui être concrètement confrontée, de partager la fatigue, la lassitude des habitants de Santa Theresa, leur impuissance, alors même qu'ils font tous les efforts pour s'intéresser à elles et partagent leur angoisse.
2666 est ancré dans la réalité du vingtième siècle, et un livre entier parle d'un homme qui fut un Black Panthers.
Edition livre de poche page 380
Nous, les Black Panthers, nous avions contribué au changement. Avec notre grain de sable, ou avec notre camion à benne. Nous y avions contribué. Et la mère de Marius y avait aussi contribué, et toutes les autres mères noires qui, la nuit au lieu de dormir, ont pleuré et ont imaginé les portes de l'enfer.
Donc il décida de retourner en Californie et de vivre là-bas le restant de sa vie, tranquille, sans faire de mal à personne, et peut-être de fonder une famille et d'avoir des enfants. Il a toujours dit qu'il appellerait son premier fils Frank, en mémoire d'un camarade qui était mort dans la prison de Soledad. En réalité, il aurait dû avoir au moins trente enfants pour rendre hommage aux amis morts. Ou bien dix, et leur donner à chacun trois prénoms. Ou bien cinq, et leur en donner à chacun six. Mais la vérité c'est qu'il n'en a eu aucun parce qu'un soir, alors qu'il était en train de marcher dans une rue de Santa Cruz, un Noir l'a tué.
On a dit que c'était pour de l'argent. On a dit que Marius devait de l'argent et c'est pourquoi on l'a tué, mais j'ai du mal à le croire. Je crois que quelqu'un a payé pour qu'on le tue. Marius, à cette époque, était en train de se battre contre le trafic de drogue dans les| quartiers et quelqu'un n'a pas aimé ça. C'est possible.
Moi, jamais encore en prison et je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. J'ai plusieurs versions sur ça, trop.
Je sais seulement que Marius est mort à Santa Cruz, où il ne vivait pas, où il était allé passer quelques jours, et il est difficile de penser que l'assassin vivait là. C'est-à-dire : l'assassin a suivi Marius. Et la seule raison qui me vienne à l'esprit pour justifier la présence de Marius à Santa Cruz, c'est la mer. Marius s'en est allé voir et sentir l'océan Pacifique. Et l'assassin s'est déplacé à Santa Cruz en suivant l'odeur de Marius. Et il est arrivé ce que tout le monde sait. Des fois je m'imagine Marius. Plus fréquemment, au fond que je ne le souhaiterais. Je le vois sur une plage de Californie. Sur l'une des plages de Big Sur, par exemple, ou sur la plage de Monterey, au nord de Fisherman's Wharf, en montant par la Highway 1. Il est accoudé à un belvédère, il nous tourne le dos. C'est l'hiver et il y a peu de touristes. Nous, les Black Panthers, nous sommes jeunes, aucun d'entre nous n'a vingt-cinq ans. Nous sommes tous armés, mais nous avons laissé les armes dans la voiture, et sur nos visages nous avons une expression de profond mécontentement. La mer rugit. Alors je m'approche de Marius et lui dis : partons d'ici tout de suite. à ce moment-là, Marius se retourne et me regarde. Il est en train de sourire. Il est au-delà. Il me montre la mer d'une main, parce qu'il est incapable d'exprimer avec des mots ce qu'il ressent. Alors je prends peur, bien que ce soit mon frère que j'ai à mes côtés, et je pense : la mer est le danger.
Du point de vue du style, le propos très concret et le récit des soucis ordinaires de gens ordinaires n'empêche pas la richesse des digressions, les divagations baroques.
Edition livre de poche page 1242
Sisyphe, oui, Sisyphe le fils d'Eole et d'Enarété, le fondateur de la ville d'Ephyra, qui est l'ancien nom de Corinthe, une ville que le brave Sisyphe transforma en repaire de ses joyeux méfaits, car, avec cette effronterie qui le caractérisait, cette disposition intellectuelle qui voyait en chaque tour et détour du destin un problème de jeu d'échecs ou une intrigue policière à résoudre, et ce penchant pour le rire, la farce, la facétie, la blague, la plaisanterie, la dérision, la raillerie, la bouffonnerie, le brocard, la moquerie, les lazzis, la singerie, le witz, l'insolence et le sarcasme, il se consacra au vol, c'est-à-dire à dépouiller de son bien tout voyageur qui passait dans le coin, et alla même jusqu'à voler son voisin Autolycos, qui lui aussi volait, peut-être avec l'improbable espoir que celui qui vole un voleur gagne cent ans de pardon, et de la fille duquel il s'était entiché, car Anticlée était très jolie, une véritable poupée, mais cette Anticlée avait un fiancé sérieux, c'est-à-dire qu'elle était engagée auprès d'un certain Laerte, qui serait célèbre plus tard, ce qui ne fit pas reculer Sisyphe, qui comptait de plus sur la complicité du père de la jeune fille, le brigand Autolycos, dont l'admiration pour Sisyphe s'était accrue comme s'accroît l'estime qu'un artiste objectif et honnête éprouve pour un autre artiste aux dons supérieurs, et donc, disons qu'Autolycos fut fidèle à la parole donnée à Laërte, car c'était un homme d'honneur, mais il ne voyait pas non plus d'un mauvais oeil, ou comme moquerie et dérision envers son futur gendre, les attentions amoureuses que Sisyphe prodiguait à sa fille, laquelle finalement, à ce que l'on dit, se maria avec Laërte après s'être donnée à Sisyphe une ou deux fois, cinq ou sept fois, ou peut-être dix ou quinze fois, toujours avec la complicité d'Autolycos, qui désirait que son voisin féconde sa fille pour avoir ainsi un petit-fils aussi rusé que lui, et, une de ces fois- là, Anticlée tomba enceinte et neuf mois plus tard, alors déjà épouse de Laërte, allait naître son fils, le fils de Sisyphe, qui fut appelé Odysseus ou Ulysse, et montra en effet qu'il était aussi rusé que son père, lequel ne s'inquiéta jamais de lui et continua à vivre sa vie, une vie d'excès, de fêtes et de plaisirs, au cours de laquelle il épousa Mérope, l'étoile la moins brillante de la constellation des Pléiades, justement pour avoir épousé un mortel, un foutu mortel, un foutu voleur, un foutu gangster abonné aux excès, aveuglé par 1'excès parmi lesquels, et même si ce n'était pas le moindre, se comptait la séduction de Tyro, la fille de son frère Salmonée, non parce que Tyro lui avait plu, ou ait été particulièrement sexy, mais parce que Sisyphe détestait son propre frère et désirait lui faire du mal, et pour cela, après sa mort, il fut condamné à pousser dans les Enfers un rocher jusqu'au sommet d'une colline, d'où le rocher roulait de nouveau au pied de celle-ci, d'où Sisyphe le poussait de nouveau jusqu'au sommet, d'où il roulait de nouveau aux pieds de celle-ci, et ainsi de suite éternellement un châtiment féroce qui n'avait pas de rapport avec les crimes ou les péchés de Sisyphe et constituait plutôt une vengeance de Zeus, car, en une certaine occasion, si on en croit ce que l'on raconte, Zeus passa par Corinthe avec une nymphe qu'il avait enlevée, et Sisyphe, qui était plus intelligent que la faim, garda l'information à toutes fins utiles, puis le père de la jeure fille, Asopos, passa par là recherchant sa fille comme un désespéré, et Sisyphe, en le voyant, lui proposa de lui donner le nom du séducteur si, en échange, Asopos faisait couler une source dans la ville de Corinthe, ce qui prouve que Sisyphe n'était pas un mauvais citoyen, ou alors qu'il avait soif, un voeu qu'Asopos réalisa : une source d'eau cristalline coula et Sisyphe dénonça Zeus, lequel, très fâché, lui envoya ipso facto Thanatos, la mort, qui cependant ne put venir à bout de Sisyphe, car celui-ci, grâce à un tour de maître qui alliait son sens de l'humour et son intelligence spéculative, captura et enchaîna Thanatos, exploit à la portée de fort peu d'hommes, vraiment à la portée de très peu, et il garda longtemps Thanatos enchaîné, et pendant tout ce temps aucun être humain ne mourut sur la surface de la terre, une époque dorée où les hommes, sans cesser d'être des hommes, vivaient sans l'angoisse de la mort, c'est-à-dire sans l'angoisse du temps, car le temps c'est ce qu'il y a en reste, ce qui peut-être caractérise une démocratie, le temps en reste, la plus-value de temps, du temps pour lire et du temps pour penser, jusqu'à ce que Zeus soit contraint d'intervertir personnellement et que Thanatos soit libéré, et alors Sisyphe mourut.
Le dernier livre est celui qui a la facture la plus classique. Il relate la vie de l'écrivain Archimboldi. Né d'un père boiteux et d'une mère borgne, élevé dans un château dont il est un des valets, Archimboldi ne sait même pas parler au début de sa vie d'adulte. Enrôlé dans la Wehrmacht, il fait la campagne de Russie où il est confronté aux situations et aux personnages les plus extrêmes. Il découvre les carnets cachés d'un écrivain de l'ombre, Ansky, qui écrit des livres que publie à son propre compte et sous son propre nom un ami, et c'est en déchiffrant ces lignes qu'Archimboldi devient finalement un écrivain, comme pour perpétuer ce geste d'un anonyme véritable auteur. On trouve dans cette partie de 2666 l'incroyable histoire de ce fonctionnaire nazi qui se retrouve un jour, quelque part en Pologne, avec sur les bras un convoi de plusieurs milliers de juifs qui lui ont été envoyés par erreur. La nécessité où il se trouve de traiter ce problème, de lui trouver une solution est une des choses les plus fortes dans l'horreur que j'ai lues sur la solution finale, car il s'agit là d'un homme qui, par commodité, ou par nécessité ou parce qu'il ne peut pas faire autrement, réinvente une solution finale bricolée avec les moyens du bord, encore plus horrible que celle d'Auschwitz.
Edition livre de poche page 1271
et elle pensa aussi combien leurs deux vies étaient différentes, celle de Moravia et celle d'Archimboldi, le premier bourgeois, raisonnable, qui allait l'amble avec son temps et ne se privait pas, cependant, d'encourager (non pour lui mais pour ses spectateurs) certaines plaisanteries délicates et intemporelles, le second, surtout si on le comparait au premier, essentiellement un lumpen, un barbare germanique, un artiste en incandescence constante, comme disait Bubis, quelqu'un qui ne verrait jamais les ruines enveloppées d'étoles de lumière qu'on admirait depuis la terrasse de Moravia, n'écouterait jamais les disques de Moravia, ne sortirait jamais la nuit pour se promener dans Rome avec ses amis, poètes, cinéastes, traducteurs et étudiants, aristocrates et marxistes, comme le faisait Moravia avec ses amis, toujours un mot aimable, une remarque intelligente, un commentaire opportun, tandis qu'Archimboldi entretenait de longs soliloques avec lui-même, pensa la baronne, alors qu'elle suivait Lista de Spagna jusqu'au Campo San Geremia, puis traversait le pont delle Guglie et descendait quelques marches jusqu'à la Fondamenta Pescaria, d'inintelligibles soliloques d'enfant employé de maison ou de soldat nu-pieds en terres russes, un enfer peuplé de succubes, pensa la baronne, et elle se souvint alors, sans qu'il n'y ait de rapport, que dans le Berlin de son adolescence certaines personnes, surtout les bonnes qui venaient de la campagne, appelaient les pédérastes des succubes, les bonnes, les soubrettes qui ouvraient très grands les yeux avec une fausse expression de peur, les petites soubrettes qui quittaient leur famille pour aller dans les énormes maisons de quartier des riches et entretenaient de longs soliloques qui leur permettait d'assurer un jour de plus leur survie.
Je crois en effet que cette oeuvre est rude. Ce n'est pas à proprement parler une saga, car, si certains personnages se retrouvent dans tous les chapitres, si le Mexique et la ville de Santa Theresa où sont assassinées toutes ces femmes est le centre de gravité, ou le point de fuite des cinq livres, l'objet n'est pas d'écrire une histoire délimitée dans le temps et dans l'espace. Il s'agit plutôt d'une divagation, que l'on pourrait comparer à Ulysse, de James Joyce, mais en moins littéraire, avec la volonté de se mettre souvent dans la tête et la peau de personnage très simples, aux réflexions et soucis très limités, mais prégnants. D'un autre côté, le propos peut devenir très grave et Roberto Bolano nous fait rentrer dans l'histoire et ce que le 20ème siècle a de plus tragique : la bataille de l'est pendant la deuxième guerre mondiale, l'enlisement et la défaite des allemands, leur débandade dantesque. Dans cette partie, qui est l'essentielle du dernier livre, consacré à l'écrivain Archimboldi, Bolano nous fait plonger au coeur de la logique nazie et du suivisme des allemands d'une façon remarquable, avec autant de force et de perspicacité que les plus grands écrivains allemands ayant décrit ce phénomène, je pense à Host Krüger par exemple. Ceci est évidemment très étonnant pour un auteur sud américain. Mais ne veut-il pas nous indiquer par là que la réalité d'aujourd'hui, résumée en quelque sorte par les meurtres de femmes dont finalement tout le monde se désintéresse, que cette réalité est la même que celle des nazis, le mal dans sa banalité comme disait Anna Arendt ?
Le livre consacré aux crimes est le plus difficile à lire, mais son propos et la thèse qui s'y devine sont terribles. Des centaines de femmes sont assassinées, peut-être par un malade, peut-être par plusieurs, peut-être pour des raisons diverses, peut-être sans aucune raison. Peu importe, ce qui fait que cela continue, est qu'il y a ici, à la frontière de l'Arizona, des milliers de personnes, hommes et femmes, qui essayent de passer aux USA, ou qui sont venus pour chercher un travail car il y a des manufactures bénéficiant d'un législation favorable aux industriels locaux, que ces personnes sont le plus souvent seules, sans famille, sans papier, sans passé, sans avenir et que leur disparition est sans conséquence. de plus la mafia est omniprésente, dans les usines, dans la police, parmi le personnel politique, toute enquête est suspecte et doit s'arrêter très rapidement. Alors peu importe que l'on fasse croupir en prison un suspect et que les crimes continuent des mois après son arrestation et que l'on retrouve toujours de nouveaux corps dans des décharges. Même les décharges en question n'existent pas car elles sont illégales… Pendant des centaines de pages, les mêmes paragraphes se succèdent, décrivant un crime, avec deux ou trois modes opératoires qui reviennent, strangulation, viol, mutilations, l'enquête rapide permet parfois d'identifier la victime, mas ses proches sont inexistants, ont disparu, ou ne répondent pas et l'affaire est classée. Ce procédé très lassant laisse des traces chez le lecteur qui a le courage de lire toutes ces pages, toujours les mêmes, dont il est absolument impossible de retenir ne serait-ce que le nom ou même le nombre des victimes. A-t-on lu 100, 200 ou 300 tels chapitres ? Mais c'est une façon d'éprouver cette réalité, de lui être concrètement confrontée, de partager la fatigue, la lassitude des habitants de Santa Theresa, leur impuissance, alors même qu'ils font tous les efforts pour s'intéresser à elles et partagent leur angoisse.
2666 est ancré dans la réalité du vingtième siècle, et un livre entier parle d'un homme qui fut un Black Panthers.
Edition livre de poche page 380
Nous, les Black Panthers, nous avions contribué au changement. Avec notre grain de sable, ou avec notre camion à benne. Nous y avions contribué. Et la mère de Marius y avait aussi contribué, et toutes les autres mères noires qui, la nuit au lieu de dormir, ont pleuré et ont imaginé les portes de l'enfer.
Donc il décida de retourner en Californie et de vivre là-bas le restant de sa vie, tranquille, sans faire de mal à personne, et peut-être de fonder une famille et d'avoir des enfants. Il a toujours dit qu'il appellerait son premier fils Frank, en mémoire d'un camarade qui était mort dans la prison de Soledad. En réalité, il aurait dû avoir au moins trente enfants pour rendre hommage aux amis morts. Ou bien dix, et leur donner à chacun trois prénoms. Ou bien cinq, et leur en donner à chacun six. Mais la vérité c'est qu'il n'en a eu aucun parce qu'un soir, alors qu'il était en train de marcher dans une rue de Santa Cruz, un Noir l'a tué.
On a dit que c'était pour de l'argent. On a dit que Marius devait de l'argent et c'est pourquoi on l'a tué, mais j'ai du mal à le croire. Je crois que quelqu'un a payé pour qu'on le tue. Marius, à cette époque, était en train de se battre contre le trafic de drogue dans les| quartiers et quelqu'un n'a pas aimé ça. C'est possible.
Moi, jamais encore en prison et je ne sais pas très bien ce qui s'est passé. J'ai plusieurs versions sur ça, trop.
Je sais seulement que Marius est mort à Santa Cruz, où il ne vivait pas, où il était allé passer quelques jours, et il est difficile de penser que l'assassin vivait là. C'est-à-dire : l'assassin a suivi Marius. Et la seule raison qui me vienne à l'esprit pour justifier la présence de Marius à Santa Cruz, c'est la mer. Marius s'en est allé voir et sentir l'océan Pacifique. Et l'assassin s'est déplacé à Santa Cruz en suivant l'odeur de Marius. Et il est arrivé ce que tout le monde sait. Des fois je m'imagine Marius. Plus fréquemment, au fond que je ne le souhaiterais. Je le vois sur une plage de Californie. Sur l'une des plages de Big Sur, par exemple, ou sur la plage de Monterey, au nord de Fisherman's Wharf, en montant par la Highway 1. Il est accoudé à un belvédère, il nous tourne le dos. C'est l'hiver et il y a peu de touristes. Nous, les Black Panthers, nous sommes jeunes, aucun d'entre nous n'a vingt-cinq ans. Nous sommes tous armés, mais nous avons laissé les armes dans la voiture, et sur nos visages nous avons une expression de profond mécontentement. La mer rugit. Alors je m'approche de Marius et lui dis : partons d'ici tout de suite. à ce moment-là, Marius se retourne et me regarde. Il est en train de sourire. Il est au-delà. Il me montre la mer d'une main, parce qu'il est incapable d'exprimer avec des mots ce qu'il ressent. Alors je prends peur, bien que ce soit mon frère que j'ai à mes côtés, et je pense : la mer est le danger.
Du point de vue du style, le propos très concret et le récit des soucis ordinaires de gens ordinaires n'empêche pas la richesse des digressions, les divagations baroques.
Edition livre de poche page 1242
Sisyphe, oui, Sisyphe le fils d'Eole et d'Enarété, le fondateur de la ville d'Ephyra, qui est l'ancien nom de Corinthe, une ville que le brave Sisyphe transforma en repaire de ses joyeux méfaits, car, avec cette effronterie qui le caractérisait, cette disposition intellectuelle qui voyait en chaque tour et détour du destin un problème de jeu d'échecs ou une intrigue policière à résoudre, et ce penchant pour le rire, la farce, la facétie, la blague, la plaisanterie, la dérision, la raillerie, la bouffonnerie, le brocard, la moquerie, les lazzis, la singerie, le witz, l'insolence et le sarcasme, il se consacra au vol, c'est-à-dire à dépouiller de son bien tout voyageur qui passait dans le coin, et alla même jusqu'à voler son voisin Autolycos, qui lui aussi volait, peut-être avec l'improbable espoir que celui qui vole un voleur gagne cent ans de pardon, et de la fille duquel il s'était entiché, car Anticlée était très jolie, une véritable poupée, mais cette Anticlée avait un fiancé sérieux, c'est-à-dire qu'elle était engagée auprès d'un certain Laerte, qui serait célèbre plus tard, ce qui ne fit pas reculer Sisyphe, qui comptait de plus sur la complicité du père de la jeune fille, le brigand Autolycos, dont l'admiration pour Sisyphe s'était accrue comme s'accroît l'estime qu'un artiste objectif et honnête éprouve pour un autre artiste aux dons supérieurs, et donc, disons qu'Autolycos fut fidèle à la parole donnée à Laërte, car c'était un homme d'honneur, mais il ne voyait pas non plus d'un mauvais oeil, ou comme moquerie et dérision envers son futur gendre, les attentions amoureuses que Sisyphe prodiguait à sa fille, laquelle finalement, à ce que l'on dit, se maria avec Laërte après s'être donnée à Sisyphe une ou deux fois, cinq ou sept fois, ou peut-être dix ou quinze fois, toujours avec la complicité d'Autolycos, qui désirait que son voisin féconde sa fille pour avoir ainsi un petit-fils aussi rusé que lui, et, une de ces fois- là, Anticlée tomba enceinte et neuf mois plus tard, alors déjà épouse de Laërte, allait naître son fils, le fils de Sisyphe, qui fut appelé Odysseus ou Ulysse, et montra en effet qu'il était aussi rusé que son père, lequel ne s'inquiéta jamais de lui et continua à vivre sa vie, une vie d'excès, de fêtes et de plaisirs, au cours de laquelle il épousa Mérope, l'étoile la moins brillante de la constellation des Pléiades, justement pour avoir épousé un mortel, un foutu mortel, un foutu voleur, un foutu gangster abonné aux excès, aveuglé par 1'excès parmi lesquels, et même si ce n'était pas le moindre, se comptait la séduction de Tyro, la fille de son frère Salmonée, non parce que Tyro lui avait plu, ou ait été particulièrement sexy, mais parce que Sisyphe détestait son propre frère et désirait lui faire du mal, et pour cela, après sa mort, il fut condamné à pousser dans les Enfers un rocher jusqu'au sommet d'une colline, d'où le rocher roulait de nouveau au pied de celle-ci, d'où Sisyphe le poussait de nouveau jusqu'au sommet, d'où il roulait de nouveau aux pieds de celle-ci, et ainsi de suite éternellement un châtiment féroce qui n'avait pas de rapport avec les crimes ou les péchés de Sisyphe et constituait plutôt une vengeance de Zeus, car, en une certaine occasion, si on en croit ce que l'on raconte, Zeus passa par Corinthe avec une nymphe qu'il avait enlevée, et Sisyphe, qui était plus intelligent que la faim, garda l'information à toutes fins utiles, puis le père de la jeure fille, Asopos, passa par là recherchant sa fille comme un désespéré, et Sisyphe, en le voyant, lui proposa de lui donner le nom du séducteur si, en échange, Asopos faisait couler une source dans la ville de Corinthe, ce qui prouve que Sisyphe n'était pas un mauvais citoyen, ou alors qu'il avait soif, un voeu qu'Asopos réalisa : une source d'eau cristalline coula et Sisyphe dénonça Zeus, lequel, très fâché, lui envoya ipso facto Thanatos, la mort, qui cependant ne put venir à bout de Sisyphe, car celui-ci, grâce à un tour de maître qui alliait son sens de l'humour et son intelligence spéculative, captura et enchaîna Thanatos, exploit à la portée de fort peu d'hommes, vraiment à la portée de très peu, et il garda longtemps Thanatos enchaîné, et pendant tout ce temps aucun être humain ne mourut sur la surface de la terre, une époque dorée où les hommes, sans cesser d'être des hommes, vivaient sans l'angoisse de la mort, c'est-à-dire sans l'angoisse du temps, car le temps c'est ce qu'il y a en reste, ce qui peut-être caractérise une démocratie, le temps en reste, la plus-value de temps, du temps pour lire et du temps pour penser, jusqu'à ce que Zeus soit contraint d'intervertir personnellement et que Thanatos soit libéré, et alors Sisyphe mourut.
Le dernier livre est celui qui a la facture la plus classique. Il relate la vie de l'écrivain Archimboldi. Né d'un père boiteux et d'une mère borgne, élevé dans un château dont il est un des valets, Archimboldi ne sait même pas parler au début de sa vie d'adulte. Enrôlé dans la Wehrmacht, il fait la campagne de Russie où il est confronté aux situations et aux personnages les plus extrêmes. Il découvre les carnets cachés d'un écrivain de l'ombre, Ansky, qui écrit des livres que publie à son propre compte et sous son propre nom un ami, et c'est en déchiffrant ces lignes qu'Archimboldi devient finalement un écrivain, comme pour perpétuer ce geste d'un anonyme véritable auteur. On trouve dans cette partie de 2666 l'incroyable histoire de ce fonctionnaire nazi qui se retrouve un jour, quelque part en Pologne, avec sur les bras un convoi de plusieurs milliers de juifs qui lui ont été envoyés par erreur. La nécessité où il se trouve de traiter ce problème, de lui trouver une solution est une des choses les plus fortes dans l'horreur que j'ai lues sur la solution finale, car il s'agit là d'un homme qui, par commodité, ou par nécessité ou parce qu'il ne peut pas faire autrement, réinvente une solution finale bricolée avec les moyens du bord, encore plus horrible que celle d'Auschwitz.
Roberto Bolaño n'est pas de ces auteurs qui vous vampirisent, de ceux qui vous assènent avec violence leurs idées ou idéologies sur le monde, de ceux qui vous imposent leurs conceptions morales...
Il montre plus qu'il ne démontre, sans volonté affichée de délivrer un message, laissant le champ libre à la réflexion de son lecteur.
Il n'est pas de ceux qui veulent vous en mettre plein la vue, de ceux qui prennent pour de la consistance ce qui n'est que du remplissage...
Il sait donner du sens aux détails, révéler la portée universelle d'événements ordinaires.
A l'inverse des "chirurgiens" de la littérature, qui décortiquent jusqu'à l'écoeurement l'objet de leur attention, triturent leur sujet jusqu'à lui ôter tout mystère et priver le lecteur de sa marge d'interprétation, Roberto Bolaño agit en généraliste à la fois sensible et curieux, son esprit restant ouvert à tous les possibles.
Il ausculte le monde, l'observe, le palpe, explore les différentes manifestations de son mal-être, ne néglige aucune piste quant à l'origine de ses maux. Il s'intéresse à son patient dans son ensemble, s'attardant parfois sur un détail qui peut sembler insignifiant mais qui acquiert son importance comme élément constitutif de cet ensemble.
Ainsi "2666", qui se compose de cinq parties dont chacune pourrait se suffire à elle-même, mais que certaines corrélations, parfois subtiles, lient, leur permettant de former un tout finalement cohérent.
L'un de leurs points communs est une ville frontalière du Mexique, Santa Teresa. Les différents protagonistes mis en scène dans ces cinq parties vont, à divers moments, s'y trouver, pour des durées plus ou moins longues.
Au début du récit, quatre universitaires européens se trouvent réunis par leur fascination commune pour les écrits d'un obscur écrivain allemand, qui a pour improbable pseudonyme Benno von Archimboldi. de colloques en conférences, le français Pelletier, l'espagnol Espinoza, l'italien Morini et l'anglaise Norton vont nouer des relations singulières, parfois pseudo amoureuses, chacun gardant pour les autres une part de mystère qui s'ajoute à leurs antagonismes et à leurs pulsions parfois violentes pour doter leurs rapports d'une tension sous-jacente.
C'est leur volonté de retrouver la piste d'Archimboldi, insaisissable écrivain fantôme, qui les amène à envisager un voyage au Mexique.
Les trois parties suivantes se déroulent presque exclusivement à Santa Teresa, ville moyenne, sans charme, dont les maquiladoras (1) attirent les miséreux en quête de n'importe quel travail, ville de cauchemar, où d'innombrables meurtres de femmes sont commis depuis des années sans que les quelques arrestations censées mettre à l'ombre les coupables n'y mettent un terme.
Nous y croisons Amalfitano. Ce professeur de philosophie (qui accueille nos universitaires européens lors de leur venue au Mexique sur les traces d'Archimboldi), a élevé seul sa fille Rosa, avec laquelle il est arrivé de Barcelone alors qu'elle n'était qu'une enfant ; sa femme les avait alors quittés pour tenter de vivre un impossible amour avec un poète espagnol interné en asile psychiatrique. Amalfitano est constamment terrorisé à l'idée que sa fille subisse le même sort que les centaines de victimes que compte Santa Teresa.
Nous y faisons aussi la connaissance de Fate, journaliste noir américain qui échoue par hasard à Santa Teresa, afin de remplacer son collègue du service des sports qui vient d'être assassiné, et qui devait y couvrir un match de boxe.
Toute une partie est ensuite consacrée uniquement aux meurtres de femmes. En une macabre litanie, Roberto Bolaño énumère le nom des victimes, livre parfois un détail qui les personnalise, mais à peine, comme si son but était de banaliser les faits -et démontrer la banalité du mal ?- : l'énormité de ces crimes, dont le nombre est à peine croyable, finit par déshumaniser les victimes, chacune n'étant plus que l'élément d'une longue série...
Parmi les enquêteurs, dont la plupart sont au mieux effarants d'indifférence, au pire complices de ces atrocités, de rares individus se distinguent par leur humanité, leur compassion, dont le poids semble d'autant plus lourd qu'ils sont complètement isolés.
La dernière partie revient sur Archimboldi, nous conte son enfance, sa participation à la deuxième guerre mondiale dans l'infanterie allemande, ses débuts d'écrivain... il conserve cependant son aura de mystère. Enfant mutique, d'une taille exceptionnelle, plus à l'aise en compagnie de la faune sous-marine que de ses semblables, il semble éprouver un détachement permanent qui l'isole du monde, qui l'en protège aussi, sans doute, et lui permettra de survivre et de rester égal à lui-même, en dépit de la violence et de la barbarie qui l'entoure.
Pour autant, la boucle n'est pas bouclée... tout comme le roman n'a pas vraiment de fin. Non pas parce qu'il est resté inachevé en raison du décès prématuré de l'auteur (seules quelques dernières corrections devaient y être apportées), mais parce qu'il ne pouvait en être autrement ! "2666" est comme une photographie du monde qu'aurait prise l'auteur, fixant un moment, mais s'attachant à ce que l'image rendue soit représentative de la condition humaine en général. Ce qui nous est montré aurait pu arriver hier ou demain, et de toutes façons arrive tous les jours, depuis toujours, et il n'y a pas de raison que cela cesse : la violence semble inhérente à l'homme (ainsi que nous le démontrent aussi bien L Histoire que les plus banals faits divers), et elle est par conséquent infinie...
Il faut du temps pour lire "2666", et pas seulement en raison de son grand nombre de pages. Il faut le temps de suivre le rythme de Roberto Bolaño, qui, une anecdote en amenant une autre, semble parfois s'écarter de l'itinéraire initialement emprunté, jusqu'à ce que l'on se rende compte que les chemins de traverse ont pour lui autant d'importance que la route principale, qu'ils composent à eux tous cette vaste fresque qu'est la vie, avec ses vicissitudes, ses grandes catastrophes et ses petits malheurs, et -mais dans une moindre mesure- ses joies et ses bonheurs... Malgré tout, comme il nous lance sur des pistes souvent sans suite, nous promet parfois l'imminence de drames qui ne surviennent pas, alors qu'à d'autres moments il nous surprend par une horreur que l'on n'a pas senti venir, notre attention est maintenue en alerte tout au long du récit.
"2666" est, pour conclure, à la hauteur de ce que j'avais imaginé : colossal, magistral, et porteur d'une mélancolie dont vous restez imprégné de longues heures après l'avoir refermé.
Lien : http://bookin-ingannmic.blog..
Il montre plus qu'il ne démontre, sans volonté affichée de délivrer un message, laissant le champ libre à la réflexion de son lecteur.
Il n'est pas de ceux qui veulent vous en mettre plein la vue, de ceux qui prennent pour de la consistance ce qui n'est que du remplissage...
Il sait donner du sens aux détails, révéler la portée universelle d'événements ordinaires.
A l'inverse des "chirurgiens" de la littérature, qui décortiquent jusqu'à l'écoeurement l'objet de leur attention, triturent leur sujet jusqu'à lui ôter tout mystère et priver le lecteur de sa marge d'interprétation, Roberto Bolaño agit en généraliste à la fois sensible et curieux, son esprit restant ouvert à tous les possibles.
Il ausculte le monde, l'observe, le palpe, explore les différentes manifestations de son mal-être, ne néglige aucune piste quant à l'origine de ses maux. Il s'intéresse à son patient dans son ensemble, s'attardant parfois sur un détail qui peut sembler insignifiant mais qui acquiert son importance comme élément constitutif de cet ensemble.
Ainsi "2666", qui se compose de cinq parties dont chacune pourrait se suffire à elle-même, mais que certaines corrélations, parfois subtiles, lient, leur permettant de former un tout finalement cohérent.
L'un de leurs points communs est une ville frontalière du Mexique, Santa Teresa. Les différents protagonistes mis en scène dans ces cinq parties vont, à divers moments, s'y trouver, pour des durées plus ou moins longues.
Au début du récit, quatre universitaires européens se trouvent réunis par leur fascination commune pour les écrits d'un obscur écrivain allemand, qui a pour improbable pseudonyme Benno von Archimboldi. de colloques en conférences, le français Pelletier, l'espagnol Espinoza, l'italien Morini et l'anglaise Norton vont nouer des relations singulières, parfois pseudo amoureuses, chacun gardant pour les autres une part de mystère qui s'ajoute à leurs antagonismes et à leurs pulsions parfois violentes pour doter leurs rapports d'une tension sous-jacente.
C'est leur volonté de retrouver la piste d'Archimboldi, insaisissable écrivain fantôme, qui les amène à envisager un voyage au Mexique.
Les trois parties suivantes se déroulent presque exclusivement à Santa Teresa, ville moyenne, sans charme, dont les maquiladoras (1) attirent les miséreux en quête de n'importe quel travail, ville de cauchemar, où d'innombrables meurtres de femmes sont commis depuis des années sans que les quelques arrestations censées mettre à l'ombre les coupables n'y mettent un terme.
Nous y croisons Amalfitano. Ce professeur de philosophie (qui accueille nos universitaires européens lors de leur venue au Mexique sur les traces d'Archimboldi), a élevé seul sa fille Rosa, avec laquelle il est arrivé de Barcelone alors qu'elle n'était qu'une enfant ; sa femme les avait alors quittés pour tenter de vivre un impossible amour avec un poète espagnol interné en asile psychiatrique. Amalfitano est constamment terrorisé à l'idée que sa fille subisse le même sort que les centaines de victimes que compte Santa Teresa.
Nous y faisons aussi la connaissance de Fate, journaliste noir américain qui échoue par hasard à Santa Teresa, afin de remplacer son collègue du service des sports qui vient d'être assassiné, et qui devait y couvrir un match de boxe.
Toute une partie est ensuite consacrée uniquement aux meurtres de femmes. En une macabre litanie, Roberto Bolaño énumère le nom des victimes, livre parfois un détail qui les personnalise, mais à peine, comme si son but était de banaliser les faits -et démontrer la banalité du mal ?- : l'énormité de ces crimes, dont le nombre est à peine croyable, finit par déshumaniser les victimes, chacune n'étant plus que l'élément d'une longue série...
Parmi les enquêteurs, dont la plupart sont au mieux effarants d'indifférence, au pire complices de ces atrocités, de rares individus se distinguent par leur humanité, leur compassion, dont le poids semble d'autant plus lourd qu'ils sont complètement isolés.
La dernière partie revient sur Archimboldi, nous conte son enfance, sa participation à la deuxième guerre mondiale dans l'infanterie allemande, ses débuts d'écrivain... il conserve cependant son aura de mystère. Enfant mutique, d'une taille exceptionnelle, plus à l'aise en compagnie de la faune sous-marine que de ses semblables, il semble éprouver un détachement permanent qui l'isole du monde, qui l'en protège aussi, sans doute, et lui permettra de survivre et de rester égal à lui-même, en dépit de la violence et de la barbarie qui l'entoure.
Pour autant, la boucle n'est pas bouclée... tout comme le roman n'a pas vraiment de fin. Non pas parce qu'il est resté inachevé en raison du décès prématuré de l'auteur (seules quelques dernières corrections devaient y être apportées), mais parce qu'il ne pouvait en être autrement ! "2666" est comme une photographie du monde qu'aurait prise l'auteur, fixant un moment, mais s'attachant à ce que l'image rendue soit représentative de la condition humaine en général. Ce qui nous est montré aurait pu arriver hier ou demain, et de toutes façons arrive tous les jours, depuis toujours, et il n'y a pas de raison que cela cesse : la violence semble inhérente à l'homme (ainsi que nous le démontrent aussi bien L Histoire que les plus banals faits divers), et elle est par conséquent infinie...
Il faut du temps pour lire "2666", et pas seulement en raison de son grand nombre de pages. Il faut le temps de suivre le rythme de Roberto Bolaño, qui, une anecdote en amenant une autre, semble parfois s'écarter de l'itinéraire initialement emprunté, jusqu'à ce que l'on se rende compte que les chemins de traverse ont pour lui autant d'importance que la route principale, qu'ils composent à eux tous cette vaste fresque qu'est la vie, avec ses vicissitudes, ses grandes catastrophes et ses petits malheurs, et -mais dans une moindre mesure- ses joies et ses bonheurs... Malgré tout, comme il nous lance sur des pistes souvent sans suite, nous promet parfois l'imminence de drames qui ne surviennent pas, alors qu'à d'autres moments il nous surprend par une horreur que l'on n'a pas senti venir, notre attention est maintenue en alerte tout au long du récit.
"2666" est, pour conclure, à la hauteur de ce que j'avais imaginé : colossal, magistral, et porteur d'une mélancolie dont vous restez imprégné de longues heures après l'avoir refermé.
Lien : http://bookin-ingannmic.blog..
Vous avez déjà dû voir, un jour sur une plage, à marée basse, les contours d un courant imprimé dans le sable, où le lit d une rivière, seulement visible lorsque la mer se retire.
2666, c est un peu ça.
Sur 1162 pages superbement bien écrites, Roberto Bolano nous parle de violences, l air de rien, au travers de plusieurs histoires qui se rejoignent. Violence visible, celle des femmes décédées à Ciudad Juares (Santa Theresa) au nord du Mexique, violence larvée d intellos à la recherche d un mystérieux personnage...
Les cinq livres contenus dans ce volume, et qui devaient être édités en autant de livres, pour assurer une tranquillité financière à la famille de Roberto Bolano qui se savait en sursis, en attente d une greffe de foie, ont été publiés dans le même ouvrage, avec l accord des héritiers et de l éditeur.
Riche idée à mon avis, c est un monde total, global, une immersion dans ce que j appellerais la grande littérature, le roman poussé à son climax.
Sous couvert de plusieurs histoires et de très nombreuses digressions, jamais ennuyeuses, Bolano nous prend dans ses filets, la lecture en devient addictive, sans toujours savoir où l on va..
C est pour moi la quintessence du roman, un formidable travail, parfois proche du journalisme, du reportage, comme ce long passage sur les enquêtes des policiers dans le désert mexicain, tout en gardant ce souffle admirable dans la narration.
C est puissant, le texte forme une sorte de puzzle, apparemment sans rapport, avant qu une phrase vienne subitement vous éclairer, dessiner les ramifications.
Un pavé d intelligence et de Littérature,avec un très grand "L".
2666, c est un peu ça.
Sur 1162 pages superbement bien écrites, Roberto Bolano nous parle de violences, l air de rien, au travers de plusieurs histoires qui se rejoignent. Violence visible, celle des femmes décédées à Ciudad Juares (Santa Theresa) au nord du Mexique, violence larvée d intellos à la recherche d un mystérieux personnage...
Les cinq livres contenus dans ce volume, et qui devaient être édités en autant de livres, pour assurer une tranquillité financière à la famille de Roberto Bolano qui se savait en sursis, en attente d une greffe de foie, ont été publiés dans le même ouvrage, avec l accord des héritiers et de l éditeur.
Riche idée à mon avis, c est un monde total, global, une immersion dans ce que j appellerais la grande littérature, le roman poussé à son climax.
Sous couvert de plusieurs histoires et de très nombreuses digressions, jamais ennuyeuses, Bolano nous prend dans ses filets, la lecture en devient addictive, sans toujours savoir où l on va..
C est pour moi la quintessence du roman, un formidable travail, parfois proche du journalisme, du reportage, comme ce long passage sur les enquêtes des policiers dans le désert mexicain, tout en gardant ce souffle admirable dans la narration.
C est puissant, le texte forme une sorte de puzzle, apparemment sans rapport, avant qu une phrase vienne subitement vous éclairer, dessiner les ramifications.
Un pavé d intelligence et de Littérature,avec un très grand "L".
Lire "2666", c'est comme se lancer dans un tour du monde à la voile en solitaire et sans escale quand on ne sait ni naviguer ni nager : une expérience difficile et exaltante, qui marque durablement. Avant d'embarquer, il faut être prêt à affronter le découragement d'une errance sans itinéraire, à se perdre dans les 1012 pages, à errer dans 5 parties disparates qui ne s'emboîtent pas, à s'ennuyer sur de fausses pistes, à subir le récit de féminicides barbares (dans "La partie des crimes", très éprouvante) et à perdre même l'espoir d'une révélation qui donnerait un sens à notre sacrifice. Bref, c'est un livre qui exclut d'emblée toutes les prises auxquelles nous avons l'habitude de nous accrocher quand nous lisons. Alors, si l'on écarte aussi le snobisme (vous savez, pour ne pas rejoindre le club de ceux qui parlent les yeux fermés de "La Recherche" ou d'"Ulysse" sans les avoir lus), pourquoi franchement s'infliger pareille douleur ?
On a souvent dit que c'était un livre sur le Mal. Moi, je dirais que c'est un livre sur la littérature. Je salue la beauté du geste littéraire, l'entreprise titanesque, le rêve de totalité condamné d'avance, que mena Roberto Bolaño jusqu'au seuil de la mort :
"Quel triste paradoxe, pensa Amalfitano. Même les pharmaciens cultivés ne se risquent plus aux grandes oeuvres, imparfaites, torrentielles, celles qui ouvrent des chemins dans l'inconnu. Ils choisissent les exercices parfaits des grands maîtres. Ou ce qui revient au même : ils veulent voir les grands maîtres dans des séances d'escrime d'entraînement, mais ne veulent rien savoir des vrais combats, où les grands maîtres luttent contre ça, ce ça qui nous terrifie tous, ce ça qui effraie et charge cornes baissées, et il y a du sang et des blessures mortelles et de la puanteur."
En tant que lectrice, j'apprécie ces expériences de lecture radicales, à la limite du supportable, car elles donnent du poids aux plus légères. La littérature, c'est aussi le spectacle de ce combat contre le Minotaure. Respect, donc, Grand Maître !
Mais il serait ennuyeux s'il se contentait d'être un écrivain mégalomane : lui, son truc, c'est de brouiller les pistes, avec malice. C'est aussi pour son art du passe-passe, du trompe l'oeil borgesien, qu'il faut lire son roman. Bolaño se fait un plaisir d'engouffrer dans sa moulinette magique tous les thèmes universels, comme la quête de la vérité, l'amour, le mal, pour les réduire à une illusion, dans un style de prestidigitation à la fois ludique et nihiliste. 2666, c'est un jeu de massacre dans un labyrinthe de miroirs.
Malgré tous ces écueils, malgré l'hétérogénéité des atmosphères et le disparate des tonalités, le plus réussi dans cette oeuvre est pour moi la fluidité avec laquelle elle avance, par nappes qui superposent les voix et les personnages. Des éléments sans ordre apparent sont juxtaposés, se chevauchant parfois, parfois non, tenus par des thématiques souterraines, des échos discrets auxquels le lecteur cherche à se raccrocher. J'aime cette fluidité aveugle qui nous mène d'une zone à l'autre, de la réalité au rêve, comme un flux, surtout sensible dans la dernière partie "La partie d'Arcimboldi", celle où un Allemand qui aime les algues plonge dans les rivières… Ces nappes nous disent que "2666" est un roman sur les apparences qu'il n'essaie pas de percer, qu'il ne fait que constater. L'amour est une apparence, comme la jeunesse, comme le national-socialisme... Dans ce cas, au lieu d'adopter la verticalité à laquelle nous sommes habitués dans un roman, force qui va vers le dévoilement progressif d'une vérité, ce roman adopte cette horizontalité de l'apparence, comme si nous ne cessions de glisser sur ce qui ne peut se nommer. Les cinq parties tournent comme une toupie plate autour d'un point aveugle, l'oeil du cyclone, qui pourrait être la ville de Santa Teresa vers laquelle tout converge, mais sur lequel aucun dévoilement ne donnera jamais de certitude.
Car Bolaño ne rassure pas, il inquiète : "Il ne s'agit pas de croire, il s'agit de comprendre, puis de changer". Peut-être est-ce pour cela que la lecture de ses oeuvres ne finit jamais en nous, et qu'elles continuent à nous poursuivre une fois refermées.
Pour lui, le livre ne se consomme pas, il ne divertit pas. Il se vit.
On a souvent dit que c'était un livre sur le Mal. Moi, je dirais que c'est un livre sur la littérature. Je salue la beauté du geste littéraire, l'entreprise titanesque, le rêve de totalité condamné d'avance, que mena Roberto Bolaño jusqu'au seuil de la mort :
"Quel triste paradoxe, pensa Amalfitano. Même les pharmaciens cultivés ne se risquent plus aux grandes oeuvres, imparfaites, torrentielles, celles qui ouvrent des chemins dans l'inconnu. Ils choisissent les exercices parfaits des grands maîtres. Ou ce qui revient au même : ils veulent voir les grands maîtres dans des séances d'escrime d'entraînement, mais ne veulent rien savoir des vrais combats, où les grands maîtres luttent contre ça, ce ça qui nous terrifie tous, ce ça qui effraie et charge cornes baissées, et il y a du sang et des blessures mortelles et de la puanteur."
En tant que lectrice, j'apprécie ces expériences de lecture radicales, à la limite du supportable, car elles donnent du poids aux plus légères. La littérature, c'est aussi le spectacle de ce combat contre le Minotaure. Respect, donc, Grand Maître !
Mais il serait ennuyeux s'il se contentait d'être un écrivain mégalomane : lui, son truc, c'est de brouiller les pistes, avec malice. C'est aussi pour son art du passe-passe, du trompe l'oeil borgesien, qu'il faut lire son roman. Bolaño se fait un plaisir d'engouffrer dans sa moulinette magique tous les thèmes universels, comme la quête de la vérité, l'amour, le mal, pour les réduire à une illusion, dans un style de prestidigitation à la fois ludique et nihiliste. 2666, c'est un jeu de massacre dans un labyrinthe de miroirs.
Malgré tous ces écueils, malgré l'hétérogénéité des atmosphères et le disparate des tonalités, le plus réussi dans cette oeuvre est pour moi la fluidité avec laquelle elle avance, par nappes qui superposent les voix et les personnages. Des éléments sans ordre apparent sont juxtaposés, se chevauchant parfois, parfois non, tenus par des thématiques souterraines, des échos discrets auxquels le lecteur cherche à se raccrocher. J'aime cette fluidité aveugle qui nous mène d'une zone à l'autre, de la réalité au rêve, comme un flux, surtout sensible dans la dernière partie "La partie d'Arcimboldi", celle où un Allemand qui aime les algues plonge dans les rivières… Ces nappes nous disent que "2666" est un roman sur les apparences qu'il n'essaie pas de percer, qu'il ne fait que constater. L'amour est une apparence, comme la jeunesse, comme le national-socialisme... Dans ce cas, au lieu d'adopter la verticalité à laquelle nous sommes habitués dans un roman, force qui va vers le dévoilement progressif d'une vérité, ce roman adopte cette horizontalité de l'apparence, comme si nous ne cessions de glisser sur ce qui ne peut se nommer. Les cinq parties tournent comme une toupie plate autour d'un point aveugle, l'oeil du cyclone, qui pourrait être la ville de Santa Teresa vers laquelle tout converge, mais sur lequel aucun dévoilement ne donnera jamais de certitude.
Car Bolaño ne rassure pas, il inquiète : "Il ne s'agit pas de croire, il s'agit de comprendre, puis de changer". Peut-être est-ce pour cela que la lecture de ses oeuvres ne finit jamais en nous, et qu'elles continuent à nous poursuivre une fois refermées.
Pour lui, le livre ne se consomme pas, il ne divertit pas. Il se vit.
critiques presse (2)
Œuvre posthume et inachevée, parue en 2004, peu après la mort, à 50 ans, de l’écrivain chilien Roberto Bolaño, 2666 incarne surtout l’inachèvement érigé en ars poetica : à la fois roman de l’urgence de la quête finale et celui de l’in-fini promis à toute quête.
Lire la critique sur le site : LeMonde
Un roman labyrinthique et total, superbement écrit, que Bolaño a composé sur son lit de mort.
Lire la critique sur le site : Bibliobs
Citations et extraits (69)
Voir plus
Ajouter une citation
– En realidad no sé cómo explicarlo -dijo Amalfitano-. La relación con el poder de los intelectuales mexicanos viene de lejos No digo que todos sean así. Hay excepciones notables. Tampoco digo que los que se entregan lo hagan de mala fe. Ni siquiera que esa entrega sea una entrega en toda regla. Digamos que solo es un empleo. Pero es un empleo con el Estado. En Europa losintelectuales trabajan en editoriales o en la prensa o los mantienen susmujeres o sus padres tienen buena posición y les dan una mensualidad o son obreros y delincuentes y viven honestamente de sus trabajos. En México, y puede que el ejemplo sea extensible a toda Latinoamérica, salvo Argentina, losintelectuales trabajan para el Estado. Esto era así con el PRI y sigue siendo así con el PAN. El intelectual, por su parte, puede ser un fervoroso defensor del Estado o un crítico del Estado. Al Estado no le importa. El Estado lo alimenta y lo observa en silencio. Con su enorme cohorte de escritores más bien inútiles, el Estado hace algo. ¿Qué? Exorciza demonios, cambia o al menos intenta influir en el tiempo mexicano. Añade capas de cal a un hoyo que nadie sabe si existe o no existe. Por supuesto, esto no siempre es así. Un intelectual puede trabajar en la universidad o, mejor, irse a trabajar a una universidad norteamericana, cuyos departamentos de literatura son tan malos como los de las universidades mexicanas, pero esto no lo pone a salvo de recibir una llamada telefónica a altas horas de la noche y que alguien que habla en nombre del Estado le ofrezca un trabajo mejor, un empleo mejor remunerado, algo que el intelectual cree que se merece, y los intelectuales siempre creen que se merecen algo más. Esta mecánica, de alguna manera, desoreja a los escritores mexicanos. Los vuelve locos. Algunos, por ejemplo, se ponen a traducir poesía japonesa sin saber japonés y otros, ya de plano, se dedican a la bebida. Almendro, sin ir más lejos, creo que hace ambas cosas. La literatura en México es como un jardín de infancia, una guardería, un kindergarten, un parvulario, no sé si lo podéis entender. El clima es bueno, hace sol, puede salir de casa y sentarse en un parque y abrir un libro de Valéry, tal vez el escritor más leído por los escritores mexicanos, y luego acercarse a casa de los amigos y hablar. Tu sombra, sin embargo, ya no te sigue. En algún momento te ha abandonado silenciosamente. Tú haces como que no te das cuenta, pero sí que te has dado cuenta, tu jodida sombra ya no va contigo, pero, bueno, eso puede explicarse de muchas formas, la posición del sol, el grado de inconsciencia que el sol provoca en las cabezas sin sombrero, la cantidad de alcohol ingerida, el movimiento como de tanques subterráneos del dolor, el miedo a cosas más contingentes, una enfermedad que se insinúa, la vanidad herida, el deseo de ser puntual al menos una vez en la vida. Lo cierto es que tu sombra se pierde y tú, momentáneamente, la olvidas. Y así llegas, sin sombra, a una especie de escenario y te pones a traducir o a reinterpretar o a cantar la realidad. El escenario propiamente dicho es un proscenio y al fondo del proscenio hay un tubo enorme, algo así como una mina o la entrada a una mina de proporciones gigantescas. Digamos que es una caverna. Pero también podemos decir que es una mina. De la boca de la mina salen ruidos ininteligibles. Onomatopeyas, fonemas furibundos o seductores o seductoramente furibundos o bien puede que sólo murmullos y susurros y gemidos. Lo cierto es que nadie ve, lo que se dice ver, la entrada de la mina. Una máquina, un juego de luces y de sombras, una manipulación en el tiempo, hurta el verdadero contorno de la boca a la mirada de los espectadores. En realidad, sólo los espectadores que están más cercanos al proscenio, pegados al foso de la orquesta, pueden ver, tras la tupida red de camuflaje, el contorno de algo, no el verdadero contorno, pero sí, al menos, el contorno de algo. Los otros espectadores no ven nada más allá del proscenio y se podría decir que tampoco les interesa ver nada. Por su parte, los intelectuales sin sombra están siempre de espaldas y por lo tanto, a menos quetuvieran ojos en la nuca, les es imposible ver nada. Ellos sólo escuchan losruidos que salen del fondo de la mina. Y los traducen o reinterpretan o recrean. Su trabajo, cae por su peso decirlo, es pobrísimo. Emplean la retórica allí donde se intuye un huracán, tratan de ser elocuentes allí donde intuyen la furia desatada procuran ceñirse a la disciplina de la métrica allí donde sólo queda un silencio ensordecedor e inútil. Dicen pío pío, guau guau, miau miau, porque son incapaces de imaginar un animal de proporciones colosales o la ausencia de ese animal. El escenario en el que trabajan, por otra parte, es muy bonito, muy bien pensado, muy coqueto, pero sus dimensiones con el paso del tiempo son cada vez menores. Este achicamiento del escenario no lo desvirtúa en modo alguno. Simplemente cada vez es más chico y también las plateas son más chicas y los espectadores, naturalmente, son cada vez menos. Junto a este escenario, por supuesto, hay otros escenarios. Escenarios nuevos que han crecido con el paso del tiempo. Está el escenario de la pintura, que es enorme, y cuyos espectadores son pocos pero todos, por decirlo de algún modo, son elegantes. Está el escenario del cine y de la televisión. Aquí el aforo es enorme y siempre está lleno y el proscenio crece a buen ritmo año tras año. En ocasiones, los intérpretes del escenario de los intelectuales se pasan, como actores invitados, al escenario de la televisión. En este escenario la boca de la mina es la misma, con un ligerísimo cambio de perspectiva, aunque tal vez el camuflaje sea más denso y, paradójicamente, esté preñado de un humor misterioso y que sin embargo apesta. Este camuflaje humorístico, naturalmente, se presta a muchas interpretaciones, que finalmente siempre se reducen, para mayor facilidad del público o del ojo colectivo del público, a dos. En ocasiones los intelectuales se instalan para siempre en el proscenio televisivo. De la boca de la mina siguen saliendo rugidos y los intelectuales los sigue malinterpretando. En realidad, ellos, que en teoría son los amos del lenguaje, ni siquiera son capaces de enriquecerlo. Sus mejores palabras son palabras prestadas que oyen decir a los espectadores de primera fila. A estos espectadores se les suele llamarflagelantes. Están enfermos y cada cierto tiempo inventan abras atroces y su índice de mortalidad es elevado. Cuando a la jornada laboral se cierran los teatros y se tapan las bocas minas con grandes planchas de acero. Losintelectuales se retiran. La luna es gorda y el aire nocturno es de una purezatal que parece alimenticio. En algunos locales se oyen canciones cuyas notasllegan a las calles. A veces un intelectual desvía y penetra en uno de estoslocales y bebe mezcal. Piensa entonces qué sucedería si un día él. Pero no. Nopiensa nada Sólo bebe y canta. A veces alguno cree ver a un escritor alemánlegendario. En realidad sólo ha visto una sombra, en ocasiones sólo ha visto asu propia sombra que regresa a casa cada noche para evitar que el intelectual reviente o se cuelgue del portal. Pero él jura que ha visto a un escritor alemán y en esa convicción cifra su propia felicidad, su orden, su vértigo, su sentido de la parranda. A la mañana siguiente hace un buen día. El sol chisporrotea, pero no quema. Uno puede salir de casa razonablemente tranquilo, arrastrando su sombra, y detenerse en un parque y leer unas páginas de Valéry. Y así hasta el fin.
La première conversation téléphonique, celle que lança Pelletier, démarra laborieusement, même si Espinoza attendait cet appel, comme si tous deux avaient eu du mal à se dire ce que tôt ou tard ils devaient se dire. Les premières vingt minutes eurent un ton tragique, le terme de destin fut employé dix fois et celui d'amitié vingt-quatre fois. Le nom de Liz Norton fut prononcé cinquante-neuf fois, dont neuf fois pour rien. Le nom de Paris fut avancé en sept occasions. Madrid en huit. Le mot amour fut prononcé deux fois, une fois par chacun d'eux. Horreur fut prononcé en six occasions et bonheur une fois (c'est Espinoza qui l'employa). Résolution fut dit en douze occasions. Solipsisme, sept. Euphémisme, dix. Catégorie, au singulier et au pluriel, neuf. Structuralisme, une (par Pelletier). Les termes de littérature nord-américaine, trois. Les mots dîner, nous dînons, petit déjeuner et sandwich, dix-neuf. Yeux, mains et cheveux, quatorze. Puis la conversation devint plus fluide.
Tout avait commencé, supposait Rosa Amalfitano, car à ce moment là elle n'était pas dans le salon mais dans la cuisine à remplir quatre verres de jus de mangue, avec l'une des questions mal intentionnées que son père balançait d'habitude à ses invités, ses invités à elle, sans doute pas les siens, ou alors tout avait commencé par une déclaration de principe de la naïve Rosa Méndez, car sa voix, au cours des premiers instants, était celle qui semblait s'imposer dans le salon. Peut-être que Rosa Méndez avait parlé de sa passion pour le cinéma et qu'à ce moment là, Oscar Amalfitano lui avait demandé si elle savait ce qu'était le mouvement apparent. Mais la réponse, il ne pouvait en être autrement, ce n'était pas son amie qui l'avait donnée, mais Charly Cruz. Celui-ci lui avait dit que le mouvement apparent est l'illusion du mouvement provoquée par la persistance des images sur la rétine.
- Exactement, avait dit Oscar Amalfitano, les images persistent pendant une fraction de seconde sur la rétine.
Et alors son père, laissant de côté Rosa Méndez,(...) avait directement demandé à Charly Cruz s'il savait qui avait découvert ça, le truc de la persistance de l'image, et Charly Cruz dit qu'il ne se souvenait pas de son nom, mais qu'il était sûr que c'était un Français. À quoi son père lui avait répondu :
- Exact, un Français qui répondait au nom de professeur Plateau.
Lequel, une fois le principe découvert, s'était mis à faire des expériences de manière acharnée avec différents artefacts construits par lui-même, afin de créer des effets de mouvement grâce à la
succession d'images fixes passées à grande vitesse. C'est à ce moment-là qu'est né le zootrope.
- Vous savez ce que c'est ? avait dit Oscar Amalfitano.
- J'en ai eu quand j'étais petit, avait dit Charly Cruz. J'ai eu aussi un disque magique.
- Un disque magique, avait dit Oscar Amalfitano. Comme c'est intéressant. Vous vous en souvenez ? Vous pourriez me le décrire ?
- Je pourrais vous le faire tout de suite, avait dit Charly Cruz, j'ai juste besoin d'un bristol, de deux crayons de couleur et d'une ficelle, si je me souviens bien.
- Ah non, ah non, ah non, ce n'est pas nécessaire, avait dit Oscar Amalfitano. j'en aurai assez avec une bonne description. D'une certaine façon, nous avons des millions de disques magiques qui flottent ou qui tournoient dans le cerveau.
- Ah oui ? dit Charly Cruz...
- Bon, eh bien, c'était un poivrot en train de rire. Ça, c'était dessiné d'un côté du disque. Sur l'autre face, était dessinée une cellule, je veux dire les barreaux d'une cellule. Lorsque je faisais tourner le disque, le poivrot qui riait était dans la prison.
- Et il n'y a pas de quoi rire en prison, pas vrai, avait dit Oscar Amalfitano.
- Non, il n'y a pas de quoi rire, dit Charly Cruz.
- Pourtant le poivrot (au fait, pourquoi l'appelez-vous poivrot et pas ivrogne ? ) riait, peut-être parce que, lui, il ne savait pas qu'il était en prison.
Pendant quelques secondes, se souvenait Rosa, Charly Cruz avait regardé son père avec un autre regard, comme s'il cherchait à deviner où son hôte voulait l'entraîner...
- Le poivrot rit parce qu'il croit qu'il est libre, mais en réalité il est dans une prison, avait dit Oscar Amalfitano, c'est là que se trouve, disons, le truc amusant, mais ce qui est sûr c'est que la prison est dessinée de l'autre côté du disque, et donc nous pouvons aussi affirmer que le poivrot se moque de nous parce que nous croyons qu'il se trouve en prison, sans nous rendre compte que la prison se trouve d'un côté et le poivrot de l'autre, et on aura beau faire tourner le disque et avoir l'impression que le poivrot est en prison, la réalité c'est ça. De fait, nous pourrions même deviner de quoi rit le poivrot : il rit de notre crédulité, c'est à dire qu'il rit de nos yeux...
Tout avait commencé, supposait Rosa Amalfitano, car à ce moment là elle n'était pas dans le salon mais dans la cuisine à remplir quatre verres de jus de mangue, avec l'une des questions mal intentionnées que son père balançait d'habitude à ses invités, ses invités à elle, sans doute pas les siens, ou alors tout avait commencé par une déclaration de principe de la naïve Rosa Méndez, car sa voix, au cours des premiers instants, était celle qui semblait s'imposer dans le salon. Peut-être que Rosa Méndez avait parlé de sa passion pour le cinéma et qu'à ce moment là, Oscar Amalfitano lui avait demandé si elle savait ce qu'était le mouvement apparent. Mais la réponse, il ne pouvait en être autrement, ce n'était pas son amie qui l'avait donnée, mais Charly Cruz. Celui-ci lui avait dit que le mouvement apparent est l'illusion du mouvement provoquée par la persistance des images sur la rétine.
- Exactement, avait dit Oscar Amalfitano, les images persistent pendant une fraction de seconde sur la rétine.
Et alors son père, laissant de côté Rosa Méndez,(...) avait directement demandé à Charly Cruz s'il savait qui avait découvert ça, le truc de la persistance de l'image, et Charly Cruz dit qu'il ne se souvenait pas de son nom, mais qu'il était sûr que c'était un Français. À quoi son père lui avait répondu :
- Exact, un Français qui répondait au nom de professeur Plateau.
Lequel, une fois le principe découvert, s'était mis à faire des expériences de manière acharnée avec différents artefacts construits par lui-même, afin de créer des effets de mouvement grâce à la
succession d'images fixes passées à grande vitesse. C'est à ce moment-là qu'est né le zootrope.
- Vous savez ce que c'est ? avait dit Oscar Amalfitano.
- J'en ai eu quand j'étais petit, avait dit Charly Cruz. J'ai eu aussi un disque magique.
- Un disque magique, avait dit Oscar Amalfitano. Comme c'est intéressant. Vous vous en souvenez ? Vous pourriez me le décrire ?
- Je pourrais vous le faire tout de suite, avait dit Charly Cruz, j'ai juste besoin d'un bristol, de deux crayons de couleur et d'une ficelle, si je me souviens bien.
- Ah non, ah non, ah non, ce n'est pas nécessaire, avait dit Oscar Amalfitano. j'en aurai assez avec une bonne description. D'une certaine façon, nous avons des millions de disques magiques qui flottent ou qui tournoient dans le cerveau.
- Ah oui ? dit Charly Cruz...
- Bon, eh bien, c'était un poivrot en train de rire. Ça, c'était dessiné d'un côté du disque. Sur l'autre face, était dessinée une cellule, je veux dire les barreaux d'une cellule. Lorsque je faisais tourner le disque, le poivrot qui riait était dans la prison.
- Et il n'y a pas de quoi rire en prison, pas vrai, avait dit Oscar Amalfitano.
- Non, il n'y a pas de quoi rire, dit Charly Cruz.
- Pourtant le poivrot (au fait, pourquoi l'appelez-vous poivrot et pas ivrogne ? ) riait, peut-être parce que, lui, il ne savait pas qu'il était en prison.
Pendant quelques secondes, se souvenait Rosa, Charly Cruz avait regardé son père avec un autre regard, comme s'il cherchait à deviner où son hôte voulait l'entraîner...
- Le poivrot rit parce qu'il croit qu'il est libre, mais en réalité il est dans une prison, avait dit Oscar Amalfitano, c'est là que se trouve, disons, le truc amusant, mais ce qui est sûr c'est que la prison est dessinée de l'autre côté du disque, et donc nous pouvons aussi affirmer que le poivrot se moque de nous parce que nous croyons qu'il se trouve en prison, sans nous rendre compte que la prison se trouve d'un côté et le poivrot de l'autre, et on aura beau faire tourner le disque et avoir l'impression que le poivrot est en prison, la réalité c'est ça. De fait, nous pourrions même deviner de quoi rit le poivrot : il rit de notre crédulité, c'est à dire qu'il rit de nos yeux...
Qu’est-ce qui se passe ? On étouffe, merde. Vous, vous vous défoulez comme vous pouvez. Moi, je tabasse ou je me laisse tabasser. Mais ce ne sont pas n’importe quels tabassages, des cassages de gueule apocalyptiques. Je vais vous raconter un secret. Parfois je sors le soir, et je vais dans des bars que vous ne pouvez même pas imaginer. Là, je joue l’efféminé. (...) Un mignon efféminé prétentieux, avec du fric, qui regarde tout le monde de haut. Alors arrive ce qui doit arriver. Deux ou trois brutes m’invitent à aller dehors. Et le tabassage commence. Je le sais, et je m’en fous. Parfois ce sont eux qui s’en tirent mal, surtout quand j’y vais avec mon pistolet. D’autres fois, c’est moi. Je m’en fous. J’ai besoin de ces saloperies de sorties. (...) Nous, les Mexicains, nous sommes pourris, vous le saviez ? Tous. Ici, pas un pour sauver l’autre. Du président de la République jusqu’à ce clown de subcomandante Marcos. Si j’étais le subcomandante Marcos, vous savez ce que je ferais ? Je lancerais une attaque avec toute mon armée contre une ville quelconque du Chiapas, à condition qu’elle ait une bonne garnison militaire. Et là, j’immolerais mes pauvres Indiens. Et ensuite, probablement, je m’en irais vivre à Miami. (...) Quels livres lisez-vous d’habitude ? Avant, je lisais de tout, professeur, et en grande quantité, aujourd’hui je ne lis que de la poésie. La poésie seule n’est pas contaminée, la poésie seule n’est pas dans le coup. Je ne sais pas si vous me comprenez professeur. La poésie seule, et encore pas toute, que ce soit clair, est un aliment sain et pas une merde.
c’est en Allemagne que se trouvait sa maison d’édition ou plutôt l’idée qu’il avait de la maison d’édition, une maison allemande, des éditions dont le siège se trouvait à Hambourg et dont les réseaux, sous la forme de commandes de livres, s’étendaient dans les vieilles librairies de toute l’Allemagne, des librairies dont il connaissait personnellement certains des libraires, et avec qui, lorsqu’il faisait une tournée d’affaires, il prenait le thé ou le café, assis dans un coin de la librairie, se plaignant constamment des temps difficiles, pleurnichant à cause du mépris du public envers les livres, accablant de reproches les intermédiaires et les marchands de papier, se lamentant à propos du futur d’un pays qui ne lisait pas, en un mot, passant un super bon moment tout en grignotant des biscuits ou des morceaux de Kuchen, jusqu’à ce que, finalement, M. Bubis se remette debout, donne une bonne poignée de main au libraire d’Iserlohn, par exemple, après quoi il s’en allait à Bochum rendre visite au vieux libraire de la ville, qui conservait comme des reliques, des reliques en vente certes, des livres à l’enseigne de Bubis publiés en 1930 ou 1927 et que, d’après la loi, la loi de la Forêt-Noire, bien sûr, il aurait dû brûler au plus tard en 1935, mais que le vieux libraire avait préféré cacher, par pur amour, ce que Bubis comprenait (et pas grand monde d’autre, y compris l’auteur du livre, n’aurait pu le comprendre), une action pour laquelle il le remerciait par un geste qui était au-delà ou en deçà de la littérature, un geste, pour le qualifier ainsi, de commerçants honnêtes, de commerçants en possession d’un secret qui remontait peut-être aux origines de l’Europe, un geste qui était une mythologie, ou qui ouvrait la porte à une mythologie dont les deux piliers principaux étaient le libraire et l’éditeur, non pas l’écrivain, au chemin capricieux ou sujet à de fantomatiques impondérables, mais le libraire, l’éditeur et un long chemin zigzaguant dessiné par un peintre de l’école flamande. (p. 914)
Video de Roberto Bolaño (2)
Voir plusAjouter une vidéo
Roberto Bolano - Entre parenthèses .Ignacio Echevarria vous présente l'ouvrage de Roberto Bolano "Entre parenthèses" aux éditions Bourgois.http://www.mollat.com/livres/roberto-bolano-entre-parentheses-9782267021455.html
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Roberto Bolaño (26)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les classiques de la littérature sud-américaine
Quel est l'écrivain colombien associé au "réalisme magique"
Gabriel Garcia Marquez
Luis Sepulveda
Alvaro Mutis
Santiago Gamboa
10 questions
371 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature sud-américaine
, latino-américain
, amérique du sudCréer un quiz sur ce livre371 lecteurs ont répondu