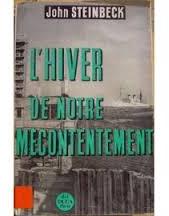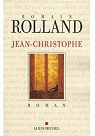Retrouvez les derniers épisodes de la cinquième saison de la P'tite Librairie sur la plateforme france.tv :
https://www.france.tv/france-5/la-p-tite-librairie/
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune des vidéos de la P'tite Librairie.
A l'heure où beaucoup redoutent une crise économique après la crise sanitaire, voici un grand roman dans lequel chacun puisera des conseils utiles. Il raconte la vie quotidienne des travailleurs pendant la Grande Dépression aux Etats-Unis et n'a hélas rien perdu de son actualité.
« Les raisins de la colère » de John Steinbeck, à lire en poche chez Folio.

John Steinbeck
EAN : SIE127349_634
Del Duca Biarritz, impr. C. Del Duca (30/11/-1)
/5
18 notes
Del Duca Biarritz, impr. C. Del Duca (30/11/-1)
Résumé :
Ce dernier roman de John Steinbeck, L'Hiver de notre déplaisir (The Winter of Our Discontent, 1961), parachève l'œuvre de son auteur, marquée par un fort engagement social et un questionnement en profondeur des fondements de nos sociétés occidentales actuelles.
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après L'Hiver de notre mécontentementVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (5)
Ajouter une critique
C'est drôle, j'ai le sentiment que je pourrais commencer toutes mes critiques des livres de John Steinbeck par exactement la même formule : « Et BING ! encore un chef-d'oeuvre signé Steinbeck ! » Bon, mais comme j'ai l'impression de l'avoir déjà utilisée un certain nombre de fois et que j'aurais peur de vous lasser par un trop grand manque de variété, je vais essayer d'innover un peu aujourd'hui.
J'ai beaucoup d'amies qui me disent avec un fond de dégoût dans la voix : « Ooohh ! les westerns !… Je déteste ça, c'est nul. C'est toujours pareil, ça ne m'intéresse pas. » Erreur, les filles, erreur ! Même si je reconnais qu'à 95 % vous avez probablement raison, j'ose prétendre qu'il existe un terrain cinématographique où vous auriez tort de ne pas poser votre petit mufle dédaigneux. Il y a les westerns et il y a les westerns de Sergio Leone, qui, selon mes critères, sont légèrement au-dessus des autres (d'environ quatorze têtes).
Et parmi ces westerns de Sergio Leone, il en est un qui est particulièrement intéressant, c'est Il Était Une Fois Dans L'Ouest. Je vous fais grâce de tous les passages musclés, musicaux ou balistiques, qui sont peut-être un peu appuyés à mon goût mais qui ravissent manifestement le public masculin. Non, ce qui me titille particulièrement dans ce film, ce sont les personnages de Morton (le patron des chemins de fer handicapé) joué par Gabriele Ferzetti et le tueur à gages Frank, campé à l'écran par Henry Fonda.
J'ai essayé en vain de retrouver la vieille interview de Sergio Leone, je crois que c'était un entretien avec Noël Simsolo, où il qualifiait son film par une formule de ce genre : « J'ai filmé le passage d'un monde d'hommes, viril et sauvage, à un monde sans couille, dominé par l'argent. » le personnage de Morton symbolisant la pourriture de ce type de personnes n'hésitant pas à corrompre ou à payer des gens pour faire ce dont ils sont eux-mêmes incapables.
Il me semble que Henry Fonda, s'adressant à Morton (je cite tout de mémoire donc les aficionados me pardonneront les inexactitudes) envoie une réplique du genre : « J'ai vu cette pourriture sèche vous bouffer un peu plus chaque jour. » Puis, vers la fin du film, Charles Bronson lance à Henry Fonda quelque chose comme : « En somme, tu t'es rendu compte que tu n'étais pas un homme d'affaires.
— Non, je ne serai jamais un homme d'affaires… un homme, tout simplement. (Henry Fonda)
— C'est une race très ancienne… Mais d'autres Norton viendront, qui essaieront de l'éteindre. (Charles Bronson) »
Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je suis en train de vous ennuyer avec cette histoire d'Il Était Une Fois Dans L'Ouest alors qu'il eût été si simple de vous parler de la véritable source d'inspiration du livre de John Steinbeck, à savoir, Richard III de Shakespeare ? N'ayez crainte, j'y viens, j'y viens, mais je vous ai promis de faire dans l'originalité aujourd'hui et vais tâcher de m'y tenir.
Le film de Sergio Leone dépeint très bien, je trouve le passage d'une époque à une autre, les cow-boys « old school » n'y auront bientôt plus leur place ni le droit de cité. La « civilisation » arrive, le « progrès » arrive, et donc, on ne peut plus se faire justice soi-même avec son six-coups. Vient le temps des réglementations, des chicanes administratives, des procès, des dommages et intérêts, etc., etc. Tout ce qui n'existait pas du temps du six-coups.
Alors de deux choses l'une : soit l'on s'adapte et l'on accepte docilement les nouvelles règles, soit l'on reste soi-même, c'est-à-dire, très vite un homme (ou une femme) du passé, amené à être marginalisé socialement, sans aucune chance aucune de retrouver jamais son statut d'autrefois. S'adapter ou mourir, quitte à y laisser son âme. Telle pourrait être la devise du film et c'est assurément l'un des propos du livre.
John Steinbeck, encore une fois, nous sert un roman plein d'intelligence et d'humour, riche, profond, fin, subtil, complexe et qui suscite la réflexion bien au-delà du domaine qu'il explore. J'ai lu deux ou trois sombres abrutis qui pour présenter cet ouvrage parlent d'un auteur « en déclin ». Franchement dit, j'aimerais bien décliner comme ça et j'imagine que bon nombre de nos petits auteurs de pacotille aimeraient bien s'approcher dans leurs grands moments du déclin d'un Steinbeck. Surtout, surtout, mesdames et messieurs de chez Gallimard & consorts, ne changez rien, mettez-moi du D'Ormesson en pléiade et en tête de gondole et parallèlement, laissez moisir cet auteur en déclin qu'est Steinbeck. Bande de nazes ! J'aime autant changer de sujet parce que j'en deviendrais vite ordurière…
Mais encore avant de vous parler réellement du fond de l'oeuvre, permettez-moi encore une toute petite digression qui fait le lien entre ces merveilleux éditeurs et le Richard III de tout à l'heure. le titre original de ce roman, The Winter Of Our Discontent, est issu de l'incipit de la pièce de Shakespeare, dans la bouche de Gloucester, futur roi Richard :
« Now is the winter of our discontent
Made glorious summer by this sun of York;
And all the clouds that lour'd upon our house
In the deep bosom of the ocean buried. »
Steinbeck est coutumier du fait ; il aime bien puiser ses titres d'autres oeuvres en rapport avec son travail. Il avait choisi pour titre Les Raisins de la Colère (The Grapes Of Wrath) issu de l'Hymne de Bataille de la République, texte engagé écrit par Julia Ward Howe ; il avait choisi En Un Combat Douteux du poème de John Milton, le Paradis Perdu ; il avait choisi À L'Est D'Éden de la Bible, et le voici donc venu piocher chez Shakespeare, comme Faulkner (Le Bruit Et La Fureur) ou Huxley (Le Meilleur Des Mondes) avant lui, pour ne citer que ces deux-là.
Voilà pourquoi j'aimerais dire deux mots de la traduction. En ce qui me concerne, j'ai lu la traduction de Jean Rosenthal de 1970. Il en existe une plus récente, de 1995 d'Anouk Neuhoff qui ne m'a absolument pas plu. La traduction du titre est à l'image du reste : elle a complètement perdu l'esprit (Une Saison Amère). Cette traduction publiée chez le livre de poche est probablement plus moderne, plus actuelle, mais… je n'y reconnais pas l'écriture de Steinbeck, alors que je la reconnais fort bien chez Jean Rosenthal. Donc, si vous avez la possibilité, vous savez ce qui vous reste à faire…
Cette première tirade de Richard III colle à merveille au propos que souhaite véhiculer l'auteur. Voilà un homme, John Steinbeck, qui est né, qui a grandi et vécu une bonne partie de sa vie en Californie du début du XXe jusqu'après la seconde guerre mondiale. La tragédie, pour lui, c'est qu'entre temps, son pays est devenu la première puissance mondiale, sa population a explosé et son mode de vie s'est métamorphosé du tout au tout. La Californie agricole de son enfance n'est plus qu'un très lointain souvenir ; désormais, c'est le temple du high tech, du business et de la superficialité.
Il ne s'y reconnaît probablement plus beaucoup au début des années 1960 (voir à ce propos des mutations survenues en Californie durant l'entre-deux-guerres le roman graphique d'Emmanuel Guibert, L'Enfance D'Alan) de sorte qu'il finit même par s'installer sur la côte Est, celle des origines de son pays.
Il ne faut donc probablement pas s'étonner si l'auteur choisit pour établissement de son dernier grand roman une ville imaginaire, New Baytown, mais qu'il est aisé de situer sur Long Island, en tant qu'ancienne ville baleinière, une ville de pionniers totalement dépassée par le mouvement des années 1960. Au passage, l'auteur fait très certainement un clin d'oeil à Moby Dick, un type d'ouvrage qui lui aussi appartient au passé, du temps des glorieux pionniers de l'Amérique.
Le narrateur et personnage principal, Ethan Hawley, est issu d'une des anciennes grandes familles de la ville. Son père a perdu toute la fortune de la famille ; ne subsiste que le nom (mais ce qui est déjà mieux que rien). Ce faisant, Ethan est désormais garçon d'épicerie au service d'un émigré italien de première génération, ce qui est une sorte de relégation sociale indéniable.
Ethan s'en accommoderait assez bien s'il ne tenait qu'à lui. C'est un employé modèle, honnête et travailleur, qui fait l'ébahissement de son patron italien qui se demande toujours, avec son regard suspicieux qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière une telle incompréhensible honnêteté.
Ethan, homme de la quarantaine, est marié avec une femme qu'il aime et qui le lui rend bien. Ils ont deux grands enfants de l'âge de l'adolescence. Malgré tous les sentiments qui unissent Ethan à sa famille, il sent bien dans leur regard qu'un peu d'argent supplémentaire et une situation professionnelle et sociale supérieure leur conviendrait mieux et le grandiraient à leurs yeux.
Le problème d'Ethan, c'est qu'il est à la fois intelligent, lucide et moral. le sang Hawley qui coule dans ses veines vient souvent lui rappeler qu'il est issu de fiers marins besogneux : des gens francs avec des valeurs. Derrière son comptoir, Ethan observe tout, comprend tout, et comprend surtout qu'il n'a pas l'âme d'un homme d'affaire.
Les compromissions, les entourloupes, les coups bas pour arriver à tirer son épingle du jeu le révulsent. Pourtant, il voit tout, il sent tout, il est capable comme Gloucester de devenir Richard III, mais que va-t-il devoir abandonner ou trahir pour se hisser sur le trône qui lui ouvre les bras ?
John Steinbeck nous offre en guise de testament littéraire une sensationnelle réflexion sur la réussite, économique et sociale, sur la notoriété, sur la possession et l'argent. Pour lui, comme pour Georges Brassens, les trompettes de la renommée sont vraiment très mal embouchées. Pourtant, c'est le visage de son Amérique : la réussite à tout prix, quel qu'en soit le prix ; quitte à tricher, quitte à tuer discrètement, quitte à écraser autrui, quitte à voler mais en conservant toujours la face en se réfugiant derrière un joli tampon officiel de légalité.
Voici l'argent, voici le trésor, voici la récompense, elle ne vous appartient pas mais vous pourriez aisément mettre la main dessus discrètement en toute dignité. Pour cela, il suffit juste d'aider un mourant à rejoindre rapidement sa tombe, ou de passer un petit coup de fil aux services de répression pour attirer l'attention sur les affaires d'untel ou d'untel. Que dit votre âme ?
L'auteur, avec son sens de l'humour et de la facétie, utilise la parabole, et même la parabole dans la parabole, au travers d'un jeu-concours comme seule l'Amérique des années 1960 peut en organiser : faire un texte sur « Combien j'aime l'Amérique », une compétition à laquelle les deux enfants d'Ethan vont participer et dont les résultats sont très certainement à l'image de ce que l'auteur pense de son pays, du moins de ce qu'il est devenu.
Je termine la boucle avec le cinéma, car l'on connaît les liens qui unissent John Steinbeck avec l'immense réalisateur John Ford. Ce dernier a dit dans le livre de Peter Bogdanovich qui lui est consacré : « Si nos ancêtres pouvaient nous voir, ils seraient salement honteux. » Voilà, c'est sans doute à peu près le message que nous délivre L'Hiver de Notre Déplaisir, un livre à ne pas rater (mais à ne pas lire dans sa traduction bidon Une Saison Amère), assurément l'un de mes coups de coeur de l'année.
Bien entendu, tout ceci n'est que mon avis, en espérant qu'il ne fera pas votre déplaisir en cette saison d'hiver, car, somme toute, il ne représente pas grand-chose.
J'ai beaucoup d'amies qui me disent avec un fond de dégoût dans la voix : « Ooohh ! les westerns !… Je déteste ça, c'est nul. C'est toujours pareil, ça ne m'intéresse pas. » Erreur, les filles, erreur ! Même si je reconnais qu'à 95 % vous avez probablement raison, j'ose prétendre qu'il existe un terrain cinématographique où vous auriez tort de ne pas poser votre petit mufle dédaigneux. Il y a les westerns et il y a les westerns de Sergio Leone, qui, selon mes critères, sont légèrement au-dessus des autres (d'environ quatorze têtes).
Et parmi ces westerns de Sergio Leone, il en est un qui est particulièrement intéressant, c'est Il Était Une Fois Dans L'Ouest. Je vous fais grâce de tous les passages musclés, musicaux ou balistiques, qui sont peut-être un peu appuyés à mon goût mais qui ravissent manifestement le public masculin. Non, ce qui me titille particulièrement dans ce film, ce sont les personnages de Morton (le patron des chemins de fer handicapé) joué par Gabriele Ferzetti et le tueur à gages Frank, campé à l'écran par Henry Fonda.
J'ai essayé en vain de retrouver la vieille interview de Sergio Leone, je crois que c'était un entretien avec Noël Simsolo, où il qualifiait son film par une formule de ce genre : « J'ai filmé le passage d'un monde d'hommes, viril et sauvage, à un monde sans couille, dominé par l'argent. » le personnage de Morton symbolisant la pourriture de ce type de personnes n'hésitant pas à corrompre ou à payer des gens pour faire ce dont ils sont eux-mêmes incapables.
Il me semble que Henry Fonda, s'adressant à Morton (je cite tout de mémoire donc les aficionados me pardonneront les inexactitudes) envoie une réplique du genre : « J'ai vu cette pourriture sèche vous bouffer un peu plus chaque jour. » Puis, vers la fin du film, Charles Bronson lance à Henry Fonda quelque chose comme : « En somme, tu t'es rendu compte que tu n'étais pas un homme d'affaires.
— Non, je ne serai jamais un homme d'affaires… un homme, tout simplement. (Henry Fonda)
— C'est une race très ancienne… Mais d'autres Norton viendront, qui essaieront de l'éteindre. (Charles Bronson) »
Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je suis en train de vous ennuyer avec cette histoire d'Il Était Une Fois Dans L'Ouest alors qu'il eût été si simple de vous parler de la véritable source d'inspiration du livre de John Steinbeck, à savoir, Richard III de Shakespeare ? N'ayez crainte, j'y viens, j'y viens, mais je vous ai promis de faire dans l'originalité aujourd'hui et vais tâcher de m'y tenir.
Le film de Sergio Leone dépeint très bien, je trouve le passage d'une époque à une autre, les cow-boys « old school » n'y auront bientôt plus leur place ni le droit de cité. La « civilisation » arrive, le « progrès » arrive, et donc, on ne peut plus se faire justice soi-même avec son six-coups. Vient le temps des réglementations, des chicanes administratives, des procès, des dommages et intérêts, etc., etc. Tout ce qui n'existait pas du temps du six-coups.
Alors de deux choses l'une : soit l'on s'adapte et l'on accepte docilement les nouvelles règles, soit l'on reste soi-même, c'est-à-dire, très vite un homme (ou une femme) du passé, amené à être marginalisé socialement, sans aucune chance aucune de retrouver jamais son statut d'autrefois. S'adapter ou mourir, quitte à y laisser son âme. Telle pourrait être la devise du film et c'est assurément l'un des propos du livre.
John Steinbeck, encore une fois, nous sert un roman plein d'intelligence et d'humour, riche, profond, fin, subtil, complexe et qui suscite la réflexion bien au-delà du domaine qu'il explore. J'ai lu deux ou trois sombres abrutis qui pour présenter cet ouvrage parlent d'un auteur « en déclin ». Franchement dit, j'aimerais bien décliner comme ça et j'imagine que bon nombre de nos petits auteurs de pacotille aimeraient bien s'approcher dans leurs grands moments du déclin d'un Steinbeck. Surtout, surtout, mesdames et messieurs de chez Gallimard & consorts, ne changez rien, mettez-moi du D'Ormesson en pléiade et en tête de gondole et parallèlement, laissez moisir cet auteur en déclin qu'est Steinbeck. Bande de nazes ! J'aime autant changer de sujet parce que j'en deviendrais vite ordurière…
Mais encore avant de vous parler réellement du fond de l'oeuvre, permettez-moi encore une toute petite digression qui fait le lien entre ces merveilleux éditeurs et le Richard III de tout à l'heure. le titre original de ce roman, The Winter Of Our Discontent, est issu de l'incipit de la pièce de Shakespeare, dans la bouche de Gloucester, futur roi Richard :
« Now is the winter of our discontent
Made glorious summer by this sun of York;
And all the clouds that lour'd upon our house
In the deep bosom of the ocean buried. »
Steinbeck est coutumier du fait ; il aime bien puiser ses titres d'autres oeuvres en rapport avec son travail. Il avait choisi pour titre Les Raisins de la Colère (The Grapes Of Wrath) issu de l'Hymne de Bataille de la République, texte engagé écrit par Julia Ward Howe ; il avait choisi En Un Combat Douteux du poème de John Milton, le Paradis Perdu ; il avait choisi À L'Est D'Éden de la Bible, et le voici donc venu piocher chez Shakespeare, comme Faulkner (Le Bruit Et La Fureur) ou Huxley (Le Meilleur Des Mondes) avant lui, pour ne citer que ces deux-là.
Voilà pourquoi j'aimerais dire deux mots de la traduction. En ce qui me concerne, j'ai lu la traduction de Jean Rosenthal de 1970. Il en existe une plus récente, de 1995 d'Anouk Neuhoff qui ne m'a absolument pas plu. La traduction du titre est à l'image du reste : elle a complètement perdu l'esprit (Une Saison Amère). Cette traduction publiée chez le livre de poche est probablement plus moderne, plus actuelle, mais… je n'y reconnais pas l'écriture de Steinbeck, alors que je la reconnais fort bien chez Jean Rosenthal. Donc, si vous avez la possibilité, vous savez ce qui vous reste à faire…
Cette première tirade de Richard III colle à merveille au propos que souhaite véhiculer l'auteur. Voilà un homme, John Steinbeck, qui est né, qui a grandi et vécu une bonne partie de sa vie en Californie du début du XXe jusqu'après la seconde guerre mondiale. La tragédie, pour lui, c'est qu'entre temps, son pays est devenu la première puissance mondiale, sa population a explosé et son mode de vie s'est métamorphosé du tout au tout. La Californie agricole de son enfance n'est plus qu'un très lointain souvenir ; désormais, c'est le temple du high tech, du business et de la superficialité.
Il ne s'y reconnaît probablement plus beaucoup au début des années 1960 (voir à ce propos des mutations survenues en Californie durant l'entre-deux-guerres le roman graphique d'Emmanuel Guibert, L'Enfance D'Alan) de sorte qu'il finit même par s'installer sur la côte Est, celle des origines de son pays.
Il ne faut donc probablement pas s'étonner si l'auteur choisit pour établissement de son dernier grand roman une ville imaginaire, New Baytown, mais qu'il est aisé de situer sur Long Island, en tant qu'ancienne ville baleinière, une ville de pionniers totalement dépassée par le mouvement des années 1960. Au passage, l'auteur fait très certainement un clin d'oeil à Moby Dick, un type d'ouvrage qui lui aussi appartient au passé, du temps des glorieux pionniers de l'Amérique.
Le narrateur et personnage principal, Ethan Hawley, est issu d'une des anciennes grandes familles de la ville. Son père a perdu toute la fortune de la famille ; ne subsiste que le nom (mais ce qui est déjà mieux que rien). Ce faisant, Ethan est désormais garçon d'épicerie au service d'un émigré italien de première génération, ce qui est une sorte de relégation sociale indéniable.
Ethan s'en accommoderait assez bien s'il ne tenait qu'à lui. C'est un employé modèle, honnête et travailleur, qui fait l'ébahissement de son patron italien qui se demande toujours, avec son regard suspicieux qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière une telle incompréhensible honnêteté.
Ethan, homme de la quarantaine, est marié avec une femme qu'il aime et qui le lui rend bien. Ils ont deux grands enfants de l'âge de l'adolescence. Malgré tous les sentiments qui unissent Ethan à sa famille, il sent bien dans leur regard qu'un peu d'argent supplémentaire et une situation professionnelle et sociale supérieure leur conviendrait mieux et le grandiraient à leurs yeux.
Le problème d'Ethan, c'est qu'il est à la fois intelligent, lucide et moral. le sang Hawley qui coule dans ses veines vient souvent lui rappeler qu'il est issu de fiers marins besogneux : des gens francs avec des valeurs. Derrière son comptoir, Ethan observe tout, comprend tout, et comprend surtout qu'il n'a pas l'âme d'un homme d'affaire.
Les compromissions, les entourloupes, les coups bas pour arriver à tirer son épingle du jeu le révulsent. Pourtant, il voit tout, il sent tout, il est capable comme Gloucester de devenir Richard III, mais que va-t-il devoir abandonner ou trahir pour se hisser sur le trône qui lui ouvre les bras ?
John Steinbeck nous offre en guise de testament littéraire une sensationnelle réflexion sur la réussite, économique et sociale, sur la notoriété, sur la possession et l'argent. Pour lui, comme pour Georges Brassens, les trompettes de la renommée sont vraiment très mal embouchées. Pourtant, c'est le visage de son Amérique : la réussite à tout prix, quel qu'en soit le prix ; quitte à tricher, quitte à tuer discrètement, quitte à écraser autrui, quitte à voler mais en conservant toujours la face en se réfugiant derrière un joli tampon officiel de légalité.
Voici l'argent, voici le trésor, voici la récompense, elle ne vous appartient pas mais vous pourriez aisément mettre la main dessus discrètement en toute dignité. Pour cela, il suffit juste d'aider un mourant à rejoindre rapidement sa tombe, ou de passer un petit coup de fil aux services de répression pour attirer l'attention sur les affaires d'untel ou d'untel. Que dit votre âme ?
L'auteur, avec son sens de l'humour et de la facétie, utilise la parabole, et même la parabole dans la parabole, au travers d'un jeu-concours comme seule l'Amérique des années 1960 peut en organiser : faire un texte sur « Combien j'aime l'Amérique », une compétition à laquelle les deux enfants d'Ethan vont participer et dont les résultats sont très certainement à l'image de ce que l'auteur pense de son pays, du moins de ce qu'il est devenu.
Je termine la boucle avec le cinéma, car l'on connaît les liens qui unissent John Steinbeck avec l'immense réalisateur John Ford. Ce dernier a dit dans le livre de Peter Bogdanovich qui lui est consacré : « Si nos ancêtres pouvaient nous voir, ils seraient salement honteux. » Voilà, c'est sans doute à peu près le message que nous délivre L'Hiver de Notre Déplaisir, un livre à ne pas rater (mais à ne pas lire dans sa traduction bidon Une Saison Amère), assurément l'un de mes coups de coeur de l'année.
Bien entendu, tout ceci n'est que mon avis, en espérant qu'il ne fera pas votre déplaisir en cette saison d'hiver, car, somme toute, il ne représente pas grand-chose.
Une merveille de Steinbeck, encore une! et pas des moindres.
J'adore les romans qui chroniquent sur un mode doux amer le passage d'un monde à un autre, vu du point de vue de celui que l'extinction inexorable du premier inquiète, ignore, enthousiasme ou désole.
C'est bien ce qui arrive à Ethan, "a brave man" s'il en est, un de ces personnages comme seul Steinbeck sait les brosser et que l'on aime spontanément, mari et père aimant, honnête, intègre et surtout, malheureusement pour lui, lucide.
Simple commis de magasin depuis la faillite frauduleusement imposée à son père, riche de son ADN familial fait de pirates au coeur noble, Ethan se contenterait bien de sa vie simple s'il ne constatait, en observant la banque sur le trottoir en face du magasin, dans les petites et grandes magouilles de ses clients et jusqu'au sein de sa propre famille qui lui réclame la richesse, la déferlante irrépressible des valeurs du matérialisme et de l'argent venir supplanter son monde. Alors, après mûre réflexion, il joue. Qu'il perde ou qu'il gagne, vous vous doutez bien qu'un auteur aussi subtil que Steinbeck ne tranchera pas aussi simplement.
L'évocation de la petite ville fictive de New Baytown au début des années soixante est un bonheur, les échanges énamourés et bourrés d'humour entre Ethan et sa douce sont un délice, en même temps que les réflexions d'Ethan sur les invariants et les travers de la nature humaine dans ce monde qui s'en va et celui qui s'en vient sont d'une intemporalité et d'une pertinence qui vous retourne le coeur.
J'ai adoré ce roman d'une Amérique disparue, déroulé au rythme de la vie d'avant, jusqu'à sa fin solaire comme Martin Eden.
J'adore les romans qui chroniquent sur un mode doux amer le passage d'un monde à un autre, vu du point de vue de celui que l'extinction inexorable du premier inquiète, ignore, enthousiasme ou désole.
C'est bien ce qui arrive à Ethan, "a brave man" s'il en est, un de ces personnages comme seul Steinbeck sait les brosser et que l'on aime spontanément, mari et père aimant, honnête, intègre et surtout, malheureusement pour lui, lucide.
Simple commis de magasin depuis la faillite frauduleusement imposée à son père, riche de son ADN familial fait de pirates au coeur noble, Ethan se contenterait bien de sa vie simple s'il ne constatait, en observant la banque sur le trottoir en face du magasin, dans les petites et grandes magouilles de ses clients et jusqu'au sein de sa propre famille qui lui réclame la richesse, la déferlante irrépressible des valeurs du matérialisme et de l'argent venir supplanter son monde. Alors, après mûre réflexion, il joue. Qu'il perde ou qu'il gagne, vous vous doutez bien qu'un auteur aussi subtil que Steinbeck ne tranchera pas aussi simplement.
L'évocation de la petite ville fictive de New Baytown au début des années soixante est un bonheur, les échanges énamourés et bourrés d'humour entre Ethan et sa douce sont un délice, en même temps que les réflexions d'Ethan sur les invariants et les travers de la nature humaine dans ce monde qui s'en va et celui qui s'en vient sont d'une intemporalité et d'une pertinence qui vous retourne le coeur.
J'ai adoré ce roman d'une Amérique disparue, déroulé au rythme de la vie d'avant, jusqu'à sa fin solaire comme Martin Eden.
J'ai lu "L'hiver de notre mécontentement" dans la traduction originale de Monique Thiès, datant de 1961. Et je l'ai trouvée laborieuse. du coup, j'ai loupé ce roman. Je suis passé à côté des enjeux. Je n'ai pas compris les tournants de l'histoire et, quand j'ai lu le résumé, c'était comme si j'avais lu un autre bouquin. Dommage car je pense que c'est un grand roman de Steinbeck, qui dépeint très bien les travers de l'argent et de l'avidité. L'argent, en gros, corrompt tout. Avec lui, plus de scrupules, plus d'amitié : son prisme modifie le mode de vie de tout un chacun. On oublie son honnêteté. On oublie les autres. On s'oublie et on sombre. Ethan, le petit épicier qui a tout perdu, cède aux sirènes de la tentation de se refaire, mû par l'esprit de vengeance qui est le plus fort. Il est guidé, certes, mais il ne résiste pas. Il trahit ses idéaux au nom de l'argent. Un roman sombre donc, comme la vie.
Ethan faisait partie d'une famille riche de Long Island mais il en est réduit à travailler comme commis dans une épicerie qui appartenait à son père. Ethan est homme droit doté d'une grande force morale, il ne se plaint jamais de son statut et se contente de travailler au mieux pour faire vivre femme et enfants, et justement ce sont eux qui sont plutôt en manque et réclament toujours plus. Ethan résistera t il aux tentations, tel est le dilemme que Steinbeck va étudier dans ce roman, la moralité d'Etan résistera t elle à la pression.d'une famille qu'il adore?
bon livre
Citations et extraits (58)
Voir plus
Ajouter une citation
Dans sa petite maison immaculée bâtie au milieu d'un grand jardin envahi de végétation tout près du Vieux Port, elle se penchait vers son miroir pour inspecter son matériel de maquillage, et à travers la crème, la poudre, le mascara et les cils gainés de noir, ses yeux voyaient les rides cachées, le manque d'élasticité de la peau. Elle sentait les années monter comme la marée autour d'un rocher sur une mer calme. Il existe un arsenal de la maturité, de l'âge mûr, mais cela exige un entraînement, une technique qu'elle ne possédait pas encore. Elle devait les apprendre avant de voir écrouler la structure de sa jeunesse qui la laisserait nue, pourrie, ridicule. Son succès était dû au fait qu'elle ne mettait jamais bas les armes, même quand elle était seule. Et là, à titre d'expérience, elle laissa sa bouche s'affaisser comme elle en avait envie, ses paupières se mettre en berne. Elle baissa le menton qu'elle tenait si haut, et un tendon un peu noueux apparut devant elle, dans le miroir, elle vit vingt années fondre sur elle et elle frissonna tandis que le murmure glacé lui disait ce qui l'attendait. Elle avait reculé trop longtemps ce moment. Une femme doit avoir une vitrine où vieillir, avec des éclairages, des accessoires, du velours noir, des enfants, de l'amour, de la protection, un mari serein et peu exigeant, ou bien son testament et son héritage encore plus sereins et encore moins exigeants. Une femme qui vieillit seule est un déchet inutile, une horreur fripée sans serviteurs boitillants pour hocher la tête et marmonner sur ses douleurs et le frictionner.
Deuxième partie, Chapitre II.
Deuxième partie, Chapitre II.
Quand Ethan revint au magasin, il trouva Marullo qui examinait le contenu d'une poubelle.
— Où voulez-vous que nous bavardions, M. Marullo ?
— On va commencer ici, petit. (Il prit dans la poubelle des feuilles de chou-fleur.) Tu en coupes trop.
— C'est pour que ça soit mieux présenté.
— Le chou-fleur se vend au poids. Tu jettes de l'argent à la poubelle. Je connais un Grec astucieux qui possède peut-être vingt restaurants. Il dit que le grand secret c'est de surveiller les poubelles. Ce que tu jettes, tu ne le vends pas. C'est un malin.
— Oui, M. Marullo.
Ethan se dirigeait nerveusement vers le devant du magasin, suivi de Marullo, qui pliait et dépliait ses coudes.
— Tu arroses bien les légumes comme je t'ai dit ?
— Bien sûr.
Le patron souleva une tête de laitue.
— Ça m'a l'air sec.
— Enfin, bon sang, Marullo, je ne veux pas qu'elles soient saturées… Il y a là un tiers d'eau.
— Ça leur donne un air appétissant, joli et frais. Tu crois que je ne sais pas ? Moi, j'ai démarré avec une voiture à bras… Une seule. Je sais. Il faut apprendre les trucs du métier, petit, sinon on se retrouve fauché. Tiens, la viande… Tu la paies trop cher.
— Oh ! nous annonçons du bœuf de première qualité.
— Première, deuxième, troisième… Qui le sait ? C'est le carton, non ? Écoute, on va avoir une bonne conversation. Il y a du bois mort parmi la clientèle. Tous ceux qui ne paient pas le 15… Plus de crédit.
— On ne peut pas faire ça. Certains de ces gens achètent ici depuis vingt ans.
— Écoute, petit. Les magasins à succursales multiples ne font pas crédit d'un centime à John D. Rockefeller.
— Oui, mais on peut leur faire confiance, à ces gens, la plupart.
— Ça rime à quoi, la confiance ? Ça immobilise de l'argent. Les magasins à succursales multiples achètent par camions. On ne peut pas faire ça. Il faut apprendre, petit. Bien sûr, ce sont des gens bien ! L'argent c'est bien aussi. Tu as trop de déchets de viande dans la boîte à ordures.
— C'est de la graisse et de la peau.
— Ça va si tu pèse avant de préparer ta viande. Il faut appliquer le principe N°1. SI tu ne l'appliques pas, qu'est-ce qui le fera pour toi ? Il faut apprendre, petit.
Première partie, Chapitre I.
— Où voulez-vous que nous bavardions, M. Marullo ?
— On va commencer ici, petit. (Il prit dans la poubelle des feuilles de chou-fleur.) Tu en coupes trop.
— C'est pour que ça soit mieux présenté.
— Le chou-fleur se vend au poids. Tu jettes de l'argent à la poubelle. Je connais un Grec astucieux qui possède peut-être vingt restaurants. Il dit que le grand secret c'est de surveiller les poubelles. Ce que tu jettes, tu ne le vends pas. C'est un malin.
— Oui, M. Marullo.
Ethan se dirigeait nerveusement vers le devant du magasin, suivi de Marullo, qui pliait et dépliait ses coudes.
— Tu arroses bien les légumes comme je t'ai dit ?
— Bien sûr.
Le patron souleva une tête de laitue.
— Ça m'a l'air sec.
— Enfin, bon sang, Marullo, je ne veux pas qu'elles soient saturées… Il y a là un tiers d'eau.
— Ça leur donne un air appétissant, joli et frais. Tu crois que je ne sais pas ? Moi, j'ai démarré avec une voiture à bras… Une seule. Je sais. Il faut apprendre les trucs du métier, petit, sinon on se retrouve fauché. Tiens, la viande… Tu la paies trop cher.
— Oh ! nous annonçons du bœuf de première qualité.
— Première, deuxième, troisième… Qui le sait ? C'est le carton, non ? Écoute, on va avoir une bonne conversation. Il y a du bois mort parmi la clientèle. Tous ceux qui ne paient pas le 15… Plus de crédit.
— On ne peut pas faire ça. Certains de ces gens achètent ici depuis vingt ans.
— Écoute, petit. Les magasins à succursales multiples ne font pas crédit d'un centime à John D. Rockefeller.
— Oui, mais on peut leur faire confiance, à ces gens, la plupart.
— Ça rime à quoi, la confiance ? Ça immobilise de l'argent. Les magasins à succursales multiples achètent par camions. On ne peut pas faire ça. Il faut apprendre, petit. Bien sûr, ce sont des gens bien ! L'argent c'est bien aussi. Tu as trop de déchets de viande dans la boîte à ordures.
— C'est de la graisse et de la peau.
— Ça va si tu pèse avant de préparer ta viande. Il faut appliquer le principe N°1. SI tu ne l'appliques pas, qu'est-ce qui le fera pour toi ? Il faut apprendre, petit.
Première partie, Chapitre I.
Joey avait l'air d'un cheval, et il avait un sourire de cheval, retroussant une longue lèvre supérieure pour découvrir de grandes dents carrées. Joseph Patrick Morphy, Joey Morphy, ce vieux Joey — " le petit Morph " — un garçon vraiment très populaire il y a encore quelques années à New Baytown. Un plaisantin qui débitait ses gags l'œil voilé comme un joueur de poker, mais il hennissait quand les autres faisaient des plaisanteries, qu'il les eût entendues ou pas. Un malin, le gars Morph, il avait des tuyaux sur tout — et sur tout le monde de la Mafia à Mountbatten — mais il les confiait en haussant un peu la voix, presque comme s'il posait une question. Cela leur ôtait tout caractère de fanfaronnade, cela faisait de son auditeur un complice qui pouvait ensuite les répéter comme des renseignements de première main. Joey était un type fascinant, un joueur, mais personne ne le voyait jamais parier, un bon comptable et un merveilleux caissier. Mr Baker, le président de la First National, se fiait si complètement à Joey qu'il laissait le caissier faire le plus clair du travail. Le gars Morph connaissait tout le monde mais n'appelait personne par son prénom. Ethan était Mr Hawley. Margie Young-Hunt était pour Joey Mrs Young-Hunt, bien qu'on chuchotât qu'il la sautait. Il n'avait pas de famille, pas de relations, il vivait seul dans un deux pièces-salle de bains de la vieille maison Phillips, et prenait la plupart de ses repas au Bar du Premier-Maître. Son passé dans la banque était connu de Mr Baker et de la société financière, et c'était un passé sans tache, mais ce vieux Joey avait une façon de raconter les histoires qui étaient arrivées à quelqu'un d'autre d'une façon qui vous faisait soupçonner qu'elles étaient arrivées à Joey, et, si c'était vrai, on pouvait vraiment dire qu'il avait roulé sa bosse. Le fait qu'il ne s'en vantât pas le rendait encore plus sympathique. Il avait les ongles très soignés, s'habillait avec une élégance discrète, il avait toujours une chemise propre et des chaussures bien cirées.
Première partie, Chapitre I.
Première partie, Chapitre I.
— Ça peut arriver à n'importe qui d'être fauché. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous l'êtes resté, un homme qui a la famille, les antécédents que vous avez. Ça aurait pas dû être permanent, ou alors c'est que vous n'avez plus de tripes. Qu'est-ce qui vous a mis K.-O., Ethan ? Et pourquoi êtes-vous resté K.-O. ?
Ethan s'apprêtait à répliquer avec colère : « Bien sûr que vous ne comprenez pas, vous n'avez jamais connu ça » — et puis, d'un coup de balai circulaire, il rassembla en pyramide les emballages de chewing-gum et des mégots de cigarettes, puis poussa la pyramide vers le caniveau.
— On n'est pas K.-O. comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut lutter contre des gros trucs. Ce qui les tue, c'est l'érosion. Ils sont lentement poussés vers l'échec. Ils prennent peur peu à peu. Moi, j'ai peur. La Compagnie d'électricité de Long Island pourrait me couper le courant. Ma femme a besoin de vêtements. Mes enfants, de chaussures et d'amusements. Et imaginez qu'ils ne puissent pas aller au collège . Et les factures tous les mois, et les médecins, et les dentistes, et une opération des amygdales, et, par-dessus le marché, imaginez que je tombe malade et que je ne sois plus capable de balayer ce foutu trottoir ? Bien sûr que vous ne comprenez pas. C'est un lent processus. Ça vous pourrit les tripes. Je suis incapable de penser plus loin que le prochain versement mensuel sur le réfrigérateur. Je déteste mon boulot et je suis terrifié à l'idée de le perdre. Comment pouvez-vous comprendre ça ?
Première partie, Chapitre I.
Ethan s'apprêtait à répliquer avec colère : « Bien sûr que vous ne comprenez pas, vous n'avez jamais connu ça » — et puis, d'un coup de balai circulaire, il rassembla en pyramide les emballages de chewing-gum et des mégots de cigarettes, puis poussa la pyramide vers le caniveau.
— On n'est pas K.-O. comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut lutter contre des gros trucs. Ce qui les tue, c'est l'érosion. Ils sont lentement poussés vers l'échec. Ils prennent peur peu à peu. Moi, j'ai peur. La Compagnie d'électricité de Long Island pourrait me couper le courant. Ma femme a besoin de vêtements. Mes enfants, de chaussures et d'amusements. Et imaginez qu'ils ne puissent pas aller au collège . Et les factures tous les mois, et les médecins, et les dentistes, et une opération des amygdales, et, par-dessus le marché, imaginez que je tombe malade et que je ne sois plus capable de balayer ce foutu trottoir ? Bien sûr que vous ne comprenez pas. C'est un lent processus. Ça vous pourrit les tripes. Je suis incapable de penser plus loin que le prochain versement mensuel sur le réfrigérateur. Je déteste mon boulot et je suis terrifié à l'idée de le perdre. Comment pouvez-vous comprendre ça ?
Première partie, Chapitre I.
Ce fut ensuite la guerre silencieuse et redoutable de la vaisselle.
— Laissez-moi vous aider.
— Pas du tout. Vous êtes l'invitée.
— Alors, laissez-moi desservir.
Les yeux de Mary cherchèrent les enfants et les transpercèrent d'un regard aigu comme une baïonnette. Ils savaient ce qui les attendaient mais ils ne pouvaient rien faire.
Mary déclara :
— Les enfants le font toujours. Ils adorent ça. Et ils le font si bien que je suis fière d'eux.
— Oh ! que c'est gentil ! On ne voit plus beaucoup ça.
— Je sais. Nous estimons que nous avons beaucoup de chance qu'ils aient envie d'aider.
Je devinais leurs petits esprits agiles comme des furets cherchant une issue, envisageant de faire une histoire, de tomber malades, de laisser choir les beaux plats anciens. Mary avait dû lire aussi leurs vilaines petites pensées. Elle reprit :
— Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'ils ne cassent jamais rien, qu'ils n'ébrèchent même pas un verre.
— Eh bien ! vous êtes bénie du Ciel ! dit Margie. Comment leur avez-vous appris ?
— Je ne leur ai pas appris. C'est naturel chez eux.
[…]
Je jetai un coup d'œil aux enfants pour voir comment ils prenaient la chose. Ils savaient qu'ils étaient coincés.
Première partie, Chapitre V.
— Laissez-moi vous aider.
— Pas du tout. Vous êtes l'invitée.
— Alors, laissez-moi desservir.
Les yeux de Mary cherchèrent les enfants et les transpercèrent d'un regard aigu comme une baïonnette. Ils savaient ce qui les attendaient mais ils ne pouvaient rien faire.
Mary déclara :
— Les enfants le font toujours. Ils adorent ça. Et ils le font si bien que je suis fière d'eux.
— Oh ! que c'est gentil ! On ne voit plus beaucoup ça.
— Je sais. Nous estimons que nous avons beaucoup de chance qu'ils aient envie d'aider.
Je devinais leurs petits esprits agiles comme des furets cherchant une issue, envisageant de faire une histoire, de tomber malades, de laisser choir les beaux plats anciens. Mary avait dû lire aussi leurs vilaines petites pensées. Elle reprit :
— Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'ils ne cassent jamais rien, qu'ils n'ébrèchent même pas un verre.
— Eh bien ! vous êtes bénie du Ciel ! dit Margie. Comment leur avez-vous appris ?
— Je ne leur ai pas appris. C'est naturel chez eux.
[…]
Je jetai un coup d'œil aux enfants pour voir comment ils prenaient la chose. Ils savaient qu'ils étaient coincés.
Première partie, Chapitre V.
Videos de John Steinbeck (17)
Voir plusAjouter une vidéo
autres livres classés : société de consommationVoir plus
Les plus populaires : Littérature étrangère
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de John Steinbeck (56)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Des souris et des hommes
En quelle année est paru ce roman de John Steinbeck ?
1935
1936
1937
10 questions
907 lecteurs ont répondu
Thème : Des souris et des hommes de
John SteinbeckCréer un quiz sur ce livre907 lecteurs ont répondu