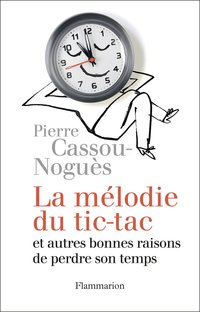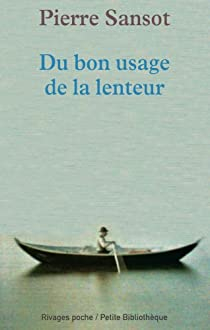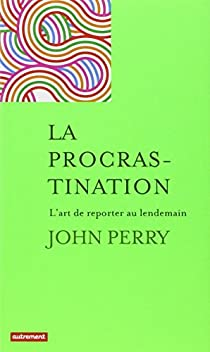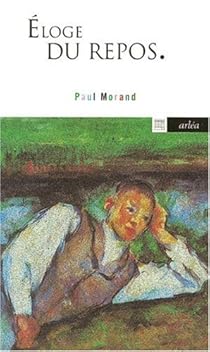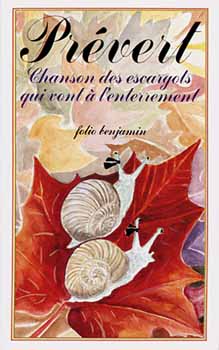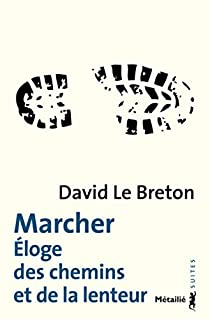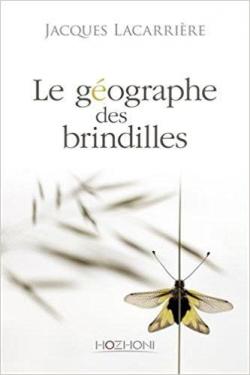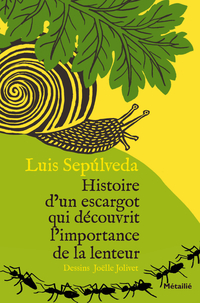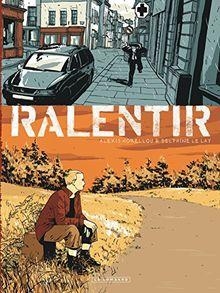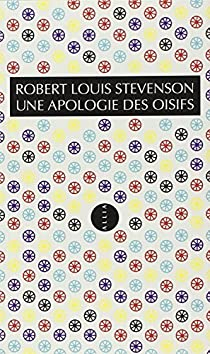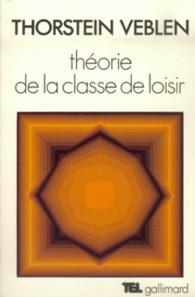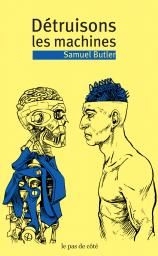Carpe diem
De quelques lectures pour prendre le pouls de la lenteur et ralentir le rythme/
Mise à jour janvier 2020.
1.
Hâte-toi lentement
Lamberto Maffei
Lamberto Maffei
2.90★
(19)
Nous vivons dans un monde où le temps semble se réduire de plus en plus. Sous l'action de la technologie et de la marchandisation, nous somme toujours connectés, sollicités à répondre et à réagir avec empressement à des courriels, tweets, SMS, vidéos, happés par une véritable frénésie visuelle et cognitive. Nous oublions que le cerveau a des mécanismes lents et, dans la tentative d'imiter les machines rapides, nous sommes confrontés à de nombreuses frustrations. la culture de la rapidité domine dans les relations et les décisions; l'action immédiate l'emporte sur la réflexion. Même la politique et l'éducation subissent ce changement.
Dans ce best-seller international, au style soigné et accessible, Lamberto Meffei, neuroscientifique éminent, démontre que c'est la nature même de notre cerveau qui n'est pas adaptée à cette précipitation. Il nous invite à redécouvrir les potentialités et les avantages d'une civilisation pratiquant la réflexion, basée notamment sur le langage et sur l'écriture, et à redonner la priorité au temps du cerveau plutôt qu'à celui des machines.
2.
La mélodie du tic-tac et autres bonnes raisons de perdre son temps
Pierre Cassou-Noguès
Pierre Cassou-Noguès
2.00★
(10)
Procrastiner, ne pas travailler, perdre son temps... Inutile de culpabiliser : « traîner », en fin de compte, c'est déjà philosopher. Cette valeur du temps perdu, on la découvre à pas feutrés, en suivant dans les cimetières et les rues de Paris un narrateur passé maître dans l'art de ne rien faire, de « rompre avec la temporalité mécanique qui est attendue de nous ». Dans cette succession de scènes étrangement familières, empreintes d'une absurde drôlerie, la profondeur des heures perdues finit par se révéler : ne rien faire, ce n'est pas rien. C'est faire l'expérience du rien, du néant, dont l'idée « nous viendrait de la conscience que nous pouvons ne rien faire ». Je traîne donc je suis? Pas si simple : l'inactivité est « un sol sur lequel s'appuie la philosophie mais qu'elle recouvre et qu'elle oublie, dans l'évidence d'un sujet qui pense et ne traîne plus ». Mais alors, si penser le temps, c'est cesser de le perdre, à quoi rime une philosophie du temps perdu ? « Elle frôle inévitablement l'inconsistance », puisqu'elle est vouée à traquer le néant de nos vies. Une chose est sûre, pourtant : entre philosophie et fiction, cette plongée dans l'opacité des instants volés au tic-tac de l'horloge est tout sauf une perte de temps
3.
Du bon usage de la lenteur
Pierre Sansot
Pierre Sansot
3.26★
(269)
Une certaine forme de sagesse se reconnaît à la volonté de ne pas brusquer la durée, de ne pas se laisser bousculer par elle, pour augmenter notre capacité à accueillir l'événement. Nous avons nommé lenteur cette disponibilité de l'individu. Elle exige que nous donnions au temps toutes ses chances et laissions respirer notre âme à travers la flânerie, l'écriture, l'écoute et le repos. Pierre Sansot, l'auteur de Gens de peu, de La France sensible et de Jardins publics, donne, dans cet essai, quelques conseils concernant une politique de la ville, un certain emploi de la culture, un certain usage des sens.
4.
Journées perdues
Frédéric Schiffter
Frédéric Schiffter
4.08★
(27)
« Pour évoquer mon ennui, le mieux est de rendre compte de mes journées vouées à regarder passer le temps. L?homme affairé tient un agenda, l?homme sans horaire son journal intime. Le premier note ses rendez-vous avec les autres, le second consigne ses réunions avec lui-même. Mon livre est fait des carnets écrits du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Deux ans vécus à Biarritz, ville de tous mes excès casaniers. Des jours qui se sont succédés entre flâneries, lectures, griffonnages et siestes. Des nuits à faire les cent pas dans mon crâne en attente de l?aurore. Des heures qui ont tourné sans déformer la mollesse de leur cadran. En écrivant ces pages, j?ai trompé mon ennui sans lui être infidèle. »
5.
Jours de Lenteur
Richard Millet
Richard Millet
4.50★
(8)
A l'instar de Ma vie parmi les ombres, ce texte inédit de Richard Millet possède un fort écho autobiographique. C'est à Siom, nom d'emprunt pour la ville corrézienne de Viam qui l'a vu naître, que prennent place les nouvelles qui composent ces Jours de lenteur. Les mots y coulent naturellement, malgré le titre, comme les eaux vives d'une rivière.
6.
La lenteur
Milan Kundera
Milan Kundera
3.66★
(2573)
" Tu m'as souvent dit vouloir écrire un jour un roman où aucun mot ne serait sérieux. Une Grande Bêtise Pour Ton Plaisir. J'ai peur que le moment ne soit venu. Je veux seulement te prévenir : fais attention. " J'incline la tête encore plus bas. " Te rappelles-tu ce que te disait ta maman ? J'entends sa voix comme si c'était hier : Milanku, cesse de faire des plaisanteries. Personne ne te comprendra. Tu offenseras tout le monde et tout le monde finira par te détester. Te rappelles-tu ? - Oui, dis-je. - Je te préviens. Le sérieux te protégeait. Le manque de sérieux te laissera nu devant les loups. Et tu sais qu'ils t'attendent, les loups. "
Autre résumé:
«[...] L'homme au casque, avec sa drôle d'intonation, répète : "Je viens de vivre une nuit tout à fait merveilleuse."
Le chevalier hoche la tête comme s'il disait oui, je te comprends, ami. Qui d'autre pourrait te comprendre ? Et puis, il y pense : ayant promis d'être discret, il ne pourra jamais dire à personne ce qu'il a vécu. Mais une indiscrétion après deux cents ans est-elle encore une indiscrétion ? Il lui semble que le Dieu des libertins lui a envoyé cet homme pour qu'il puisse lui parler ; pour qu'il puisse être indiscret en tenant en même temps sa promesse de discrétion ; pour qu'il puisse déposer un moment de sa vie quelque part dans l'avenir : le projeter dans l'éternité ; le transformer en gloire.
"Tu es vraiment du XXe siècle ?
- Mais oui, mon vieux. Il se passe des choses extraordinaires dans ce siècle. La liberté des m?urs. Je viens de vivre, je le répète, une nuit formidable.
- Moi aussi", dit encore une fois le chevalier [...]»
8.
La Procrastination: L'art de remettre au lendemain
John Perry
John Perry
3.48★
(216)
Vous ne pouvez pas vous empêcher de paresser, décaler, lambiner, atermoyer, ajourner, proroger, différer, décaler, musarder, zigzaguer, suivre des chemins de traverse ? Ce livre est pour vous. Le philosophe américain John Perry bâtit un plaidoyer souvent inattendu, toujours convaincant en faveur de la procrastination structurée, ce « défaut » qui, bien utilisé, peut vous transformer en foudre de guerre.
9.
Eloge de la lenteur
Carl Honore
Carl Honore
3.60★
(369)
Aujourd'hui, la culture est à la rapidité. Mais dans cette course contre la montre, rien ne survit - notre travail, notre santé, nos relations, notre vie sexuelle. Nous sommes si pressés que la personne ou la chose qui nous ralentit représente, d'emblée, l'ennemi à abattre. Tout un courant d'opinion met en question ce culte de la vitesse et réaffirme les vertus de la lenteur. Baptisé " Slow ", il ne prétend nullement qu'il faut tout faire à une allure d'escargot mais souligne que notre qualité de vie passe par un meilleur équilibre entre rapidité et lenteur. L'enquête de Carl Honoré, menée de pays en pays, montre les différentes formes prises par ce phénomène qui touche de plus en plus de monde. Et si un bon usage de la lenteur pouvait rendre nos vies plus riches et plus productives ?
10.
Éloge de l'immobilité
Jérôme Lèbre
Jérôme Lèbre
2.88★
(14)
Dans ce monde qui semble soumis à une accélération constante, où l'on ne cesse de louer la marche ou la course, nous souhaitons et craignons à la fois que tout ralentisse ou même que tout s'arrête. L'ambivalence de ce désir reste à étudier, comme ce que signifie aujourd'hui le fait de ne pas bouger. La privation de mouvement est une peine ; le droit pénal, les disciplines scolaires ou militaires immobilisent ; les accidents et les maladies paralysent ; l'accélération technique se paye en inertie dans les embouteillages ou les bureaux. Les éloges de la mobilité comme la critique de l'accélération sont passés à côté de ces situations où l'immobilité s'impose, non sans violence. Il faut redonner son sens à l'immobilisation. Car cette peine est aussi une étape, une station, impliquant le corps et la pensée. Tenir, debout, assis, dans la position du lotus ou même couché, c'est exercer sur soi une contrainte signifiante. Les « mouvements » d'occupation des places nous le rappellent, l'art également. Savoir faire halte, c'est savoir résister.
11.
Vitesses
Jérôme Lèbre
Jérôme Lèbre
tout va trop vite, et de plus en plus vite, jusqu'au temps lui-même. Mais cette impression générale de vitesse absorbe sans vraiment rassembler le mouvement local, la perception de l'espace et du temps, l'expérience de l'écriture ou de la pensée. Elle risque de nous laisser aux prises avec une vitesse unique qui n'est qu'une ombre projetée par un impensé : celui de la valeur profonde de la lenteur, du repos, des racines et de la Terre. Cet essai vise à combattre cet impensé et à insister sur la pluralité des vitesses. Il défend l'idée que toute vitesse se mesure sur le fond incommensurable d'une vitesse infinie, qui n'est de l'ordre de l'expérience que si l'expérience elle-même (donc aussi l'impression de vitesse) n'est pas univoque. Contre l'attente d'une catastrophe généralisée, il entend préserver l'imprévisibilité des événements et la survenue à contretemps de chaque invention.
12.
Elogio della lentezza
Lamberto Maffei
Lamberto Maffei
5.00★
(2)
Viviamo in un mondo veloce, dove il tempo sembra via via contrarsi: continuamente connessi, chiamati a rispondere in tempi brevi a e-mail, tweet e sms, iper-sollecitati dalle immagini, in una frenesia visiva e cognitiva dai tratti patologici. Dimentichiamo così che il cervello è una macchina lenta e, nel tentativo di imitare le macchine veloci, andiamo incontro a frustrazioni e affanni. Queste pagine esplorano i meccanismi cerebrali che guidano le reazioni rapide dell?organismo umano, di origine sia genetica sia culturale, con un invito a scoprire i vantaggi di una civiltà dedita alla riflessività e al pensiero lento.
13.
Éloge du repos
Paul Morand
Paul Morand
3.39★
(92)
A quoi bon gagner du temps si nous ne savons pas en profiter ? Se reposer est un art. Un " professionnel " du loisir et de la fantaisie vagabonde nous offre cet éloge - nuancé - du repos.
Pour éviter que le temps gagné ne soit aussitôt perdu, Paul Morand se livre ici à une pédagogie ironique : les vacances et les voyages s'apprennent comme le reste. Cette pratique du farniente n'est pas seulement une question de lois et de congés payés, c'est d'abord avec l'âme qu'elle a affaire.
14.
L'homme pressé
Paul Morand
Paul Morand
3.61★
(486)
Pierre gâche tout, l'amitié, l'amour, la paternité, par sa hâte fébrile à précipiter le temps. A cette allure vertigineuse, il ne goûte plus ce qui fait le prix de la vie, ni les moments d'intimité que sa femme Hedwige lui ménage, ni la poésie des choses. Il se consume et consume les siens en fonçant vers un but qu'il renouvelle, chaque fois qu'il l'atteint. " A quoi reconnaître qu'on est arrivé si l'on ne s'arrête jamais ? " demande la sage Hedwige. Pierre saura trop tôt qu'il ne se hâtait ainsi que pour arriver plus vite au rendez-vous de la mort.
15.
L'homme qui apprenait lentement
Thomas Pynchon
Thomas Pynchon
3.26★
(116)
Ils escaladent les décharges en quête d'un matelas, descendent des tequilas à la quarantième heure d'une fête, composent une symphonie en écoutant le bruissement des feuilles ou attendent l'apocalypse.
Thomas Pynchon, auteur culte, met en scène des héros à la fois insolites, farfelus et fantasques.
16.
Le jeune homme qui voulait ralentir la vie
Max Genève
Max Genève
3.40★
(10)
Le jeune homme n'a pas fait de longues études, mais il aime lire et rumine volontiers. On le trouve parfois un peu endormi. Benoît, vingt ans, appartient au grand peuple des lents : il va même jusqu'à considérer qu'un usage judicieux et voluptueux de la lenteur, loin d'être un handicap, peut se révéler un véritable art de vivre. Son imagination jamais tarie lui permet d'échapper plus souvent qu'à son tour aux servitudes de son modeste emploi de magasinier dans une quincaillerie de la rue des Pyrénées. Enrôlé par monsieur Belon, inspecteur de police à la retraite, dans un étonnant Mouvement pour la Promotion de la Lenteur, il poursuit en songe ses lointaines pérégrinations sur les mers australes, tout en méditant cette pensée de l'un de ses amis : la fugacité du temps qui passe n'a plus de prise sur celui qu'a saisi au moins une fois dans sa vie la soudaine intuition de l'infinie lenteur de l'être.
17.
L'homme ralenti
J. M. Coetzee
J. M. Coetzee
3.29★
(142)
Vol plané au ralenti après le choc initial et retombée brutale sur le bitume d'un carrefour d'Adélaïde : mis à bas de son vélo par un jeune chauffard puis amputé d'une jambe, le sexagénaire Paul Rayment reprend connaissance d'un moi diminué sur son lit d'hôpital. Il refuse l'équilibre factice d'une prothèse, s'empêtre dans ses béquilles. Il lui faut désormais une auxiliaire de vie pour veiller au ménage et soigner le moignon. Marijana Jokic, l'immigrée croate, s'acquitte au mieux de sa tâche, mais ranime, à son corps défendant, le c?ur en souffrance de Paul Rayment. Il va jusqu'à offrir de prendre tous les Jokic sous son aile. A la réalité inerte d'un membre artificiel, Paul substitue la chimère d'une famille fantôme qui prolongerait son monde rétréci. C'est alors qu'Elizabeth Costello frappe à sa porte. Prompt à le rappeler à l'ordre, ce double féminin bavard, intempestif et omniprésent s'acharne sans relâche à élaborer une fiction d'un homme amoindri et indûment épris qui aborde la vieillesse. La vie passée du jeune garçon transplanté d'Europe en Australie et le progrès difficile vers l'âge d'homme, entre deux langues et deux cultures, font place, dans la dignité précairement conservée et avec un humour résigné, à un questionnement sur le crépuscule qui nous attend.
18.
La découverte de la lenteur
Sten Nadolny
Sten Nadolny
3.68★
(41)
Dès l'enfance, l'Anglais John Franklin souffrit d'un étrange défaut:une extrême lenteur. Cette tare le disposa plus qu'un autre a la réflexion, l'observation. C'est ainsi qu'il devint, après bien des humiliations, l'un des plus grands navigateurs de la marine britannique du dix-neuvième siècle. Il explora l'Australie, gouverna la Tasmanie, découvrit le passage du Nord-Ouest, avant de se perdre en 1847 dans l'Arctique. De cette vie rebelle, Sten NadolnY a tiré un roman picaresque, torpillé par des salves d'humour et d'ironie. Mais La Découverte de la lenteur est aussi un conte philosophique qui bouleverse, jusqu'au vertige, notre vision des femmes et du monde... Autant dire un voyage dont on revient différent, plus tolérant aussi.
20.
L'art de prendre son temps : Essai de philosophie politique
Jean-Paul Jouary
Jean-Paul Jouary
4.50★
(14)
Une réflexion où la question de la conception du temps en relation avec la question de la démocratie, de l?Antiquité à nos jours, occupe une place centrale.
« L'Art de prendre son temps réunit une série de conférences prononcées en 1993 au Collège international de philosophie. Jean-Paul Jouary reprend la phrase terriblement révolutionnaire de Diderot : « Hâtons-nous de rendre populaire la philosophie ! » Et c'est le même sillon qu'il creuse en reprenant à un autre niveau les réflexions qu'il avance dans son essai de philosophie politique qu?est L'Art de prendre son temps. Levons tout de suite une ambiguïté que pourrait faire naître ce titre. On est pressé. L'auteur aussi. Il écrit, en fait, qu'il faut prendre son temps dans tout son concret pour ne pas le perdre et en gagner. La précision n'est pas aussi elliptique qu'elle en a l'air. Il s'agit ici de travailler autour de la façon « explicite ou implicite d'inclure certaines conceptions du temps dans la réflexion politique ». En gros, de se plonger dans son temps pour construire notre futur. Un réflexion déjà portée par l'auteur dans d'autres ouvrages.
Point de départ : une nouvelle visite dans la caverne de Platon, cette allégorie célèbre où le sujet enchaîné n'a de perception du monde réel que le reflet projeté sur la paroi des ombres de ceux qui sont au dehors. Généralement, dans les ouvrages scolaires de philosophie, l'extrait de texte proposé à la lecture s'arrête là. Mais la « République » de Platon va bien plus loin et questionne sur le prisonnier qui a été libéré, qui a vu le monde, et revient dire aux autres prisonniers ce qu'il est. Ceux-ci, se fondant sur leur expérience, sur leurs sensations, ne peuvent le croire. C'est ce moment qui interroge l'auteur. La question est directement politique, par le fossé infranchissable dressé entre celui qui a vu (et cela peut être dit d?une vision du futur d?une société) et celui dont l'expérience contredit cette vision. D?où peut naître la pensée d'une société future et les moyens d'y parvenir ? Chez Platon, il faut des rois philosophes. D'autres ont pensé qu'il fallait des « Lumières » pour guider le peuple. Jean-Paul Jouary, dans cet essai, montre l'évolution de ce questionnement à travers plusieurs penseurs, dont Galilée, Darwin, Lacan, Rousseau et Marx. Il critique ceux pour qui la transformation sociale proviendrait de « valeurs universelles, qui s'imposeraient partout sans même avoir été portées par des pratiques populaires », ou encore ceux qui pensent que la révolution technologique est d?elle-même porteuse de révolution sociale.
Pour Jean-Paul Jouary, il faut en revenir à Marx et son « introduction de la pratique dans la position même des problèmes théoriques », avec l'idée qu'il n'est pas de plus haute existence de la théorie que celle qui inscrit ses créations dans le creuset des potentialités en acte dans les pratiques populaires. « L'avenir est toujours quelque part dans le présent, et, à l'ignorer, on s'expose à chercher l'avenir loin devant soi, alors même qu'il nous rattrape, nous dépasse, nous sème en se riant des plans que nous avions tiré sur lui ». »
Bruno Peuchamiel
21.
Mes trains de nuit
Éric Faye
Éric Faye
3.06★
(28)
Les trains de nuit ont offert à Eric Faye ses premières insomnies heureuses. New York, Prague, Samarkand, Sarajevo, Berlin, Pékin... autant de nuits blanches partagées avec le " petit peuple du couloir " : fumeurs, noctambules, bavards impénitents. Espace privilégié où le temps semble s'arrêter, le wagon-lit est un lieu de rêverie et de rencontres, le voyage en train un condensé de l'existence, avec ses séparations et son terminus. Au fil de ses souvenirs parfois incertains et romanesques, l'auteur nous entraîne dans son labyrinthe littéraire et insolite. A bord du transsibérien ou du Kafka express nous traversons des frontières aujourd'hui disparues, des empires rayés de la carte, des bouts du monde ignorés. Enfant, Eric Faye s'endormait en écoutant le chant des locomotives, ce qui lui permet d'affirmer aujourd'hui que certains trains de nuit pleurent. Héritier d'une histoire familiale dans laquelle les chemins de fer ont toute leur place, il nous offre cet éloge de la lenteur, de la contemplation et du nomadisme.
22.
Marcher : Eloge des chemins et de la lenteur
David Le Breton
David Le Breton
4.03★
(249)
Revisitant une réflexion menée il y a dix ans, l'auteur constate que le statut de la marche a énormément changé en une trentaine d'années.
Aller à pied, livré à son seul corps et à sa volonté, est un anachronisme en un temps de vitesse, de fulgurance, d'efficacité, de rendement, d'utilitarisme. Marcher ainsi de nos jours - et surtout de nos jours, disait J Lacarrière, "ce n'est pas revenir aux temps néolithiques, mais bien plutôt être prophète". Il est l'un des premiers à en retrouver le goût. Les chemins de Compostelle sont devenus en quelques années des lieux très fréquentés et dotés d'une organisation méticuleuse.
Nous sommes bien loin des anciens chemins, mal aménagés, mal balisés, avec une population méfiante envers ces gens de passage portant leur sac à dos qui étaient les pionniers de leur renaissance dans les années 70. Ceux qu'essaient alors de reconstituer P Barret et J-N Gurgand ont disparu sous les "coquelicots, les chemins sont goudronnés ou ne sont plus". Les années 80 voient leur réorganisation méthodique, en 1983 est créée la première association jacquaire, qui sera suivie de bien d'autres.
Dans les années 90 les chemins de Compostelle prennent leur essor. Aujourd'hui la marche s'impose comme une activité essentielle de retrouvailles avec le corps, avec les autres. Là où ils existent, même dans les villages, rares sont les syndicats d'initiative qui ne proposent pas un répertoire de chemins bien balisés pour la découverte de la cité ou de ses environs. Les imaginaires contemporains de la marche sont heureux, ils réfèrent plutôt au loisir, à la disponibilité.
Marcher est un long voyage à ciel ouvert et dans le plein vent du monde dans la disponibilité à ce qui vient. Tout chemin est d'abord enfoui en soi avant de se décliner sous les pas, il mène à soi avant de mener à une destination particulière. Et parfois il ouvre enfin la porte étroite qui aboutit à la transformation heureuse de soi.
23.
Marcher, méditer
Michel Jourdan
Michel Jourdan
3.17★
(83)
La marche peut devenir méditation active. Et nous qui courons sans cesse, noyés dans nos pensées, nous pourrions retrouver le sens perdu de nos déambulations en apprenant à les rendre conscientes. Depuis la plus haute Antiquité, en effet, il existe une vraie réflexion sur la marche comme exercice de ressourcement. Comme dans la méditation immobile, l'attention aux processus respiratoires et aux va-et-vient mentaux s'avère essentielle pour connaître l'état de clarté intérieure qui nous amène à ne faire plus qu'un avec la réalité.
"L'esprit du paysage et mon esprit se sont concentrés et, par là, transformés de sorte que le paysage est bien en moi", disait le peintre chinois Shi Tao.
Fort de l'expérience des poètes errants et méditants de tous les temps et de tous lieux, ce livre nous entraîne dans une philosophie de la marche accompagnée d'une véritable psychologie de la méditation en Orient et en Occident. Marcher, méditer : une carte pour l'être.
24.
Le géographe des brindilles
Jacques Lacarrière
Jacques Lacarrière
4.42★
(23)
Dans ce nouveau et savoureux recueil, l'auteur de L'Eté grec et de Chemin faisant nous emporte par sa qualité d'écriture, son humour, son appétence pour les mots, sa poésie délicate et sa culture singulière. Il nous entraîne dans Une forêt de signes où l'on respire Le parfum des légendes et où l'on écoute avec ravissement La cantate des chemins. L'Ode à mes amis les arbres, L'offertoire des vents ou L'homme qui voulut rencontrer le printemps sont autant d'agréables moments à passer en compagnie de celui qui fut aussi un arpenteur émerveillé des chemins et un attentif écrivain-voyageur nous emmenant avec délectation au pays des arganiers, dans sa Bourgogne ou sa Grèce tant aimée. Féru de botanique et de biologie, l'amoureux des jardins et des "jardineurs" savait errer dans les bois, discourir savamment sur Le privilège de l'abeille, la mémoire des Libellules ou la Sagesse serpentine, esquisser le portrait d'une vache, passer (au microscope !) Un été chez les Infusoires, déceler La mélancolie du géranium, s'inquiéter de La nostalgie de l'anguille ou réclamer Justice pour les Crapauds. La relation de Lacarrière avec la nature est, nous dit Gil Jouanard dans sa belle préface, celle "des nomades du Paléolithique qui habitaient le monde en le nommant"...
25.
Histoire d'un escargot qui découvrit l'importance de la lenteur
Luis Sepúlveda
Luis Sepúlveda
3.85★
(353)
Les escargots qui habitent sous l'acanthe touffue, dans la prairie qu'ils appellent le Pays de la Dent-de-Lion, mènent une vie paisible, lente et silencieuse ; ils sont à l'abri des autres animaux et entre eux s'appellent simplement "escargot". L'un d'eux pourtant trouve injuste de n'avoir pas de nom et surtout il voudrait connaître les raisons de la lenteur. Malgré la désapprobation de ses camarades il entreprend un voyage qui lui fera rencontrer un hibou mélancolique, une tortue pleine de sagesse, des fourmis très organisées, et gagner un nom à lui. A leur contact il comprendra la valeur de la mémoire et la vraie nature du courage, ce qui lui permettra de sauver ses camarades lors d'une aventure héroïque pour échapper à la destruction par les hommes. Un nouveau personnage inoubliable rejoint la galerie de Luis Sepúlveda. Une belle histoire qui nous montre comment redécouvrir le sens perdu du temps.
26.
Les hommes lents : Résister à la modernité (XVè-XXè siècle)
Laurent Vidal
Laurent Vidal
3.73★
(101)
L'histoire de la modernité est d'abord celle d'une discrimination : en érigeant la vitesse en modèle de vertu sociale, les sociétés modernes ont inventé un vice, celui de la lenteur - cette prétendue incapacité à tenir la cadence et à vivre au rythme de son temps. Partant d'une violence symbolique et d'un imaginaire méconnu, Laurent Vidal fait la genèse des hommes lents, ces individus mis à l'écart par l'idéologie du Progrès. On y croise tour à tour un Indien paresseux et un colonisé indolent à l'époque des grandes découvertes, des ouvriers indisciplinés dans le XIXe siècle triomphant ; plus proches de nous, le migrant en attente ou le travailleur fainéant restent en marge de l'obsession contemporaine de l'efficacité. Mais l'auteur révèle avant tout la façon dont ces hommes s'emparent de la lenteur pour subvertir la modernité, à rebours de la cadence imposée par les horloges et les chronomètres : de l'oisiveté revendiquée aux ruses déployées pour s'approprier des espaces assignés, les hommes lents créent des rythmes inouïs, jusque dans les musiques syncopées du jazz ou de la samba. En inventant de nouveaux modes d'action fondés sur les ruptures de rythme - telles les stratégies de sabotage du syndicalisme révolutionnaire -, ils nous offrent un autre regard sur l'émancipation. Mêlant la rigueur de l'historien à la sensibilité d'un écrivain qui puise aussi bien dans la littérature que dans les arts, cet essai ouvre des horizons inédits pour repenser notre rapport à la liberté.
27.
Ralentir
Delphine Le Lay
Delphine Le Lay
3.61★
(105)
David est représentant commercial et vient de recevoir une proposition de promotion. Après une semaine passée loin de sa famille, il prend la route pour rentrer pour le week-end. Le temps est pluvieux et David ne se sent pas très bien. Alors qu'il s'arrête pour reprendre ses esprits, Emma, une auto-stoppeuse à l'allure marginale s'engouffre dans sa voiture. Il n'avait pas vraiment prévu ça mais, bonne âme, il accepte de faire un bout de chemin avec cette passagère aux convictions et au mode de vie opposés aux siens. Le temps d'un trajet tendu et semé d'embûches, David entrevoit la possibilité d'une autre manière de vivre et oscille entre deux extrêmes.
28.
Pédale douce : ode au vélo et à la lenteur
Franck Michel
Franck Michel
Dans un monde de plus en plus robotisé, Franck Michel nous propose de ralentir et de réfléchir, pour retrouver le sens de la vie et l'autonomie. Il montre l'intérêt, aussi bien pour la tête que pour les jambes, des flâneries vélocipédiques, et d'une "vélosophie" qui prône la lenteur, la rencontre, la liberté : la vélonomadie.
Biographie de l'auteur
Franck Michel vit à Strasbourg et à Bali. Il est anthropologue. Il écrit sur les thèmes de l'interculturalité, de la "route", du voyage, du tourisme, et de l'Asie.
29.
Une apologie des oisifs - Causerie et causeurs
Robert Louis Stevenson
Robert Louis Stevenson
3.73★
(172)
Aujourd'hui, chacun est contraint, sous peine d'être condamné par contumace pour lèse-respectabilité, d'exercer une profession lucrative, et d'y faire preuve d'un zèle proche de l'enthousiasme. La partie adverse se contente de vivre modestement, et préfère profiter du temps ainsi gagné pour observer les autres et prendre du bon temps, mais leurs protestations ont des accents de bravade et de gasconnade. Il ne devrait pourtant pas en être ainsi. Cette prétendue oisiveté, qui ne consiste pas à ne rien faire, mais à faire beaucoup de choses qui échappent aux dogmes de la classe dominante, a tout autant voix au chapitre que le travail.? On se persuadera à la lecture de ces textes jubilatoires, où défile une galerie d'excentriques anglais de la plus belle eau, que la paresse et la conversation ? au même titre que l'assassinat ? méritent de figurer parmi les beaux-arts.
30.
Théorie de la classe de loisir
Thorstein Veblen
Thorstein Veblen
4.33★
(74)
Source d'inspiration pour les tâcherons du savoir, exemple de sagesse froide - ni la mesure de Tocqueville ni l'indignation tempétueuse de Marx -, l'oeuvre de Thorstein Veblen apprend à discerner, au-delà de l'accoutumance à la vie quotidienne, la comédie humaine, la rivalité puérile des adultes en quête d'argent, de gloire et de prestige, jamais capables d'atteindre un but qui fuit à mesure qu'ils en approchent puisque ce but se définit non pas en soi mais par rapport aux conquêtes des autres.
Raymond Aron
31.
Le repos du cavalier
Gustave Roud
Gustave Roud
4.17★
(6)
Le Repos du cavalier parut en 1958 à la Bibliothèque des Arts fait partie de ces recueils de prose " construits dans le mouvement d'une errance qui se voulait disposition à percevoir (C. Jéquier). Avec son exigence de beauté et sa langue épurée, Gustave Roud tire le lecteur vers le haut, là où baigne le silence et l'harmonie. Parmi ceux qui vivent, parmi ceux qui jouent à vivre, les hommes dont on n'a que faire, qui ne servent à rien, les inutilisables, attendent à l'écart, une question perpétuellement aux lèvres, qu'ils ont toute la vie pour poser. Les uns attendent la mort comme une réponse ; d'autres, le temps d'un éclair, sentent en eux-mêmes cette réponse confusément s'ébaucher, puis le silence retombe
Thèmes de cette liste
Les Dernières Actualités
Voir plus