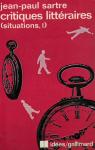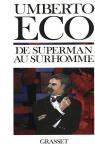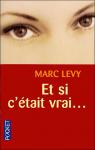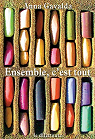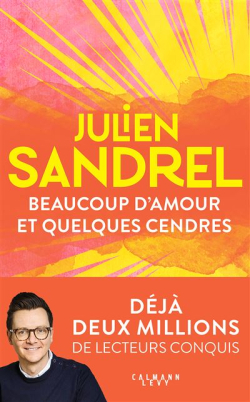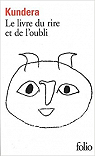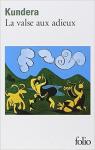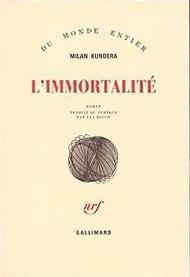Milan Kundera/5
108 notes
Résumé :
" Un rideau magique, tissé de légendes, était suspendu devant le monde. Cervantes envoya don Quichotte en voyage et déchira le rideau. Le monde s'ouvrit devant le chevalier errant dans toute la nudité comique de sa prose... C'est en déchirant le rideau de la préinterprétation que Cervantes a mis en route cet art nouveau ; son geste destructeur se reflète et se prolonge dans chaque roman digne de ce nom ; c'est le signe d'identité de l'art du roman. "
... >Voir plus
... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Le RideauVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (9)
Voir plus
Ajouter une critique
Troisième essai de Milan Kundera, après L'Art du Roman et Les Testaments Trahis, troisième réflexion sur ce qu'est — ou ce que devrait être — le roman et la façon de le faire. le résultat est captivant, comme toujours.
Ici, Milan Kundera creuse, comme à son habitude, de façon approfondie, pertinente et pluri-axiale ce qu'est, selon lui, l'essence du roman, c'est-à-dire, au-delà de ce qui le caractérise extérieurement, ce qui ne pourrait être exprimé autrement que PAR le roman.
Premier constat, le roman n'est ni de la poésie, ni du théâtre. La poésie, c'est la recherche de l'esthétique à tout prix : le roman ne s'interdit pas de ne pas être esthétique ou, à tout le moins, son esthétique correspond à l'esthétique " ordinaire " de la vie. le théâtre, quant à lui, c'est une unité de lieu, de temps, de personnages : c'est une extrême condensation, une extrême focalisation sur un point précis, infinitésimal si j'ose écrire, de la vie. Ses personnages ne sont pas des êtres humains véritables, ce sont des rôles, c'est-à-dire, pour faire simple, des fonctions ou des symboles ou des allégories de grandes catégories de comportements ou d'êtres, mais pas des êtres véritables.
Le roman, lui, s'attache à essayer de restituer non pas la vie (qui le peut ?), mais la vision particulière d'un individu sur la vie. Il est à même de percevoir les premiers frémissements d'une nouveauté universelle. (Kundera cite Adalbert Stifter, qui, dans L'Arrière-Saison, perçoit une mutation de la société européenne, à savoir, l'avènement de l'administration, thème qui sera repris et amplifié 60 ans plus tard par Franz Kafka dans le Château. Cette mutation qualitative de nos vies, ce changement de paradigme est devenu tellement " naturel " que plus personne ne le perçoit à l'heure actuelle car l'administration fait partie de nos vies.)
Quel poète ou quel dramaturge aurait pu exemplifier dans l'une de ses oeuvres un tel virage ou une telle évolution ? Certes, le théâtre peut, à l'heure actuelle, se moquer, tourner en dérision ou en horreur ce qu'est devenue la machinerie administrative à notre temps t. Mais faire sentir une mutation, en temps réel, c'est-à-dire dès le XIXème siècle, voilà qui était et qui demeure, par définition, impossible car l'unité de temps ne l'autorise guère. C'est le ressenti intime, inconscient presque, d'une personne dans une époque qui est perceptible dans le roman.
Le roman peut toucher à l'essai (L'homme sans Qualités de Robert Musil, Les Somnambules de Hermann Broch, par exemples), le roman peut laisser parler une foule de narrateurs qui donnent chacun leur point de vue sur une même série d'événements (e. g. Les Liaisons Dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos, Tandis que J'Agonise de William Faulkner).
Le roman parle des vraies gens et de leurs problèmes très prosaïques : Don Quichotte a beaucoup de problèmes avec ses dents tandis que les héros de l'Iliade ont tous des sourires parfaits ; c'est ce qui distingue le roman de l'épopée ou de la Saga. le roman ne s'interdit pas de diluer ce qui n'est à l'origine qu'une blague pour en analyser tous les ressorts sociétaux : Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert est le sujet d'une plaisanterie qu'on aurait entièrement dilué et disséqué. Même chose pour le Procès de Franz Kafka. le but n'est plus ici d'appuyer sur le comique mais d'analyser en profondeur ce que le comique ne fait que suggérer.
Bref, le roman est à même de saisir toutes les composantes de la vie, même l'ennui, même le gore, même le trivial, même la bêtise moyenne, même la pensée fugace, même l'art de se faire un thé, même les fantasmes ou les pulsions non assouvies, même les non-conscientes : il n'est ni poésie, ni théâtre, ni essai, ni traité, ni jeu, car il est tout cela à la fois et parfois, même, simultanément.
Le romancier est celui qui peut — ET QUI DOIT — écarter ou déchirer le rideau qui dissimule un aspect de ce qui pourrait nous empêcher d'aller au fond des choses. En somme, pour paraphraser Marcel Proust, le romancier est un genre d'opticien qui passe son temps à imaginer de nouveaux modèles de lunettes pour toujours mieux percevoir le monde.
En somme, d'après moi, un grand essai, mais bien évidemment, ceci n'est qu'un avis derrière un rideau, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Ici, Milan Kundera creuse, comme à son habitude, de façon approfondie, pertinente et pluri-axiale ce qu'est, selon lui, l'essence du roman, c'est-à-dire, au-delà de ce qui le caractérise extérieurement, ce qui ne pourrait être exprimé autrement que PAR le roman.
Premier constat, le roman n'est ni de la poésie, ni du théâtre. La poésie, c'est la recherche de l'esthétique à tout prix : le roman ne s'interdit pas de ne pas être esthétique ou, à tout le moins, son esthétique correspond à l'esthétique " ordinaire " de la vie. le théâtre, quant à lui, c'est une unité de lieu, de temps, de personnages : c'est une extrême condensation, une extrême focalisation sur un point précis, infinitésimal si j'ose écrire, de la vie. Ses personnages ne sont pas des êtres humains véritables, ce sont des rôles, c'est-à-dire, pour faire simple, des fonctions ou des symboles ou des allégories de grandes catégories de comportements ou d'êtres, mais pas des êtres véritables.
Le roman, lui, s'attache à essayer de restituer non pas la vie (qui le peut ?), mais la vision particulière d'un individu sur la vie. Il est à même de percevoir les premiers frémissements d'une nouveauté universelle. (Kundera cite Adalbert Stifter, qui, dans L'Arrière-Saison, perçoit une mutation de la société européenne, à savoir, l'avènement de l'administration, thème qui sera repris et amplifié 60 ans plus tard par Franz Kafka dans le Château. Cette mutation qualitative de nos vies, ce changement de paradigme est devenu tellement " naturel " que plus personne ne le perçoit à l'heure actuelle car l'administration fait partie de nos vies.)
Quel poète ou quel dramaturge aurait pu exemplifier dans l'une de ses oeuvres un tel virage ou une telle évolution ? Certes, le théâtre peut, à l'heure actuelle, se moquer, tourner en dérision ou en horreur ce qu'est devenue la machinerie administrative à notre temps t. Mais faire sentir une mutation, en temps réel, c'est-à-dire dès le XIXème siècle, voilà qui était et qui demeure, par définition, impossible car l'unité de temps ne l'autorise guère. C'est le ressenti intime, inconscient presque, d'une personne dans une époque qui est perceptible dans le roman.
Le roman peut toucher à l'essai (L'homme sans Qualités de Robert Musil, Les Somnambules de Hermann Broch, par exemples), le roman peut laisser parler une foule de narrateurs qui donnent chacun leur point de vue sur une même série d'événements (e. g. Les Liaisons Dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos, Tandis que J'Agonise de William Faulkner).
Le roman parle des vraies gens et de leurs problèmes très prosaïques : Don Quichotte a beaucoup de problèmes avec ses dents tandis que les héros de l'Iliade ont tous des sourires parfaits ; c'est ce qui distingue le roman de l'épopée ou de la Saga. le roman ne s'interdit pas de diluer ce qui n'est à l'origine qu'une blague pour en analyser tous les ressorts sociétaux : Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert est le sujet d'une plaisanterie qu'on aurait entièrement dilué et disséqué. Même chose pour le Procès de Franz Kafka. le but n'est plus ici d'appuyer sur le comique mais d'analyser en profondeur ce que le comique ne fait que suggérer.
Bref, le roman est à même de saisir toutes les composantes de la vie, même l'ennui, même le gore, même le trivial, même la bêtise moyenne, même la pensée fugace, même l'art de se faire un thé, même les fantasmes ou les pulsions non assouvies, même les non-conscientes : il n'est ni poésie, ni théâtre, ni essai, ni traité, ni jeu, car il est tout cela à la fois et parfois, même, simultanément.
Le romancier est celui qui peut — ET QUI DOIT — écarter ou déchirer le rideau qui dissimule un aspect de ce qui pourrait nous empêcher d'aller au fond des choses. En somme, pour paraphraser Marcel Proust, le romancier est un genre d'opticien qui passe son temps à imaginer de nouveaux modèles de lunettes pour toujours mieux percevoir le monde.
En somme, d'après moi, un grand essai, mais bien évidemment, ceci n'est qu'un avis derrière un rideau, c'est-à-dire, pas grand-chose.
"Le rideau" est un essai littéraire sur l'art romanesque.
Le rideau c'est le voile qui recouvre la réalité du monde dans lequel on vit, et des lieux communs, légendes, histoires fondatrices sur lequel il repose.
Le romancier de toutes les époques doit "déchirer" ce rideau pour passer de l'autre côté de ce que la vie et la tradition nous ont inculqué vers un espace de liberté imaginaire qui bientôt viendra s'incorporer à sa façon au réel et le refondre.
C'est pourquoi le roman est inséparable de son histoire. Par des sauts imaginaires successifs, chacun ayant incorporé le précédent, il ouvre l'accès à de nouveaux accès de compréhension du monde, à une esthétique renouvelée.
Et il arrive qu'à son tour, le roman précède une époque, en dessine les contours avec une avance considérable sur les sciences, la philosophie et les mentalités.
Le roman est le laboratoire des possibles.
Bien sûr Kundera ne se contente pas d'affirmer ces principes, il les illustre à travers des exemples pris dans la littérature mondiale : tchèque, allemande, française, sud américaine.
Cervantes fut le créateur de cet art nouveau quand il mit en route son personnage don Quichotte : il déchira le rideau de la "pré-interprétation" du monde pour courir l'aventure des mots et de la prose et créa ainsi un océan de possibles qui à son tour vint fertiliser et agrandir le monde.
Chaque bon romancier est un transgresseur de valeurs anciennes, un pourfendeur de voile, un "chevalier à la triste figure" peut-être ! mais un chevalier éclaireur.
Ou devrait être un éclaireur : Kundera note la disparition de ces livres précurseurs capables de tirer derrière eux le char des représentations nouvelles. Non par manque de génie personnel des auteurs, mais par complexification des données à traiter.
Cet essai possède toutes les qualités que l'on peut attendre d'un essai : clair dans l'expression (pas de jargon hermétique), il n'en est pas moins profond par son angle d'approche original du roman (l'histoire y est vue comme une dynamique et non comme un cumul de connaissances poussiéreuses). Les grandes oeuvres sont abordées sous l'optique de ce qu'elles ont apporté à leur époque, à l'art ; les personnages littéraires sont évoqués sous des éclairages différents de ceux auxquels on se réfère en général : il s'intéresse à Charles Bovary plutôt qu'à Emma ; réfléchit à l'importance de la jeunesse des héros dans la compréhension d'une oeuvre (tous les protagonistes importants de "L'idiot" de Dostoïevski ont moins de 26 ans) ; s'interroge sur la notion de "bêtise" en littérature et la cohabitation fréquente de ce défaut humain avec la sincérité des idéaux politiques (rapports de l'intégrité morale et du fanatisme vus à travers les personnages secondaires de "L'éducation sentimentale" et le parcours de Cioran.
Cette liste n'est pas exhaustive, il faudrait un ouvrage plus volumineux que l'essai lui-même pour en tirer "la substantifique moelle".
On a la merveilleuse impression en cours de lecture de devenir de plus en plus intelligent. Je me fais la promesse de ne pas me priver de cette joie et de relire "Le rideau".
Le rideau c'est le voile qui recouvre la réalité du monde dans lequel on vit, et des lieux communs, légendes, histoires fondatrices sur lequel il repose.
Le romancier de toutes les époques doit "déchirer" ce rideau pour passer de l'autre côté de ce que la vie et la tradition nous ont inculqué vers un espace de liberté imaginaire qui bientôt viendra s'incorporer à sa façon au réel et le refondre.
C'est pourquoi le roman est inséparable de son histoire. Par des sauts imaginaires successifs, chacun ayant incorporé le précédent, il ouvre l'accès à de nouveaux accès de compréhension du monde, à une esthétique renouvelée.
Et il arrive qu'à son tour, le roman précède une époque, en dessine les contours avec une avance considérable sur les sciences, la philosophie et les mentalités.
Le roman est le laboratoire des possibles.
Bien sûr Kundera ne se contente pas d'affirmer ces principes, il les illustre à travers des exemples pris dans la littérature mondiale : tchèque, allemande, française, sud américaine.
Cervantes fut le créateur de cet art nouveau quand il mit en route son personnage don Quichotte : il déchira le rideau de la "pré-interprétation" du monde pour courir l'aventure des mots et de la prose et créa ainsi un océan de possibles qui à son tour vint fertiliser et agrandir le monde.
Chaque bon romancier est un transgresseur de valeurs anciennes, un pourfendeur de voile, un "chevalier à la triste figure" peut-être ! mais un chevalier éclaireur.
Ou devrait être un éclaireur : Kundera note la disparition de ces livres précurseurs capables de tirer derrière eux le char des représentations nouvelles. Non par manque de génie personnel des auteurs, mais par complexification des données à traiter.
Cet essai possède toutes les qualités que l'on peut attendre d'un essai : clair dans l'expression (pas de jargon hermétique), il n'en est pas moins profond par son angle d'approche original du roman (l'histoire y est vue comme une dynamique et non comme un cumul de connaissances poussiéreuses). Les grandes oeuvres sont abordées sous l'optique de ce qu'elles ont apporté à leur époque, à l'art ; les personnages littéraires sont évoqués sous des éclairages différents de ceux auxquels on se réfère en général : il s'intéresse à Charles Bovary plutôt qu'à Emma ; réfléchit à l'importance de la jeunesse des héros dans la compréhension d'une oeuvre (tous les protagonistes importants de "L'idiot" de Dostoïevski ont moins de 26 ans) ; s'interroge sur la notion de "bêtise" en littérature et la cohabitation fréquente de ce défaut humain avec la sincérité des idéaux politiques (rapports de l'intégrité morale et du fanatisme vus à travers les personnages secondaires de "L'éducation sentimentale" et le parcours de Cioran.
Cette liste n'est pas exhaustive, il faudrait un ouvrage plus volumineux que l'essai lui-même pour en tirer "la substantifique moelle".
On a la merveilleuse impression en cours de lecture de devenir de plus en plus intelligent. Je me fais la promesse de ne pas me priver de cette joie et de relire "Le rideau".
J'ai été réellement captivée par cet essai. En général, lorsque je lis un roman, et que je m'en fais le débriefing, je ne me la joue pas intello littéraire que je ne suis pas et que je ne cherche pas à être. Pas d'analyse du style, de la composition, encore moins de recherche de paternité, de courant, de question de temporalité, de ci ou ça… bref je ne suis pas une théoricienne, et encore moins une historienne de la littérature, pour quoi faire d'ailleurs ?
Et vlan voilà le Milan qui vient s'en mêler, hop ! hop ! Il faudrait peut-être y regarder d'un peu plus près mamie, et qui m'embarque dans un atelier, tire le rideau, et patatras, tout le confort de mon ignorance qui s'envole. le pire c'est que j'ai tout de suite compris que c'était irréversible.
Pensez donc, un Milan qui réussit à vous faire, avec une petite centaine de pages, préférer en priorité la relecture de Bouvard et Pécuchet à celle de ses propres livres encore dans ma pal, à me faire regretter d'avoir dédaigné les vieilles éditions de Rabelais dans la biblio de mon père et me faire aimer encore davantage Cervantès…. Il est fort.
Il nous dit que l'insignifiance est le propre de la nature humaine : « L'un de nos plus grands problèmes n'est-il pas l'insignifiance ? N'est-ce pas elle notre sort ? Et si oui, ce sort est-il notre chance ou notre malheur ? »
J'étais une lectrice insignifiante et, par chance, j'ai pris une claque que j'aurais préféré recevoir plus tôt, mais il n'est jamais trop tard pour recevoir une leçon. Après cette lecture, il me semble que je ne pourrai plus lire de roman avec la même désinvolture ou plutôt que je ne pourrai plus me contenter de subir sa magie narrative.
Et vlan voilà le Milan qui vient s'en mêler, hop ! hop ! Il faudrait peut-être y regarder d'un peu plus près mamie, et qui m'embarque dans un atelier, tire le rideau, et patatras, tout le confort de mon ignorance qui s'envole. le pire c'est que j'ai tout de suite compris que c'était irréversible.
Pensez donc, un Milan qui réussit à vous faire, avec une petite centaine de pages, préférer en priorité la relecture de Bouvard et Pécuchet à celle de ses propres livres encore dans ma pal, à me faire regretter d'avoir dédaigné les vieilles éditions de Rabelais dans la biblio de mon père et me faire aimer encore davantage Cervantès…. Il est fort.
Il nous dit que l'insignifiance est le propre de la nature humaine : « L'un de nos plus grands problèmes n'est-il pas l'insignifiance ? N'est-ce pas elle notre sort ? Et si oui, ce sort est-il notre chance ou notre malheur ? »
J'étais une lectrice insignifiante et, par chance, j'ai pris une claque que j'aurais préféré recevoir plus tôt, mais il n'est jamais trop tard pour recevoir une leçon. Après cette lecture, il me semble que je ne pourrai plus lire de roman avec la même désinvolture ou plutôt que je ne pourrai plus me contenter de subir sa magie narrative.
Variations sur la vie et le roman
Par Daniel Rondeau (L'Express), publié le 04/04/2005
En artiste lettré, Kundera abandonne son âme musicale à sa double réserve de savoir et de sagesse. Il cherche dans le roman le secret de la nature humaine
Le Rideau poursuit une méditation commencée il y a longtemps par Milan Kundera sur le roman, l'Europe et notre existence d'Européens en survie. Il ne s'agit pas seulement d'un essai sur l' «art d'être un bon lecteur», comme aurait dit Vladimir Nabokov à ses étudiants de Cornell, mais d'un livre de variations sur la fiction et ses liens avec le réel.
Autour de ce thème, la pensée de l'auteur progresse par contrepoints multiples sur L Histoire, le temps, la mémoire, etc. Ils donnent au texte sa cadence et sa liberté. Réflexions, (re) lectures, questions, mais aussi anecdotes et souvenirs personnels, qui témoignent d'un discret amour pour la vie, nourrissent la recherche de Kundera sur les moyens de connaître l'âme du monde et la nature humaine. Où chercher notre visage? Comment comprendre notre histoire? Quelle est la raison d'être du roman?
Le rideau en question est le rideau tissé de légendes, d'explications usées et de clichés qui dissimule souvent aux yeux de l'artiste, peintre ou écrivain, la nature, légère et dense, de la réalité. Cervantès, en envoyant Don Quichotte errer à la découverte du monde, a déchiré le rideau et fait entrer dans son livre la «prose de la vie». Rien dans le Quichotte n'est jamais monochrome. le tragique y fait bon ménage avec le comique, le quotidien, avec l'épique, les personnages apparaissent et disparaissent sous des éclairages changeants.
Le «geste destructeur [de Cervantès] se reflète et se prolonge dans chaque roman digne de ce nom; c'est le signe d'identité de l'art du roman». Nous n'avons qu'à lire quelques pages de Rushdie, d'Axionov, de Haruki Murakami ou de Stendhal (et aussi des Misérables, que Kundera n'aime pas, hélas!) pour vérifier que derrière chaque phrase se trouve un c?ur qui bouge. Dans chaque grand roman toujours, la vie «déthéâtralisée» court, marche, se précipite. Charles du Bos ne disait pas autre chose en évoquant Guerre et Paix, de Tolstoï: c'est ainsi que «la vie parlerait, si elle pouvait parler».
Milan Kundera est un homme qui campe solitairement à l'écart de la comédie littéraire et de ses graphomanes à bout de souffle, ces romanciers moyens, dit-il, qui nous sont moins utiles qu'un plombier moyen. C'est un écrivain familiarisé depuis longtemps avec l'art de faire dialoguer les grands romans. Il tire sa généalogie de romanciers de l'ancienne France (Rabelais, Diderot, Laclos, et de l'Europe centrale du XXe siècle. C'est aussi quelqu'un qui a compris qu'un homme est d'abord la somme de ses métamorphoses.
Dans le Rideau, c'est en artiste lettré qu'il abandonne son âme musicale à sa double réserve de savoir et de sagesse. Ce qu'il cherche avant tout, et avec passion, à découvrir dans le roman, c'est le point mystérieux de la «nature humaine». Pour lui, le romancier n'est pas seulement celui qui enchante ses lecteurs, mais une sorte de père aimant et lointain, pas très sérieux, parce qu'il a depuis longtemps cessé de «prendre au sérieux le sérieux des hommes», leur apprenant, tout en leur racontant une histoire, les secrets de la vie. «Hermann Broch l'a dit: la seule morale du roman est la connaissance.»
Tandis que Kundera nous parle apparaît l'ombre d'un poète qui, pendant toute son existence, tourna en rond, comme l'écrivait André Suarès, «dans un cercle de quelques lieux, entre Francfort, Iéna et Weimar»: Goethe le grand Européen, qui cherchait l'Europe «dans un accord, et non dans un unisson». Il fut le premier à évoquer avec autant de lucidité que de ferveur l'émergence d'une littérature universelle. C'est-à-dire, pour lui, essentiellement européenne (une exception de taille pourtant: Chamsoddine, dit Hafiz, le grand lyrique de la poésie persane). Il la pensait comme un tout et la nommait d'un mot: Weltliteratur.
La pensée de Goethe alors avait quelque chose de révolutionnaire et de prophétique. Elle annonçait, en même temps, le rétrécissement de la planète, son uniformisation et le dialogue des ?uvres capables de sauter avec allégresse les frontières des littératures nationales. Mais la leçon de Goethe, dit Kundera, qui semble tout au long du Rideau converser par-dessus les siècles avec l'auteur de Werther, n'a pas été entendue.
«Encore un testament trahi, s'exclame-t-il, en se focalisant sur des exemples tirés de l'université ou des médias. L'Europe n'a pas réussi à penser sa littérature comme une unité historique et je ne cesserai de répéter que c'est là son irréparable échec intellectuel.» Il serait pourtant aisé de considérer que L Histoire a réalisé la première partie de la prophétie de Weimar (le nivellement de la vie) et que Goethe lui-même n'attendait pas grand-chose de bon de cette Weltliteratur. L'important n'est pas dans ce que l'on fait dire, ou non, à Goethe, mais dans la façon qu'a Milan Kundera de replacer le poète allemand, qui s'était accaparé les grands romans étrangers, au centre de notre histoire. Seule notre culture commune peut «prolonger le rayonnement» de chaque oeuvre et les protéger toutes «contre l'oubli».
Il y a bien d'autres choses encore dans ce Rideau, sur les âges de la vie qu'il dissimule, l'incessante métamorphose des concepts esthétiques, la beauté des sentiments modestes, la bêtise, «inséparable de la nature humaine», Camus et Sartre, la genèse des romanciers, qui naissent toujours sur «les ruines de leur monde lyrique», le kitsch, «voile rose jeté sur le réel», ou le modernisme antimoderne (nous en reparlerons bientôt à propos du livre d'Antoine Compagnon). Lisez le Rideau. Il n'est pas si fréquent de pouvoir réfléchir en si bonne compagnie à la vie, à l'histoire et au roman, et à ce que «seul le roman peut découvrir et dire».
Lien : http://www.lexpress.fr/cultu..
Par Daniel Rondeau (L'Express), publié le 04/04/2005
En artiste lettré, Kundera abandonne son âme musicale à sa double réserve de savoir et de sagesse. Il cherche dans le roman le secret de la nature humaine
Le Rideau poursuit une méditation commencée il y a longtemps par Milan Kundera sur le roman, l'Europe et notre existence d'Européens en survie. Il ne s'agit pas seulement d'un essai sur l' «art d'être un bon lecteur», comme aurait dit Vladimir Nabokov à ses étudiants de Cornell, mais d'un livre de variations sur la fiction et ses liens avec le réel.
Autour de ce thème, la pensée de l'auteur progresse par contrepoints multiples sur L Histoire, le temps, la mémoire, etc. Ils donnent au texte sa cadence et sa liberté. Réflexions, (re) lectures, questions, mais aussi anecdotes et souvenirs personnels, qui témoignent d'un discret amour pour la vie, nourrissent la recherche de Kundera sur les moyens de connaître l'âme du monde et la nature humaine. Où chercher notre visage? Comment comprendre notre histoire? Quelle est la raison d'être du roman?
Le rideau en question est le rideau tissé de légendes, d'explications usées et de clichés qui dissimule souvent aux yeux de l'artiste, peintre ou écrivain, la nature, légère et dense, de la réalité. Cervantès, en envoyant Don Quichotte errer à la découverte du monde, a déchiré le rideau et fait entrer dans son livre la «prose de la vie». Rien dans le Quichotte n'est jamais monochrome. le tragique y fait bon ménage avec le comique, le quotidien, avec l'épique, les personnages apparaissent et disparaissent sous des éclairages changeants.
Le «geste destructeur [de Cervantès] se reflète et se prolonge dans chaque roman digne de ce nom; c'est le signe d'identité de l'art du roman». Nous n'avons qu'à lire quelques pages de Rushdie, d'Axionov, de Haruki Murakami ou de Stendhal (et aussi des Misérables, que Kundera n'aime pas, hélas!) pour vérifier que derrière chaque phrase se trouve un c?ur qui bouge. Dans chaque grand roman toujours, la vie «déthéâtralisée» court, marche, se précipite. Charles du Bos ne disait pas autre chose en évoquant Guerre et Paix, de Tolstoï: c'est ainsi que «la vie parlerait, si elle pouvait parler».
Milan Kundera est un homme qui campe solitairement à l'écart de la comédie littéraire et de ses graphomanes à bout de souffle, ces romanciers moyens, dit-il, qui nous sont moins utiles qu'un plombier moyen. C'est un écrivain familiarisé depuis longtemps avec l'art de faire dialoguer les grands romans. Il tire sa généalogie de romanciers de l'ancienne France (Rabelais, Diderot, Laclos, et de l'Europe centrale du XXe siècle. C'est aussi quelqu'un qui a compris qu'un homme est d'abord la somme de ses métamorphoses.
Dans le Rideau, c'est en artiste lettré qu'il abandonne son âme musicale à sa double réserve de savoir et de sagesse. Ce qu'il cherche avant tout, et avec passion, à découvrir dans le roman, c'est le point mystérieux de la «nature humaine». Pour lui, le romancier n'est pas seulement celui qui enchante ses lecteurs, mais une sorte de père aimant et lointain, pas très sérieux, parce qu'il a depuis longtemps cessé de «prendre au sérieux le sérieux des hommes», leur apprenant, tout en leur racontant une histoire, les secrets de la vie. «Hermann Broch l'a dit: la seule morale du roman est la connaissance.»
Tandis que Kundera nous parle apparaît l'ombre d'un poète qui, pendant toute son existence, tourna en rond, comme l'écrivait André Suarès, «dans un cercle de quelques lieux, entre Francfort, Iéna et Weimar»: Goethe le grand Européen, qui cherchait l'Europe «dans un accord, et non dans un unisson». Il fut le premier à évoquer avec autant de lucidité que de ferveur l'émergence d'une littérature universelle. C'est-à-dire, pour lui, essentiellement européenne (une exception de taille pourtant: Chamsoddine, dit Hafiz, le grand lyrique de la poésie persane). Il la pensait comme un tout et la nommait d'un mot: Weltliteratur.
La pensée de Goethe alors avait quelque chose de révolutionnaire et de prophétique. Elle annonçait, en même temps, le rétrécissement de la planète, son uniformisation et le dialogue des ?uvres capables de sauter avec allégresse les frontières des littératures nationales. Mais la leçon de Goethe, dit Kundera, qui semble tout au long du Rideau converser par-dessus les siècles avec l'auteur de Werther, n'a pas été entendue.
«Encore un testament trahi, s'exclame-t-il, en se focalisant sur des exemples tirés de l'université ou des médias. L'Europe n'a pas réussi à penser sa littérature comme une unité historique et je ne cesserai de répéter que c'est là son irréparable échec intellectuel.» Il serait pourtant aisé de considérer que L Histoire a réalisé la première partie de la prophétie de Weimar (le nivellement de la vie) et que Goethe lui-même n'attendait pas grand-chose de bon de cette Weltliteratur. L'important n'est pas dans ce que l'on fait dire, ou non, à Goethe, mais dans la façon qu'a Milan Kundera de replacer le poète allemand, qui s'était accaparé les grands romans étrangers, au centre de notre histoire. Seule notre culture commune peut «prolonger le rayonnement» de chaque oeuvre et les protéger toutes «contre l'oubli».
Il y a bien d'autres choses encore dans ce Rideau, sur les âges de la vie qu'il dissimule, l'incessante métamorphose des concepts esthétiques, la beauté des sentiments modestes, la bêtise, «inséparable de la nature humaine», Camus et Sartre, la genèse des romanciers, qui naissent toujours sur «les ruines de leur monde lyrique», le kitsch, «voile rose jeté sur le réel», ou le modernisme antimoderne (nous en reparlerons bientôt à propos du livre d'Antoine Compagnon). Lisez le Rideau. Il n'est pas si fréquent de pouvoir réfléchir en si bonne compagnie à la vie, à l'histoire et au roman, et à ce que «seul le roman peut découvrir et dire».
Lien : http://www.lexpress.fr/cultu..
J'avais lu Kundera il y a de très Nombreuses années et il faisait partie de mes auteurs contemporains préférés.
Sa mort m'a profondément touchée, mais elle a eu peu d'écho en France et même chez certains aficionados qui hantent les plates formes littéraires..
Me revient en mémoire le dernier livre que j'ai lu de lui, á savoir le Rideau, ses passages pleins de pertinence et de bon sens, dans lequel il pose la question du roman, qu'est ce donc, quels sont les différents genres, les styles, pourquoi ne l'enseigne t on pas assez dans les lycées, les facs et même dans la vie de tous les jours ? On y apprendrait qui étaient Kafka, Cervantes, Flaubert, Camus et tant d'autres, qui sont allés au fond des choses pour en tirer la substantifique moelle.
Car un jour il faudra déchirer le rideau qui fait écran à toute entreprise « Car c'est en déchirant le rideau de la préinterprétation que Cervantès a mis en route cet art nouveau ; son geste destructeur se reflète, se prolonge dans chaque roman, digne de ce nom ; c'est le signe d'identité de l'art du roman ».
Même si Kundera écrit que la vie est ailleurs, tout romancier bien ancré dans le hic et nunc traverse toutes les époques et les épreuves. Il en est de même pour chaque oeuvre d'art vouée à l'oubli tôt ou tard même si son but princeps était fait pour côtoyer l'immortalité ou l'éternité.
La musique au cours des siècles à voulu s'éloigner des anciens canons et modes harmoniques en voulant faire du nouveau et il y eut ainsi une Histoire de la Musique. Il faut ainsi pour Kundera que cette Histoire miraculeuse se perpétue. Et les derniers mots de son roman sont tels « Car l'histoire de l'art est périssable, le babillage de l'art est éternel ».
Sa mort m'a profondément touchée, mais elle a eu peu d'écho en France et même chez certains aficionados qui hantent les plates formes littéraires..
Me revient en mémoire le dernier livre que j'ai lu de lui, á savoir le Rideau, ses passages pleins de pertinence et de bon sens, dans lequel il pose la question du roman, qu'est ce donc, quels sont les différents genres, les styles, pourquoi ne l'enseigne t on pas assez dans les lycées, les facs et même dans la vie de tous les jours ? On y apprendrait qui étaient Kafka, Cervantes, Flaubert, Camus et tant d'autres, qui sont allés au fond des choses pour en tirer la substantifique moelle.
Car un jour il faudra déchirer le rideau qui fait écran à toute entreprise « Car c'est en déchirant le rideau de la préinterprétation que Cervantès a mis en route cet art nouveau ; son geste destructeur se reflète, se prolonge dans chaque roman, digne de ce nom ; c'est le signe d'identité de l'art du roman ».
Même si Kundera écrit que la vie est ailleurs, tout romancier bien ancré dans le hic et nunc traverse toutes les époques et les épreuves. Il en est de même pour chaque oeuvre d'art vouée à l'oubli tôt ou tard même si son but princeps était fait pour côtoyer l'immortalité ou l'éternité.
La musique au cours des siècles à voulu s'éloigner des anciens canons et modes harmoniques en voulant faire du nouveau et il y eut ainsi une Histoire de la Musique. Il faut ainsi pour Kundera que cette Histoire miraculeuse se perpétue. Et les derniers mots de son roman sont tels « Car l'histoire de l'art est périssable, le babillage de l'art est éternel ».
Citations et extraits (52)
Voir plus
Ajouter une citation
Depuis longtemps la révolte d'un Risach rompant avec sa vie de fonctionnaire n'est plus possible. La bureaucratie est devenue omniprésente et on ne lui échappera nulle part ; nulle part on ne trouvera une " maison des roses " pour y vivre en contact intime avec les « choses telles qu'elles sont en elles-mêmes ». Du monde de Stifter, irrévocablement, nous sommes passés au monde de Kafka.
Quand jadis, mes parents allaient en vacances, ils achetaient des billets à la gare dix minutes avant le départ du train ; ils logeaient dans un hôtel de campagne où, le dernier jour, ils réglaient la note en espèce au patron. Ils vivaient dans le monde de Stifter.
Mes vacances se passent dans un autre monde : j'achète les billets deux mois à l'avance en faisant la queue à l'agence de voyages ; là, une bureaucratie s'occupe de moi et téléphone à Air France, où d'autres bureaucrates avec lesquels je ne serai jamais en contact m'affectent une place dans un avion et enregistrent mon nom sous un numéro dans une liste de passagers ; ma chambre, je la retiens aussi à l'avance, en téléphonant à un réceptionniste qui inscrit ma demande sur son ordinateur et en informe sa petite administration à lui ; le jour de mon départ, les bureaucrates d'un syndicat, après des disputes avec les bureaucrates d'Air France, déclenchent une grève. Après de nombreux coups de téléphone de ma part, et sans s'excuser (personne ne s'excusait jamais auprès de K. ; l'administration se trouve par-delà la politesse), Air France me rembourse et j'achète un billet de train ; pendant mes vacances, je paye partout avec une carte bancaire et chacun de mes dîners est enregistré par la banque à Paris et ainsi tenu à la disposition d'autres bureaucrates, par exemple ceux du fisc ou, au cas où je serais soupçonné d'un crime, de la police. Pour mes petites vacances toute une brigade de bureaucrates se met en mouvement et moi-même je me transforme en bureaucrate de ma propre vie (remplissant des questionnaires, envoyant des réclamations, rangeant des documents dans mes propres archives).
La différence entre la vie de mes parents et la mienne est frappante ; la bureaucratie a infiltré tout le tissu de la vie. « Jamais encore K. n'avait vu nulle part l'administration et la vie à ce point imbriquées, si imbriquées qu'on avait parfois le sentiment que l'administration et la vie avaient pris la place l'une de l'autre » (Le Château). D'emblée, tous les concepts de l'existence ont changé de sens :
Le concept de LIBERTÉ : aucune institution n'interdit à l'arpenteur K. de faire ce qu'il veut ; mais, avec toute sa liberté, que peut-il vraiment faire ? Qu'est-ce qu'un citoyen, avec tous ses droits, peut changer à son environnement le plus proche, au parking qu'on lui construit sous sa maison, au haut-parleur hurleur qu'on installe en face de ses fenêtres ? Sa liberté est aussi illimitée qu'elle est impuissante.
Le concept de VIE PRIVÉE : personne n'a l'intention d'empêcher K. de faire l'amour avec Frieda même si elle est la maîtresse de l'omnipotent Klamm ; pourtant, il est suivi partout par les yeux du château, et ses coïts sont parfaitement observés et notés ; les deux aides qu'on lui a affectés sont avec lui pour cela. Quand K. se plaint de leur importunité, Frieda proteste : « Qu'as-tu, chéri, contre les aides ? Nous n'avons rien à leur cacher. » Personne ne contestera notre droit à la vie privée mais celle-ci n'est plus ce qu'elle était : aucun secret ne la protège ; où que nous soyons, nos traces restent dans les ordinateurs ; « nous n'avons rien à leur cacher », dit Frieda ; le secret, nous ne l'exigeons même plus ; la vie privée n'exige plus d'être privée.
Sixième partie : LE RIDEAU DÉCHIRÉ, Le sens existentiel du monde bureaucratisé.
Quand jadis, mes parents allaient en vacances, ils achetaient des billets à la gare dix minutes avant le départ du train ; ils logeaient dans un hôtel de campagne où, le dernier jour, ils réglaient la note en espèce au patron. Ils vivaient dans le monde de Stifter.
Mes vacances se passent dans un autre monde : j'achète les billets deux mois à l'avance en faisant la queue à l'agence de voyages ; là, une bureaucratie s'occupe de moi et téléphone à Air France, où d'autres bureaucrates avec lesquels je ne serai jamais en contact m'affectent une place dans un avion et enregistrent mon nom sous un numéro dans une liste de passagers ; ma chambre, je la retiens aussi à l'avance, en téléphonant à un réceptionniste qui inscrit ma demande sur son ordinateur et en informe sa petite administration à lui ; le jour de mon départ, les bureaucrates d'un syndicat, après des disputes avec les bureaucrates d'Air France, déclenchent une grève. Après de nombreux coups de téléphone de ma part, et sans s'excuser (personne ne s'excusait jamais auprès de K. ; l'administration se trouve par-delà la politesse), Air France me rembourse et j'achète un billet de train ; pendant mes vacances, je paye partout avec une carte bancaire et chacun de mes dîners est enregistré par la banque à Paris et ainsi tenu à la disposition d'autres bureaucrates, par exemple ceux du fisc ou, au cas où je serais soupçonné d'un crime, de la police. Pour mes petites vacances toute une brigade de bureaucrates se met en mouvement et moi-même je me transforme en bureaucrate de ma propre vie (remplissant des questionnaires, envoyant des réclamations, rangeant des documents dans mes propres archives).
La différence entre la vie de mes parents et la mienne est frappante ; la bureaucratie a infiltré tout le tissu de la vie. « Jamais encore K. n'avait vu nulle part l'administration et la vie à ce point imbriquées, si imbriquées qu'on avait parfois le sentiment que l'administration et la vie avaient pris la place l'une de l'autre » (Le Château). D'emblée, tous les concepts de l'existence ont changé de sens :
Le concept de LIBERTÉ : aucune institution n'interdit à l'arpenteur K. de faire ce qu'il veut ; mais, avec toute sa liberté, que peut-il vraiment faire ? Qu'est-ce qu'un citoyen, avec tous ses droits, peut changer à son environnement le plus proche, au parking qu'on lui construit sous sa maison, au haut-parleur hurleur qu'on installe en face de ses fenêtres ? Sa liberté est aussi illimitée qu'elle est impuissante.
Le concept de VIE PRIVÉE : personne n'a l'intention d'empêcher K. de faire l'amour avec Frieda même si elle est la maîtresse de l'omnipotent Klamm ; pourtant, il est suivi partout par les yeux du château, et ses coïts sont parfaitement observés et notés ; les deux aides qu'on lui a affectés sont avec lui pour cela. Quand K. se plaint de leur importunité, Frieda proteste : « Qu'as-tu, chéri, contre les aides ? Nous n'avons rien à leur cacher. » Personne ne contestera notre droit à la vie privée mais celle-ci n'est plus ce qu'elle était : aucun secret ne la protège ; où que nous soyons, nos traces restent dans les ordinateurs ; « nous n'avons rien à leur cacher », dit Frieda ; le secret, nous ne l'exigeons même plus ; la vie privée n'exige plus d'être privée.
Sixième partie : LE RIDEAU DÉCHIRÉ, Le sens existentiel du monde bureaucratisé.
Qui sommes-nous ? Et quelle est notre terre, la terra nostra ? On ne comprendra que peu de chose si l'on se contente de sonder l'énigme de l'identité à l'aide d'une mémoire purement introspective ; pour comprendre, il faut comparer, disait Broch ; il faut soumettre l'identité à l'épreuve des confrontations ; il faut confronter.
Septième partie : LE ROMAN, LA MÉMOIRE, L'OUBLI, Le roman comme voyage à travers les siècles et les continents.
Septième partie : LE ROMAN, LA MÉMOIRE, L'OUBLI, Le roman comme voyage à travers les siècles et les continents.
(84%) LIBERTÉ DU MATIN, LIBERTÉ DU SOIR
Quand Picasso a peint son premier tableau cubiste, il avait vingt-six ans : dans le monde entier, plusieurs autres peintres de sa génération se sont joints à lui et l'ont suivi. Si un sexagénaire s'était alors précipité pour l'imiter en faisant du cubisme, il serait apparu (et à juste titre) grotesque. Car la liberté d'un jeune et la liberté d'un vieux sont des continents qui ne se rencontrent pas.
« Jeune, tu es fort en compagnie, vieux, en solitude », écrivit Goethe (le vieux Goethe) dans une épigramme. En effet, quand les jeunes gens se mettent à attaquer des idées reconnues, des formes installées, ils aiment se regrouper en bandes ; quand Derain et Matisse, au début du siècle, passaient ensemble de longues semaines sur les plages de Collioure, ils peignaient des tableaux qui se ressemblaient, marqués par la même esthétique fauve ; pourtant, aucun des deux ne se sentait l'épigone de l'autre – et, en effet, ni l'un ni l'autre ne l'étaient.
Dans une solidarité enjouée, les surréalistes saluèrent en 1924 la mort d'Anatole France par une nécrologie-pamphlet mémorablement bête : « Tes semblables, cadavre, nous ne les aimons pas ! » écrivait Eluard, âgé de vingt-neuf ans. « Avec Anatole France, c'est un peu de la servilité humaine qui s'en va. Que ce soit fête le jour où l'on enterre la ruse, le traditionalisme, le patriotisme, l'opportunisme, le scepticisme, le réalisme et le manque de cœur ! » écrivait Breton, âgé de vingt-huit ans. « Que donc celui qui vient de crever [...] s'en aille à son tour en fumée ! Il reste peu de chose d'un homme : il est encore révoltant d'imaginer de celui-ci, que de toute façon il a été », écrivait Aragon, âgé de vingt-sept ans.
Les mots de Cioran me reviennent à propos des jeunes et de leur besoin « de sang, de cris, de tumulte... » ; mais j'ai hâte d'ajouter que ces jeunes poètes qui pissaient sur le cadavre d'un grand romancier ne cessaient pas pour autant d'être de vrais poètes, des poètes admirables ; leur génie et leur bêtise jaillissaient de la même source. Ils étaient violemment (lyriquement) agressifs envers le passé et avec la même violence (lyrique) dévoués à l'avenir dont ils se considéraient les mandataires et qu'ils voyaient bénir leur joyeuse urine collective.
Quand Picasso a peint son premier tableau cubiste, il avait vingt-six ans : dans le monde entier, plusieurs autres peintres de sa génération se sont joints à lui et l'ont suivi. Si un sexagénaire s'était alors précipité pour l'imiter en faisant du cubisme, il serait apparu (et à juste titre) grotesque. Car la liberté d'un jeune et la liberté d'un vieux sont des continents qui ne se rencontrent pas.
« Jeune, tu es fort en compagnie, vieux, en solitude », écrivit Goethe (le vieux Goethe) dans une épigramme. En effet, quand les jeunes gens se mettent à attaquer des idées reconnues, des formes installées, ils aiment se regrouper en bandes ; quand Derain et Matisse, au début du siècle, passaient ensemble de longues semaines sur les plages de Collioure, ils peignaient des tableaux qui se ressemblaient, marqués par la même esthétique fauve ; pourtant, aucun des deux ne se sentait l'épigone de l'autre – et, en effet, ni l'un ni l'autre ne l'étaient.
Dans une solidarité enjouée, les surréalistes saluèrent en 1924 la mort d'Anatole France par une nécrologie-pamphlet mémorablement bête : « Tes semblables, cadavre, nous ne les aimons pas ! » écrivait Eluard, âgé de vingt-neuf ans. « Avec Anatole France, c'est un peu de la servilité humaine qui s'en va. Que ce soit fête le jour où l'on enterre la ruse, le traditionalisme, le patriotisme, l'opportunisme, le scepticisme, le réalisme et le manque de cœur ! » écrivait Breton, âgé de vingt-huit ans. « Que donc celui qui vient de crever [...] s'en aille à son tour en fumée ! Il reste peu de chose d'un homme : il est encore révoltant d'imaginer de celui-ci, que de toute façon il a été », écrivait Aragon, âgé de vingt-sept ans.
Les mots de Cioran me reviennent à propos des jeunes et de leur besoin « de sang, de cris, de tumulte... » ; mais j'ai hâte d'ajouter que ces jeunes poètes qui pissaient sur le cadavre d'un grand romancier ne cessaient pas pour autant d'être de vrais poètes, des poètes admirables ; leur génie et leur bêtise jaillissaient de la même source. Ils étaient violemment (lyriquement) agressifs envers le passé et avec la même violence (lyrique) dévoués à l'avenir dont ils se considéraient les mandataires et qu'ils voyaient bénir leur joyeuse urine collective.
Peu à peu j’ai compris que je venais d’un « far away country of which we know little ». Les gens qui m’entouraient prêtaient une grande importance à la politique, mais connaissaient piètrement la géographie : ils nous voyaient « communisés », pas « annexés ». D’ailleurs, les Tchèques n’appartiennent-ils pas depuis toujours au même « monde slave » que les Russes ? J’expliquais que, s’il existe une unité linguistique des nations slaves, il n’y a aucune culture slave, aucun monde slave : l’histoire des Tchèques, de même que celle des Polonais, des Slovaques, des Croates ou des Slovènes (et, bien sûr, des Hongrois qui ne sont pas slaves du tout), est purement occidentale : Gothique ; Renaissance ; Baroque ; contact étroit avec le monde germanique ; lutte du catholicisme contre la Réforme. Rien à voir avec la Russie qui était loin, tel un autre monde. Seuls les Polonais vivaient avec elle dans un voisinage direct, mais qui ressemblait à un combat à mort.
Peine perdue : l’idée d’un « monde slave » demeure un lieu commun, indéracinable, de l’historiographie mondiale. J’ouvre l’Histoire universelle dans la prestigieuse édition de la Pléiade : dans le chapitre Le monde slave, Jan Hus, le grand théologien tchèque, irrémédiablement séparé de l’Anglais Wyclif (dont il était le disciple), ainsi que de l’Allemand Luther (qui voit en lui son précurseur et maître), est obligé de subir, après sa mort sur le bûcher à Constance, une sinistre immortalité en compagnie d’Ivan le Terrible avec qui il n’a pas envie d’échanger le moindre propos.
Peine perdue : l’idée d’un « monde slave » demeure un lieu commun, indéracinable, de l’historiographie mondiale. J’ouvre l’Histoire universelle dans la prestigieuse édition de la Pléiade : dans le chapitre Le monde slave, Jan Hus, le grand théologien tchèque, irrémédiablement séparé de l’Anglais Wyclif (dont il était le disciple), ainsi que de l’Allemand Luther (qui voit en lui son précurseur et maître), est obligé de subir, après sa mort sur le bûcher à Constance, une sinistre immortalité en compagnie d’Ivan le Terrible avec qui il n’a pas envie d’échanger le moindre propos.
Sans cesse, les concepts esthétiques se transforment en questions ; je me demande : l’Histoire est-elle tragique ? Disons-le différemment : la notion de tragique a-t-elle un sens hors du destin personnel ? Quand l’Histoire met en branle les masses, les armées, les souffrances et les vengeances, on ne peut plus distinguer les volontés individuelles ; la tragédie est entièrement engloutie par les débordements d’égouts qui submergent le monde.
À la rigueur, on peut chercher le tragique enseveli sous les décombres des horreurs, dans la première impulsion de ceux qui ont eu le courage de risquer leur vie pour leur vérité.
Mais il y a des horreurs sous lesquelles aucune fouille archéologique ne trouvera le moindre vestige de tragique ; des tueries pour l’argent ; pis : pour une illusion ; encore pis : pour une stupidité.
L’enfer (l’enfer sur terre) n’est pas tragique ; l’enfer, c’est l’horreur sans aucune trace de tragique.
À la rigueur, on peut chercher le tragique enseveli sous les décombres des horreurs, dans la première impulsion de ceux qui ont eu le courage de risquer leur vie pour leur vérité.
Mais il y a des horreurs sous lesquelles aucune fouille archéologique ne trouvera le moindre vestige de tragique ; des tueries pour l’argent ; pis : pour une illusion ; encore pis : pour une stupidité.
L’enfer (l’enfer sur terre) n’est pas tragique ; l’enfer, c’est l’horreur sans aucune trace de tragique.
Videos de Milan Kundera (40)
Voir plusAjouter une vidéo
Vidéo du 12 juillet 2023, date à laquelle le romancier tchèque naturalisé français, Milan Kundera, s’est éteint à l’âge de 94 ans. La parution en 1984 de son livre "L’Insoutenable légèreté de l’être", considéré comme un chef-d'œuvre, l'a fait connaître dans le monde entier. Milan Kundera s’était réfugié en France en 1975 avec son épouse, Vera, fuyant la Tchécoslovaquie communiste (vidéo RFI)
Dans la catégorie :
Oeuvres de fiction, romansVoir plus
>Littérature : généralités>Biographie littéraire>Oeuvres de fiction, romans (119)
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Milan Kundera (27)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Milan Kundera
Presque tous les romans de Kundera comportent le même nombre de parties : quelle est la structure type de ses romans ?
3 parties
5 parties
7 parties
10 questions
172 lecteurs ont répondu
Thème :
Milan KunderaCréer un quiz sur ce livre172 lecteurs ont répondu